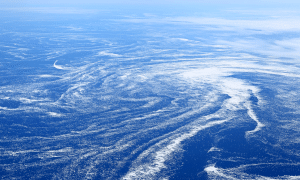L'IRISA
C RESEAL; SEPTEMBRE 1995* N' 114 • 20 F MENSUEL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN BRETAGNE
DOSSIER
L'IRISA
BILAN BRITTA
LE MARION DUFRESNE,
NAVIRE AUSTRAL
SOMMAIRE
La vie des labos
Le Marion Dufresne
à Brest :
l'aventure scientifique P.3
Britta : 5 ans après P.4
Transport ionique
et messagerie P.6
Rencontre
Pierre-Gilles de Gennes
Les principes
de l'adhésion P.5
Les sigles du mois P.7
LE DOSSIER DU MOIS
L'IRISA P.9 à 15
La vie des entreprises
TNI : l'informatique
de haut niveau P. 17
Mobil'Affiche :
publicité à la carte P.23
Histoire et société
Augustin Fresnel,
père des
phares modernes P.18/19
Les Brèves
de Réseau P.19à22
J :111:1 MENSUEL DE IA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN BRETAGNE
Président du ((STI : Paul Tréhen. • Directeur de la publication :
Michel Cabaret. • Rédacteur en chef: Hélène Tattevin. • Collaboralion
:Marc-Élie Pou, Jérôme Arros, Nicolas Guilles. t• Comité de lecture:
Louis Rouit, Christian Willoime, Gilbert Blanchard, Monique Thorel.
Abonnements/Promotion : Béatrice Texier, Danièle Zum-Falo.
Publicité : Evénement Média, BP 33 - 35511 (esson-Sévigné Cedex,
tél. 99 8317 00.
RÉSEAU est publié grâce au soutien de la Région Bretagne, du
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de
lo Recherche et de l'Insertion professionnelle (DISTB), du minislare
de la Culture (DRAC), du département du Finistére et de la Ville de
Rennes. Edition : CCSTI. Réalisation : Pieniak Bert6t Création Graphique,
Cessan-Sévigné.
~
Vue nocturne
du bâtiment de
la recherche
en informatique,
' ( sur le campus
de Beaulieu.
L'architecture
moderne de l'IRISA
mise sur les lignes.
Sa façade blanche
et ses nombreuses
ouvertures montrent son intérêt pour le
monde qui l'entoure.
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE
El
EDITORIAL
Il Michel Cabaret accueille au
CCSTI Gérard Massé, le directeur
du Pôle d'innovation et de
recherche de Nantes (PRIN).
Ensemble, ils préparent la
publication d'un ouvrage :
"Les 20 ans du département
des Sciences pour l'ingénieur en
Bretagne et Pays de la Loire".
L'IRISA et les Sciences
pour l'ingénieur
réé à Rennes en 1975, l'Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires emploie plus de 400 personnes, dont
340 chercheurs et doctorants. "L'informatique apparaît comme
un élément déterminant de la compétitivité de tous les secteurs
économiques et même de l'évolution de la société, par son impact
dans des domaines comme la santé, l'éducation, les loisirs,
l'environnement...", explique Jean-Pierre Banâtre, directeur de
l'IRISA. Ces enjeux impliquent de nombreuses collaborations entre
le inonde de la recherche et celui des entreprises, comme le montre
le dossier que Réseau consacre ce mois-ci à l'informatique en
Bretagne, pour les 20 ans de l'IRISA.
D'autre part, à l'occasion du 20e anniversaire du département
des Sciences pour l'ingénieur (SPI), la délégation régionale CNRS
Bretagne-Pays de la Loire a demandé au CCSTI de s'associer à
la parution d'un numéro spécial, présentant les compétences des
10 unités de recherche présentes dans les deux régions. Les Sciences
pour l'ingénieur se penchent sur tous les problèmes de l'industrie.
Cela va de la résistance des pare-brise d'avions à la supraconductivité,
en passant par l'électronique et l'informatique : à titre d'exemple,
l'IRISA à Rennes est un laboratoire "Sciences pour l'ingénieur".
Pour mieux présenter ce département, c'est avec plaisir que nous
offrirons très prochainement à nos abonnés, l'ouvrage "Les 20 ans
des Sciences pour l'ingénieur", réalisé en collaboration avec le
Pôle de recherche et d'innovation de Nantes (PRIN). Placé sous
la direction de Gérard Massé, le PRIN remplit une mission proche
de celle qui anime le CCSTI en Bretagne. Que cette première action
commune ouvre pour les deux régions, une ère de coopération
en matière de rédaction et de diffusion d'informations scientifiques
et technologiques ! n
Michel CABARET
Directeur du CCSTI.
RÉSEAU est édité par le Centre de cul
mage mensuel: 3500 ex. Dépôt légal n°650. I.591 0769-6264.
CSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tel. 99 35 28 22 - Fax 99 35 28 21
mail ccsti@univ-rennesl.(r 8
Antenne Finistère : CCSTI, 40, rue Jim Sevellec, 29608 BREST Cedex. Tel. 98 05 60 91 - Fax 98 05 15 02
ESEAU SEPTEMBER 1995 • N • 114
DOSSIER
IRISA : computing research in Brittany
Ep
THE IMPORTANCE
OF COMPUTING TODAY
pages 9 and 10
This month's special topic describes some of
IRISA's areas of research and is designed to
help the less computer-literate to understand
why computer sciences, which were used for
many years solely in the fields of defence and
industry, have now become part of everyday
life. Jean-Pierre Banâtre, the Director of
IRISA, describes this "new" type of computing.
Information: Jean-Pierre Banâtre, fax (33) 99 84 71 11.
FROM LANNION TO BRISBANE
page 11
The Badins project underway at ENSSAT
(Ecole nationale supérieure de sciences
appliquées et de technologie, National
applied sciences and technology college) in
Lannion aims to develop user-friendly ways
of consulting multimedia data bases. Two
fairly recent theories, the "Fuzzy logic
theory" and the "Theory of possibilities" have
been implemented as part of this project.
In Rennes and Brisbane, Jocelyne Erhel and
Kevin Burrage are preparing a rainfall map
within the framework of the Aladin project.
Their aim is to forecast the next major Australian
drought.
PARALLEL ARCHITECTURES
page 12
The computation needs required in order to
take ocean soundings, simulate a vehicle collision
or design optical glass are enormous
and the problems encountered are so complex
and costly in terms of time that they can only
be overcome by parallel machines. The aim
of IRISA's Caps and Pampa projects is to
improve the performances of these machines
by making them easier to programme.
LIFE IN BRITTANY, A TRULY
EUROPEAN REGION
page 13
Whether you want to check your bank
account, consult a work in a virtual library, or
make a train booking, in fact whatever your
needs as regards information, bookings and
shopping, all you have to do is log on to a
vocal or telematic server. Behind the computer
are a multitude of processors that are
interlinked to provide a maximum number of
services - and ensure a high level of reliabi-
A
One of the specialist areas of expertise
provided by IRISA in Rennes is parallel
computation. This photo shows the Paragon
XP/S, an extremely powerful computer
tool which has been made available to
IRISA's research team and to the members
of the parallel computer club, an association
open to industrialists and other
research bodies.
lity. These "distributed" systems are the subject
of IRISA's Solidor project.
As to the Synchron project, which is being
undertaken as part of a European Eurêka programme,
its purpose is to standardise the
various synchronous technology systems
existing throughout Europe. Synchronous
technology, when combined with "real time"
applications, has a wide number of uses in
sectors where security is of paramount importance
e.g. transport, energy, and defence.
THE TOOLS OF THE FUTURE
page 14
In order to develop the concept of active
vision, the Ternis research team has just acquired
a new robot called "Lookout", which is
capable of simulating the movements of the
human eye and zooming in on any anomaly or
incident detected by it. The machine, however,
requires a human operator. More than
fifty sites can be monitored on a single computer
screen, using a remote-control system.
Three active vision specialists, all of them
IRISA graduates, have set up their own company
called Timeat. Their latest product,
Mercure, consists of video cameras which are
installed at accident black spots along motorways.
A software program processes the
images in real time, so that accidents, traffic
jams and non-moving vehicles constituting a
danger to other road users are all detected
automatically. The information is then transmitted
to a control centre.
STEPPING INTO
TOMORROW'S WORLD
page 15
Every day, biologists analyse and compare
the biological sequences of living organisms
i.e. DNA and proteins. In order to speed up
and improve this repetitive work, IRISA's
Repco and Api projects have joined forces to
develop computer tools capable of providing
an accurate analysis of major biological
sequences and comparing them quickly with
sequence banks.
Another application within the field of medicine
is the Siames project. Exhausted cyclists,
to take but one example, run an increased risk
of broken ankles. In order to avoid an accident,
potential fracture zones that are otherwise
invisible, even to the expert eye of a
doctor, can be located by building a model of
the sportsman's movements. The Siames project
uses the laws of mechanics to produce
virtual images that can be exploited without
any further processing.
For further information in English, please
contact Gérard Paget, Fax (33) 99 84 71 71,
e-mail Gérard.Paget@irisafr
These abstracts in English are sent to
foreign universities that have links with
Brittany and to the Scientific Advisers in
French Embassies, in an effort to widen
the availability of scientific and technical
information and promote the research carried
out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts
on a regular basis, with a copy of the corresponding
issue of "RESEAU", please
contact Hélène Tattevin, Editor, Fax (33)
99 35 28 21, e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
Brittany Regional Council is providing
financial backing for this service.
It E C I ON
MEN111111
-
\
BRETAGNE
Brittany is the 7th most-populated
region in France, with 2.8 million
inhabitants, but it is the leading French
region as regards research in the fields of
telecommunications, oceanography,
and agricultural engineering.
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. (33) 99 35 28 22 - Fax (33) 99 35 28 21 - e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
Antenne Finistère: CCSTI, 40, rue Jim Sevellec, 29608 BREST Cedex. U. (33) 98 05 60 91 - Fax (33) 98 05 15 02
MONTHLY MAGAZINE OF RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY
Abstracts for the international issue
!taro By EemBas/ INRIA, C. Paedms.
EDITORIAL
IRISA AND
ENGINEERING SCIENCES
page 2
The Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires (IRISA, Computer
science and random systems research institute)
in Rennes, which employs more than
400 people including 340 researchers and
Ph.D students, is currently celebrating its
20th birthday. "Computing is seen as a vital
factor for competitiveness in every sector of
the economy and is, indeed, considered as
essential for the development of society as a
whole through its impact in fields such as
health care, education, leisure activities, the
environment, etc." , explains Jean-Pierre
Banâtre, IRISA's director.
Information: Michel Cabaret, fax (33) 99 35 28 21.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
THE MARION DUFRESNE
IN BREST:
A SCIENTIFIC ADVENTURE
page 3
From 19th to 22nd May, immediately after
leaving the shipyard in Le Havre, the
scientific research and supply ship used in
the French Antarctic Territories (TAAF)
put into Brest before setting off on her first
oceanographic trip in the North Atlantic
and the seas off Norway. The vessel will
later sail to her home port on the island of
La Réunion.
Information: Gaëlle Plouzennec, fax (33) 98 05 65 55.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
BRITTA, FIVE YEARS ON
page 4
The Britta biotechnologies development
programme was set up by the Brittany
Regional Council at the end of 1989 and is
currently engaged in taking stock of its
achievements. Britta is a financially-based
programme designed to involve all the
bodies and organisations that are likely to
ensure its success and it covers every stage
of product development, from research to
the marketing of new products and technology
transfers.
Information: Brittany Regional Council,
fax (33) 99 38 85 75.
A
A night-time view of the IRISA computer
science research building on the Beaulieu
Campus in Rennes. The architectural design
is resolutely modern, emphasising
the interaction of straight lines. The Institute's
white façade with many doors and
windows symbolise its interest in the
world outside.
PEOPLE IN THE NEWS
THE PRINCIPLES
OF ADHESION
page 5
On 24th May, an unusually large number
of science students (500 of them in all)
attended a lecture in the University of
Rennes 1 despite the fact that it was the
eve of a long weekend! The lecturer that
day was none other than Pierre-Gilles de
Gennes, Professor at the Collège de
France and Nobel prizewinner in physics.
His topic was especially intriguing -
"Glue, or the principles of adhesion".
Information: Pierre-Gilles de Gennes,
fax 33 (1) 4079 45 25.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
ION CARRIERS
page 6
A living cell carries ions through its membrane
in a never-ending process caused by
the activity of carrier proteins, among them
the exchangers and ion channels which are
of particular interest to the Cell physiology
research unit (URPC) in Brest. This fundamental
research may lead to applications in
the fields of underwater diving and the
marine environment or, in quite a different
area, in the fight against cystic fibrosis.
Information: Serge Thomas, fax (33) 98 0167 85.
FIRMS AT WORK
TNI:
HIGH-LEVEL COMPUTING
page 17
The Techniques nouvelles d'informatique
company was set up in 1985 in Brest by
two 25-year-old graduates fresh out of the
Institut d'informatique industrielle (Industrial
computing institute). The company
will soon be celebrating its first 10 years
of success in the implementation of the
object approach. "These days, the object
approach has become an essential part of
software design," notes Thierry Guéguen.
Information: Thierry Guéguen, fax (33) 98 49 45 33.
HISTORY AND SOCIETY
AUGUSTIN FRESNEL,
THE FATHER OF MODERN
LIGHTHOUSES
pages 18 and 19
After winning a place at the Ecole polytechnique,
France's premier engineering
college, at the age of only 16, Augustin
Fresnel was appointed to an engineering
post with France's Highways Department
in 1809. Later, in 1819, he was seconded
to the Lighthouse Commission and asked
to look into ways of improving lighting to
warn ships of danger. Until the middle of
the 18th Century, such lighting had still
consisted of nothing more than wood and
coal beacons lit on the top of towers!
Information: Christian Delaunay, fax (33) 99 78 16 08.
"PRESENCE BRETAGNE"
TECHNOLOGICAL NETWORK
MOBIL'AFFICHE:
CUSTOM-MADE ADVERTISING
page 23
The original idea was simple but unusual.
Advertisements were to be given greater
impact by mounting them on revolving
hoardings on a lorry which would then be
driven through an urban area. Each hoarding
could run six different posters.
Mobil'Affiche was born and this very
young company, based in Brest, already
distributes its products all over France and
in countries abroad.
Information: Michel Kervoas, fax (33) 99 67 60 22.
LA VIE DES LABOS RE5EA17 114
Le géant technologique, aussi bleu
que les mers qu'il fréquente, allonge
respectueusement ses 120 mètres
de coque dans le port de Brest, avant
de larguer les amarres, destination :
La Réunion.
Le Marion Dufresne à Brest
l'aventure scientifique
Du 19 au 22 mai dernier, tout juste sorti des Ateliers et
chantiers du Havre, le navire de recherche scientifique
et de ravitaillement des Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) faisait une escale à Brest, point de
départ de sa première campagne océanographique
(IMAGES) en Atlantique Nord et en mer de Norvège.
Le navire rejoindra ensuite son port d'attache à La
Réunion.
Le Marion Dufresne est le
deuxième du nom, ses familiers
le nomment simplement :
MD II. Comme son prédécesseur
et homonyme, il est armé par la
Compagnie générale maritime, et
affrété par les TAAF, et par l'Institut
français pour la recherche et
la technologie polaires (IFRTP),
basé à Brest.
UN NAVIRE POLYVALENT
Yvon Balut, responsable des
opérations scientifiques à bord
du MD I, a assuré dès 1988 les
études et le suivi des travaux
pour le nouveau navire. Chargé
du département "Océanographie"
de l'IFRTP, il parle des problèmes
liés à l'absence de fonctionnalité
scientifique du premier
bateau : "le «MD I» avait été
conçu prioritairement en 1973
pour le ravitaillement des
TAAF, les scientifiques ont dû
s'adapter à un bâtiment qui
n'avait pas été totalement pensé
pour eux."
Le MD II, fruit de cette réflexion,
est véritablement un navire
polyvalent. Il pourra tout
aussi bien remplir des fonctions
de paquebot, de cargo, de pétrolier,
de porte-hélicoptères, pour
les TAAF, et de navire de recherche
scientifique pour le
compte de l'Institut polaire. Ses
dimensions de ravitailleur en font
même l'un des plus grands bâtiments
de recherche au monde, et
donc l'une des plates-formes mobiles
les plus stables, même par
mauvais temps.
UNE TECHNOLOGIE
DE POINTE
De nombreux équipements
français sont présents à bord du
navire. Parmi ceux-ci, on peut
citer un sondeur multifaisceaux
développé par une entreprise brestoise,
Thomson-Sintra. L'outil intègre
un pénétrateur de sédiments
ainsi qu'une centrale de verticale
destinée à compenser automatiquement
les phénomènes de roulis,
de tangage et de variation de
cap. Conçu pour le MD II, destiné
aux missions les plus difficiles
dans les mers australes (cyclones,
40" rugissants...), le sondeur embarqué
est également adapté aux
grands fonds et aux fosses sousmarines
de plus de 4000 m.
Parmi les innovations du
Marion Dufresne, Yvon Balut
mentionne tout particulièrement
l'ensemble électro-hydraulique
intégré. Ce système permet, par le
biais de câbles, de portiques, de
grues et de treuils, la mise en
oeuvre de tout engin océanographique,
ainsi que les prélèvements
les plus lourds, tel le carottage par
7 000 m de fond. Les câbles de
traction utilisés sont réalisés en
aramide. Ce matériau synthétique,
d'une résistance à la traction supérieure
à celle de l'acier (50 t et
plus), présente l'avantage incontestable
de ne plus rien peser
lorsqu'il est immergé.
AU SERVICE DE TOUS
L'escale brestoise du navire
flambant neuf a permis à ses affréteurs
d'effectuer à demeure les
dernières mises au point techniques.
Roger Gendrin, directeur
de l'Institut polaire, nous a parlé
des missions diverses du Marion
Dufresne dans son rôle de bâtiment
océanographique : "l'IFRTP
est une agence de moyens. Le
«MD I», le «MD II» aujourd'hui,
sont des outils que l'Institut
met au service des chercheurs
et des laboratoires internationaux."
Les grands programmes
mondiaux de recherches océaniques,
IGBP"", IMAGES"),
JGOFS") sont donc les premiers
bénéficiaires des compétences développées.
"Chaque sollicitation
de mission doit passer deux types
d'épreuves : les commissions thématiques
nationales (dont un
conseil scientifique à l'IFREMER)
et le conseil scientifique de
l'Institut polaire, qui juge de la
faisabilité du projet. L'IFRTP
étudie enfin avec l'administration
des TAAF les périodes de disponibilité
du navire." Ainsi, en
juillet et en août, le MD II a effectué
une rotation de ravitaillement
pour les bases françaises des îles
de Kerguelen, Crozet et Amsterdam.
En septembre et en octobre,
il redeviendra navire de recherche
des mers australes, pour le programme
ANTARES"). n
J.A.
"' IGBP : International geosphere biosphere
program. IMAGES : International marine global
change study. JGOFS : Joint global ocean
flux study. ANTARES : Antarctic research.
Contact : Gaëlle Plouzennec
Tel. 98056551
131
Transport ionique et messagerie
LA VIE DES LABOS RESEAU 114
t Sur l'un des deux postes de
"patch-clamp", un chercheur
fait une démonstration pour
Jacques Berthelot, conseiller
général, chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche
au Conseil général du Finistère,
co-financeur de cette technologie
de pointe.
La cellule vivante est le siège d'un incessant transport
d'ions au travers de sa membrane. Ce mouvement résulte
de l'activité des protéines de transport. Parmi ces
protéines, c'est aux échangeurs et aux canaux ioniques
que s'intéresse l'Unité de recherche en physiologie cellulaire
(URPC), à Brest. Ces recherches fondamentales
peuvent déboucher aussi bien sur l'application à la plongée
et à l'environnement marin, que sur la lutte contre
la mucoviscidose.
Dirigée
par Serge Thomas,
chercheur du CNRS, l'URPC
compte 10 physiologistes de
l'Université de Bretagne occidentale,
chercheurs ou enseignantschercheurs,
dont sept sont habilités
à encadrer des étudiants.
L'URPC est d'ailleurs équipe
d'accueil du DEA "Biologie cellulaire
et moléculaire et sciences
de la santé" de Rennes. Habilitée
DGRT (Direction générale de la
recherche et la technologie),
l'unité est composée de trois
équipes : deux en médecine et
une en sciences, installée désormais
dans les locaux libérés par le
départ de l'ENIBl11. Pour l'URPC,
issue de l'URA CNRS des professeurs
Barthélémy et Peyraud,
l'ancienne approche sur l'organisme
entier a fait place à une
compréhension de l'activité au niveau
cellulaire, et notamment à la
mise en évidence et à l'étude des
transports d'ions à travers la
membrane de la cellule. Ainsi,
pour obtenir son habilitation
CNRS d'Unité propre de recherche
et d'enseignement supérieur
(UPRES), le laboratoire
brestois met en avant le thème de
recherche "Transports ioniques
membranaires et adaptation aux
environnements aquatiques". Cependant,
les études de l'URPC
portent également sur diverses
autres contraintes. "La cellule de
l'animal aquatique est soumise à
des variations de pression hydrostatique,
de température et de
pression des gaz. Elle réagit
aussi à la salinité, au pH et à
l'action des polluants, comme le
TBT (tributylétain)," explique
Serge Thomas.
INTÉRÊT POUR
LA MUCOVISCIDOSE
Pour vivre, la cellule accumule
de l'énergie de part et d'autre de
sa membrane, sous forme d'un
gradient de concentration ionique.
Chaque cellule reçoit son ordre de
mission à sa création, par le message
génétique codé dans l'ADN.
Elle peut ensuite effectuer son
travail en activant ses canaux, et
donc en libérant de façon contrôlée
l'énergie accumulée. De plus,
dans la cellule épithéliale, une
conversation croisée, appelée
"cross-talk", s'instaure entre les
différents canaux afm que leur action
soit intégrée et que soit réglé
le trafic ionique entre la membrane
externe et la membrane interne.
Décrire les caractéristiques
électriques et fonctionnelles, la
régulation, le rôle physiologique
des canaux, mesurer les grandeurs
de l'équilibre acido-basique et son
effet sur le potentiel des cellules
et la régulation de leur volume,
c'est tout le travail de l'URPC.
Ses cellules-cibles sont les cellules
cardiaques de l'adulte ou
de l'embryon, l'épithélium du
système intestinal et celui du
système respiratoire. C'est, par
exemple, dans un dysfonctionnement
de ce dernier que réside le
mécanisme de la mucoviscidose.
La communication est brouillée
entre la membrane interne de
l'épithélium pulmonaire et la
membrane externe, qui ne régule
plus la composition et l'épaisseur
du mucus.
LE "PATCH-CLAMP"
Autres applications des recherches
de l'URPC, la toxicité
de l'oxygène (notamment en
plongée), la compréhension de la
vie près des sources hydrothermales
profondes et d'autre part, la
substitution d'une approche fine
et cellulaire de l'effet des polluants
sur les canaux ioniques, à
la démarche plus classique de la
Dose létale 50 (dose de toxiques à
partir de laquelle meurent 50 %
des témoins). Pour mener à bien
ces études, le laboratoire dispose
d'un matériel conséquent, avec
notamment des caissons hyperbares
atteignant 100 fois la pression
atmosphérique, des équipements
d'électrophysiologie, une
salle de culture cellulaire et surtout,
deux postes consacrés à une
technique de pointe, le "patchclamp".
Cette technique consiste
à imposer, sous l'oeil d'un microscope
inversé et le monitoring
d'un PC, un potentiel de l'ordre
de quelques millivolts à la surface
d'une cellule, et de mesurer le
courant qui traverse la membrane,
en fonction de la composition du
milieu conducteur. Une manipulation
pointue, apprise lors d'un
séjour au Cellular physiology research
unit de Cork en Irlande,
avec lequel est jumelé l'URPC. n
M.-E.P.
"' ENIB : Ecole nationale d'ingénieurs de Brest.
Contact : Serge Thomas
Tél. 98 01 62 63
INRIA Institut national de recherche
en informatique et en automatique
Statut juridique : Etablissement public à caractère scientifique et technologique
(EPST) a succédé en 1980 à l'IRIA, créé en 1967.
Effectifs : 1 141 personnes, dont 292 chercheurs, 377 ITA (Ingénieurs, techniciens,
administratifs) et 472 personnels non statutaires (stagiaires, boursiers...)
auxquelles il faut ajouter 418 personnes appartenant aux autres organismes de
recherche (CNRS, universités...) collaborant aux programmes de l'INRIA.
Structure : L'INRIA possède cinq unités de recherche : • Unité de Rocquencourt
(78), où se situe le siège et l'unité de communication et d'information
scientifique • Unité de Rennes (35), créée en 1980 • Unité de Sophia-Antipolis
(06), créée en 1982 • Unité de Lorraine (54), créée en 1984 • Unité de Rhône-
Alpes, créée en 1994.
Budget - financement : 498 millions de francs en 1993, dont une subvention
d'état de 409 millions de francs + ressources propres : 89 millions de francs
dont 31 millions de francs en contrats de recherche avec des partenaires industriels
et 24 millions de francs en contrats de recherche européens.
Missions : Entreprendre des recherches fondamentales et appliquées : • Réaliser
des systèmes expérimentaux • Organiser des échanges scientifiques internationaux
• Assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire
Contribuer à la valorisation des résultats de la recherche • Contribuer, notamment
par la formation, à des programmes de coopération pour le développement
Effectuer des expertises scientifiques • Contribuer à la normalisation.
Programmes de recherche : • Architectures parallèles, bases de données,
réseaux et systèmes • Calcul symbolique, programmation et génie logiciel • Intelligence
artificielle, systèmes cognitifs et interaction homme-machine • Robotique,
image et vision • Traitement du signal, automatique et productique •
Calcul scientifique, modélisation et logiciels numériques.
Président-directeur général : Alain Bensoussan.
Correspondant : Christine Genest, directrice de l'unité de communication et
information scientifique.
Adresse : INRIA, Domaine de Voluceau, BP 105, 78153 Le Chesnay Cedex,
téléphone 16 (I) 39 63 55 11, télécopieur 16 (1) 39 63 53 30, courrier électronique
: @inria.fr Internet : www.inria.fr
RÉSEAU SEPTEMBRE 95 - N°114
~
LES SIGLES DU MOIS RESEAU- 114
l7l
INRIA de Rennes
Statut juridique : Unité de recherche de l'INRIA créée en 1980.
L'INRIA de Rennes est l'une des composantes de l'IRISA avec l'université
de Rennes 1, I'INSA de Rennes et le CNRS.
Effectifs : 45 chercheurs et directeurs de recherche, 45 ingénieurs, techniciens,
administratifs, 90 autres personnels (doctorants, post-doctorants, invités...).
Missions : Correspondent aux missions de l'INRIA.
Programmes de recherche : Les mêmes que ceux de l'INRIA, avec un
accent particulier sur les axes suivants : • Nouvelles architectures parallèles
Systèmes et applications distribués • Technologies des logiciels • Intelligence
artificielle • Traitement d'images • Automatiques et traitement du signal.
Collaborations scientifiques régionales : • Universités (Rennes 1,
Bretagne occidentale) • Grandes écoles (INSA de Rennes, Télécom Bretagne,
Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, ENS Cachan, Supélec, Ecole navale,
Ecole des Mines de Nantes...) • Grands organismes de recherche
(IFREMER, CEMAGREF...), CELAR, CNET, CCETT...).
Collaborations industrielles nationales : France Télécom, Thomson,
DGA, Renault, EDF-GDF, Bull, CEA, Steria, Verilog...
Collaborations régionales : AQL, OST, Edixia, Caption, CRIL, Faros,
TNI. Timeat...
Collaborations internationales : Participation à plusieurs programmes
européens dans le cadre d'Esprit et d'Eurêka.
Directeur : Jean-Pierre Banâtre.
Correspondant : Gérard Paget, chargé de la communication.
Adresse : INRIA de Rennes/IRISA, campus universitaire de Beaulieu,
35042 Rennes Cedex, téléphone : 99 84 71 00, télécopieur : 99 84 71 71,
courrier électronique : @irisa.fr, Internet : www.irisa.fr
RÉSEAU SEPTEMBRE 95 - W114
LES MOYENS INFORMATIQUES
DE L'IRISA 1995
TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
Durée : 1994-1998.
Montant : 1911 millions d'Ecus soit 12,8 milliards de francs.
Décision : Nouvel appel à propositions de projets du 15/06/1995. Ce programme
spécifique de recherche et de développement technologique a déjà
fait l'objet d'une fiche (voir Réseau n°106 ).
Objectif : La production de logiciels et composants électroniques, circuits
intégrés dédiés à des applications spécifiques, développement de technologies
multimédias et systèmes de microprocesseurs, intégration des technologies
de l'information dans les entreprises.
L'appel à propositions de projets du 15/06/1995 est le troisième d'une série
d'appels ciblés. Le prochain et dernier paraîtra le 15/12/1995. Echéance de
l'appel à propositions : 15/09/95.
Plan indicatif des domaines de recherche et d'expérimentation
et répartition budgétaire : 1/ Technologies des logiciels (35 millions
d'Ecus) : ingénierie des systèmes à forte composante logicielle, technologies
des bases de données • 2/ Technologies des composants et soussystèmes
(20 millions d'Ecus) : semi-conducteurs, services de bases de
données, actions en faveur des nouveaux utilisateurs • 3/ Systèmes multimédias
(19 millions d'Ecus) : technologies multimédias, systèmes multimédias
pilotes en coordination avec les programmes ACTS et Télématique
4/ Recherche à long terme (10 millions d'Ecus) : réactivité aux besoins
industriels • 5/ Systèmes des microprocesseurs ouverts (5 millions
d'Ecus) • 6/ Technologies destinées aux processus d'entreprises (22 millions
d'Ecus) • 7/ Modélisation de données relatives aux produits et
processus (32 millions d'Ecus).
Procédure : Soumission d'une proposition complète conformément à la
description du dossier d'information, à demander à : DG III - Industrie, Bureau
du programme TI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
Contact Euro Info Centre : Tél. 99 25 41 57.
RÉSEAU SEPTEMBRE 95 - N' 114
ENVIRONNEMENTS LOGICIELS
d'origines variées : INRIA ; freeware, shareware ;
fournisseurs
couvrant un champ applicatif extrêmement large :
scientifique (mutes disciplines), administratif
(outils d'aide à la gestion)
nécessitant une démarche cohérente, coordonnée
évaluation, gestion technique, accès aux compétences,
respect des obligations
RESPECT des STANDARDS
SI POSSIBLE EN ANTICIPANT
UNIX
ETHERNET... FDDI ; TCP-IF... NFS
X... MOTIF
POSTCRIPT... HTML; SGML
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES des PROJETS et SERVICES
PROJETS : traitement d'images, robotique, plate-forme avec nouveaux
systèmes d'exploitation...
SERVICES : test, mesures, supervision des réseaux...
MACHINES IYEXPÉRIMENTATION RESSOURCES en CALCUL SCIENTIFIQUE
BESOINS CONSTANTS: • ENVIRONNEMENT
DE PRODUCTION
COMPATIBILITÉ des
ENVIRONNEMENTS
SOLUTIONS : • INTERNES : machines parallèles
PARTENAIRES : accès au centre
IDRIS du CNRS
RÉSEAUX DE COMMUNICATION
INTERNE : réseau FDDI fédérant des réseaux ETHERNET,
raccordant globalement plus de 500 équipements
informatiques
EXTERNE : raccordement au réseau régional OUEST-RECHERCHE
et au réseau RENATER par une liaison de 2 Mb/s
POSTES DE TRAVAIL MACHINES DE SERVICE,'
LARGEMENT DIFFUSÉS auprès de SUPPORT DE SERVICES VARIÉS:
MULTI-PLATES-FORMES : stations de travail
l'ENSEMBLE des PERSONNELS exploitation, logiciels, fichiers, applicatifs...
ÉVOLUTION des PLATES-FORMES :
et terminaux X au MEILLEUR NIVEAU centralisées distribuées
TECHNOLOGIQUE: (>400) spécifiques — banalisées
Pam de MICRO-INFORMATIQUE
BONNE RÉPAR1ITION entre tes DIFFÉRENTS SON
RÉSEAU SEPTEMBRE 95 - N"114
OBJET de recherches, d'expérimentation
DOMAINE des architectures parallèles
PARC: 51MO : DEC MPP
MIMD : INTEL PARAGON XP/S ;
INTEL IPSC/2
SAINT-MALO
PUBU
WIM Ain MN
4mg
• ~ r ~—>-
~~~ '•--- -'~ =~
`..= •-
., ~ ~•: ; FORFAITS
POUR CONGRÈS
RÉUNIONS, ÉCOLES
SCIENTIFIQUES
À PARTIR DE
F. TTC
Par jour et par personne
Hébergement - Restauration compris
PALAIS DU GRAND LARGE
Quand les grands esprits se rencontrent
DEMANDE D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOM PRENOM
ORGANISME
COORDONNÉES
TÉL. FAX
Souhaite recevoir une documentation complète sur les prestations du Palais du Grand Large et ses forfaits scientifiques.
PALAIS
DU GRAND
LARGE
~
PALAIS DU GRAND LARGE - B.P. 109 - 35407 SAINT-MALO CEDEX
TÉL 9 9. 4 0. 3 4. 8 8 - FAX 9 9. 4 0. 5 4. 9 0
Ce dossier spécial IRISA
est édité par le CCSTI, et
intégré au numéro 114
du mensuel RÉSEAU, en
collaboration avec l'IRISA.
DOSSIER L'IRISA RESEAU 114
Les enjeux de l'informatique
aujourd'hui
Selon Jean-Pierre Banâtre,
directeur de l'IRISA,
l'informatique est un
élément déterminant pour
l'avenir de notre société.
Elle intervient dans des
domaines comme la santé,
l'éducation, les loisirs,
l'environnement...
Ce dossier spécial IRISA va permettre aux non-informaticiens
de comprendre pourquoi la culture informatique,
longtemps confinée à la défense et à l'industrie, fait désormais
partie de la culture générale. Outil d'accès aux
connaissances, l'informatique doit, elle aussi, bénéficier
des immenses réseaux de communication pour se faire
connaître. Laissons à Jean-Pierre Banâtre, directeur de
l'IRISA, le soin de nous présenter cette "nouvelle" informatique.
Réseau : Quels sont les enjeux
de l'informatique aujourd'hui ?
Jean-Pierre Banâtre : La profonde
mutation que connaît le domaine
des technologies de l'information
est maintenant assez bien
comprise je crois. La numérisation
et le rôle des logiciels deviennent
prédominants dans l'ensemble
du secteur informatique,
télécommunications et audiovisuel.
L'informatique apparaît comme
un élément déterminant de la
compétitivité de tous les secteurs
économiques et même de l'évolution
de la société, par son impact
dans des domaines comme la
santé, l'éducation, les loisirs,
l'environnement...
La réponse à cette demande
passe par la mise en place de systèmes
complexes, bien organisés,
intégrant des machines très performantes
et communiquant efficacement
entre elles. Ces systèmes
sont assemblés à partir de
modules de base, qui doivent être
conçus pour interopérer facilement
en respectant des standards.
L'industrie informatique comprendra
donc essentiellement des
fournisseurs de technologie ou de
modules de base (matériels ou logiciels),
ainsi que des spécialistes
de l'intégration et de l'organisation.
La recherche doit s'adapter à
cet état de fait et concentrer ses
efforts sur les méthodologies clés,
qui sont à la base des nouvelles
générations de technologie. Les
chercheurs doivent, tout en
conservant leur spécificité, s'efforcer
d'adapter leurs résultats au
monde des applications qui nous
entoure. Cette analyse concerne
tous les domaines de recherche de
l'IRISA, aussi bien l'automatique
que l'informatique.
Réseau : En quoi, d'après vous,
l'informatique va-t-elle "changer
la vie" ?
J.-P.B.: Il est toujours délicat de
répondre à ce genre de question,
mais on peut tenter d'imaginer
l'avenir. L'avènement des "autoroutes
de l'information", pour
prendre un exemple à la mode,
risque de constituer une révolution
qui modifiera fondamentalement
les structures économiques,
les modèles d'organisation et de
production, l'accès de l'individu à
la connaissance, ses loisirs, ses
méthodes de travail et ses relations
sociales. Et c'est là que
l'IRISA peut intervenir, en mettant
à disposition ses compétences
et ses moyens.
Réseau : Quelles sont les particularités
de l'IRISA par rapport
aux autres centres de recherche ?
J.-P.B. : La spécificité de l'IRISA
est de rassembler, au sein d'une
même communauté, des personnels
émanant de quatre tutelles :
l'INRIA, le CNRS, l'université
de Rennes 1 et l'INSA de Rennes.
L'IRISA regroupe plus de 300
personnes, dont environ 120
INRIA, 25 CNRS, 60 universitaires
et 120 doctorants.
La recherche est structurée
autour de 6 grands programmes :
architecture des machines et des
systèmes, programmation et génie
logiciel, intelligence artificielle et
communication homme-machine,
robotique, image et vision, automatique
et traitement du signal,
calcul scientifique. Chaque programme
comprend un certain
nombre de projets (équipes)
constitués de 8 à 25 chercheurs,
ingénieurs et doctorants.
Parmi ces projets, 14 sont communs
à l'INRIA, au CNRS et à
l'Enseignement supérieur, trois
projets sont communs au CNRS
et à l'Enseignement supérieur.
Les activités de l'IRISA vont
du développement de composants
matériels à la mise en oeuvre d'applications
avancées. La conception
de circuits et d'architectures
nouvelles, mettant en oeuvre un
parallélisme important, est maintenant
un axe de recherche privilégié.
La construction de systèmes
distribués, permettant de rendre
transparente l'utilisation des multiples
ressources composant l'architecture,
donne lieu à des travaux
tout à fait originaux. Enfin,
il est nécessaire de fournir à l'utilisateur
de tels machines et systèmes,
des outils de programmation
à la fois sûrs et puissants.
Le traitement d'images est également
un point fort de l'IRISA ;
dans le domaine, deux actions essentielles
sont en cours : l'une
concerne le traitement d'images
séquentielles, l'autre la synthèse
d'images réalistes et animées.
L'intelligence artificielle est aussi
un domaine suscitant des travaux
importants, notamment en ce qui
concerne la représentation des
connaissances et l'interaction
homme-machine. Enfin, la construction
de logiciels qui permettent
de gouverner les systèmes
temps réel occupe une place essentielle
dans nos activités. Ces
logiciels s'appuient sur des algorithmes
de traitement de l'information,
de commande, de contrôle
et de surveillance.
Réseau : Pour mener à bien ces
recherches, quels sont vos partenaires
?
J.-P.B. : L'IRISA entretient des
liens contractuels avec de nombreux
industriels français ou européens
(via les programmes Esprit
et Eureka) et cette tendance
ne peut que se renforcer dans les
années à venir. Nos travaux de recherche
sont reconnus au niveau
mondial. Ceci se reflète par les
nombreux échanges et contacts
que nous entretenons avec les laboratoires
de pointe aux Etats-
Unis, en Europe et au Japon, par
la participation de nombreux
membres de l'IRISA à des actions
internationales, par un grand
nombre de publications internationales
et par les nombreuses visites
de chercheurs étrangers.
L'IRISA s'implique fortement
dans des coopérations avec les
centres de recherche présents en
région Bretagne (CNET"',
CCETT"', IFREMER'...), avec
de grands industriels (tel Thomson)
et avec des PME/PMI
(OST"', AQL", TNI"l, Timeat...).
Ce dernier point nous tient à coeur
et devrait connaître une progression
dans les années à venir. Soulignons
également l'implication
de l'IRISA dans des opérations à
vocation régionale, telles que le
réseau Ouest-Recherche, le projet
Immédiat conduit par Thomson,
ou le projet de télé-formation
conduit par le CNET.
Enfin, l'IRISA entretient des
liens privilégiés avec le monde
de la formation. Plusieurs de ses
chercheurs appartiennent à l'université
de Rennes '1 (IFSIC"',
ENSSAT'", IUT informatique
de Lannion) ou à l'INSA"' de
Rennes. Un effort particulier a été
fait pour mettre en place des partenariats
avec les grandes écoles
de la région (Télécom Bretagne,
Ecole Navale, Supélec, Ecoles de
Saint-Cyr, Ecole des Mines de
Nantes et ENS Cachan/Bretagne).
"' CNET : Centre national d'études des télécommunications
: CCETT : Centre commun
d' éudes de télédiffusion et télécommunications
IFREMER : Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer ; OST : Ouest
standard télématique : AQL : Alliance qualité
logiciel ; TNI : Techniques nouvelles d'informatique
; IFSIC : Institut de formation supérieure
en informatique et communication
ENSSAT : Ecole nationale supérieure de
sciences appliquées et de technologie ; INSA :
Institut national des sciences appliquées.
Contact : Jean-Pierre Banâtre
Tél. 99 84 71 00
Réseau : D'un point de vue stratégique,
qu'apportent les industriels
à l'IRISA ?
Jean-Loïc Delhaye : Nous travaillons
dans un contexte, l'informatique
et l'automatique, où les
technologies évoluent rapidement
et où la compétition est très forte,
aussi bien dans les laboratoires
de recherche que dans les entreprises.
Il est donc essentiel, pour
l'IRISA, d'avoir de fortes implications
avec le milieu industriel,
pour répondre efficacement à
leurs besoins. L'INRIA et le
CNRS, deux des tutelles de
l'IRISA, sont des EPST (Etablissements
publics à caractère
scientifique et technologique) : le
transfert de technologie est l'une
de leurs principales missions.
Réseau : Pouvez-vous nous citer
des exemples de valorisation ?
J.-L.D. : Le constructeur automobile
Renault a signé un accord
d'étude avec l'IRISA concernant
la surveillance préventive de
l'ensemble moteur-pot d'échappement-
sonde, afin de réguler
automatiquement la composition
du mélange air-carburant. Cette
régulation diminue à la fois la
consommation du véhicule et
son émission de substances polluantes.
Un autre exemple a conduit au
dépôt d'un brevet par l'IRISA,
dans le secteur de la santé. Il
Depuis décembre 1994,
Jean-Laïc Delhaye est
responsable de la valorisation
et des relations industrielles
de l'IRISA.
s'agit d'un "accélérateur pour la
comparaison de séquences
d'ADN", un outil utile pour les
recherches sur le génome.
Réseau : Quelle place accordezvous
aux entreprises régionales ?
J.-L.D. : L'IRISA tient à être un
moteur de la vie économique locale.
Le tissu industriel breton est
particulièrement riche en PME,
qui sont des structures favorables
aux collaborations entre la recherche
et l'industrie. C'est pourquoi
nous comptons, parmi nos
partenaires, des entreprises telles
que AQL, Edixia, Timeat et Caption
à Rennes, Faros à Lannion et
TNI à Brest. Nous souhaitons
renforcer nos actions dans ce
sens.
Un exemple significatif est la signature,
le 23 février dernier,
d'un partenariat important avec
OST, concernant la mise en place
d'une plate-forme distribuée s'appuyant
sur la technologie ATM"'
de réseau à haut débit. Enfin,
l'IRISA a aussi de nombreuses
collaborations avec des organismes
tels que le CNET"', la
DGA"'...
ATM : Mode de transfert asynchrone ;
CNET : Centre national d'études des télécommunications
; DGA : Direction générale de
l'armement.
Les relations
industrielles
En 1994, l'IRISA a participé à une quarantaine d'actions
industrielles. C'est dire l'importance de la fonction
"valorisation et relations industrielles", occupée par
Jean-Loïc Delhaye.
Ilol
Carte pluviométrique du Queensland, grande région
au nord-est de l'Australie : les régions sèches sont
représentées en rouge et les régions humides, en bleu.
100
150
200
250
/` 250
100:
Soo
o-
L'IRISA RESEAU 119 DOSSIER
Badins
l'interrogation souple à Lannion
A Lannion, l'IRISA est présent par une quinzaine d'enseignants-
chercheurs en informatique, de l'IUT et de
l'ENSSAT". Ils travaillent sur deux thèmes : les relations
homme-machine et l'interrogation souple des bases
de données. Ce deuxième thème est sous la direction de
Patrick Bosc, professeur à l'ENSSAT, et fait l'objet
d'une collaboration avec France Télécom.
La bibliothèque de l'ENSSAT
à Lannion se situe dans une
chapelle, un lieu propre
au travail intellectuel et à la
méditation !
Réseau : Pouvez-vous nous définir
le sujet de cette collaboration ?
Patrick Bosc : Elle résulte d'un
appel d'offres lancé par France
Télécom fin 1993, dans le cadre
de sa stratégie de développement
des services multimédia. D'un
point de vue scientifique, il s'agit
de traiter en informatique des
questions auxquelles on ne peut
répondre ni par oui, ni par non.
On retrouve ici le concept de logique
"floue". La base de données
doit ainsi être en mesure de fournir
des informations qui correspondent
aux préférences du client.
Avec le développement du multimédia,
la variété des supports
(photos, sons, vidéos...) nécessite
ce mode d'interrogation extrêmement
ouvert.
En voici un exemple : les services
immobiliers actuels, sur Minitel,
proposent des appartements
en fonction de leur loyer, de leur
surface et de leur emplacement.
Les prochains services devront
être capables de proposer un style
de logement correspondant au
mieux aux préférences du client,
en utilisant de plus des photos,
des schémas, des vidéos... Deux
théories assez récentes, la "théorie
des ensembles flous" et la
"théorie des possibilités", vont
nous aider à résoudre ce problème.
Cette activité s'inscrit
dans le cadre du projet Badins'''
de l'IRISA.
Réseau : Quelle est l'implication
de France Télécom ?
P.B. : France Télécom finance
une partie des recherches, qui se
déroulent en étroite coopération
avec le service SMD (Services
multimédias et dialogues), au
CNET de Lannion. Le financement
comprend, en particulier,
une thèse sur le sujet. Pour France
Télécom, l'objectif est de disposer
d'un système expérimental
d'ici trois ans, afin de promouvoir
le développement de banques de
données multimédia, comme de
toutes applications utilisant ses
infrastructures de télécommunications.
!'μ.
°' ENSSAT : Ecole nationale supérieure de
sciences appliquées et de technologie.'" Badins :
Bases de données multimédia et interrogation
souple.
Contact : Patrick Bosc
Té1. 96 46 50 30
Une sécheresse catastrophique,
liée au phénomène
cyclique El Niiio, ravagea
l'Australie en 1991. En collaboration
avec un professeur
australien, Jocelyne
Erhel, du projet Aladinl"
de l'IRISA, utilise des méthodes
de calcul répétitives
pour établir une carte pluviométrique
globale... afin
d'anticiper la prochaine
sécheresse.
1 y a en Australie 9 000 stations
météorologiques. C'est peu
pour un si vaste territoire. Les
données pluviométriques recueillies
sont trop ponctuelles
pour qu'il soit possible d'obtenir
une carte fiable des pluies sur tout
le continent. Une telle carte est
pourtant devenue indispensable
pour localiser avec précision les
régions qui seront touchées par
la prochaine sécheresse. Grâce à
l'informatique, le professeur Kevin
Burrage, de l'université du
Queensland, construit cette carte.
Kevin Burrage n'en est pas à
son coup d'essai. Primée par le
gouvernement australien, son
équipe a mis au point un logiciel
qui fournit une visualisation immédiate
des données pluviométriques
sur une zone déterminée.
L'un des objectifs du projet Aladin
consiste à rendre ce logiciel
encore plus performant.
MATHÉMATIQUES
ET PARALLÉLISME
Sous la responsabilité de Bernard
Philippe, le projet s'applique
à résoudre de grands systèmes
d'équations en utilisant des méthodes
répétitives. La solution
s'obtient par approximations successives
: à partir d'une première
estimation, on réitère le procédé
pour affiner la solution jusqu'à
la convergence. Le calcul est accéléré
en programmant ces méthodes
mathématiques sur ordinateurs
parallèles.
Cette puissance de calcul permet
de reconstruire une carte des
pluies de toute l'Australie, en extrapolant
les données recueillies
depuis un siècle. Il s'agit ensuite
de corréler la carte satellite avec
la carte des pluies et de relier la
quantité d'eau tombée au pâturage
existant. Lors de la prochaine
sécheresse, les régions les
plus touchées et où l'élevage de
bovins est important, seront alors
alimentées avec le fourrage provenant
des zones humides.
O1 Aladin : Algorithmes adaptés au calcul numérique
intensif.
Aladin
le calcul contre la sécheresse
Caps et Pampa
le parallélisme au secours du calcul
Photo INRI4 A. Edelman.
POUR EN SAVOIR PLUS
INédit, la lettre d'information de
l'INRIA, paraîtra tous les deux
mois, en anglais et en français, à
partir d'octobre prochain. Cette
publication sera peu après suivie
d'une version électronique, accessible
via Internet. Son rôle est
de susciter de nouvelles collaborations.
Contact : Gérard Paget, tél. 99 84 73 61.
pOSSl ER .arua 114 L'IRISA
Pour sonder les océans, simuler
un choc automobile
ou concevoir des verres optiques,
les besoins en calcul
sont énormes. Les problèmes
engendrés sont si
complexes et si coûteux en
temps, que seules les machines
parallèles peuvent
les résoudre. L'objectif des
projets Caps et Pampa de
l'IRISA est d'améliorer les
performances de ces machines
en facilitant leur
programmation.
omment calculer vite ? En
divisant le programme de
calcul en plusieurs morceaux répartis
sur un ensemble de processeurs
interconnectés. Chaque processeur
dispose d'une mémoire
contenant les données du calcul à
effectuer. Comment calculer encore
plus vite ? En faisant en
sorte que chaque processeur soit
le plus autonome possible. C'est
l'objectif du projet Pampa'', placé
sous la responsabilité de Françoise
André.
Afin que l'utilisateur programme
dans un langage courant,
de type Fortran, un compilateur a
été conçu. Il traduit les programmes
exprimés dans ce langage,
en programmes exécutables
par les différents processeurs.
Ainsi l'utilisateur n'a pas à gérer
explicitement les processeurs,
leurs mémoires et leurs interactions."
Le compilateur doit permettre
par exemple le traitement
de programmes visant à simuler
de grands réseaux, comme ceux
de télécommunication et de distribution
de l'énergie", conclut
Françoise André.
MASQUER LES MÉMOIRES
DISTRIBUÉES
Pour simplifier la programmation,
la distribution physique des
mémoires entre les processeurs
est masquée soit au niveau du
compilateur, c'est ce que fait
Françoise André, soit au niveau
du système d'exploitation : c'est
l'option développée par Thierry
Priol, directeur de recherche au
sein du projet Caps'''. "Une prochaine
étape pourrait être la modification
des machines ellesmêmes"
remarque-t-il. Les
machines parallèles actuelles sont
en effet incapables d'optimiser
l'accès aux données lorsque
celles-ci ne sont connues que lors
de l'exécution de l'application.
"Le concept de mémoire virtuelle
Lauréat du prix "Jeune
chercheur 1994" de la
Direction générale de
l'armement, Thierry Priol
travaille en particulier
sur la Paragon XP/S,
une grosse machine mise
à la disposition des membres
du club des machines
parallèles de l'IRISA.
partagée, que nous étudions
dans le projet Caps, permet de
masquer les mémoires distribuées
et de faciliter la programmation",
résume Thierry Priol.
PARALLÉLISME
SANS FRONTIÈRE
Pour démontrer que le concept
de mémoire partagée peut s'appliquer
à la dernière machine parallèle
fabriquée par Intel, l'IRISA a
signé un contrat avec le constructeur
américain. Contrat auquel collaborent
les équipes Caps, Pampa,
Aladin et Solidor. Les énormes
capacités de cette machine, la
Paragon XP/S, sont d'ailleurs
mises à disposition des membres
du club des machines parallèles
de l'IRISA, parmi lesquels on
trouve les universités de Brest,
de Rennes, de Nantes, l'Ecole des
Mines de Nantes, l'IFREMER,
Thomson et le CELAR.
Le problème des machines parallèles
est international : Françoise
André et ses collaborateurs
participent à la réalisation d'un
environnement de compilation
pour High Performance Fortran
dans le cadre du projet européen
Prepare. Caps, quant à lui, est en
relation avec des universités en
Angleterre, en Allemagne, en Espagne,
en Grèce, aux Pays-Bas,
au Danemark et en Irlande du
Nord, dans le cadre du projet européen
Esprit, Apparc.
"' Pampa : Programmation des architectures
massivement parallèles.'" Caps : Compilation,
architectures parallèles, systèmes.
Le centre de documentation de
l'IRISA est ouvert aux entreprises.
Le centre de
documentation
ieu de rencontre des professionnels
de la recherche en
informatique, le centre de documentation
de l'IRISA propose un
fonds documentaire de haut niveau
: 9600 ouvrages dont 2500
actes de conférences, 2 100 thèses
françaises et étrangères, 5 000
monographies, 14500 rapports de
recherche et 180 revues. Entièrement
informatisé, ce fonds documentaire
est ouvert aux entreprises
et aux autres centres de
recherche. Sur les 570 emprunteurs
actuels, 290 proviennent de
l'IRISA, 130 d'établissements
d'enseignement supérieur, 80
d'autres bibliothèques (au titre
d'interprêt) et 70 du monde industriel.
Un catalogue de ces documents
est disponible par Minitel, sur le
3616 INRIA*IRISA, en consultant
l'Irisathèque (relevé bimensuel
des dernières acquisitions),
ou sur Internet via le serveur
Wais.
Contact : Pascale Laurent
Tél. 99 $4 72 76
L'IRISA RESEAU 114 DOSSIER
Réseau : Quel est l'objectif de
Synchron ?
Paul Le Guernic : La technologie
synchrone associée aux domaines
d'application "temps
réel", fait appel à des algorithmes
et des spécifications de haut niveau,
d'où la nécessité d'associer
étroitement le monde industriel et
celui de la recherche, les applications
et le développement des outils.
Historiquement, la technologie
synchrone s'est développée en
France autour des systèmes informatiques
embarqués "temps réel".
A partir de cette technologie, nous
avons voulu développer toute une
gamme de produits pour l'industrie,
en particulier pour les secteurs
où les aspects de sécurité
sont importants. Le projet Eurêka
apporte une dimension européenne
à la diffusion de la technologie
synchrone.
Réseau : Quels sont les partenaires
de Synchron ?
P.L.G.: Ils entrent dans trois catégories
: les centres de recherche,
les constructeurs et les utilisateurs.
L'INRIA est un partenaire important
puisque 4 de ses centres, Grenoble,
Rennes, Rocquencourt et
Sophia, sont associés, aux côtés
d'un centre de recherche allemand,
le GMD"). Les utilisateurs sont
principalement des industriels de
l'avionique et du nucléaire :
Schneider Electric et la Snecma en
France, SAAB en Suède. Enfin
VTT, un centre de recherche en
Finlande, conduit des expérimentations
dans le domaine des télécommunications.
Les constructeurs
sont suédois (Logikkonsult)
et français (Verilog à Grenoble et
TM à Brest). Cette dernière PME
(25 salariés) commercialise, en
particulier, des produits directement
nés du langage synchrone inventé
à Rennes.
La technologie synchrone
est un ensemble de méthodes
et d'outils, dont l'objectif est
de produire des calculateurs
embarqués qui vont, par
exemple, contrôler le
fonctionnement d'un avion,
d'un satellite, d'une centrale
nucléaire, d'un équipement
médical...
GMD : Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung.
égïon d E
Solidor
vers des
services fiables
et hautement
disponibles
Avec le développement des
systèmes de communication,
les services (banque,
transports, tourisme...)
offrent aux usagers de
multiples possibilités. Ces
systèmes, de type "clientserveur"
reposent sur un
grand nombre de machines,
qui peuvent être
disséminées sur un vaste
territoire.
nterrogation de compte en
banque, consultation d'ouvrages
(bibliothèque virtuelle), réservation
SNCF... Pour s'informer,
réserver et acheter, il suffit
de se connecter sur un serveur,
vocal ou télématique. Derrière la
machine, une multitude de processeurs
sont reliés entre eux,
pour offrir un maximum de services...
et de fiabilité. A l'IRISA,
le projet Solidor'" s'est spécialisé
dans ces systèmes distribués :
sous la direction de Michel Banâtre,
une vingtaine de personnes
se sont fixées pour objectif de
rendre ces systèmes plus performants,
mais aussi plus disponibles
et plus fiables.
LA TOLÉRANCE
AUX PANNES
Michel Banâtre est directeur de
recherche INRIA : "Au coeur des
systèmes distribués, la réplication
des tâches offre la possibilité de
masquer toute défaillance d'une
machine, en basculant automatiquement
le travail en cours sur
une autre machine. Le déroulement
de la commande se poursuit
alors sans rupture du service."
Cette tolérance aux fautes intéresse
beaucoup les industriels,
parmi lesquels France Télécom et
Bull, partenaires de Solidor. Les
recherches pourraient même déboucher
prochainement sur la
création d'une entreprise...
LA PLATE-FORME
ASTROLAB
Toujours dans le cadre du projet
Solidor, un contrat a été récemment
signé entre l'IRISA et
OST, une entreprise de 400 personnes
spécialisée dans les réseaux
d'entreprises. Prenant place
dans le programme ITR12' de la région
Bretagne, cet accord prévoit
la création d'une plate-forme informatique
distribuée, comprenant
une trentaine de machines,
afin de tester les nouveaux produits
utilisant la technologie
ATM de réseau à haut débit.
Cette plate-forme servira d'outil
pour les chercheurs de l'IRISA,
mais aussi de banc d'essai pour
les industriels soucieux de tester
leurs produits en taille réelle.
Le préfet de Région
Jean-Claude Le Taillandier
de Gabarit, aux côtés
d'Yvon Bourges, président du
Conseil régional de Bretagne,
de Thao Lane, présidentdirecteur
général d'OST
et d'Alain Bensoussan,
président de l'INRIA, lors
de la signature du partenariat
OST-INRIA, le 23 février
dernier à l'IRISA.
"' Solidor : Systèmes distribués, tolérance aux
fautes, programmation objets ; '" !TR : Informatique
Télécoms Réseaux.
jtvre en Bre .a ne
Synchron
la technologie synchrone à l'heure
européenne
Paul Le Guernic, directeur de recherche, est responsable
du projet Synchron, un projet mené dans le cadre d'Eurêka,
programme européen de développement technologique.
La technologie synchrone a de multiples applications
dans le monde des transports, de l'énergie et de la
défense, partout où la sécurité est importante. L'objectif
de Synchron est d'homogénéiser les différents systèmes
de technologie synchrone existant dans toute l'Europe.
I;ï
Timeat
0•-- - C
la vision industrielle TIMEAT',
u La station
Mercure surveille
les portions
d'autoroute les
plus dangereuses
et signale
automatiquement
les accidents.
Trois doctorants de
l'IRISA, spécialisés dans
la vision industrielle, décident
en 1989 de créer
une entreprise. Localisée
à Cesson-Sévigné, sa spécialité
est la vidéosurveillance
active et le
contrôle visuel de la qualité.
Outil pour la gestion
du trafic routier, la station
Mercure est l'un de
ses produit-phares.
orsqu'une voiture s'arrête
sur la bande d'arrêt d'urgence
d'une autoroute, un accident
risque de survenir dans les
vingt minutes. Les boucles magnétiques,
installées tous les
deux kilomètres dans la chaussée,
signalent les engorgements
de trafic, mais pas les anomalies
ponctuelles, ni les accidents
qu'elles entraînent. Rien de
semblable avec la station Mercure,
déjà vendue à 150 exemplaires
par Timeat pour des sociétés
d'autoroute comme
Escota, Cofiroute, Area et en
Europe.
UNE VISION
INTELLIGENTE
Le système mis au point par
Timeat est constitué de caméras
vidéo disposées au niveau des
zones dites "accidentogènes
Un logiciel traite les images en
temps réel : les arrêts dangereux,
les accidents et les embouteillages
sont automatiquement
repérés, en même temps que les
paramètres de trafic. L'opérateur
n'a pas à surveiller une centaine
d'écrans vidéo, puisque
seules les images "anormales"
lui sont transmises via une
simple ligne téléphonique. La
visualisation du problème est
immédiate. Toute l'informatique
(logiciel d'acquisition et
de traitement des images, de
compression et de transmission
des données) est intégrée dans
un boîtier complet et résistant
aux intempéries.
LA RECHERCHE
VALORISÉE
En vendant Mercure et ses
autres produits de vision, Timeat
valorise des travaux de recherche
de l'INRETS'". Membre
du club des "start-up" de
l'INRIA, elle travaille toujours
en collaboration avec l'IRISA.
Aujourd'hui, l'entreprise emploie
huit personnes et une société
industrielle a pris une participation
au capital (Velec).
Son chiffre d'affaires est de
3,2 millions de francs et devrait
atteindre,eette année les cinq
million
INRETS ; Institut national de r
ur les transports et la sécurité.
Contact : Thierry Daniel
Tél. 99 26 93 00
la vision en robotique
En positionnant une caméra parallèlement à une
tranche de jambon, il est possible d'évaluer sa qualité à
partir de sa couleur et de sa texture. Le positionnement
automatique de cette caméra par un robot fait l'objet
d'une collaboration entre l'IRISA et le CEMAGREFI'l,
collaboration inscrite dans le nouveau contrat de plan
Etat-Région.
méliorer la perception d'une
scène et activer un robot par
des mouvements adéquats d'une
caméra est l'un des objectifs du
projet Temistst de l'IRISA, dont
le responsable est Claude Labit.
Ce projet comprend une partie
"Compression", une partie "Analyse
du mouvement" et une partie
"Vision active et robotique", dont
s'occupe François Chaumette,
chargé de recherche INRIA.
Certaines tâches robotiques
peuvent aujourd'hui être générées
à partir d'images prises par une
caméra. Cet aspect a notamment
fait l'objet d'un contrat important
avec Edixia et EDF, pour la mise
au point de robots capables
d'opérations de maintenance dans
les centrales nucléaires. "Pour
l'industrialisation de nos recherches,
nous travaillons beaucoup
avec la société Edixia,
spécialisée dans la vision industrielle",
précise François Chaumette.
VERS UNE VISION
GLOBALE
Temis se tourne aujourd'hui
vers la vision active globale.
Dans le cas des objets mobiles, la
caméra, portée par un robot, effectue
des mouvements complémentaires
par rapport au mouvement
des objets.
L'analyse du mouvement intéresse
par exemple 1'IFREMER0),
pour stabiliser les prises de vue
sous-marines, déviées par la
houle et les courants marins. La
Le nouveau robot, Vigie, est
particulièrement adapté à
la vision active globale : les
images de la caméra sont
immédiatement traitées,
afin de ne transmettre à
l'opérateur que les scènes
intéressantes.
sécurité routière et la télésurveillance
sont aussi des débouchés
importants. Pour développer
ces applications, le laboratoire
vient de s'équiper d'un nouveau
robot, appelé "Vigie", capable de
simuler les mouvements de l'oeil
et de zoomer sur une perturbation.
L'opérateur humain reste indispensable,
et peut alors contrôler
à distance une cinquantaine de
sites avec un seul moniteur vidéo.
En cas d'alerte sur l'un des sites,
il reçoit aussitôt sur son écran
l'image de la zone suspecte. n
"' CEMAGREF : Centre d'études du machinisme
agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts. "' Temis : Traitement, exploitation et
modélisation d'images séquentielles. "'IFREMER
: Institut,f'rançais pour la recherche et
l'exploitation des mers.
Temis
Animation par
modèle physique
d'une scène
réaliste : lampe
de bureau
articulée sur
fond de logo
"INRIA Rennes".
le virtuel au service du réel
Siames
Rhin I NR41, A. Edelman.
L'IRISA RESEAU 114 DOSSIER
Api et Repco
les informaticiens du génome
Tous les jours, dans les laboratoires de biologie moléculaire,
les chercheurs analysent et comparent les séquences
biologiques des organismes : ADN et protéines.
Afin d'accélérer et d'améliorer ce travail répétitif,
l'IRISA a mis au point des outils informatiques pour
analyser avec précision de grandes séquences biologiques,
et pour les comparer rapidement avec des
banques de séquences.
Pholo INRIA, A. fldelmon.
a séquence des gènes, déterminée
par la succession des 4
bases azotées adénine, cytosine,
guanine et thymine (A, C, G et T)
le long de la molécule d'ADN, est
un modèle simple pour les informaticiens.
"Ce n'est tout compte
fait qu'un alphabet à 4 lettres",
simplifie Pascale Guerdoux-
Jamet, une jeune biologiste préparant
actuellement une thèse à
l'IRISA.
Pour comparer très rapidement
les séquences caractère par caractère,
un accélérateur matériel a
été conçu par Dominique Lavenier,
chargé de recherche CNRS
dans le projet Api"). C'est une architecture
parallèle qui réduit le
temps de comparaison entre une
séquence et une banque, de plusieurs
heures à quelques dizaines
de secondes. Il existait déjà des
logiciels rapides mais ils ne localisaient
pas les ressemblances
fines... Afin de faciliter les comparaisons,
les séquences de bases
dont l'occurrence dépasse un certain
seuil doivent être repérées.
Un filtre a pour cela été défini, et
fait l'objet d'un dépôt de brevet.
UN LANGAGE
À DÉCRYPTER
Jacques Nicolas, chargé de recherche
INRIA dans le projet
Repcot2', décortique les séquences
mot par mot, et non pas caractère
par caractère, à l'aide d'un "fouineur".
Les motifs les plus fréquents
sont identifiés : composés
Visualisation de circuit
imprimé dédié à la
comparaison de séquences
biologiques.
de plusieurs caractères, ils forment
les mots d'un langage que
l'on tente de décrypter.
Intégrée au programme "Action
génome" de l'INRIA, cette
application de l'informatique à la
biologie se développe en collaboration
avec deux équipes de biologistes
du campus de Beaulieu et
deux équipes médicales du
CHRU Pontchaillou. Les six
équipes constituent le groupe
"Bio-informatique". L'un de leurs
travaux concerne l'étude de la régulation
des gènes spécifiques du
foie, problème d'intérêt médical
mais aussi agroalimentaire.
D'autre part, un projet européen a
été déposé : il concerne l'étude du
génome des saumons, une espèce
dont l'intérêt économique est important
en aquaculture.
°i Api : Architectures parallèles intég rées.
Repco : Représentation des connaissances.
La fracture de la cheville
menace le cycliste fatigué.
Pour l'éviter, il est possible
de localiser les zones de
fractures potentielles, invisibles
au médecin, en simulant
les mouvements
du sportif. Le projet
Siames°' de l'IRISA modélise
les phénomènes physiques,
en tenant compte
des lois de la mécanique,
pour produire des images
virtuelles directement exploitables.
'audiovisuel utilise les
images virtuelles pour leurs
effets. Le projet Siames en produit
pour simuler le réel, après
modélisation du phénomène physique
sous-jacent. En collaboration
avec des entreprises régionales,
telles que Caption, Cril,
Sogitec et Edixia, spécialisées
dans la visualisation, deux types
de simulation numérique sont effectués
: mouvement et éclairage.
La simulation permet de visualiser
des phénomènes invisibles,
mais surtout elle raccourcit les
délais et minimise l'investissement
matériel. Concernant la modélisation
automobile, si le positionnement
de la barre antiroulis
d'un véhicule est simulable en 15
secondes, son déplacement réel
sur le prototype nécessite un
mois de travail...
LE CIEL MODÉLISÉ
La simulation de l'éclairage
dans un bâtiment s'effectue en
collaboration avec le CSTBi2i, à
Nantes. La question qui se pose
est de savoir comment la lumière
naturelle va évoluer au cours de
la journée, et se mixer avec
l'éclairage artificiel. La modélisation
permet de le prévoir, en
fonction de la taille de la fenêtre
et de sa position, des objets présents
dans la pièce et de leur matériau,
de la disposition et de l'intensité
de l'éclairage artificiel, et
même du type de ciel.
Pour éviter de construire plusieurs
maquettes d'une pièce
éclairée, le CSTB s'inspire des
résultats numériques. Mais la maquette
reste indispensable pour la
confirmation du modèle... même
si la corrélation avec la modélisation
informatique est de 97 %. "À
terme, le CSTB pourra proposer
aux industriels du bâtiment notre
système de simulation d'éclairage",
envisage Bruno Arnaldi,
responsable de Siames, un projet
qui participe à la mise en place
d'un environnement pour la réalité
virtuelle.
°i Siames : Synthèse d'image, animation, modélisation
et simulation."' CSTB : Centre scientifique
et technique du bâtiment.
HISTOIRE ET SOCIÉTÉ 4E5E4..0 114
L'Ecole polytechnique
et la Bretagne
Augustin Fresnel (1788-1827),
père des phares modernes
Augustin Fresnel naît à Broglie, dans l'Eure, où son
père, architecte, dirige la restauration du château, après
avoir épousé Augustine Mérimée, d'une illustre famille.
Reçu à 16 ans à l'Ecole polytechnique, il est nommé ingénieur
des Ponts et Chaussées en 1809 et affecté en premier
poste en Vendée, à Napoléon-sur-Yon (qui devint
par la suite La Roche-sur-Yon) où l'on crée alors, sur
ordre de l'Empereur, une ville et des routes nouvelles.
a besogne administrative est
loin de suffire pour cet esprit
inventif qui, après avoir abordé
les sujets les plus divers, s'intéresse
aux propriétés de la lumière.
Après les 100 jours, il est affecté
à Rennes en 1815 et chargé de la
direction d"`ateliers de charité"
luttant contre la disette. Comme
ce n'est pas sa vocation, il rejoint
Paris peu après.
Augustin, dont la santé est toujours
précaire, mène en l'espace
de 11 ans, de 1816 à 1827, une
double carrière de scientifique et
d'ingénieur, et même de constructeur,
comme nous le verrons plus
loin.
UNE CARRIÈRE
SCIENTIFIQUE
Ses premiers mémoires sur les
franges de diffraction, qu'il étudie
expérimentalement et qu'il explique
en proposant une théorie
ondulatoire de la lumière, attirent
sur lui l'attention d'André-Marie
Ampère et de François Arago, qui
l'encouragent.
En 1818, Augustin dépose à
l'Académie des sciences un mémoire
sur les vibrations des ondes
lumineuses, avec une représentation
mathématique (appelé par la
suite "intégrale de Fresnel") de la
distribution de la luminance dans
le champ d'interférence de
l'ombre des corps étroits. L'académie
n'est convaincue qu'après
avoir vérifié expérimentalement
un résultat déduit des intégrales,
selon lequel dans des cas précis le
centre de l'ombre d'un petit écran
circulaire opaque est aussi éclairé
que si l'écran n'existait pas !
Par ailleurs, Augustin poursuit
des travaux sur la polarisation et
sur l'optique cristalline, pour
aboutir aux célèbres "formules de
Fresnel" sur la réflexion et la réfraction
polarisées par les milieux
isotropes transparents. Puis, dans
d'autres mémoires de 1821 et
1822, il met au point la théorie de
la double réfraction dans les cristaux
uniaxes et biaxes. Il donne la
représentation mathématique des
propriétés du milieu élastique
cristallin, et décrit ce qui deviendra
plus tard les propriétés d'électricité
de ce milieu.
Pierre-Simon de Laplace, au
départ imperméable aux théories
de Fresnel, lui rend ensuite publiquement
hommage, de sorte
qu'Augustin est élu à l'unanimité,
le 11 mai 1823, membre de l'Académie
des sciences.
Cent ans après, en 1925, Louis
de Broglie, descendant de
l'illustre famille du château restauré
par le père d'Augustin, met
au point, la mécanique quantique,
qui associe la théorie des ondes
de Fresnel sur la propagation de
la lumière, à celle des corpuscules,
les photons. Clin d'oeil de
l'histoire !
LE CRÉATEUR DU
PHARE MODERNE
Mis en 1819, sur proposition de
François Arago, à la disposition
de la Commission des phares, Augustin
est chargé d'étudier l'amélioration
de l'éclairage maritime.
Jusqu'au milieu du 18' siècle,
celui-ci s'effectue encore... par
des feux de bois et charbon au
sommet de tours ! Fin 18', on installe
des lampes "Argand" à huile
et mèche plate, plus des réflecteurs
paraboliques... Mais ces
lampes ont une faible intensité et
les réflecteurs absorbent une
bonne partie de l'énergie lumineuse.
Très vite, en 1820, Augustin
améliore la source lumineuse avec
courants d'air et mèches cylindriques
multiples ; et surtout, il
préconise de remplacer les réflecteurs
par des lentilles dioptriques
à échelons. Dans ce système, tous
les rayons lumineux provenant de
la source placée au foyer sortent
parallèles et l'épaisseur relativement
réduite du verre, malgré le
grand diamètre, n'entraîne qu'une
faible absorption de l'énergie.
LE PHARE DE CORDOUAN
Le premier phare équipé est
celui de Cordouan, à l'estuaire de
la Gironde, en 1823. Des prodiges
d'ingéniosité sont nécessaires
pour fabriquer les lentilles, car
l'industrie de l'époque n'en est
A
Premier appareil lenticulaire
pour feu à éclats installé à
Cordouan (Gironde), en 1823.
pas capable. Les verres sans défaut
de coulée, stries ou sulfures,
sont rares. Fresnel conçoit de nouvelles
machines à polir pour obtenir
des surfaces toriques et des
moules en fonte pour le coulage.
Dans les parties hautes et basses
des lentilles à échelons, il récupère
dans les optiques, créées à
partir de 1825, le flux lumineux
de la source par des anneaux catadioptriques,
dont il réalise l'exécution
dans un atelier en régie,
aucun industriel ne voulant s'en
charger.
Les huit lentilles à échelons de
Cordouan, complétées par un système
de lentilles et miroirs pour
les rayons hauts et bas, forment
un tambour tournant autour d'un
axe vertical, et donnent des éclats
visibles à 60 km (contre 15 km
avec les réflecteurs précédents).
Fresnel invente aussi un système
de volant-pendule, pour obtenir
un mouvement tournant régulier
de l'ensemble, et préconise déjà
de faire tourner les appareils sur
des flotteurs à bain de mercure.
LA CONSTRUCTION
DES PHARES
Ce succès unanimement reconnu
fait de Fresnel en 1824 le
Cri ÉCHOS DE L'OUEST
De gauche à droite,
Jean-Pierre Morvan,
président de la Fédération
bretonne du Crédit
agricole, Paul Tréhen,
président du CCSTI,
Michel Cabaret, directeur
du CCSTI et Michel Müller,
délégué général de la
Fédération bretonne du
Crédit agricole.
Convention Crédit agricole-CCSTI
Rennes : déjà, en 1989, la Caisse régionale du Crédit agricole avait manifesté son intérêt
pour le CCSTI, en étant partenaire de l'exposition Expomatique. "Depuis plus d'un siècle,
nous sommes partenaires du développement économique de la Bretagne, et voulons aider
nos clients à se tenir au courant des nouvelles technologies. Nous voulons les inciter à se
former, à s'informer, grâce aux produits du CCSTI", explique Jean-Pierre Morvan, président
de la Fédération bretonne du Crédit agricole. L'itinérance de l'exposition "Le lait, la
vie", cadre de la signature le 3 juillet dernier, est la première réalisation concrète de cette
convention, qui prévoit aussi la souscription d'abonnements à Réseau.
Mais pour Paul Tréhen, président du CCSTI, l'engagement du Crédit agricole concerne, en
priorité, l'information des populations : "De plus en plus, la culture scientifique va faire
partie de notre vie quotidienne, les délais entre un résultat de recherche et ses applications
se réduisant de jour en jour... Nous avons besoin du "pouvoir de diffusion" de partenaires
tels que le Crédit agricole, pour multiplier l'impact de nos actions de culture scientifique
auprès du plus grand nombre".
S'appuyant sur son réseau de 4000 salariés répartis dans 600 agences, le Crédit agricole diffusera
auprès de ses clients, notamment en milieu rural, les informations leur permettant de
bénéficier des services du CCSTI : location d'un planétarium itinérant, ou d'une exposition,
parmi les 38 présentées ce jour-là dans un tout nouveau catalogue, disponible sur simple demande
au CCSTI.
Rens. : CCSTI, tél. 99 35 28 20; Michel Müller, délégué général de la Fédération bretonne du Crédit agricole,
tél. 99 30 47 48.
DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
Culture scientifique et autoroutes
de l'information
Rennes : le projet Prisme est l'un des 10
projets bretons retenus par le ministère de
l'Industrie, des Postes et télécommunications
et du Commerce extérieur, lors de
l'appel d'offres sur les autoroutes de l'information,
au début de l'année 1995.
Prisme signifie "Plate-forme régionale pour
l'intégration de services multimédia d'entreprises".
Y participent plusieurs entreprises
et organismes professionnels du secteur des
télécommunications de la région Bretagne :
Semagroup Telecom (pilote de l'opération),
OST (entreprise produisant la panoplie complète
des outils de réseaux à haut débit),
Open Log (conseil et réalisation de scénarios),
Ystel (centre serveur) et le CCETT
(expertise technique et ergonomique). L'objectif
est d'encourager les entreprises et organismes
à se lancer dans l'utilisation des
autoroutes de l'information, en leur offrant
la possibilité de tester en vraie grandeur
leurs applications et services.
Rens. : André Renault, Semagroup Telecom,
tél. 99 38 17 38.
L'application Nectar
Rennes : proposé par le CCSTI, le projet
Nectar sera la première application de la
plate-forme Prisme, permettant de valider
l'adéquation entre les solutions techniques,
mises en place par les partenaires de
Prisme, et le contenu des autoroutes de l'information
: ici l'information scientifique et
technique à caractère régional, telle que
celle diffusée actuellement par le CCSTI et
sa publication Réseau, dans un premier
temps.
L'objectif est ensuite de proposer cet outil
aux opérateurs de l'information scientifique
nationale et internationale, afin de diffuser
toutes sortes de produits de culture scientifique
(vidéos, CD-Rom...), mis au point notamment
par les autres centres de culture
scientifiques (La Villette à Paris, Océanopolis
à Brest...). Nectar signifie "Technique
d'accès à la recherche du Nouvel équipement
culturel (NEC)" : c'est un aspect important
du développement du CCSTI dans
le cadre du NEC.
Rens. : Hélène Tattevin, a-STI, tél. 99 35 28 22,
e-mail: ccsti@univ-rennesl.fr
i191
directeur du Service des phares. Il
élabore aussitôt un plan d'équipement
des côtes françaises, permettant
de naviguer la nuit, comportant
85 phares -et feux de 4
catégories différentes. Il n'en voit
malheureusement pas la réalisation,
car il meurt, à 39 ans seulement,
d'une grave maladie. On a
peine à imaginer ce que ce génie
aurait pu produire s'il avait vécu
plus longtemps.
La Bretagne est dotée de phares
au cours du 19' siècle (ce sera
l'objet d'un prochain article). Les
optiques de Fresnel, peu modifiées
depuis l'origine, continuent
à équiper nos phares. C'est surtout
l'intensité des sources lumineuses,
grâce à l'électricité, qui a
permis d'accroître les portées et
de diminuer les distances focales,
donc l'encombrement des appareils.
Les optiques de Fresnel ont
donné à la France, à l'époque,
une avance technologique considérable
dans ce domaine. C'est
ainsi que l'industrie française est
à peu près la seule, au cours du
19' siècle, à équiper les phares de
presque tous les pays de la planète
: en 1914, 7 000 appareils
lenticulaires auraient été livrés
par notre industrie, dont moins de
10% en France. n
Christian Delaunay
A
Ce dessin montre une optique
tournante sur un chariot à galets.
LES BRÈVES RE6EAY 114
Une borne interactive pour le CM0
Brest (29) : depuis début juillet, le Centre militaire
d'océanographie (CMO) de Brest, dépendant
de l'EPSHOM (Etablissement principal
du service hydrologique et
océanographique de la Marine), est l'hôte
d'une borne interactive multimédia. Conçue
par la société Atlantide grenat logiciel
(AGL), elle est destinée à l'information des
visiteurs du CMO en matière d'océanographie,
notamment sur la propagation des sons
dans l'eau, la cartographie climatologique ou
encore les images satellitaires. Le visiteur
peut également visualiser des séquences vidéos
compressées, illustrant l'acquisition de
résultats scientifiques, ou encore voir des
images de campagnes d'essais à la mer et encore
plus spectaculaire, des données topographiques
marines, provenant du satellite
Topez-Poséidon.
La borne répond aussi au souci très pratique
de localiser et joindre son interlocuteur au
CMO, puisqu'elle permet de consulter un annuaire
interne au service, ainsi qu'un plan
des bureaux. Pour AGL, une réalisation de ce
type constitue une issue assez naturelle, des
partenariats avec différents organismes
comme le Centre commun d'études de télécommunications
et télédiffusion (CCETT,
Rennes) ou encore l'European telecommunications
standard institute (ESTI, Sophia-Antipolis).
Rens.: (MO, tél. 98 2213 04.
Produit ~~
en Bretagne `TAG
Brest : présidée par Jean-Claude Simon
(groupe Even), l'association "Produit en Bretagne"
dispose d'un budget de 5 millions de
francs pour remplir sa mission de promotion
et de commercialisation des produits agro-alimentaires
bretons. Elle associe une quarantaine
d'industriels de l'agro-alimentaire (dont
Even, la Sill, Petit Navire, Doux, Savéol...) et
plusieurs groupes de la grande distribution,
couvrant ainsi plus de 700 points de vente. En
Bretagne, le secteur agro-alimentaire
concerne près de 47 000 emplois : 25 000
dans la production et la transformation,
22000 dans la distribution.
Rens. : Anne Le Nénanff, tél. 98 47 94 88.
Le Dextroyer
Combourtillé (35) : spécialisée dans la nutrition
animale, la société Prodex Valorex vient
de lancer sur le marché un procédé pour réduire
le taux de matière grasse dans le lait,
tout en maintenant le taux protéique. Mis
au point et breveté avec l'aide de l'ANVAR,
ce nouveau produit permet à l'exploitation
d'augmenter son bénéfice de 7 centimes par
litre de lait produit.
Rens.: Prodex Valorex, tél 99 83 74 36.
•
Le procédé Dextroyer permet de
diminuer le taux de matière grasse
tout en maintenant le taux protéique.
4 De gauche à droite,
Alain Nouailhat, délégué
régional du CNRS, André
Lespagnol, président de
l'université de Rennes 2
Haute Bretagne, Liliane
Kerjean, vice-présidente
du conseil scientifique
de l'UR2, Roger Dupuy
et Jean-Pierre Marchand,
directeurs d'Unités de
recherche associées au
CNRS.
Convention Rennes 2-CNRS
Rennes : le président de l'université de
Rennes 2 Haute Bretagne, André Lespagnol,
Liliane Kerjean, vice-présidente du conseil
scientifique, Roger Dupuy et Jean-Pierre
Marchand, directeurs d'URA (Unités de recherche
associées au CNRS), sont venus à la
délégation régionale Bretagne-Pays de la
Loire, le 4 juillet dernier, pour signer la première
convention unissant l'université rennaise
et le CNRS. Pour Main Nouailhat, délégué
régional, cette convention, fruit d'un
long travail de réflexion, marque dans un
premier temps une volonté de s'informer
mutuellement, afin de coordonner au mieux
les actions de recherche menées dans les
trois URA, nommées respectivement Costel
(URA 1687, Climat et occupation du sol par
télédétection), équipe dirigée par Jean-Pierre
Marchand, Irhiso (URA 1022, Institut de
recherche historique sur les sociétés de la
France de l'Ouest), sous la direction de
Roger Dupuy et le Centre de géographie sociale
(URA 915, dirigée par Georges Macé).
Pour André Lespagnol, président de Rennes
2, ce rapprochement avec le CNRS montre,
de la part des équipes de recherche, une volonté
d'évaluer les projets scientifiques avec
toujours plus de rigueur. "Cette convention,
inspirée de celle unissant le CNRS et nos
collègues de Rennes 1, prend en compte les
spécificités de notre enseignement supérieur
et de nos recherches, en sciences humaines
et sociales..." Le président a aussi
évoqué la construction prochaine, sur le
campus de Villejean, d'un bâtiment dédié à
la recherche et rassemblant les trois unités
associées au CNRS.
Rens. : Brigitte Delahaie, CNRS, tél. 99 28 68 68;
Thérèse 011ivier, UR2, tél. 99 33 52 07.
Hélios sur orbite
Bruz (35) : pour le Centre électronique de
l'armement (CELAR), le lancement d'Hélios,
le 7 juillet dernier, est un événement
majeur. Ce satellite d'observation militaire
peut atteindre une résolution au sol de
l'ordre du mètre, soit 10 fois mieux que les
satellites SPOT. Une dizaine d'ingénieurs du
CELAR ont travaillé à l'installation des
centres d'exploitation des données d'Hélios,
à Paris, Toulouse, Madrid, Rome et Colmar...
Rens. : Jean-Luc Seignardie, lél. 99 42 9011.
LES BRÈVES RESEAU 114
DU CÔTE DES ENTREPRISES
DU CÔTE DES LABORATOIRES
Guide des laboratoires CNRS
NON
Le Guide des
laboratoires CNRS
Destiné aux entreprises, aux services
et aux innovateurs, il leur
permettra de mieux connaître les
recherches effectuées dans les laboratoires
du CNRS. Cette première
édition, qui ne présente encore que
la moitié des 1 300 laboratoires
CNRS, sera très prochainement
complétée, mais elle comprend
déjà la majorité des équipes présentes
en Bretagne-Pays de la
Loire. Chaque fiche détaille les objectifs
du laboratoire, son savoirfaire
et ses équipements.
Rens. : René Quris, tél. 99 28 6812.
A L'ESPACE DES SCIENCES
Jusqu'au 30 décembre/
Tous parents, tous différents
Rennes : les connaissances sur nos origines
ont beaucoup progressé cette dernière décennie
en biologie moléculaire, génétique...
Mais certaines avancées mettent en cause
nos principes moraux et éthiques. Où en
sont les grands travaux scientifiques ?
Quelles sont leurs implications sur notre société
? Comment quelques milliards d'êtres
humains sont-ils parents et pourtant tous
différents ? Pour se distraire, une maquette
électronique, la "Loterie de l'hérédité", permet
au public de "fabriquer" la physionomie
d'un enfant en choisissant ses parents.
Rens. : Espace des Sciences, tél. 99 35 28 28.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 18h30, le samedi de 10h à 18h30. Entrée : 10 F, tarif réduit : 5 F, gratuit
pour les moins de 12 ans. Groupes le matin sur réservation uniquement.
EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Femmes de pêcheurs
Lorient : emblèmes de la sociologie maritime, les femmes de pêcheurs ont toujours eu une image
très forte dans la société française. Aujourd'hui comme hier, elles remplissent de nombreuses
fonctions techniques et organisent, à terre, la défense du métier de leurs époux. Créée par le
CCSTI de Lorient, cette exposition de 50 m2 est disponible au prix de 3 200 F par mois. Elle
s'adresse aussi bien au grand public et au monde de l'éducation, qu'aux professionnels de la mer.
Rens. : Dominique Petit, tél. 97 84 87 37.
RESEAY 114 LES BRÈVES
, EXPOSITIONS
PUBLICITÉ
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
La Chimie aujourd'hui
Toutes les activités humaines (santé, alimentation,
habillement, éducation, transport,
chauffage, éclairage, loisirs) dépendent largement
de la chimie moderne.
Celle-ci est à l'origine de la conception, du
développement et de la production :
de médicaments toujours plus actifs et
sélectifs ;
de nouveaux matériaux organiques ou
minéraux ;
de nouvelles spécialités biocompatibles ;
de nouveaux combustibles ;
de procédés toujours plus efficaces de
traitement des pollutions ;
de nouvelles méthodes d'analyse et de
dosage plus performantes pour l'amélioration
de la qualité.
La chimie sera l'un des
principaux domaines
scientifiques et techniques
du 21e siècle.
Admissions n
Après le bac ;
Classes Prépa. Intégrées (2 ans).
Maths Spé. ;
concours communs polytechniques.
I Concours DEUG Sciences.
I Admission sur titre : BTS, IUT.
I Admission en 2° année sur titres :
(maîtrise, MST).
Préparation DEA et Thèse.
L'ENSCR, ses points forts :
0 une solide formation en chimie et en
sciences de l'ingénieur ;
I un enseignement optionnel dès la fin de la
2° année ;
I une formation humaine de qualité ;
I le partenariat avec les entreprises ;
I une ouverture internationale ;
M des options professionnalisantes en 3° année :
Chimie Fine et Biotechnologies
Méthodologie d'analyse
Génie des Procédés
Sciences de Gestion
DEA de Chimie Industrielle.
FORMATION PAR LA RECHERCHE
s'appuyant sur trois départements :
Chimie Organique - associé au CNRS
Synthèse et Activations de Biomolécules
Environnement et Valorisation
Chimie Analytique et Théorique
et deux structures associées :
Institut Technique des Gaz et de l'Air
Institut de Recherche sur les Lipides
ENSCR - Avenue du Général Leclerc - Campus de Beaulieu - 35700 RENNES
Tél. : 99 87 13 00 n Fax : 99 87 13 99
1211
Z° 15". C
Les 6, 7 et r8 Octobre 1995
Du 6 au 8 octobre/
Science en fête
En Bretagne, "La Science en fête" fait désormais
partie des grands événements culturels
de la région, avec une centaine de projets
déposés chaque année par les
organismes de recherche, les universités, associations,
établissements d'enseignement,
centres de culture scientifique, musées et
une- fréquentation d'environ 50000 visiteurs.
Chercheurs, ingénieurs, techniciens, enseignants,
animateurs, responsables culturels,
vont pouvoir rendre accessible au plus grand
nombre leurs dernières découvertes. C'est là
l'enjeu de la Science en fête : aller à la rencontre
du public et nouer avec lui le dialogue,
dans un environnement festif, pour
qu'une nouvelle fois, s'établisse cette extraordinaire
complicité entre le public et les
scientifiques.
Rens.: CCSTI, coordination régionale,
tel 99352820.
Pour recevoir RÉSEAU,
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement pour 1 an (11 numéros)
Tarif : 200 F
Abonnement de soutien : 300 F
Abonnement étudiants : 100 F
Nom
Prénom
Organisme/Société
Adresse
tr)F 1
I ,f
Code-m91 ~
~1~ ~
ooN
F991u Fi
e
Bvlléiin ~ abonnemE ent et chèque à retourner à: CCSTI, I
6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. 99 35 28 20.
Nom
Prénom
Onanisme
Adresse
F1'aERCyC EI .L=
MILES BRÈVES RESEAU 114
COLLOQUES
22
Du 10 au 15 septembre/
Migration 95
Saint-Malo : l'Institut physique nucléaire a
choisi le Palais du grand large pour tenir sa
conférence internationale "Migration 95". Cette
manifestation scientifique se tient alternativement
en Europe et aux Etats-Unis tous les 2 ans.
Elle permet aux spécialistes de plusieurs disciplines
: chimie, géochimie, géologie, hydrogéologie,
de confronter leurs idées et les résultats de
leurs expériences.
Rem.: Frédérique Dykstra, tél. 16 (1) 69 41 73 18.
19-20 septembre/
Cryogénie et supraconductivité
Rennes : le campus de Villejean organise, le 19
septembre, une journée scientifique consacrée
aux "Applications médicales de la cryogénie et
de la supraconductivité", dans le cadre des clubs
CRIN (Clubs de recherche CNRS et industrie).
Le programme de la journée scientifique portera
principalement sur cinq thèmes : la cryothérapie,
la cryopréservation, la biomagnétométrie, l'imagerie
médicale et la spectroscopie par résonance
magnétique nucléaire.
Rens. : Roger Chevrel, tél. 99 28 62 51.
Du 20 au 22 septembre/
Brasage 95
Brest : les filières électroniques d'interconnexion
ont rendez-vous au Quartz pour un
colloque international sur les technologies de
brasage : les progrès technologiques des composants,
les cartes de circuits imprimés "Fine
line", les critères de qualité et d'environnement,
font l'objet de nombreux échanges à tous les niveaux
de l'interconnexion.
Rens.: Armelle Boichot, tél. 98 4414 40, poste 300.
Du 20 au 23 septembre/Itech'Mer
Lorient (56) : les produits de la mer sont au
cour des préoccupations de l'institut technique
ID Mer, qui organise ce salon des matériels,
équipements et procédés pour la capture, la
transformation et la valorisation des produits de
la mer, au parc des expositions de Lanester.
Rens.: Marie Louarn, tél. 97 87 0013.
' CONFÉRENCE
LES MERCREDIS DE LA MER
4 octobre/
Les campagnes océanographiques
Rennes : Alain Cressard est coordinateur
scientifique des campagnes océanographiques
de l'IFREMER. Il explique comment
l'étude des océans et la compréhension
des phénomènes observés peul ent
nous permettre de trouver des explications
et de tenter de faire des prévisions
sur les évolutions futures de notre planète.
Il décrit les différents métiers de l'océanographie,
les filières et les perspectives pour
les années futures.
A 201130 à la Maison du Champ de Mars.
Rens. : CCSTI, tel 99 35 28 20.
21-22 septembre/Journées ENSP
Rennes : l'Ecole nationale de la santé publique
fête cette année son 50' anniversaire. Si son installation
à Rennes date de 1962, sa création à
Paris en tant que service interne du ministère de
la Santé remonte à 1945. Pour fêter cet anniversaire,
elle organise un colloque sur les mutations
du système de santé et présente une exposition
d'affiches sur le thème de l'éducation pour la
santé.
Rens.: lean-Francois Lemoine, tel 99 02 27 91.
Du 21 au 23 septembre/
Bretagne mieux vivre
Rennes : l'exposition précédente des aides à la
vie pour les personnes handicapées ou âgées,
avait connu un franc succès, en comptant 3000
visiteurs. Cette année encore, le 5' salon "Bretagne
mieux vivre" est un carrefour d'échanges
et de réflexion entre les usagers, les professionnels
médico-sociaux et les industriels.
Rens.: Jacky Adatte, tél. 99 5132 98.
28-29 septembre/
Instrumentation océanographique
Brest : sur le thème de l'instrumentation océanographique,
ces sixièmes journées sont le point
de rencontre des grands organismes de recherche,
des laboratoires universitaires, des
centres de recherche, ainsi bien sûr que des industriels
concernés. Au menu, présentation de
matériels, information sur l'évolution du domaine,
mais aussi toutes les prises de contact
professionnelles. Les participants peuvent ainsi
effectuer un tour d'horizon hexagonal des avancées
technologiques dans l'instrumentation
océanographique.
Rens. : Jacques Legrand, téL 98 22 40 87.
Du 28 au 30 septembre/
Les 20 ans du SPI
Rennes : à l'occasion de son 20' anniversaire, le
département des Sciences pour l'ingénieur (SPI)
du CNRS organise un colloque au Triangle,
principalement axé sur les compétences bretonnes
en microélectronique (antennes, radars...)
et le transfert de technologies. Le 28 septembre
est consacré aux moyens modernes de détection
(avec le concours de la Région Bretagne), le 29
septembre présente le monde industriel de la
microélectronique (avec le concours du District
de Rennes) et le 30 septembre est réservé aux
moyens modernes de communication (avec le
concours du département d'Ille et Vilaine).
Rens. : Louis Bette),, URA CNRS 834, tél. 99 28 62 25.
29-30 septembre/
Habitat, environnement, santé
Vannes : l'influence des bâtiments, à la fois sur
l'environnement et sur les conditions de santé
des populations, est en passe de devenir un élément
majeur de tout projet architectural au niveau
de la CEE. Ce colloque, organisé par l'Institut
de recherche sur l'environnement et la santé
(IRES), prépare à l'art de bâtir au XXI' siècle.
Rens. : Pierre Crépon, tél. 97 40 4185.
QUI A DIT ?
Réponse de la page 5: Blaise Pascal,
Pensées sur l'Esprit, XXXVII.
Faites découvrir RÉSEAU
à vos amis
Donnez-nous les coordonnées
de votre ami, il recevra gracieusement
le prochain numéro de Réseau
Améliorer votre compétitivité ?
Présence Bretagne, un contact pour gagner.
Cette page est réalisée sous la responsabilité
de Présence Bretagne,
18, place de la Gare, 35000 Rennes,
tél. 99 67 42 05, fax 99 67 60 22. _
LA VIE DES ENTREPRISES RESEAU 114
1 Les messages d'un camion
Mobil'Affiche en stationnement
sur le port de Brest :
il faudrait fermer les yeux
pour ne pas les voir !
Mobil'Affiche : publicité à la carte
Au départ, une idée simple et originale pour dynamiser
l'impact des affiches publicitaires, qu'elles soient sur un
support fixe ou sur un véhicule... Et vogue Mobil'Affiche,
une très jeune entreprise brestoise qui distribue déjà ses
produits dans toute la France et à l'étranger.
Elle nous aguiche, elle nous
agresse, elle nous amuse, elle
est partout. La publicité est le baromètre
de nos modes de vie. Du
trio des frères Ripolin aux images
provocatrices de Benetton, l'affiche,
premier des supports publicitaires,
dessine l'évolution de
notre environnement de tous les
jours. Mais en publicité, pas de
répit. Pour suivre l'air du temps,
il est indispensable d'innover.
Lorsque les modes d'affichage
traditionnels s'essoufflent et les
budgets publicitaires se réduisent,
il faut toujours surprendre, intriguer,
trouver l'idée originale, inventer
de nouveaux supports.
SIX EN UN
C'est pour mettre au point
et commercialiser un nouveau
concept d'affichage à déroulement,
que Rémy Kérouanton,
un chef d'entreprise alors âgé de
32 ans, formé à l'école de la pub,
a créé en juillet 1993 la société
Mobil'Affiche. Le principe de
son invention est simple, mais
tout à fait innovant. En effet,
Mobil'Affiche a mis au point un
panneau publicitaire, ressemblant
à un écran de télévision géant, qui
permet le défilement de six affiches
indépendantes de format
3,20 m x 2,40 m. Ces dernières, à
l'abri des intempéries et des dégradations
derrière une vitre, peuvent
être sélectionnées individuellement
dans leur diffusion, en
temps d'exposition et en temps de
passage. Le panneau à déroulement
sélectif est en effet équipé
de six rouleaux d'affiches et de
six moteurs indépendants. Les six
rouleaux sont eux-mêmes fixés
sur un bloc qui descend, afm d'effectuer
un changement rapide
d'affiche. La programmation
informatique des passages est
réalisée à l'aide d'une console.
L'accès aux affiches s'effectue
par l'avant du panneau en relevant
la porte vitrée. Souplesse
d'utilisation, affichage à la carte,
ce système offre des possibilités
multiples dans ses fonctions
(campagne progressive, superpositions
à la manière d'un dessin
animé...) et dans ses supports.
LA PUB ROULE POUR
LES ANNONCEURS
L'invention de la société brestoise,
qui a bénéficié de l'aide de
1'ANVAR, a fait l'objet d'un brevet
INPI en juillet 1994. Elle est
aujourd'hui en cours de dépôt
mondial. La société rennaise
GETI France a assuré la maîtrise
d'oeuvre du produit ; un ingénieur-
consultant, qui travaille notamment
pour l'aérospatiale, a
mis au point le programme informatique,
tandis que la réalisation
des composants du panneau est
assurée par des sous-traitants régionaux
(Polyroise à Landerneau,
Labbé à Lamballe, Barberet à
Rennes...). Mobil'Affiche commercialise
les panneaux seuls, qui
peuvent être placés sur tous supports,
à l'extérieur comme à l'intérieur
(commerces, salles de
spectacle, mobilier urbain...),
mais aussi des camions afficheurs
de marque IVECO, spécialement
carrossés. Ceux-ci sont munis de
trois panneaux (un sur chaque
côté du véhicule et le dernier à
l'arrière). "Ce concept," fait remarquer
Rémy Kérouanton, "permet
à la publicité d'aller à la
rencontre du public et évite à
l'affiche de s'installer peu à peu
dans le paysage quotidien, ce qui
en affaiblit l'impact. Chaque annonceur
peut ainsi s'offrir une
campagne sur toute une ville à
faible coût".
UNE RÉUSSITE IMMÉDIATE
Le succès n'a pas tardé : "Nous
avons été présents sur de grands
salons spécialisés et nous avons
eu plus de 1000 demandes de
concessionnaires potentiels en
15 mois !". Simultanément, la société
a augmenté son effectif, qui
comprend aujourd'hui 15 personnes,
pour un chiffre d'affaires
de 8,5 millions de francs (chiffre
1994). Le réseau de concessionnaires
se développe jour après
jour à travers la France, où 30
villes sont déjà couvertes. "Notre
premier objectif est de nous
étendre sur l'ensemble du territoire
national pour des campagnes
régionales et nationales",
indique le chef d'entreprise. Mais
d'ores et déjà, les Brestois ont fait
mouche à l'étranger et sont présents
au Portugal, en Espagne, au
Canada et aux USA.
Plus près de nous, le concept a
servi de support pour la campagne
de la compagnie d'assurances
l'Abeille dans tout l'Ouest
et les vacanciers ont pu être surpris
cet été par les camions jaunes
Mobil'Affiche, sillonnant les
côtes de la Manche pour la campagne
publicitaire de la compagnie
maritime Brittany Ferries. La
société brestoise surfe sur le succès.
Elle prévoit, pour 1995, le
doublement de son chiffre d'affaires
et une extension de ses activités
sur les marchés étrangers. n
23
COU
•
évaporation, nuage, pluie ruissellement, captag
e'
production d'eau po
table, distribution,
co ,
llution
salissure
nettoyage pollution, collecte,
nsommation
, dépo
Le vière, mer, nuage••• cycle de l'eau estlong
et les techniques pour
le préserver sont de
plus en plus compliquées.
pourlivrer à toute heure une eau potable
au domicile et au travail de
chacun, pour la nettoyer
après usage, pour la dépolluer, pour protéger
les réserves d'eau, le personnel
de la Compagnie
Générale des Eaux veille
nuit et jour sur le produit
alimentaire le plus
contrôlé de France.
pour répondre à la croissance
simultanée de la
demande en
eau potable et de la pollution,
As effectuent en quelques
heures le cycle deVean
que la nature met des années à réaliser
et à la fin
coule une rivière.
COMPA
ERALS
GN IE
GEN
DES EAUX
Compagnie Générale des Eaux
11, rue Kléber
35020 RENNES Cedex
Tel: 99. 87. 14. 14
e
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest