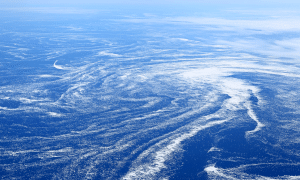Les essais à la mer en Bretagne
DÉCEMBRE 1995 • N• 117•20F BRETAGNE
LE GEDO,
LABORATOIRE
DE L'OUVERTURE
LA FERTILITÉ
MASCULINE
EN QUESTION
BRETAGNE
EAU PURE 2
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE
SOMMAIRE
La vie des labos
Les ressources en eau
de la Bretagne
Les secrets de l'ouverture
La fertilité masculine
est-elle menacée ?
Les sigles du mois o
LE DOSSIER
Les essais à la mer
en Bretagne o/®
Programme européen
Prévention des
accidents pour les
petits bateaux de pêche •
Histoire et Société
Les canaux bretons 0/0
Les Brèves
de Réseau 0/®
A
Mise à l'eau d'une sonde
de bioluminescence sur
un bâtiment d'instruction
de l'École navale.
RÉSEAU est édité par le Centre de culture scientifique
technique et industrielle (CCSTI).
Tirage mensuel : 3 900 ex. Dépôt légal n°650. ISSN 0769-6264.
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 Rennes.
Tél. 99 35 28 22. Fax 99 35 28 21. e-mail ccsti@univ-rennesl .fr
Antenne Finistère : CCSTI, 40, rue Jim Sévellec, 29608 Brest Cedex.
Tél. 98 05 60 91. Fax 98 0515 02.
ÉDITORIAL
Pour un réseau de culture
scientifique en Bretagne
La culture scientifique et technique n' est pas une préoccupation récente dans
notre région. Déjà au XVIII e siècle, le marquis de Robien, président du
Parlement de Bretagne, met en place à Rennes, un cabinet de curiosités
scientifiques. Il est composé de pièces de collection dans les domaines suivants :
géologie, zoologie. D'autres grandes familles constituent également des
collections : Oberthur, de Monthuchon, des Abbayes...
Des établissements de recherche et d'enseignement développent des activités de
diffusion du savoir scientifique : la Station biologique de Roscoff avec un
aquarium, le Muséum d'histoire naturelle de Dinard...
Plus récemment, les ouvertures d'Océanopolis, du Musée des Télécoms, du
Planétarium, de la Maison de la mer ou de l'Espace des Sciences, illustrent une
offre de qualité qui ne fait que répondre à une demande grandissante de la part
du public. Le projet du CCSTI se situe dans la volonté de créer et de diffuser des
activités de culture scientifique. C'est dans ce cadre que je souhaite exposer.
Tout d'abord, il est nécessaire que l'animation scientifique soit fondée sur le rôle
d'un dialogue entre le public et la science. Pour cela, il nous faut définir la
fonction de médiation scientifique qui concerne les pistes suivantes : journaliste
scientifique, commissaire d'exposition, animateur, chargé de la diffusion.
En conservant cet état d'esprit, nous devons en permanence renouveler la forme
et le contenu. Il est nécessaire d'être à l'écoute du public tout autant qu'à celle
des producteurs mêmes de la création et qui sont les chercheurs, les ingénieurs et
les chefs d'entreprises. La force du CCSTI est la qualité des contacts qu'il a avec
les structures de communication scientifiques, techniques et industrielles.
L'association du CCSTI avec la région Bretagne est forte. L'ouverture d'une
antenne du CCSTI à Brest est un élément clé de la diffusion de la culture
scientifique dans le Finistère. Sur ce département, le lectorat de Réseau a été
multiplié par trois en trois ans, plus d'une cinquantaine de sujets finistériens sont
traités dans la revue chaque année et une vingtaine d'expositions y sont
présentées chaque saison. Il ne s'agit pas là d'une annexe en Bretagne
Occidentale du CCSTI, mais plutôt d'un élément d'un réseau délocalisé du centre,
qui ne fonctionnera bien que s'il est suffisamment en échange avec le tissu
scientifique et économique, les établissements d' enseignement du Finistère.
Cette expérience est déjà très riche. J'espère que nous pourrons la prolonger, la
développer et pourquoi pas s'en inspirer pour des actions ultérieures dans
d'autres départements.
Venez au CCSTI, si ce n'est déjà fait, parlez-en, apportez-y vos idées et votre
dynamisme. n
Michel CABARET
Directeur du CCSTI
4 En Bretagne, depuis plus
de 10 ans, Réseau fait
le lien entre les centres de
recherche, les collectivités
et les entreprises.
These abstracts in English are sent to
foreign universities that have links with
Brittany and to the Scientific Advisers in
French Embassies, in an effort to widen
the availability of scientific and technical
information and promote the research carried
out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts
on a regular basis, with a copy of the corresponding
issue of "RESEAU", please
contact Hélène Tattevin, Editor, Fax (33)
99 35 28 21, e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
Brittany Regional Council is providing
financial backing for this service.
REGIO
-
N
BRETAGNE
Brittany is the 7th most-populated
region in France, with 2.8 million
inhabitants, but it is the leading French
region as regards research in the fields of
telecommunications, oceanography,
and agricultural engineering.
ESEAU DECEMBER 1995 • N • 117
DOSSIER
Sea trials in Brittany
19'650. 155N 0769.6164. r.rue.
SEA TRIALS IN BRITTANY
page 9
"Sea trial" is a magical expression which
conjures up pictures of brand-new transatlantic
liners gliding majestically down a
slipway and setting off to slice through the
waves of the ocean in the hope of carrying
off the "Blue Ribbon".
In Brittany today, such trials are used
mainly to check out new equipment destined
for use in a marine environment.
Indeed, the "sea" is often no more than a
saline tank in a laboratory and the sea
trials are actually carried out - on land!
NAVAL COLLEGE -
VAST RESOURCES FOR
HIGHER EDUCATION
ESTABLISHMENTS
page 10
The Naval College is the only establishment
which trains future officers for the
French Navy and it has dropped anchor on
the shores of the roadstead in Brest, in
Lanvéoc to be precise, where cadets are
given threefold training as officers, engineers
and seamen. However, higher education
also involves research and, in order to
carry out some of the projects, the Naval
College provides test facilities in its natural
realm, the sea.
Information: Capitaine de frégate Billard,
fax (33) 98 23 38 57.
THOMSON SINTRA ASM:
UNDERWATER WARFARE
IN BRITTANY
page 11
Thomson Sintra Activités Sous-Marines is
a subsidiary of the Thomson-CSF Group.
The group's head offices are in the Sophia-
Antipolis Science Park near Nice but its
plant in Brest is one of the world's leading
names in the design of military underwater
warfare equipment. This is a sector in
which the obligation to achieve excellence
leads to a need for numerous specifications
trials. This article presents a brief review
of the resources used in the Brest plant to
develop its latest "brainchild", the
variable-depth mine detector.
Information: François Pouliquen, fax (33) 98 3139 75.
A
Handling a variable-depth mine detector
on the deck of the French Navy vessel
Thétis in Douarnenez Bay (département
of Finistère).
IFREMER BREST:
A LEADING NAME
IN SEA TRIALS
pages 12 and 13
Among the many tasks required of the
IFREMER centre in Brest is the specification
of equipment for use in a marine environment.
Data cannot be validated in
oceanography unless the device which has
recorded it is capable of operating in such
an environment and this has led the Brestbased
unit to develop extensive evaluation
and test resources e.g. hyperbaric chambers,
artificial underwater trench, etc.
Information: Yvon Le Guen, fax (33) 98 22 41 35.
GESMA :
TEST FACILITIES FOR
UNDERWATER WARFARE
page 14
The Groupe d'Etudes Sous-Marines de
l'Atlantique (GESMA, Atlantic underwater
research group) has premises on
both sides of the roadstead in Brest and is
a technical centre run by the armed forces
(Délégation générale de l'armement,
DGA). It specialises in mine warfare,
underwater combat at shallow depths, and
underwater acoustic or electromagnetic
silence. GESMA anticipates future threats
and designs the most effective systems to
combat them.
Information: Jean-Pierre Dudoret,
fax (33) 98 22 72 13.
IFREMER LORIENT:
SELECTIVITY IN FISHING
TACKLE
page 15
The research team working in IFREMER's
Fishing Technology laboratory in Lorient
(département of Morbihan) has acquired a
reputation for excellence nationally and
internationally as regards the selectivity
and development of fishing gear. It has
recently developed a selective trawl net to
catch anglerfish.
Informatio4: Marc Meillat, fax (33) 99 83 41 06.
~
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. (33) 99 35 28 22 - Fax (33) 99 35 28 21 - e-mail ccsti@univ-rennesl .fr
Antenne Finistère: CCSTI, 40, rue Jim Sévellec, 29608 BREST Cedex. Tél. (33) 98 05 60 91 - Fax (33) 98 05 15 02
DECEMBER 1995 • N'117 MONTHLY MAGAZINE OF RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY
Abstracts for the international issue
EDITORIAL
A SCIENTIFIC
LEARNING NETWORK
IN BRITTANY?
page 2
Scientific and technical learning is by
no means a recent concern in our
region. In the 19th Century, Marquis
de Robien, President of the High Court
in Brittany, opened a scientific curios
centre in Rennes. More recently, a
number of research and educational
institutions have developed activities
aimed at promoting scientific knowledge.
They include the Biological
Research Station in Roscoff with its
aquarium and the Museum of Natural
History in Dinard. Bearing this need in
mind, the CCSTI maintains constant
contact with researchers, engineers
and business executives so that it can
provide the optimum solution to the
demands of its public.
Information: Michel Cabaret, fax (33) 99 35 28 21.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
WATER RESOURCES
IN BRITTANY
pages 3 and 4
Paul Tréhen chairs the Conseil scientifique
de l'environnement (Scientific
Council for the Environment), a structure
set up within Brittany Regional
Council in 1993 as a result of the
Regional Conference on the Environment.
It has recently launched a project
known as Bretagne Eau Pure 2
(Brittany Pure Water 2), which started
with the reassuring message that Brittany
is not short of water. Its quality,
though, is already inadequate and is
continuing to deteriorate. "Our aim is
to suggest real, sustainable measures
to improve water quality."
Information: Paul Tréhen, fax (33) 99 2814 25.
•
Launch of a bioluminescence probe
from a training ship belonging to the
Naval Academy in Brest.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
THE SECRETS OF RIFTS
page 5
In geological terms, a "rift" is found on
the surface of the Earth or on the ocean
floor. In Brest, the CNRS research
team specialising in the "Genesis and
evolution of oceanic areas" (GEDO)
and led by Jean Goslin keeps a watchful
eye on rifts, i.e. the cracks and openings
in the earth's crust.
Information: Pascal Gente, fax (33) 98 0166 20.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
IS MALE FERTILITY
UNDER THREAT?
page 6
On the Beaulieu campus in the University
of Rennes 1, some of the work
being carried out by INSERM's young
U435 research team led by Bernard
Jégou concerns the evolution of the
reproductive function in men, described
in recent studies as showing "worrying
developments". In certain regions
of the world, the number of sperm per
millilitre of semen (also known as the
sperm count) is said to have dropped
overall by 50 % in 50 years.
Information: Bernard Jégou, fax (33) 99 28 16 13.
EUROPEAN PROGRAMME
THE PREVENTION OF
FISHING ACCIDENTS
page 17
After observations made at sea by
French, British and Irish technicians
and ergonomists, the Institut Maritime
de Prévention (Maritime Accident
Prevention Institute) in Lorient (département
of Morbihan) has developed a
teaching module on the prevention of
accidents for use in naval colleges as
part of the European FORCE programme.
"On vessels under 12 metres
in length, one seaman in 10 is the victim
of an accident every year",
explains Patrick Dorval.
Information: Patrick Dorval, fax (33) 97 2193 25.
HISTORY AND SOCIETY
BRITTANY'S CANALS
pages 18 and 19
Until the middle of the 19th Century,
i.e. before the introduction of railways
and modem roads, waterways were the
only rational means of transporting
heavy goods from one place to another.
After the Renaissance, when
economic development was in its early
stages, work was carried out to make
rivers navigable and construct canals.
In Brittany, the first waterway to be
canalised was the R. Vilaine south of
Rennes, leading to Redon and the
coast.
Information Christian Delaunay, fax (33) 99 78 16 08.
Paul Tréhen préside le Conseil scientifique de l'environnement,
une structure mise en place au Conseil régional de
Bretagne en 1993, par la Conférence régionale pour l'environnement.
II vient récemment de présenter le programme
Bretagne Eau pure 2, en commençant par un message rassurant
: il y a assez d'eau en Bretagne. Mais sa qualité est
d'ores et déjà insuffisante et elle continue à se dégrader.
"Notre objectif est de proposer des mesures concrètes et
durables pour améliorer cette qualité."
La vie des labos
Le barrage de la Chèze à Saint-Thurial (35),
un site d'observation pour le programme
Bretagne Eau pure 2.
Les ressources
en eau
de la Bretagne
“Dar rapport à Bretagne Eau
P pure 1, basé essentiellement
sur la mise en oeuvre de moyens
technologiques, l'action du nouveau
programme est plus large :
elle prévoit un ensemble d'études
et d'observations, et l'utilisation
de solutions naturelles, parmi
lesquelles on peut citer la prise en
compte des zones humides (zones
de bas fond) et de la structure des
paysages. Si le premier programme
avait pour mission de
mesurer les quantités d'eau disponibles,
le second a pour objectif
l'évaluation et l'amélioration
de la qualité de l'eau", explique
Paul Tréhen.
Le bilan du programme Bretagne
Eau pure 1 a montré que la
quantité d'eau disponible en Bretagne
était suffisante pour l'instant,
et même pour les prochaines
années. En effet, notre consommation
en eau potable augmente peu
(environ 5 % par an).
Les paramètres
de la pollution
Notre stock d'eau se renouvelle
d'année en année, mais avec de
plus en plus de nitrates, de phosphates,
de pesticides... Ce sont
principalement des pollutions diffuses,
difficiles à localiser. Leur
diffusion dépend de plusieurs paramètres,
comme par exemple la
géologie et les paysages, propres à
la Bretagne. "Pour comprendre
le rôle de la géologie et des paysages,
nous devons examiner
non seulement la topographie
actuelle, mais aussi les événements
passés, pour voir quelle a
pu être leur incidence sur la qualité
de l'eau." L'approche du programme
Eau pure 2 est, on le voit,
beaucoup plus scientifique que
technologique.
Un exemple en est le problème
des nitrates, sur lequel les chercheurs
se sont focalisés ces dernières
années. "Nous connaissons
bien maintenant leur processus
d'accumulation, ainsi que les
mécanismes naturels de dénitrification.
Ceci est important car
nous allons pouvoir identifier et
protéger les sols actifs dans la
dénitrification." Ces sols se
situent en particulier dans les parties
humides, appelées encore
zones hydrophiles, ou zones de
bas-fond. "Ce sont toutes ces parties
basses, un peu marécageuses,
que l'on avait autrefois tendance
à combler pour gagner de la
surface cultivable. Il faut au
contraire les préserver et veiller à
ne pas leur apporter plus de
nitrates qu'elles ne peuvent en
traiter, sous peine de les détruire."
Mais ces mêmes zones humides
jouent également un autre rôle,
qui peut dans son excès être
néfaste, en libérant des phosphates.
Ainsi, on ne peut envisager
de traiter séparément les questions
posées à propos des nitrates, des
phosphates et d'autres molécules
toxiques, qui s'accumulent dans
divers compartiments des sols, des
sédiments et de l'eau libre.
Structure
du programme
Associant l'État et la Région,
les départements et l'Agence de
l'eau, le programme Eau pure 2
met en relation plus d'une centaine
de chercheurs des universités
de Rennes 1 et de Bretagne occidentale,
du CNRS, de l'INRA/
ENSAR, de l'IFREMER, du
CEMAGREF, de l'École de chimie
(ENSCR) et de l'École de
santé publique (ENSP)11. Il bénéficie
d'un fmancement de 205 millions
de francs (dont 40 millions
consacrés aux travaux dans les
sièges d'exploitations agricoles et
75 millions pour la construction
de stations d'épuration).
Il prévoit une série de travaux
et de recherches sur quelques
bassins versants (voir liste). En
concentrant les efforts sur un petit
nombre de bassins de superficie
réduite, le programme vise une
amélioration sensible de la qualité
de l'eau potable en seulement
quelques années. Ensuite, ces bassins
pilotes serviront de modèles
pour le reste de la région. Les
recherches comportent une mesure
précise des exportations agricoles
et industrielles, avant de passer aux
actions proprement dites, par
exemple la limitation des exportations
de pollutions et l'utilisation
des zones humides pour dénitrifier
les sols. "Sur ces bassins, nous
allons pouvoir mener une série
d'expérimentations in situ, à la
bonne échelle."
Liste des bassins
versants concernés
par le programme
Bretagne Eau pure 2
11 Bassins versants d'application
et de démonstration :
Haut-Gouessant, Noë-Sèche
(22), Kermorvan (29), Chèze,
Canut, drains de Rennes 1
(35), Miny, Frémeur (56).
2/ Bassins versants d'action
renforcée : Goët, Arguenon,
Haut-Blavet (22), Elorn, Steir,
rivière de Pont-L'Abbé, Penzé
(29), Haute-Vilaine, Loisance
et Minette (35), Yvel-Hyvet,
Loch, Scorff (56).
Comment font
les autres ?
Nous ne sommes pas, loin s'en
faut, la seule région à se préoccuper
de la qualité de notre eau. Les
États-Unis voient une solution P.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995 40
DES PRODUITS DE FORMATION A DISTANCE
NEREE : Mesures en mer pour l'océanographie physique
(Vidéo et document d'accompagnement)
L'eau comme objet de droit (Vidéo et document d'accompagnement)
Dynamique de l'eau et télédétection
Gestion multicritère de l'eau - Méthodes et stratégies
MM 11
POLE EUROPEEN
D'ENSEIGNEMENT
A DISTANCE
Renseignements : Michèle DEMOULIN - POLE EAD - CNED - 7, rue du Clos Courte! - 35050 RENNES Cédez 9
Tél : 99.25.13.30 - 99.38.43.89
POUR FAVORISER LA DÉMARCHE D'INNOVATION
OU D'ACCROISSEMENT DU NIVEAU
TECHNOLOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE...
PRESENCE
BRETAGNE
Pour toute PMI, PME de la région Bretagne de moins de 2000 salariés
et ne faisant pas partie d'un grand groupe industriel.
Par tout prestataire public ou privé, au choix de l'entreprise.
Assistance technique
Etude de faisabilité
Calculs
Essais
Modélisation
Etude de marché
Recherche de partenaires
technologiques
Etat de l'art
Recherches d'antériorité
Information scientifique et
technique
Dépôt du premier brevet
Les membres conseillers du réseau vous accompagnent
dans la recherche de compétences technologiques.
Les prestations bénéficient d'un soutien financier
spécifique. Elles sont subventionnées à hauteur de 75 %
de leur montant. L'aide est plafonnée à 35 580 F TTC.
PRÉSENCE BRETAGNE
18, PLACE DE LA GARE
35000 RENNES
TEL. 99 67 42 05 - FAX 99 67 60 22
Membre du Réseau Interrégional de Diffusion Technologique
Adressezvous
à :
Contact ► Pascal Gente
Tél. 98 01 61 79
Quand "ouverture" se
conjugue au mode géologique,
c'est à la surface de la
terre et sous celle des océans
qu'il faut la traquer. À
Brest, l'unité de recherche
CNRS "Genèse et évolution
des domaines océaniques"
(GEDO), dirigée par Jean
Goslin, scrute les ouvertures,
ces interstices dans la
croûte terrestre.
Qu'elle soit sous-marine ou à
terre, l'ouverture résulte de
la dérive des continents. Les 30
chercheurs du laboratoire GEDO
en font la plus importante unité
française étudiant le sujet. Il est
associé à l'École doctorale des
sciences de la mer dirigée par
Thierry Juteau, qui regroupe plusieurs
DEA différents. Douze à
vingt étudiants en DEA de géosciences
marines sont accueillis
chaque année au GEDO, où l'on
compte une trentaine de thésards.
Voyage
au fond du rift
Chargé de recherche CNRS,
Pascal Gente est un chercheur
représentatif de l'activité incessante
du GEDO : au fond des eaux
comme à la surface de la terre, il
étudie les phénomènes d'ouverture
océanique. Au travers de ces
interstices de la croûte terrestre,
continentale ou océanique, c'est
l'activité de la planète que l'on
scrute, parfois jusqu'à de nombreux
millions d'années en
arrière... "Notre organisme suit
quatre grands thèmes scientifiques
: la riftogenèse°1, l'accrétion
océanique"), le volcanisme
intra-plaque et le volcanisme lié
aux zones de convergence",
explique Pascal Gente.
En riftogenèse, toute une équipe
étudie les débuts des ouvertures
océaniques, soit à terre, comme
dans le rift est-africain (Tanganyika,
fossé du Kenya ou Éthiopie),
soit au niveau des marges
océaniques (depuis les rivages jusqu'aux
grandes profondeurs), qui
sont des ouvertures fossilisées,
comme en Méditerranée ou sur la
bordure est de l'Atlantique. "Les
prémices de ces ouvertures sont
signalées par du volcanisme, des
sources hydrothermales et une
sismicité mesurable. Puis la mer
envahit la faille et enfin se forme
une croûte océanique, comme
c'est le cas dans le sud de la mer
Rouge, par exemple," note le
chercheur.
Sur le dos
des dorsales
Deuxième thème, l'accrétion
océanique mobilise à elle seule
une quinzaine de chercheurs qui
étudient comment les nouveaux
apports magmatiques venant du
manteau remplissent les interstices
et forment une nouvelle croûte, au
niveau de ces grandes chaînes de
montagnes sous-marines que l'on
appelle les dorsales. Cette étude
justifie deux types de chantiers, à
terre et en mer. Les chantiers en
mer font appel à toutes les
méthodes possibles (géologie
structurale, géophysique, pétrochimie...)
pour étudier toutes les
signatures venant de l'intérieur de
la terre. Nécessitant de gros
moyens (navires, submersibles
habités, ROV"'), ce sont souvent
des "superproductions" menées en
collaboration avec d'autres laboratoires
français, mais aussi européens,
américains, canadiens, nippons,
voire brésiliens ou chiliens,
en général sur des bateaux gérés
par l'IFREMER.
À bord du Nautile
Le volcanisme intra-plaque,
troisième thème, se localise au
milieu des plaques océaniques,
comme dans le Pacifique (exemple
: Mururoa). Enfin le dernier
thème, le volcanisme des zones de
convergence, est lié aux phénomènes
de subduction des plaques
océaniques : poussés par le mouvement
de la tectonique des
plaques, de grands pans de croûte
océanique s'enfoncent dans les
profondeurs du manteau, comme
dans les Antilles, l'Indonésie ou
les Mariannes.
Comme ses confrères, Pascal
Gente travaille aussi sur des données
satellitaires de type SPOT,
grâce à la collaboration d'ELFAquitaine.
"Ces thèmes font partie
de la recherche fondamentale
sur la connaissance de la Terre.
Mais il y a également un intérêt
économique, quand l'on pense
que les zones chaudes accélèrent
la transformation des matières
organiques en pétrole...", conclut
Pascal Gente. Toujours sur la
brèche, il s'apprête bientôt à
replonger sur la dorsale atlantique
avec le submersible Nautile. Avant
cela, il participera avec la communauté
française spécialisée (200 à
300 personnes), à un colloque à
Brest, les 18 et 19 décembre, pour
faire le point sur la "Genèse et
l'évolution de la lithosphère océanique."
n
M.-E.P.
Le GEDO
30 chercheurs et enseignants
chercheurs, ainsi qu'une dizaine
d'ingénieurs et de techniciens
composent cette URA CNRS
1278, au sein du département des
Sciences de la Terre de la faculté
des sciences et techniques de
l'Université de Bretagne occidentale.
Le GEDO est associé à
plusieurs partenaires : le département
de Géosciences marines de
l'IFREMER (Institut français de
recherche pour l'exploitation
de la mer), celui de Géosciences
de l'ORSTOM (Institut français
de recherche scientifique pour le
développement en coopération),
l'antenne brestoise du BRGM
(Bureau de recherches géologiques
et minières) et depuis
cette année, l'EPSHOM (Établissement
principal du service
hydrographique de la Marine).
L'URA 1278 compose avec
ceux-ci un Groupement de
recherches (GDR), qui permet de
soutenir et d'organiser des missions,
des campagnes, et des
études communes. n
"' Riflogenèse : ouverture des grands fossés d' effondrement.
'" Accrétion océanique : mécanisme
de croissance de la croûte terrestre. 1" ROV :
Remote operated vehicle, véhicule sous-marin
câhlo-commandé.
La vie des labos
Les secrets
de l'ouverture
4 Pascal Gente
devant
une carte
bathymétrique
de la dorsale
atlantique,
où l'emportera
bientôt le
submersible
Nautile.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
•
Voici les testicules d'un embryon de souris âgé
de 2 semaines, où sont colorées en bleu les cellules
produisant une des deux hormones nécessaires
à la formation de ces organes. Au moment de leur
formation, ovules et testicules ne se distinguent pas.
C'est seulement au bout de quelques semaines,
que par le jeu des hormones, l'embryon devient
mâle ou femelle.
La vie des labos
La fertilité masculine
est-elle menacée ?
Au sein de l'université de
Rennes 1, sur le campus de
Beaulieu, certains travaux
de la jeune équipe INSERM
U435 dirigée par Bernard
Jégou, concernent l'évolution
de la fonction de reproduction
chez l'homme, "une
évolution préoccupante",
selon de récentes études.
Depuis 1974, de nombreux
articles ont été publiés sur
ce problème. Les plus récents
concluent que, chez l'homme,
dans certaines régions du monde,
le nombre de spermatozoïdes par
millilitre de sperme (ou concentration
spermatique) aurait baissé
globalement de 50 % en 50 ans.
La moyenne de la concentration
spermatique serait ainsi passée de
113 millions/mi en 1940 à 66 millions/
mi en 1990, selon Carlsen et
al(". Ce n'est pas grave a priori,
puisque 66 millions de spermatozoïdes
sont largement suffisants
pour assurer la fonction de reproduction
: n'oublions pas qu'en
théorie pour faire un bébé, un
spermatozoïde suffit !
Mais de plus en plus d'hommes
se retrouvent dans les catégories
les plus basses. "De plus en plus
d'hommes atteindraient aujourd'hui
le seuil des 5 millions par
ml, qui correspond à la limite en
dessous de laquelle la probabilité
d'avoir un enfant sans recours
médical devient basse", précise
Bernard Jégou, qui a baptisé
GERM (Groupe d'étude de la
reproduction chez le mâle) son
unité INSERM. D'autres signes
viennent assombrir encore le
tableau : le volume moyen d'un
éjaculat serait en diminution, et
les spermatozoïdes d'aujourd'hui
seraient moins mobiles et présenteraient
une morphologie altérée par
rapport à celle de leurs ancêtres.
Présomption et
précaution
Dans le domaine de la fertilité,
il faut se garder des conclusions
hâtives. Relier la dégradation du
spermogramme moyen (enregistrement
des caractéristiques du
sperme) à une éventuelle baisse de
la fécondité, relève de la spéculation
pour le moment. La fécondation
est, on le sait, un phénomène
complexe, faisant intervenir de
multiples paramètres.
"Ce qui nous mobilise",
explique Bernard Jégou, "c'est
qu'avec ce problème de déclin des
caractéristiques spermatiques,
nous sommes récemment passés
du domaine de l'hypothèse plus
ou moins fondée, à celle de la
forte présomption. En effet, les
premières études sérieuses ont
été publiées par des Danois.'" en
1992. Depuis, plusieurs équipes
européennes ont obtenu des
résultats similaires. En France,
des études ont été réalisées au
CECOS") de Paris-Cochin. Les
chercheurs de ce CECOS ont pu
évaluer l'évolution des caractéristiques
spermatiques, grâce à
l'analyse des données dont ils
disposaient sur les donneurs de
sperme depuis deux décennies. Ils
obtiennent, pour la région parisienne,
un déclin de la concentration
spermatique de 2% par an
et établissent l'existence d'une
dégradation de la qualité des
spermatozoïdes."
Les produits
phytosanitaires à la
barre des accusés
"Le testicule est l'un des organes
les plus vulnérables aux
xénobiotiques", constate Bernard
Jégou. C'est ainsi qu'en plus des
causes régulièrement citées,
comme le stress, les radiations,
certaines habitudes vestimentaires,
les chercheurs rennais s'intéressent
à de nouveaux coupables
potentiels : des agents de l'environnement
tels que certains produits
phytosanitaires, qui posséderaient
les caractéristiques
d'hormones femelles et qui,
concentrés dans la chaîne alimentaire,
pourraient interférer avec
l'action des hormones naturelles
mâles et perturber la fonction testiculaire,
de la vie foetale à l'âge
adulte.
Parmi les collaborateurs de
Bernard Jégou, Daniel Guerrier,
chercheur. INSERM, observe plus
particulièrement l'action des
oestrogènes et de xéno-oestrogènes
sur la formation des organes génitaux
chez l'embryon. L'objectif de
ces recherches n'est pas encore de
trouver des solutions, mais de
comprendre les mécanismes. En
parallèle, il est important d'informer
les populations sur ces travaux
et leurs incidences éventuelles.
Mais Bernard Jégou tient à ne
pas alarmer, rappelant qu'il ne
s'agit pour le moment que de présomptions
: "Il nous paraît nécessaire
de développer un effort de
recherche à l'échelle internationale,
s'appuyant sur l'épidémiologie,
la recherche clinique et la
recherche fondamentale". n
H.T.
Contact Bernard Jégou
Tél. 99 28 61 25
"' Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek
N.E. (1992) Evidence for decreasing quality
of semen during past 50 years, E. Med. J.
305, 609-613. "' CECOS : Centre d'étude et de
conservation des oeufs et du sperme humains.
"'Auger J., Kunstmann J.M., Czyglik F., Jouannet
P. (1995) Decline in semen quality among fertile
men in Paris during the past 20 years, New Engl.
J. Med. 332, 281-285.
"C'est pas l'homme qui prend la mer,
c'est la mer qui prend l'homme".
Réponse page 23 ®
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
GESMA Groupe d'études
sous-marines de l'Atlantique
Statut juridique - date de création : Centre d'études et de
recherches de la Délégation générale pour l'armement (DGA) au
sein de la Direction des constructions navales (DCN) créé en 1959.
Nombre d'adhérents : 2 centres implantés, l'un à Brest, l'autre
à Lanvéoc.
Structures : Centre d'études et de recherches étatique dépendant
organiquement de 1'ECN Brest (Établissement des constructions
navales) et fonctionnellement du STSN Paris (Service technique
des systèmes navals).
Missions : Études sous-marines (guerre des mines, détection sousmarine,
armes sous-marines, lutte sous-marine).
Activités : Lutte sous-marine par petits fonds • Acoustique sousmarine
• Traitement du signal et de l'information • Traitement
d'image et interfaces homme-machine pour les sonars • Champs
magnétiques rayonnés (ou électromagnétiques) statiques et
alternatifs, applications aux mines, aux contre-mesures passives et
aux systèmes de détection • Hydrodynamique pour les véhicules
sous-marins supports de sonars ou les dragues • Robotique sousmarine.
Nombre d'employés : Une centaine de personnes réparties sur
les deux centres, chercheurs, techniciens, étudiants en thèse et
administratifs.
Correspondant : François-Régis Martin-Lauzer, ingénieur en
chef de l'armement, directeur.
Adresse : Groupe d'études sous-marines de l'Atlantique, BP 42,
29240 Brest-Naval, tél. (33) 98 22 8142, fax (33) 98 22 72 13.
RÉSEAU DÉCEMBRE 95 - N°117
1
L'IFREMER dan est
O Centres
Stations
rattachées
L--0 Brest
Concarneau
0 n Lorient
La Trinité
Nantes
Noirmoutier
Saint-Malo
Les sigles du mois RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
THOMSON SINTRA
Activités sous-marines
Structure : Filiale du groupe Thomson-CSF, créée en
1985, dont le siège est à Sophia-Antipolis.
L'activité guerre des mines de Thomson Sintra ASM
a été implantée à Brest en 1969.
Activités : Systèmes sonars de guerre des mines
Systèmes d'immunisation des navires • Systèmes
sonars aéroportés • Mécanique marine • Maritime
civil : océanographie, offshore, pêche et navigation.
Références : Plus de 30 marines, dont la Marine
nationale, utilisent nos équipements installés sur près
de 200 navires.
Leader mondial en guerre des mines, Thomson Sintra
ASM Brest a équipé environ 60 % des navires de lutte
contre les mines construits dans le monde.
Dans le domaine civil : IFREMER, IFRTP, SHOM,
CEA.
Nombre d'employés du centre de Brest : 314.
Direction : Édouard Arrubarrena.
Adresse : Thomson Sintra Activités sous-marines,
route de Sainte-Anne-du-Portzic, 29601 Brest Cedex,
tél. 98 3137 00, fax 98 3139 91.
RÉSEAU DÉCEMBRE 95 - N°117
IFREMER Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer
IFREMER Bretagne
Statut juridique : Établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), créé en 1984. Il est né de la fusion du CNEXO (Centre national pour
l'exploitation des océans) et de l'ISTPM (Institut scientifique et technique des
pêches maritimes).
Effectifs : 650 personnes sont rattachées administrativement au centre de Brest
dont 550 localisées sur le technopôle de Brest-Iroise, et les 100 autres sur les sites
bretons de Saint-Malo, Concarneau, Lorient et La Trinité-sur-Mer.
Structures : L'IFREMER a son siège social à Issy-les-Moulineaux et dispose de
5 centres de recherche : Boulogne, Brest, Nantes, Toulon et Tahiti auxquels sont
rattachées 15 stations côtières. Ses effectifs sont répartis en quatre directions
opérationnelles : ressources vivantes, environnement et aménagement du littoral,
recherches océaniques, ingénierie, technologie et informatique.
Missions : L'IFREMER est le seul organisme de recherche français dont la
vocation est exclusivement maritime. B exerce cinq missions : organisme de
recherche pluridisciplinaire, agence d'objectifs, agence de moyens (navires
océanographiques et engins sous-marins entre autres), mission de service public,
mission de valorisation.
Programmes de recherches : Ressources aquacoles • Ressources halieutiques
Valorisation des produits de la mer • Économie maritime • Environnement
littoral • Géosciences marines • Environnement profond • Physique des océans
Océanographie spatiale • Intervention sous-marine • Ouvrages en mer
Matériaux et structures • Technologie navale • Ingénierie des pêches et cultures
marines • Instrumentation océanographique.
Collaborations scientifiques : Universités (Rennes et Brest), grandes écoles
(Sup Télécom Bretagne, CNET, École normale supérieure...), grands organismes de
recherche (CNRS, INSU, IPG, ORSTOM, IFRTP, BRGM, Météo France, CNES,
CNEVA, INRA, Collège de France, Muséum national d'histoire naturelle...).
Collaborations industrielles : ELF, TOTAL, IFP, EDF, CEA, Alcatel...
Collaborations internationales : Programmes européens (Mast, Far, Air,
Eureka-Euromar) et coopération dans le cadre de programmes internationaux
(Goos) ou de collaborations bilatérales avec des États ou des organismes.
Directeur : Guy Pautot.
Correspondants : Patrick Nérisson, responsable des relations publiques, et
Brigitte Millet, relations presse.
Adresse : BP 70 - 29280 Plouzané, tél. 98 22 40 40, fax 98 22 45 45.
RESEAU DÉCEMBRE 95 - N°117
La Bretagne en chiffres
Effectifs
Brest et stations rattachées 558
Nantes et stations rattachées 275
M11.1 DÉCEMBRE 95 - N' 1 17
DES PRODUITS DEFORMATION A DISTANCE
NEREE : Mesures en mer pour l'océanographie physique
(Vidéo et document d'accompagnement)
L'eau comme objet de droit (Vidéo et document d'accompagnement)
Dynamique de l'eau et télédétection
3 Gestion multicritère de l'eau - Méthodes et stratégies
POLE EUROPEEN
D'ENSEIGNEMENT
A DISTANCE
Renseignements : Michèle DEMOULIN - POLE EAD - CNED - 7, rue du Clos Courte! - 35050 RENNES Cédex 9
Tél : 99.25.13.30 - 99.38.43.89
POUR FAVORISER LA DÉMARCHE D'INNOVATION
OU D'ACCROISSEMENT DU NIVEAU
TECHNOLOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE...
PRESENCE
BRETAGNE
Pour toute PMI, PME de la région Bretagne de moins de 2000 salariés
et ne faisant pas partie d'un grand groupe industriel.
Par tout prestataire public ou privé, au choix de l'entreprise.
Assistance technique
Etude de faisabilité
Calculs
Essais
Modélisation
Etude de marché
Recherche de partenaires
technologiques
Etat de l'art
Recherches d'antériorité
Information scientifique et
technique
Dépôt du premier brevet
Les membres conseillers du réseau vous accompagnent
dans la recherche de compétences technologiques.
Les prestations bénéficient d'un soutien financier
spécifique. Elles sont subventionnées à hauteur de 75 %
de leur montant. L'aide est plafonnée à 35 580 F TTC.
PRÉSENCE BRETAGNE
18, PLACE DE LA GARE
35000 RENNES
TEL. 99 67 42 05 - FAX 99 67 60 22
Membre du Réseau Interrégional de Diffusion Technologique
Adressezvous
:
dressezvousà:
LE DOSSIER
Les essais à la mer
en Bretagne
ccr ssais à la mer", une expression bien
magique qui suscite dans notre imaginaire
des réminiscences d'images de transatlantiques
flambant neufs, glissant majestueusement
d'un slipway, pour s'en aller
fendre les eaux de l'Atlantique en quête
d'un hypothétique "ruban bleu".
En Bretagne aujourd'hui, la réalité a
des accents moins éblouissants en ce qui
concerne la construction navale, quelques
unités de pêches sortent encore ici ou là.
Pour le chantier naval majeur de la
région, le porte-avions nucléaire Charlesde-
Gaulle, le temps des essais à la mer est
encore bien loin.
C'est donc d'essais à la mer plus restreints,
mais finalement plus ciblés qu'il
s'agit. On ne parlera pas ici de réparation
navale, mais bien de la qualification de
matériels nouveaux, devant être soumis
aux influences du milieu marin. Des essais
qui bien souvent, mettent la mer en bouteille
pour que de telles qualifications se
déroulent... à terre.
Voilà donc un panorama qui ne prétend
pas à l'exhaustivité, mais où l'on aura eu à
coeur de brosser le tableau de la majorité
des moyens d'essais de la région. Un secteur
où la puissance publique, que ce soit
directement par les services dépendant du
ministère de la Défense ou indirectement,
par le biais d'établissements publics ou de
grandes sociétés nationales, se taille,
moyens obligent, la part du lion de mer !
Manipulation
d'un détecteur
de mines sur le
pont de la Thétis,
en baie de
Douarnenez.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995 9
LE DOSSIER
Ecole navale
Aux grandes écoles
les grands moyens
L'École navale, le seul établissement militaire formant les
futurs officiers de notre Marine nationale, a jeté l'ancre sur
les bords de la rade de Brest. À Lanvéoc-Poulmic, en effet,
les cadres de nos escadres suivent une triple formation d'officiers,
d'ingénieurs et de marins. Mais qui dit enseignement
supérieur dit recherches, et pour mener certaines
d'entre elles, l'École navale dispose de moyens d'essais dans
son domaine naturel, la mer.
' a recherche est indissociable
L de l'enseignement scientifique
de haut niveau," écrit dans
le dernier rapport de recherche de
l'École navale, le contre-amiral
André Le Berre, qui en a récemment
quitté le commandement,
ainsi que celui du groupe des
écoles du Poulmic. Dirigée par le
professeur Bruno Ramstein, la
direction de l'enseignement scientifique
et de la recherche de
l'École navale dispose pour cela
de moyens d'essais, qui lui permettent
de mener à bien des
recherches dans le cadre des
études de deux de ses laboratoires,
ceux d'hydrodynamique (LHEN)
et d'océanographie (LOEN).
Dernier créé, en 1992, le LOEN
est le seul service océanographique
de la Défense à effectuer des travaux
d'océanographie biologique.
Il faut dire que le sujet principal,
l'étude de la bioluminescence
marine, est un thème novateur en
France. L'approche actuelle est la
compréhension fondamentale des
mécanismes de l'émission de
lumière par les organismes marins,
zooplancton, phytoplancton ou
encore bactéries. Spontanée ou
créée par des mouvements de
vagues ou bien le sillage d'un
mobile, cette luminescence est un
phénomène encore mal expliqué.
Pourtant, si l'on pense à la possible
détection d'un mobile trahi par la
luminescence qu'il suscite, tel
qu'un sous-marin glissant entre
deux eaux, on comprend l'importance
des moyens affectés au
LOEN.
Deux navires
Lancés en 1992, les deux bâtiments
d'instruction à la navigation
de l'École navale sont affectés au
LOEN selon ses besoins d'essais.
D'une longueur de 28,30 m, déplaçant
295 t, la Glycine et l'Églantine
sont des navires de 800 CV,
équipés d'un câble (1500 m),
d'une potence et d'un treuil permutable,
installé suivant les
besoins. Menés par des équipages
de 7 personnes, ils peuvent en
emmener 25 en mission océanographique
en mer d'Iroise. Outre le
personnel du LOEN, embarquent
au gré des collaborations, des ingénieurs
du SHOM"', de la DGAt2',
ou d'autres institutions civiles et
militaires. Pour autant, le LOEN
ne néglige pas les moyens que peut
apporter la collaboration internationale.
Ainsi, deux personnes ont
bénéficié du support d'un navire
britannique en août 94, pour une
mission en mer d'Oman afm d'essayer
la sonde de bioluminescence
mise au point à l'École navale.
Un tunnel pour
y voir plus clair
De son côté, le LHEN est également
doté d'un équipement particulier.
Associé depuis fin 91 à plusieurs
laboratoires français pour
former l'Action concertée cavitation,
le LHEN dispose en effet
d'un tunnel de cavitationt3', afin
d'étudier et prévenir ce phénomène
qui affecte la discrétion
acoustique des bâtiments. "Réalisé
depuis 1989, avec une forte
participation de la région, c'est
un moyen complémentaire de
ceux qui existent en France. Cette
machine a été étudiée en liaison
avec la Direction de la recherche
et de la technologie (DRET), qui
coordonne les recherches de
défense, que celles-ci soient réalisées
par des universitaires ou du
personnel de la DGA, comme
c'est le cas au bassin d'essai des
carènes du Val de Reuil," explique
le capitaine de frégate Jean-Yves
Billard, adjoint du professeur
Ramstein et responsable du
LHEN. Le coeur de la machine est
en fait une veine transparente et
carrée, de 1 m de long pour une
section de 20 cm, où circule de
l'eau douce. On y place par
exemple un type de profil, destiné
à une hélice, et on cherche à mettre
en évidence le phénomène de cavitation
en imprimant au fluide une
vitesse qui peut être de l'ordre de
15 m/seconde. Toute une machinerie
l'alimente : plus de 10 m de
long pour le tunnel et une pompe
Le capitaine de frégate
Billard présente
la veine d'eau du tunnel
de cavitation.
de 40 kW fonctionnant sous une
colonne d'eau de plus de 7 m de
haut (la hauteur de la structure). Le
tout met en circulation 65 m3 d'une
eau que des injecteurs peuvent
enrichir en air saturé, introduisant
ainsi des germes de cavitation, et
qu'un groupe compresseur peut
porter de 30 millibars à 3 bars.
"Mais attention, notre laboratoire
est de type universitaire, c'est
donc une recherche ouverte et
non confidentielle qui y est réalisée.
Nous nous occupons donc des
aspects fondamentaux, même si
les résultats peuvent être ensuite
exploités au bassin des carènes,
par exemple," précise Jean-Yves
Billard. Le LHEN mène d'ailleurs
des collaborations diverses avec
plusieurs institutions civiles, la
plus récente étant l'École polytechnique
fédérale de Lausanne
(EPFL). Avec sa partenaire suisse,
le laboratoire met ainsi au point
l'équipement d'une embarcation
en capteurs de couple et de poussée,
afm d'étudier dans le cadre de
la formation des élèves de l'École
navale et de ceux de l'EPFL, le
fonctionnement d'une hélice. n
M.-E.P.
V Contact
Capitaine de frégate Billard
Tél. 98 23 40 35
"' SHOM : Service hydrographique de la Marine.
DGA : Direction générale à l'armement.
"1 Changement de phase de l'eau brassée par une
hélice : l'accélération du fluide induit une baisse
de pression du liquide qui se vaporise localement,
il se reliquéfie immédiatement, entraînant
une augmentation du niveau de bruit (signature
acoustique caractéristique de l'hélice), des pertes
de performance du propulseur, et éventuellement
une érosion des structures métalliques au contact
des poches de vapeurs.
Le bâtiment d'instruction
à la navigation Glycine.
~
LES ESSAIS À LA EN VETAGNE LE DOSSIER
Thomson Sintra Activités sous-marines
La lutte sous-marine à l'essai
à la pointe de Bretagne
Thomson Sintra Activités sous-marines est une filiale du
groupe Thomson-CSF. Le site brestois de cette entité, dont
le siège se trouve à Sophia-Antipolis, est l'une des références
mondiales dans la conception d'équipements militaires de
lutte sous-marine. Une activité où l'obligation d'excellence
impose de nombreux essais de validation. Tableau des
moyens de l'usine brestoise, à propos du développement du
dernier "bébé" de Thomson Sintra ASM : le PVDS.
A
La mine a obligé les marines du
monde entier à s'équiper de
façon à en contrer la menace. Le
meilleur moyen de l'éviter reste
encore sa détection au sonar. La
première génération, les HMS
(Hull-mounted sonar) sont les
sonars de coque. À 6 ou 700
mètres de distance, par 100 m de
fond maximum, ce système permet
la détection d'un objet, et à 200 m
de distance, sa classification. Mais
au-dessous de 100 m, il est difficile
d'investiguer les objets, à cause
de l'angle d'incidence des ondes
sonar. C'est le phénomène de
"rasance" : l'ombre acoustique de
l'objet, projetée par le faisceau
sonar, devient trop petite pour être
classifiable. Qui plus est, les différences
de températures d'eau font
que ces ondes rebondissent parfois
sur la surface d'une couche plus
froide, la thermocline"'. Aussi, la
deuxième génération de sonar est,
elle, remorquée, et peut, par 300
mètres de fond, passer sous la thermocline
et détecter les mines profondes
qui menacent les sousmarins.
Seul problème, le déport
arrière du sonar croît avec la
vitesse du navire et la profondeur
d'immersion. Le navire-support
peut donc éventuellement se trouver
lui-même au-dessus d'une
mine, alors que son sonar en est
encore à tenter de la classifier,
voire de simplement la détecter.
Enfin, l'altitude au-dessus du fond
d'un tel mobile, passif, n'est pas
contrôlable lorsque la vitesse du
bateau varie. Pour contrer ces phénomènes,
Thomson Sintra ASM
lance sur le marché de la guerre
des mines un produit de troisième
génération, nommé PVDS (Propelled
variable depth sonar), dont
le système autonome de propulsion
lui permet de détecter les
mines sur l'avant du navire-support,
par des profondeurs variant
de5mà300m.
Un nouveau concept
Le porteur du PVDS est un
ROV"), fabriqué par une société
suédoise, Bofors Underwater Systems-
Sutec. Il porte sur lui un véritable
système de détection, doté
du nec plus ultra de la technologie
de l'entreprise implantée à Brest, le
sonar TSM 2022 Mk III. Un appareillage
ayant la particularité
unique au monde d'être muni de
transducteurs multifréquences. Le
PVDS est donc la nouvelle arme
de bataille de Thomson Sintra
ASM, qui devra s'imposer sur le
marché mondial, dans un combat
où ses capacités doivent faire la
différence avec celles de ses futurs
concurrents. Aussi, l'entreprise
doit assurer l'excellence de son
produit par des campagnes d'essais
qui seules, permettent d'affirmer la
prééminence de son nouveau
concept sur les systèmes existants.
Équipée récemment d'un bassin
d'eau douce de 50 m de long sur
8 m de largeur et 8 m de profondeur,
l'entreprise peut à présent
mettre au point et tester ses sonars
dans ses locaux, alors qu'elle utilisait
auparavant les moyens d'autres
organismes, comme le bassin de
l'IFREMER (voir en pages centrales
du dossier). Mais pour valider
le système entier à la mer,
Thomson Sintra ASM a besoin
d'une coopération lui permettant
d'installer le système complet à
bord d'un bâtiment.
Coopération
La première campagne s'est
effectuée, elle, en octobre 94, en
baie de Douarnenez, près de Brest,
pendant le salon Euronaval. La
Marine nationale, client naturel du
PVDS comme d'autres produits de
guerre des mines, fournissait la
Thétis, un bâtiment d'expérimentation
de guerre des mines. Pour la
partie concernant le système de
déploiement et de récupération,
c'est avec la collaboration du
GESMA (Groupe d'études sousmarines
de l'Atlantique) que les
Brestois et leurs confrères suédois
ont pu assurer la démonstration.
En septembre dernier, c'est en mer
Baltique que se sont déroulés les
essais, un chasseur de mines
"Landsort" de la marine suédoise
accueillant tous les systèmes
nécessaires au déploiement du
PVDS. Ces coopérations croisées,
nationales autant qu'internationales,
prouvent que quelle que soit
la valeur d'une innovation, on est
décidément plus fort unis. n
M.-E.P.
1
Contact François Pouliquen
1 Le PVDS, dont on voit
distinctement l'antenne
détectrice, manipulé sur le
pont d'un navire suédois
lors de la dernière
campagne d'essais.
Tél. 98 31 37 61
Thermocline : interface entre deux couches
d'eau de différentes températures, qui fait notamment
obstacle aux passages des ondes acoustiques
du sonar. "' ROV : Remote operated
vehicle, véhicule sous-marin commandé par
câble, inhabité et doté d'une caméra, ainsi que
de divers senseurs.
RI SI AU117 • DFCFM14Rf 199;
Des contraintes
dues au milieu
Qualifier au milieu marin,
c'est s'assurer qu'au long de sa
vie, l'instrument résiste à toute
une kyrielle d'agressions. Le
service Qualification-Essais en
a dressé une liste à la Prévert :
froid, brouillard salin, rayonnement
solaire, vibrations
(machines), chocs mécaniques,
mouvements de plate-forme
(tangage, roulis), continuité de
masse, compatibilité électromagnétique
(par exemple entre
radars différents, radios...),
pression hydrostatique, choc
thermique à l'immersion,
condensation, gel/dégel/givre/
glace, biosalissures marines,
perturbation de réseau, foudre,
chocs pendulaires (contre la
coque, à la mise à l'eau), étanchéité
au ruissellement (sur le
pont), étanchéité des connecteurs
et des joints de porte,
résistance à la contamination
par les fluides (liquide hydraulique,
gazole)...
Des partenaires
dans les normes
Bien que nationale, la norme
Afnor concernant l'instrumentation
océanographique a une
origine à la fois locale et extérieure,
puisque de nombreux
intervenants ont travaillé à son
élaboration. On y retrouve,
outre l'IFREMER, l'INSU
(Institut national des sciences
de l'univers), la DCN (Direction
des constructions navales),
l'EPSHOM (Établissement
principal du service hydrographique
de la marine), Météo
France, le STNMTE (Phares et
balises), l'Orstom (recherche
outre-mer) et des entreprises
comme Mors, Orca, Thomson
Sintra ASM, Tekelec...
Le géant finistérien
de la qualification
à la mer
Parmi ses multiples missions, le centre de Brest de l'IFREMER
a en charge la qualification du matériel à l'environnement
marin. Car pour qu'une donnée soit validée en
océanographie, encore faut-il s'assurer que l'instrument qui
la recueille est capable de fonctionner dans son environnement.
Ce qui a amené l'antenne de Brest à développer d'importants
moyens de qualification et d'essais. Le service
compte 14 personnes, dont le rôle est d'entretenir le parc de
moyens, de le moderniser et de réaliser les essais.
LE DOSSIER
IFREMER
Quand la norme
naît des essais
"Pour imposer une norme, il
faut avoir derrière soi des
moyens d'essais l" explique
Yvon Le Guen. À partir de la
rédaction d'un guide à l'usage
des concepteurs, l'institut et
ses partenaires ont réussi à
imposer une norme, qu'un
contrat avec l'AFNOR a rendu
nationale. Le texte définit
quatre familles d'instruments
selon leur degré d'exposition.
La catégorie El concerne le
matériel fonctionnant habituellement
à l'extérieur, dans une
atmosphère marine. On y
trouve des treuils, des panneaux
solaires, télécommandes,
antennes...
La catégorie E2 concerne ce qui
fonctionne à l'extérieur, en eau
de mer. Il s'agit de tout appareil
sous-marin. On retrouvera dans
cette catégorie ce qui est sonar
militaire, courantomètre, bathysonde,
balise acoustique, sondeur
de pêche, flotteur libre,
outillage sous-marin...
La catégorie I1 est celle des
équipements fonctionnant à
l'intérieur, dans des locaux climatisés
(salles, conteneurs) et
soumis essentiellement aux
vibrations : PC, coffrets électriques,
baies électroniques,
systèmes de visualisation,
pupitres de commandes, matériel
de laboratoire...
Enfin la catégorie I2 concerne
les équipements fonctionnant
à l'intérieur, dans des salles
non climatisées (salle des
machines, phares...). On y
retrouve de l'informatique, du
matériel de maintenance,
l'électronique d'un sonar, des
générateurs électriques...
Qualifier à l'environnement
marin suppose une triple
réflexion préalable : quel doit être
le cycle de vie, quel sera le niveau
d'agression subi, quels seront les
essais à mener ? "Il existe trois
grands types d'essais : électriques,
un domaine où nous ne
faisons pas grand chose ; mécaniques,
comprenant tout ce qui est
vibrations, transports, manutention,
avec notamment une table de
A
Dans son berceau, cette
bouée de mesure de houle
va subir un étalonnage
sur simulateur de houle.
vibration, des «appareils de tortures
», soumettant l'équipement à
des chocs ou à la pression... et
enfin, essais climatiques pour lesquels
nous disposons d'une
chambre permettant de créer
chaud, froid ou encore humidité,
d'une autre qui simule le
brouillard salé ou la pluie normalisée,
et d'une troisième reproduisant
le rayonnement solaire,"
explique Yvon Le Guen, responsable
du service Qualification-
Essais de l'IFREMER Brest.
Cependant, ces moyens ne sont pas
spécifiques à l'institut. Par contre,
l'IFREMER en a développé
d'autres qui lui sont propres, ce qui
fait de Brest un centre majeur en
France dans ce type d'activité.
Trois types de moyens sont principalement
utilisés. Les premiers
sont une batterie de six caissons
hyperbares qui permettent des
essais en pression jusqu'à 2400
bars, où l'on teste étanchéité et
résistance mécanique. Viennent
ensuite les bassins d'essais. Si
deux d'entre eux sont de simples
canaux d'études hydrodynamiques
et d'essais d'engin, le troisième est
une véritable fosse, profonde de 20
mètres à son maximum et longue
de 50 mètres (record d'Europe de
profondeur). Cette fosse artificielle
' Arialik6
LE DOSSIER
t Un caisson de test
hyperbare à
50 atmosphères.
est remplie d'eau de mer pompée
directement dans la rade, et équipée
de deux batteurs de houle permettant
d'imprimer à la surface du
plan d'eau des ondulations dignes
de certaines (mauvaises) conditions
de navigation. Ce bassin sert
ainsi à étudier, entre autres, la mise
à l'eau d'apparaux"' divers, le
fonctionnement de certains matériels
et le réglage de flottabilité de
divers engins. Enfin la station d'essais
en mer de Sainte-Anne-du-
Portzic, au pied de l'IFREMER,
permet des essais d'exposition en
site naturel, au fond, en surface, au
marnage et aux embruns.
Tout matériel
"Tous ces moyens d'essais ont
été développés par l'institut pour
qualifier notamment son instrumentation
océanographique : cela
coûte moins cher qu'une campagne
ratée. Pourtant, la qualification
d'un matériel à l'environnement
marin est une démarche
relativement récente, et lorsque
nous avons commencé en 84-85,
les moyens n'étaient pas très utilisés
par les scientifiques, qui ne
prenaient pas suffisamment en
compte tout ce que subissait le
matériel," retrace Yvon Le Guen.
Il est vrai que ce matériel est muldésormais
saisies en majorité par
des capteurs. Ceux-ci, qui mesurent
des paramètres aussi variés
que la vitesse du son dans l'eau, la
salinité, la houle, le courant, le
taux d'oxygène dissous, de nitrates
ou encore la turbidité de l'eau
parmi d'autres, passent donc "à
l'équerre" de façon périodique, sur
les bancs de l'IFREMER. Car "ce
type de mesure représente la nouvelle
donne de l'instrumentation
océanographique", souligne Yvon
Le Guen, qui marque ainsi l'un
des points forts de son service.
Autre motif de satisfaction, par
rapport à une clientèle venant de
l'offshore pétrolier cette fois : le
bassin d'essais profond constitue
lui aussi un point fort. Sa profondeur
le rend apte à l'essai de
maquettes à grande échelle de sections
de structures pétrolières...
Même les militaires ont profité des
capacités de fond et de houle, testant
des engins blindés, y compris
en submersion ! Une clientèle extérieure
que les compétences de
l'IFREMER séduisent toujours,
puisqu'en 94, 32% des demandes
de prestations en essais et qualification
venaient de l'extérieur. •
M.-E.P.
Côntact Yvon Le Guen
Tél. 98 22 41 29
"'Apparaux : matériel équipant un navire.
Un blindé
AMX 10
testé dans
la houle
du bassin
d'essais
profond.
tiple et varié, puisque l'on parle ici
aussi bien du récepteur satellite
embarqué, que de l'ampoule d'un
phare, d'une sonde destinée à aller
à - 6000 mètres, ou encore d'une
baie électronique devant rester
dans les coursives. Ces instruments
sont soumis, parfois alternativement,
à toute une gamme d'agressions
très diverses, que l'on n'imagine
même pas, vu du plancher des
vaches (voir encadré). D'ailleurs,
pour aider ceux qui conçoivent et
fabriquent de l'instrumentation,
souvent issus de l'univers PMEPMI,
l'IFREMER a établi avec
d'autres organismes un guide
d'essais en environnement marin
de l'instrumentation océanographique.
En effet, ces constructeurs
n'ont pas les moyens de mettre en
oeuvre des procédures complètes,
type marine. Ils peuvent à présent
se référer à ce guide, qui est maintenant
devenu une norme AFNOR
à part entière (voir encadré).
Label métrologie
Un autre aspect de l'activité du
service Qualification-Essais, est
l'étalonnage de toutes sortes d'instruments
océanographiques, dans
un laboratoire ad hoc, qui assure
une calibration périodique des
appareils. Le laboratoire de métrologie
est ainsi accrédité par le
Comité français d'accréditation
(Cofrac) en ce qui concerne pression
et température, un label de
qualité aux normes européennes.
En effet, la mesure in situ prend de
plus en plus le pas sur le prélèvement
d'échantillons, les grandeurs
physico-chimiques sont donc
GESMA
Les moyens d'essai
de la guerre sous-marine
•
Vue artistique du polygone de mesures acoustiques
Rascas.
LE DOSSIER BRETAGNE
Implanté des deux côtés de
la rade de Brest, le Groupe
d'études sous-marines de
l'Atlantique (GESMA) est
un centre technique étatique
de la Délégation générale
de l'armement (DGA),
expert en guerre des mines,
en lutte sous-marine par
petits fonds, ainsi qu'en discrétion
acoustique et électromagnétique
sous-marine.
Le GESMA anticipe sur la
menace future et imagine
les systèmes les plus aptes à
la contrer.
ur ses deux centres, l'un au
sein de l'arsenal de Brest,
l'autre à Lanvéoc, le GESMA travaille
à sauvegarder les navires de
guerre, leurs systèmes et tous ceux
qui les manoeuvrent ou les opèrent.
Il est chargé des études en
amont, des développements exploratoires,
de l'assistance aux directeurs
de programmes, et du soutien
aux états-majors et aux bases
des forces de lutte sous-marine. Il
dispose de moyens d'essais
importants, qui couvrent l'ensemble
de ses activités. En mer, le
GESMA met en oeuvre un bâtiment
d'expérimentation, l'Aventurière
: 12 noeuds en vitesse de
pointe, 24 m de long, de 4 à 6
membres d'équipage, équipée de
deux treuils de 4 tonnes, d'une
grue de 2,5 t à 2,50 m et d'un
laboratoire permettant de recevoir
des matériels divers. Ce bâtiment
permet la mise au point à la mer
de véhicules et de gréements (jusqu'à
12 noeuds de vitesse). Lorsqu'un
support plus important
devient nécessaire, le GESMA utilise
également le bâtiment d'expérimentation
de guerre des mines
(BEGM), Thétis, navire de la
Marine nationale attaché à la Force
de guerre des mines, basé à Brest
et chargé de l'évaluation des systèmes
futurs de détection des
mines. À terre, dans l'enceinte de
l'arsenal, les locaux du GESMA
comportent toute une série d'équipements
de pointe. Le premier est
un bassin de mesures dépressionnaires
de 30 m de long, équipé
d'un vélocimètre laser qui effectue
des mesures de sillage en similitude°'.
Un autre consiste en une
cuve acoustique d'eau douce de 30
m', équipée de moyens de levage
et de positionnement précis, ainsi
que de sondes étalons. Pour les
mesures acoustiques, un autre bassin,
en eau de mer cette fois, mesurant
80 m sur 10 m de large et 8 m
de profondeur, est utilisé à 50 %
par le laboratoire "détection sousmarine"
de la DCN-Brest"), chargé
de l'entretien des sonars de guerre
des mines. Enfin, six cuves d'essais
sous pression, dont les capacités
s'étagent de 30 à 1000 bars,
permettent au GESMA de réaliser
des essais de tenue en pression,
qu'il s'agisse de résistance mécanique,
d'étanchéité, ou d'autres
paramètres.
Les polygones
de Lanvéoc
En face de Brest, la station de
Lanvéoc rassemble les moyens
d'essais du GESMA pour la
mesure du bruit rayonné et de l'indiscrétion
électromagnétique des
navires. En effet, les bâtiments de
surface et les sous-marins déployés
par la Marine nationale sur la
façade atlantique sont exposés aux
menaces sous-marines par petits
fonds (sous-marins, UUV ), torpilles
et mines par exemple). Il est
donc important d'estimer la vulnérabilité
de nos bâtiments vis-à-vis
de ces menaces. À ce titre, le
GESMA assure la disponibilité
d'un vaste complexe de mesures,
immergé en grande rade de Brest
et mis à la disposition de la marine.
Ces installations de mesures
constituent les polygones de Lanvéoc,
dont la mise en oeuvre est
confiée au Centre d'essais techniques
et d'évaluation de Brest
(CETEB, un centre de la DCNBrest).
Les polygones de mesure électromagnétique
permettent celle de
tous types de bâtiments, et le
réglage optimal de leur système
•
Bâtiment d'expérimentation
à la mer l'Aventurière.
d'immunisation'''. La station de
Lanvéoc dispose également des
moyens de traitement magnétique
des navires à coques métalliques.
Les moyens de mesure acoustique,
(polygones en mer ou
moyens mobiles) assurent quant à
eux la mesure du bruit rayonné
par les bâtiments faisant route, ou
à quai. De plus, le GESMA dispose
à Lanvéoc d'un simulateur
d'environnement magnétique, intégré
à une chaîne de mesures à terre
pour la définition, entre autres, des
systèmes d'immunisation des
navires au moyen de maquettes en
treillis.
L'ensemble de ces moyens d'essais
permet aux 47 ingénieurs et
cadres, aux 50 techniciens et
ouvriers de travailler à la définition,
à la mise au point et à l'évaluation,
y compris à la mer, de
nouveaux systèmes comme le
sonar remorqué DUBM 42 Lagadmots',
le plus puissant au monde
dans sa catégorie, capable de
balayer une zone de 400 m et de
couvrir 7 hectares de fond à
l'heure, et dont le développement
avait été confié à Thomson Sintra
ASM et ECA. n
M.-E.P.
Contact Jean-Pierre Dudoret
Tél. 98 22 60 73
"' Mesure de la vitesse de traction et des vitesses
horizontales. "' DCN : Direction des constructions
navales. "' UUV : Unmanned underwater
vehicle : véhicule sous-marin inhabité. "' Un
navire métallique crée des perturbations magnétiques
locales, mesurables à relativement grande
distance. L'immunisation consiste à installer à
bord des sources de champs magnétiques opposés,
qui permettent de réduire entre 5 et l0 fois la
perturbation."' Lagadmor: "L'oeil de la mer" en
breton.
Contact Marc Meillat
Tél. 97 87 73 10
LE DOSSIER
IFREMER Lorient
La sélectivité des
engins de pêche
L'équipe du laboratoire Technologie des pêches d'IFREMER
à Lorient a acquis une compétence reconnue au plan national
et international dans le domaine de la sélectivité et du
développement des engins de pêche. Il vient de mettre au
point un chalut"' sélectif pour la pêcherie de lottes.
Préserver les petits poissons et
les laisser grandir afm d'améliorer
à moyen terme la ressource,
donc la capacité de pêche future,
telle est la doctrine en matière de
protection de la ressource marine.
Si le maillage des filets demeure le
pilier de la sélectivité (il permet
d'éviter des captures trop importantes
d'espèces juvéniles), il ne
suffit plus lorsqu'il s'agit de
bateaux opérant sur des pêcheries
multi-spécifiques''). Il faut faire
appel à des engins sélectifs qui
jouent le rôle de filtre en séparant
les spécimens matures commercialisables
et les petits spécimens
immatures, ces derniers s'échappant
du piège.
Un pôle de
compétence
Le laboratoire Technologie des
pêches d'IFREMER à Lorient est
un pôle de compétence dans le
domaine du développement des
engins de pêche et notamment
des chaluts sélectifs. On compte
notamment, parmi ses travaux, la
mise au point de chaluts à nappe
séparatrice pour les pêcheries suivantes
: langoustines et merlus (il
s'agissait de laisser échapper les
merlus juvéniles) ; crevettes et
soles (ici ce sont les soles juvéniles
qu'on cherche à préserver) .
La lotte est une espèce dangereusement
surexploitée. À la suite
des travaux du biologiste Hervé
Dupouy, spécialiste de la lotte (ou
baudroie) au centre IFREMER de
Lorient et à la demande de l'Organisation
de producteurs de l'ouest
Bretagne (OPOB), à laquelle
adhère une importante flottille
hauturière bigoudène, première
productrice de lotte en France,
l'équipe du laboratoire Technologie
des pêches de Lorient a imaginé
un système permettant
d'épargner les petites lottes de
moins de 30 cm. Ce travail a été
financé par le département du
Finistère et la région Bretagne.
Première étape des scientifiques
lorientais : la recherche bibliographique
sur les travaux menés dans
le monde sur le sujet, qui a permis
de trouver un système de grille mis
au point par les Norvégiens pour
séparer les crevettes nordiques des
poissons de fond. S'appuyant sur
ce principe, les chercheurs ont mis
au point un chalut dont la poche est
munie d'une grille combinant barreaux
horizontaux et verticaux. Le
principe est le suivant : les poissons
buttent sur la grille, les petits
spécimens traversent cette grille et
s'échappent, tandis que les gros
poissons longent la grille et se
retrouvent piégés dans la poche.
Les premiers tests techniques
ont été réalisés en bassin d'essais
sur une maquette au 1/2, les poissons
étant simulés par de petits
flotteurs lestés d'eau. Dans un
deuxième temps, un chalut sélectif
en vrai grandeur a été embarqué
sur le Gwen Drez, le navire de
recherche halieutique d'IFREMER.
Cinq campagnes ont été
menées de juin 1993 à juin 1995.
Grâce à un engin remorqué d'observation
(ROV), le comportement
du chalut a été observé et filmé. Il
//
est à signaler que la vidéo sousmarine
est en cours de développement
pour répondre précisément
aux essais de chaluts.
Marc Meillat, ingénieur à
Lorient, explique : "La lotte se
trouve sur une pêcherie multispécifique
avec des cardines (ou
limandes), des raies, des poissons
ronds dont le merlu. Le problème
se complique donc considérablement
du fait des morphologies et
comportements très différents de
toutes ces espèces. Comment laisser
partir les petites lottes en gardant
les grosses cardines, par
exemple ? Il a fallu trouver un
compromis en essayant de sauver
le maximum de petits poissons (et
pas seulement les lottes) tout en
conservant dans la poche le maximum
de gros spécimens. Il faut
en effet améliorer la productivité
à moyen et long terme, tout en
réduisant au maximum les pertes
immédiates en chiffre d'affaires".
Les pertes immédiates ont été estimées
par les chercheurs à 10 % du
chiffre d'affaires, tandis que les
gains de productivité à 5 ans sont
de 30 %.
Le travail des scientifiques est
achevé : "Nous allons rencontrer
l'OPOB, annonce Marc Meillat.
Notre objectif est que des bateaux
se munissent de ce chalut sélectif.
Nous assurerons le suivi à bord
des navires". La balle est désormais
dans le camp des pêcheurs. n
F.B.-C.
'0 Le chalut est un filet en forme d'entonnoir que
le bateau traîne derrière lui par l'intermédiaire
de deux câbles (ou funes). La partie supérieure
de la "gueule" du chalut est munie de flotteurs,
la partie inférieure de racleurs pour déloger les
poissons enfouis sous le sédiment. L'extrémité
arrière du chalut est appelée poche ou "cul". Les
chaluts de fond sont utilisés pour capturer les
espèces suivantes : langoustine, merlu-merluchon,
lotte, cabillaud, raie, Saint-Pierre, cardine...
Pêcherie multi-spécifique : zone de pêche oA
plusieurs espèces coexistent.
•
La poche du chalut est munie d'une grille permettant
d'évacuer les petits spécimens.
ifremer institut français de recherche pour l'exploitation de la mer -
Siège social: 155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy-les-Moulineaux
Centre de Brest : Technopôle Brest-Iroise, B.P. 70, 29280 Plouzané.
Une techno 1. 4 pàur les entre~ r
n
~ses
du secteur de{ i~.4
l!environnemènt
Des services
Veille technologique, équipements
analytiques, mandataires en brevets,
documentation technique.
-*45v
Rennes Atalante
,
Technopole de Rennes District : Rennes Atalante - 11, rue du Clos Courte! - 35700 Rennes - Tél. 99 12 73 73
Des entreprises
Compagnie Générale des Eaux, Sofrel
Télécontrol, Vitobio, AES Laboratoire,
Filière Blanche, Hypred, Apave de
l'Ouest, CBB Développement, ITGA...
De la recherche
3 centres de recherche publics : INRA,
CEMAGREF, CNRS.
400 chercheurs.
De la formation supérieure
4 écoles d'ingénieurs : ENSP, ENSCR,
ENSAR, EME.
1 université.
Être seul à bord
présente des
risques accrus.
Prévention des accidents
pour les petits bateaux de pêche
Après des observations
faites en mer par des techniciens
et ergonomes de trois
pays (France, Grande-Bretagne
et Irlande) sur les
bateaux de moins de 12
mètres, l'Institut maritime
de prévention de Lorient
met à la disposition des
écoles maritimes un module
pédagogique de prévention
des accidents.
« lus un secteur d'activité est P en difficulté, plus il faut être
vigilant sur la sécurité", a indiqué
Patrick Dorval, directeur du laboratoire
sécurité et conditions de
travail de l'université de Lorient,
lors d'une conférence tenue au
salon Itech'Mer.
Le métier de la pêche est très
dangereux. Il met en oeuvre des
techniques génératrices d'accidents
dans un environnement soumis
à des mouvements aléatoires
et à des intempéries. 44 % des
accidents mortels à la pêche sont
dus à une chute à la mer et 19 %
des décès au travail sont dus à des
accidents individuels. Être seul à
bord présente des risques considérablement
accrus.
La plupart des travaux réalisés
depuis plusieurs années sur la
sécurité et les conditions de travail
à bord des navires de pêche, portaient
sur les flottilles hauturières
et de grande pêche (unités de
24 mètres et plus). On doit au
laboratoire lorientais la première
étude, en 1990, relative aux
bateaux de taille inférieure à
12 mètres qui constituent la petite
pêche et une partie de la pêche
côtière"). Le nombre de ces petits
bateaux ou "canots" aux métiers
très diversifiés (chalut, drague,
filet, ligne, casiers...), menés bien
souvent par un seul marin, s'est
accru du fait de la reconversion de
navigants de la marine marchande.
Ils représentent 73 % de la flottille
de pêche française (5124 bateaux
sur un total de 7 000) et emploient
10000 marins sur les 18000 en
activité.
Selon l'enquête de l'équipe du
professeur Dorval, un marin sur
neuf était victime d'un accident
du travail à la petite pêche, et un
navire sur six concerné ; les dragueurs
de coquillages représentant
les bateaux à plus haut risque puisqu'un
marin sur cinq était victime
d'un accident par an, 90 % des
accidents ayant lieu sur le pont.
Premières causes respectives d'accidents
: les chutes et les engins de
pêche.
S'appuyant sur les travaux des
scientifiques lorientais, l'étude
européenne transnationale Force
a approfondi, sur le terrain, l'étude
des risques à la petite pêche, pour
aboutir à la réalisation d'un
module pédagogique destiné aux
écoles maritimes et aquacoles.
Techniciens
embarqués
L'initiative de ce projet revient
à la cellule Europe du Conseil
général du Finistère, relayée par
le comité des pêches du Guilvinec.
Les autres partenaires professionnels
sont l'Irish South and
West Fishermen's Organisation
(Irlande), la Cornish Fish Producers
Organisation et la South Western
Fish Producers Organisation
Ltd (Grande-Bretagne). Des organismes
de formation et des spécialistes
de l'ergonomie, de la sécurité
et des conditions de travail des
trois pays concernés, se sont associés
à l'étude. Après embarquement
sur les bateaux, observations
et validation de celles-ci auprès
des professionnels, l'ensemble des
résultats a été coordonné par l'Institut
maritime de prévention de
Lorient dirigé par Guy Hanno.
L'étude analyse le risque d'accident,
non seulement dans son
contexte technique, mais aussi
dans son environnement socioéconomique.
Le module se présente
sous forme de "valise pédagogique"
comprenant : livret du
formateur, vidéo, diapositives,
photos. Une plaquette destinée aux
élèves résume le contenu des
cours.
Les mesures de prévention s'organisent
autour de deux grands
axes : l'aménagement des espaces
et la disposition des apparaux ; la
prévention des risques de chute à
la mer. Elles ne sont pas forcément
synonymes d'investissements
importants. La prévention consiste
avant tout à inculquer aux marinspêcheurs,
dès leur formation professionnelle
initiale, un "esprit de
sécurité".
L'intérêt du programme Force
n'est pas à démontrer. Les chiffres
de l'année 1994 parlent d'euxmêmes
: sur les bateaux de moins
de 12 mètres du premier quartier
maritime français, celui du Guilvinec,
un marin sur 10 est victime
chaque année d'un accident contre
un salarié sur 23 dans le bâtiment,
secteur considéré cependant
comme particulièrement exposé. n
F.B.-C.
°1 Petite pêche : activité pratiquée par des
bateaux de dimension modeste qui s'absentent du
port pour la journée. Pêche côtière : activité pratiquée
par des bateaux qui s'absentent du port
pour de courtes marées qui n'excèdent pas trois
jours.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Les canaux bretons
Histoire et Société
L'École polytechnique et la Bretagne
Jusqu'au milieu du 19' siècle, avant l'apparition du chemin de fer et
des routes modernes, la voie d'eau était le seul moyen rationnel d'effectuer
des transports de marchandises pondéreuses. Après la Renaissance, avec
le développement économique naissant, on a cherché à rendre les rivières
navigables, et à construire des canaux.
HIC
Sous
l'Ancien Régime
En Bretagne, le cas de la Loire
étant mis à part, seuls les
estuaires permettaient, à la marée,
de remonter à l'intérieur des terres.
La première canalisation fut celle
de la Vilaine au sud de Rennes, en
direction de Redon et de la mer.
Elle fut très utile pour amener des
matériaux de reconstruction après
le grand incendie de 1720. Mais
les ouvrages réalisés étaient
médiocres, et seuls pouvaient naviguer
des bateaux de très faibles
tonnages, avec en outre deux ruptures
de charge à Messac et à
Redon.
La misère dans les campagnes
était grande au 18' siècle. En 1783,
les États de Bretagne furent autorisés
par lettres patentes du roi à
créer des ouvrages de navigation
intérieure. L'objectif était de développer
l'économie rurale en permettant
les transports d'amendements
des sols, de matériaux de
construction, de marchandises, les
exportations des surplus de production
agricole et réciproquement
les importations pour lutter contre
les disettes, car les stockages
modernes étaient alors inconnus.
L'effet était jugé bénéfique jusqu'à
25 km de part et d'autre des voies
navigables.
Les études furent conduites par
les ingénieurs de Chézy, Brémontier,
Brie et Rochon, sur St-Malo -
Rennes - Redon, Rennes - Laval,
Nantes - Redon - Châteaulin. Les
travaux furent réalisés sur Rennes -
Redon avant 1790 (où tout fut
arrêté), et les études étaient disponibles
sur les autres liaisons. Entre
Rennes et St-Malo, c'est le projet
par l'Ille et le Linon qui fut finalement
adopté, et non celui proposé
par le Meu, le Garun, et la Rance à
partir de St-Jouan.
L'ère
napoléonienne
Le coup d'envoi des chantiers
de canalisation fut donné en 1804.
Aux motifs économiques relatés
ci-dessus, s'ajoutait alors un
objectif militaire : lutter contre le
blocus continental de l'Angleterre,
et assurer l'approvisionnement des
arsenaux de Brest, Lorient et
Indret.
Les premiers travaux furent lancés
sur Nantes - Redon, section la
plus aisée à traiter, car le bief de
partage de Bout-de-bois, entre
l'Erdre et l'Isac, se situe à l'altitude
de 20 m seulement, d'où pas
plus de 18 écluses entre Nantes et
Redon ; et possibilité d'alimenter
ce bief par un réservoir important
et une rigole de 22 km. Cette alimentation
est indispensable pour
compenser les pertes d'eau par
éclusages, évaporations ou infiltrations.
En 1807 fut décidée la création
d'une ville nouvelle à Pontivy, qui
fut rebaptisée Napoléonville. Elle
se situait à la jonction du Blavet et
du canal à réaliser Blavet-Oust, et
était destinée à devenir un pôle
stratégique et économique en Bretagne
intérieure. Auparavant avait
été décidée la canalisation du Blavet
entre cette ville et Lorient. Ce
fut, dirait-on aujourd'hui, une
bonne décision d'aménagement
du territoire.
De Redon à Pontivy, il y a
112 km et 91 écluses. Le franchissement
du plateau de Rohan
par le bief de partage se situe à
l'altitude de 126 m. Entre Redon
et ce plateau, l'Oust est canalisé
sur 90 km, avec 37 écluses.
Une mention spéciale doit être
faite pour la Rigole d'Hilvern,
destinée à alimenter ce bief :
serpentant à flanc de coteau sur
65 km, avec une pente très faible.
Elle prend l'eau au barrage qui
fut construit à Bosméléac près
d'Uzel, à l'altitude de 148 m. Ce
fut un très gros travail, réalisé plus
tard, en 1834.
La période des
grands travaux
1820-1842
Sous l'Empire, les travaux ne
furent réalisés que sur l'Oust, et
ensuite interrompus de 1814 à
1820. A cette dernière date, l'ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées
Becquey réussit à convaincre
les autorités de l'intérêt d'achever
les canaux bretons, entre Nantes et
Brest, et de Rennes à St-Mato. Une
loi intervint en 1822 pour définir le
financement de cette oeuvre considérable.
Les travaux furent alors entrepris
sur une grande échelle, et terminés
en 1832 pour Rennes - St-
Malo (85 km, 49 écluses), et en
1842 pour Nantes - Brest. Le coût
atteignit 45 millions de francs-or
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Pham Musée de Bremgne.
t La Vilaine à Rennes : lithographie du 19' siècle.
•
La vie à bord d'une péniche sur la Vilaine, dans les années 1930.
Ces clichés ont été fournis par le Musée de Bretagne à Rennes, qui a consacré
une exposition importante à "L'aventure intérieure des canaux bretons",
jusqu'en octobre dernier.
pour Nantes - Brest (360 km, 236
écluses).
De Pontivy à Châteaulin, il y a
149 km et, compte tenu du franchissement
du seuil de Glomel
entre le Blavet et l'Aulne, à 184 m
d'altitude, on compte 127 écluses.
Le bief de partage de Glomel, alimenté
par le réservoir du barrage
du Korong, comporte une "grande
tranchée" de 23 m de hauteur sur
3 km, nécessitant 1600 000 m3 de
déblais.
Ce furent des travaux pharaoniques
: le volume de la pyramide
de Khéops peut se comparer à
celui de la terre et de la roche à
extraire et transporter pour la seule
grande tranchée et ses abords, ou à
celui des pierres de taille nécessitées
par les 236 écluses du canal.
Pour les réaliser, on fit appel
pour partie à des prisonniers. C'est
ainsi qu'à Glomel, on ouvrira en
1823 un camp pour déserteurs
condamnés aux travaux forcés,
véritable bagne de 600 hommes
environ, lequel fermera en 1834, à
l'achèvement de la grande tranchée.
Les conditions de vie y
étaient épouvantables. Une révolte
y eut lieu en 1830.
Mais beaucoup de chantiers
furent réalisés par des entreprises,
qui n'eurent guère de mal à recruter
toute la main d'oeuvre nécessaire.
La misère était telle dans les
campagnes que beaucoup acceptaient
ces travaux très durs, payés
à la tâche, pour gagner de quoi
survivre avec du pain (la pomme
de terre n'était pas encore cultivée
dans la région), des sabots, et
quelques vêtements.
Les outils étaient des pelles,
pioches et brouettes. Les terrassements
étaient exécutés souvent
dans l'eau, ou dans la boue. Pour
les étanchements : argile, paille et
de rares planches. Pour le rocher,
on utilisait la barre à mine et la
poudre noire, sans mèche lente.
Pas de lunettes pour les tailleurs
de pierre. L'éclairage provenait de
bougies ou de lampes à graisse.
Les plans des ingénieurs étaient en
exemplaire unique (pas de reproductions).
Les canaux bretons
depuis 1842
La période favorable, pour les
péniches de moins de 100 t pouvant
emprunter ces canaux et
tirées par des chevaux sur les
halages, fut brève. Le trafic commença
à décliner à partir de 1870.
La concurrence du chemin de fer
en fut la cause, d'autant plus que
celui-ci, fin du 19' et début du
20' siècle, avait un réseau déjà
très maillé avec les lignes à voie
métrique, et beaucoup d'entreprises
embranchées. En outre, les
crédits d'entretien des canaux,
pour le dévasage et surtout le remplacement
des portes d'écluse,
firent défaut.
En 1929 fut achevé le barrage
de Guerlédan sur le Blavet, l'État
y ayant donné une concession
pour une usine hydroélectrique.
18 écluses étaient noyées. La
concession imposait la construction
d'un ascenseur à bateaux,
mais il ne fut jamais réalisé. La
liaison Pontivy - Châteaulin était
coupée, et le trafic disparut.
Sur la Vilaine et le canal d'Illeet-
Rance, le trafic s'effectua par
halage jusqu'en 1914. Par la suite
apparurent des automoteurs. Dans
les années 1950, il y avait encore
un certain trafic de sable de Loire,
de pâte à papier et d'hydrocarbures.
Mais la concurrence des
transports routiers porte à porte
devint irrésistible, vis-à-vis non
seulement de la voie d'eau, mais
même du chemin de fer. Les
canaux sont handicapés par le tonnage
limité des péniches (taille
des écluses), la lenteur, les ruptures
de charge.
Actuellement, les canaux bretons,
maintenant entretenus par les
collectivités locales, départements
et région, représentent un patrimoine
sur le plan du paysage créé,
avec ses plans d'eau, ses plantations,
ses chemins pour piétons et
vélos. Les loisirs (pêche, promenade)
et le tourisme fluvial
(house-boats) s'y développent. Il
faut sauver les maisons éclusières,
les halages et assurer l'entretien
minimal : bajoyers et portes
d'écluses, barrages, protection des
berges, dévasements.
Les deux siècles écoulés ont
ainsi vu la grande aventure des
canaux bretons. n
Christian Delaunay
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995 Q
®ALLUMEZ VOS MENINGES1
i
z
E
a
0
PonqjiN
a~~
R.,,E ~ d...
~
MJ..nw.d'f`~, ~
eNE.H.mY
~
~ _ _ eumEind'.Ill..a
1.
~~~
-.....M,,._
RESERVE AUX ltal ANS'`•~~
' figFEwF JI~
SCIENCE fl VIE e?
SCIENCE 8 VIE JUNIOR
LES BRÈVES RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
•
Joël Renault, P-DG de la
société Delta Dore, et Jean
Brusa, directeur délégué
EDF-GDF services Ille et
Vilaine, lors de la signature
du premier contrat
Émeraude, le 3 octobre
dernier à Bonnemain.
Contrat Émeraude
Rennes : la direction départementale
Ille et Vilaine d'EDF a signé le
3 octobre dernier avec la société
Delta Dore, le premier contrat
Émeraude, l'un des sept nouveaux
services mis en place pour assurer
la qualité des prestations envers les
PME-PMI. Le contrat Émeraude
apporte la garantie par EDF d'une
qualité de fourniture électrique
déterminée, en prenant en compte
les conditions de fonctionnement
des équipements électriques de
l'entreprise, en collaboration avec
les fournisseurs de matériels électroniques
et informatiques.
Pour Delta Dore, la qualité est
indispensable, à tous les niveaux.
Située à Bonnemain (35), cette
entreprise de haute technologie est
spécialisée dans l'étude, la conception
et la fabrication de produits
électroniques destinés à la gestion
de l'énergie et des automatismes,
et aux produits de publiphonie.
Rens.: Fabienne Bry-Clary,
tel. 99 03 55 50.
Un nouveau directeur
à la technopole ►
Quimper Cornouaille
Quimper : Alain Schlesser, ancien
directeur du GIP Bretagne Biotechnologie,
a été nommé directeur
de la technopole Quimper Cornouaille
(ex-PIQA). Créée en
1987, la technopole compte
aujourd'hui une centaine d'entreprises
adhérentes. Lors de l'assemblée
générale du 24 novembre, les
nouvelles orientations ont été
annoncées : "Tout d'abord, élargir
notre rayon d'action sur toute la
Cornouaille. Avec 350 000 habitants
et 850 entreprises générant
plus de 5 milliards de francs de
chiffre d'affaires, la Cornouaille
est une des régions les plus dynamiques
de Bretagne."
D'un point de vue stratégique,
trois grands axes de développement
ont été adoptés, centrés sur
l'industrie agroalimentaire, sur
l'emballage et sur les technologies
de l'information et de la communication.
"Grâce à la mise en place
d'une plate-forme expérimentale
à Creac'h Gwen, dans le cadre du
programme ITR (Informatiquetélécommunications-
réseaux) créé
par la Région Bretagne, nous
développons dès aujourd'hui un
Cyberpôle, centré sur Quimper.
Notre spécificité est de nous intéresser
davantage au contenu,
c'est-à-dire à l'information qui
sera véhiculée sur ces réseaux de
télécommunications à haut débit".
Les premiers bénéficiaires du
Cyberpôle seront les organismes
de formation du Sud Finistère.
► Rens. : Alain Schlesser,
tél. 98 82 87 87.
•
Récemment nommé à la
direction de la technopole
Quimper Cornouaille,
située à Creac'h Gwen,
Alain Schlesser a de grands
projets pour les entreprises
du Sud Finistère.
Un CD-Rom
sur Anticipa
Hénon (22) : les 70 structures,
entreprises et centres de recherche,
présents sur la technopole Anticipa,
seront bientôt consultables
sur bornes interactives et sur CDRom.
Ces produits sont réalisés
par la société REC (Rechercheéducation-
communication) Multimédia,
une jeune entreprise de 3
salariés spécialisée dans l'informatique
de communication et de
formation.
ANticipa
TECHNOPOLE LANNION TREGOR
Rens.: Vincent Noirbusson,
tél. 96 44 37 79.
Du côté des
laboratoires
Les Français et
les sciences
Les scientifiques ont plus la cote
que les politiques et les religieux !
C'est ce que montre un récent sondage
réalisé par la SOFRES pour
le compte d'Eurêka, le nouveau
magazine scientifique du groupe
Bayard Presse. Selon ce sondage,
deux Français sur trois s'intéressent
aux sciences. Pour résoudre
les problèmes du monde, leur
confiance est accordée prioritairement
aux scientifiques (38 %), suivis
par les hommes politiques
(28 %) et les personnalités religieuses
(23 %).
► Rens. : Eurêka,
tél. 16 (1) 44 35 60 60.
•
Concours européen
pour jeunes
scientifiques
Le groupe Excelsior, éditeur des
magazines de vulgarisation scientifique
"Science et vie" et "Science
et vie junior", organise "Allumez
vos méninges", un concours à destination
des jeunes de 15 à 21 ans,
placé sous le patronage des ministères
de l'Éducation nationale et de
la Recherche. Les candidats doivent
présenter une recherche scientifique,
théorique ou appliquée,
avant le 30 mars 1996. Les prix
seront remis à Helsinki (Finlande)
en septembre 96.
Rens.: Victoria Popovac,
tél. 16 (1) 46 34 35 35.
Du côté des entreprises
1995 : premier siècle du cinéma
En 1895, les frères Louis et Auguste Lumière trouvaient le meilleur moyen d'enregistrer des
images et de les projeter sur un écran. Le cinématographe a depuis conquis les écrans du
monde, pour une meilleure diffusion de la culture, mais aussi des sciences ! Sept ans après l'invention
du cinéma naît Jean Painlevé, auquel est consacrée une exposition disponible au
CCSTI. Depuis la Station biologique de Roscoff, dans le Finistre, ce cinéaste biologiste a
filmé les mollusques, les crustacés, les oursins et autres animaux marins jusque-là ignorés.
t Science, on tourne ! Pour le centenaire du cinéma, le journal du CNRS
a édité un numéro spécial consacré au cinéma scientifique.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Du côté de l'Ouest
•
Le Recteur de l'académie de Rennes, Pierre Lostis (à gauche),
aux côtés de Monsieur et Madame Dabard, le 6 octobre à
l'INSA de Rennes.
CiT É Lis
LA CITE VIRTUELLE
INTERNET
Crédit.. Mutuel
_de Bretagne_
1411771MG_ , 1-
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995 LES BRÈVES
Hommage
à René Dabard •
Rennes : le 6 octobre dernier, l'Institut
national des sciences appliquées
(INSA) rendait hommage à
René Dabard, son directeur depuis
1991. Chimiste de formation, René
Dabard a largement contribué à la
diversification des formations de
l'INSA, en ouvrant deux nouvelles
filières : "Génie mécanique et productique"
(parrainée par Citroën),
et "Électronique et systèmes de
communications". Il a amélioré la
vie étudiante par la construction
d'une nouvelle résidence et la
rénovation de l'ancienne. René
Dabard a également développé
l'activité de recherche, grâce au
soutien des collectivités (District,
Région).
Désiré Amoros
à I'INSA
Rennes : nous avons évoqué précédemment,
le départ en retraite de
René Dabard, directeur de l'Institut
national des sciences appliquées
de Rennes. Son successeur, Désiré
Amoros, est pour les Bretons un
personnage bien connu. Il a en
effet été Délégué régional à la
recherche et à la technologie
(DRRT), de 1984 à 1989, et assurait
en même temps le rôle de
chargé de mission auprès du Préfet
de région. "Cette époque a vu se
développer de nombreuses initiatives
en matière de promotion de
la recherche et du développement
technologique : mise en place du
réseau des conseillers technologiques,
des centres de transfert et
d'innovation (les CRITT), éveil de
la culture scientifique...", se souvient
Désiré Amoros.
L'INSA est également un terrain
connu pour Désiré Amoros, qui y a
enseigné pendant 10 ans, et y a
assumé plusieurs charges, dont la
direction des relations industrielles
et la responsabilité du service de
formation continue. En 1989, à la
suite de son mandat de DRRT, il a
été nommé à Toulouse, à la direction
de l'École nationale supérieure
d'électrotechnique, d'électronique,
d'informatique et d'hydraulique
(ENSEEIHT), avant de revenir à
Rennes en septembre dernier, pour
prendre la direction de l'INSA.
Rens. : Marie-France Kerlan,
tél. 99 28 65 93.
•
Désiré Amoros a été
enseignant à l'INSA de
1974 à 1984. Il en est
aujourd'hui le directeur.
Retour à l'herbe
Brennilis (29) : vingt-cinq experts
nucléaires de l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économiques) ont, quatre
jours durant, expertisé le démantèlement
de la centrale nucléaire de
Brennilis dans les monts d'Arrée.
Séduits par le démantèlement à la
bretonne, en fait d'une qualité
équivalente à celle des partenaires
occidentaux, les experts internationaux
ont rendu leur copie. Le
Belge Lucien Teuckens, président
de ce groupe de travail émanant de
la Nuclear energy Agency (créé
dans le cadre de l'OCDE), est
positif : "Le niveau technique et
scientifique des opérations est très
élevé." Pour le prochain stade de
démantèlement, on envisage
maintenant d'aller encore plus
loin, et de passer à ce que les
experts nomment un démantèlement
de niveau 3. C'est ce que
l'on appelle sur le site de la centrale,
"le retour à l'herbe".
► Rens. : Michel Noraz,
tél. 98 99 69 00.
Moyens
informatiques :
la "coop" du Ponant...
Brest : réunir les moyens informatiques
destinés aux élèves d'écoles
du Ponant comme l'ENSIETA
(École nationale supérieure des
industries et techniques d'armement),
l'UBO (Université de Bretagne
occidentale), l'ENIB (École
nationale d'ingénieurs de Brest)
ou d'autres, c'est l'objectif de
Michel Moan, directeur de l'IUP
Génie mécanique de Brest, qui a
lancé un projet d'Atelier inter-établissement
de production (AIP)
dans le cadre du plan État-Région.
Il s'agit en fait de la création d'un
véritable parc informatique commun,
qui permettra aux partenaires
de faire entre autres, des économies,
tout en assurant un renouvellement
plus facile du matériel. À
terme, on pourra même envisager
d'ouvrir ledit parc aux entreprises.
Cependant, si les 6 millions de
francs nécessaires à l'équipement
de base sont d'ores et déjà réunis,
cette coopérative nouvelle manière
ne devrait pas voir le jour avant
deux ans.
Internet via votre
banque
Rennes : le Crédit mutuel de Bretagne
(CMB) est la première
banque française à offrir à ses
clients un accès au réseau international
Internet. Baptisé Citélis, ce
service comporte, en plus de l'accès
au monde Internet, une galerie
marchande virtuelle, où l'on peut
réserver un voyage, lire un journal,
acheter du vin, directement à
partir de son compte bancaire.
Cette initiative permet d'étendre à
une large population la connaissance
du réseau Internet, dont
l'accès était jusqu'alors réservé
aux chercheurs et à quelques
entreprises. Le coût est particulièrement
attractif, puisque toute
personne équipée d'un microordinateur
et d'un modem devient
citoyen de Citélis pour seulement
15 F par mois plus le prix de la
communication (70 centimes la
minute de connexion).
► Rens. : Citélis, tél. 99 85 78 78.
Le radôme sert
aux rencontres
L'Agence de développement
industriel du Trégor (ADIT) et le
Musée des télécommunications
de Pleumeur-Bodou ont mis en
place les "Rencontres du radôme".
Avec un rendez-vous tous les
deux mois, les organisateurs incitent
tous ceux que la région
compte de décideurs, ingénieurs,
techniciens ou enseignants à venir
écouter les plus grands chercheurs
bretons. Ceux-ci défricheront
pour ce public tous les thèmes
d'avenir.
► Rens. : ADIT, tél. 96 46 42 28
ou Musée des télécommunications,
tél. 96 46 63 63.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
À lire
"Les cahiers de
biologie marine", édités
par la Station biologique
de Roscoff. Fondée par le
professeur Georges Teissier
en 1960, cette revue internationale
trimestrielle, abondamment
illustrée, publie en
anglais et en français, les
résultats de travaux réalisés
aussi bien à Roscoff qu'à
Santa Cruz en Californie ou
dans la mer du Japon. L'abonnement
est de 950 F par an.
► Rens. : Nicole Guyard,
tél. 98 29 23 04.
FORMATION
CONTINUE
S E P
LES BRÈVES
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Expositions
Jusqu'au 30 décembre/
Tous parents...
tous différents
Rennes : la connaissance sur nos origines a
beaucoup progressé cette dernière décennie
grâce à la biologie moléculaire et à la
génétique... Mais certaines avancées mettent
en cause nos principes moraux et
éthiques. Où en sont les grands travaux scientifiques ? Quelles sont leurs
implications sur notre société ? Comment quelques milliards d'êtres
humains sont-ils parents et pourtant tous différents ? Pour se distraire, une
maquette électronique, la "Loterie de l'hérédité", permet au public de
"fabriquer" la physionomie d'un enfant en fonction de ses parents.
Rens. : Espace des Sciences, tél. 99 35 28 28.
À partir du 8 janvier/
Aux origines de l'univers
Rennes : notre histoire est intimement liée à celle de l'univers. Elle a commencé
par une gigantesque explosion, le Big-Bang, il y a 15 milliards
d'années. Les atomes d'hydrogène qui entrent dans la composition des
molécules organiques de notre corps sont nés quelques minutes seulement
après le Big-Bang... Cette exposition est un véritable voyage à remonter
le temps, en compagnie d'Hubert Reeves.
Espace des Sciences : ouvert du lundi au vendredi de 12 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 10 h à 18 h 30. Entrée : 10 F, tarif réduit : 5 F, gratuit pour les moins
de 12 ans. Groupes le matin sur réservation uniquement.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Formation
Technologie
spécialisée
Brest, Quimper : créé et expérimenté
en 1994 dans quatre IUT
de la région lyonnaise, le Diplôme
national de technologie spécialisée
(DNTS) arrive à Brest et
Quimper. Le thème retenu pour le
DNTS finistérien est "Maîtrise de
l'environnement industriel", le
seul de ce type en France pour
l'instant. Il s'agit d'apprendre à
maîtriser les problèmes de pollution
dus à l'activité des entreprises,
une démarche qui correspond
bien aux tendances de
l'époque.
Dispensé à la fois dans des établissements
de Brest et Quimper,
ce diplôme a comme principale
originalité de comporter, en plus
d'un enseignement classique, des
stages suivis intégralement en
entreprise.
► Rens. : IUT Brest,
tél. 98 0160 50.
•
FORMATION CONTINUE UNIVERSITE DE RENNES1
INSTITUT DE -X.
FORMATION ::.. SUPÉRIEURE '•' '~ '-'
en INFORMATIQUE et COMMUNICATION
FORMATIONS
EN IPIFORMATIQUE
IRISA
L'Institut de Formation Supérieure en Informatique et Communication (IFSIC) et
L'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) proposent
FORMATIONS COURTES
Systèmes (UNIX, SYSTEMES DISTRIBUES, WINDOWS...)
Programmation (LANGAGE C, OBJETS-C++, PROLOG,
LANGAGES SYNCHRONES...)
Bases de données (ORACLE, BD RELATIONNELLES...)
Réseaux (RESEAUX DE MICROS, ADMINISTRATION ...)
Internet, Multimédia, Images numériques, Maintenance d'un
parc PC, Méthode MERISE etc...
Stages
ac
salariés
ala Formation Cessibles en
Possibilité
et de Continue
ss et d a dears aux
sur mesure eu intraa1 mA1oi
treprlse
FORMATIONS DIPLOMANTES
DESS Informatique Double Compétence (IDC)
DESS Informatique et Ses Applications (ISA)
MAITRISE Méthodes Informatiques Appliquées à la
info rFmOrmatiotts
aticieus o accessibles à
Par Valida t. hr°n.int°r des
Gestion (MIAGE) tl° d'Acqumatidiens
1 I F_MAT10NS
Service d'Education Permanente
4, rue Kléber 35000 RENNES
Tél. 99 84 39 50 Fax 99 63 30 33
Email: Henri.Cuvellier@univ-rennesl.fr 3615 F Choix ormation continue
1,01 F / mn
INFOREN 1
•
18et1-
--- . ddcembre
199
Gents
Qt tvolutio
de la lithosphtr
octaniqu
.
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995 LES BRÈVES
1er-2 décembre/
Les médias à l'Est
Rennes : le département "Sciences
de l'information et de la communication"
de l'université de Rennes 2
organise un colloque sur les médias
dans les pays de l'Est. Quatre
thèmes sont traités : l'information
de guerre en Europe, les médias
des minorités, médias et identités
de frontière, images et identités.
Rens. :Main Calmes,
tél. 99 14 15 85.
7 décembre/
Soins ambulatoires
Rennes : l'Observatoire régional
de santé de Bretagne (ORSB) organise
une rencontre des professionnels
de santé libéraux de la région
Bretagne, à l'École nationale de la
santé publique (ENSP). Plusieurs
débats sont au programme, notamment
sur les informations nécessaires
à une meilleure connaissance
de l'état sanitaire d'une population,
sur les modes actuels de coordination
des professionnels de
santé libéraux, sur le rôle technique
de l'ORSB et sur les perspectives
d'avenir.
► Rens. : Odile Picquet,
tél. 99 33 98 94.
18-19 décembre/
Géosciences marines
Brest : plus de 200 personnes sont
attendues au Quartz, pour confronter
leurs derniers résultats sur la
croûte océanique, lors de ce colloque
organisé principalement par
l'URA CNRS GEDO "Genèse et
évolution des domaines océaniques",
un laboratoire de l'université
de Bretagne occidentale, et par
la Société géologique de France
(SGF).
► Rens. : Pascal Gente,
tél. 98 01 61 79.
Biologie-santéculture
Les rencontres Biologie-santéculture
1995 sont organisées
par le CCSTI, la Ville de
Rennes et le centre culturel
Triangle. Elles présentent le
bilan de 50 années de recherche
sur le cancer. Au Triangle,
à 20 h 30, entrée libre.
Rens.: CCSTI,
tél. 99 35 28 20.
5 décembre/
Environnement et
cancer
Rennes : spécialiste de gastroentérologie
à l'hôpital Avicenne
de Bobigny, Robert
Benamouzig expose l'implication
des facteurs exogènes
(environnementaux, alimentaires...)
dans la survenue
d'un cancer de l'cesophage. Il
évoque, en particulier, l'effet
de l'alcool et du tabac.
Les mercredis
de la mer
Ces conférences sont
organisées par le
CCSTI et le centre
IFREMER de Brest,
en collaboration avec
la fondation Natures & découvertes.
À la Maison du Champ de
Mars, à 20 h 30, entrée libre.
► Rens. : CCSTI, tél. 99 35 28 20.
13 décembre/
Technologie - 6000 m
Rennes : c'est au tour de Patrick
Nérisson, chef du service des relations
publiques du Centre IFREMER
de Brest et co-organisateur
de ces conférences "Les mercredis
de la mer", de venir nous parler
des engins sous-marins, habités ou
non, qui descendent sans frémir
jusqu'à 6000 mètres de profondeur.
Embarquement immédiat à
bord du Nautile...
10 janvier/
Les pesticides en
milieu marin
Rennes : les pesticides regroupent
herbicides, insecticides et fongicides.
Destinés à améliorer la qualité
et le rendement des cultures, et
à protéger les bâtiments et les axes
de circulation, ils sont hélas rejetés
en grande quantité dans la plupart
des rivières et dans la mer, où ils
nuisent à la croissance des algues
et provoquent divers dégâts encore
mal connus. Gaël Durand, chargé
de mission à la Communauté
urbaine de Brest, prend l'exemple
de la rade de Brest.
Conférences
à Océanopolis
A 20 h 30, à l'auditorium
d'Océanopolis,
port du Moulin-Blanc,
entrée libre.
Rens. : Chantal Guillerm,
tél. 98 00 96 00.
6 décembre/
La météo, élément
de sécurité en mer
Brest : le domaine maritime est
divisé en plusieurs parties, chacune
d'entre elles bénéficiant de
bulletins météorologiques qui sont
diffusés par des moyens radio
appropriés, mais aussi par radio
VHF, fax, répondeurs téléphoniques,
Minitel, médias. "Tout ce
dispositif n'a qu'un but : assurer
la sécurité en mer", explique
Claude Fons, directeur départemental
de Météo France.
10 janvier 1996/
Les marées
Brest : les populations littorales
vivent depuis des temps immémoriaux
au rythme des marées. Deux
fois par jour, la mer monte et descend,
couvrant et découvrant de
plus ou moins vastes étendues.
Dans ces rythmes, on retrouve les
rythmes astronomiques de ce formidable
ballet de la Terre, de la
Lune et du Soleil.
r
MEN. a f 1T Of ITTOYATION MET AG.
Président du CCSTI : Paul Tréhen.
Directeur de la publication : Michel
Cabaret. • Rédacteur en chef : Hélène
Tattevin. n Collaboration : Françoise
Boiteux-Colin, Marc-Élie Pau. • Comité
de lecture : Louis Rault, Christian
Willaime, Gilbert Blanchard, Monique
Thorel. • Abonnements/Promotion
Béatrice Texier, Danièle Zum-Folo, Alain
Diard. • Publicité : Événement Média,
BP 33 - 35511 Cesson-Sévigné Cedex,
tel. 99 83 77 00.
RÉSEAU est publié grâce au soutien
de la Region Bretagne, du
secrétariat d'Eta! à la Recherche,
des départements du Finistère et
d'Ille et Vilaine, de la Ville de
Rennes et de la Direction régionale
des Affaires culturelles. Édition :
CCSTI. Réalisation : Pierrick Bertôt
Création Graphique, Ces.son•
Sévigné.
QUI A DIT 4
Réponse de la page 6
Le chanteur Renaud Séchan.
Pour recevoir
RÉSEAU,
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement pour 1 an (Il numéros)
Tarif : 200 F
Abonnement de soutien : 300 F
Abonnement étudiants : 100 F
Nom
Prénom
Organisme/Société
Adresse
Ville
Code postal
Tél.
Facture OUI E NON q
Bulletin d'abonnement et chèque à retourner à :
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES.
Tél. 99 35 28 20.
Faites découvrir
RÉSEAU à vos amis
Donnez-nous les coordonnées de
votre ami, il recevra gracieusement
le prochain numéro de Réseau
Nom
Prénom
Organisme/Société
Adresse
Ville
Code postal
\ Tél.
R 11
RÉSEAU 117 • DÉCEMBRE 1995
Colloques Conférences
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE
Medra Graphic, Rennes. T61. 99 66 718 6.
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest