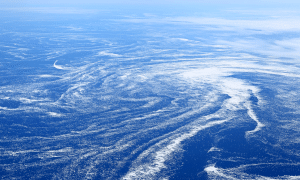Les prix Bretagne Jeune chercheur
FÉVRIER 1996•N•119•20F MENSUEL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN BRETAGNE
DOSSIER
Les prix Bretagne
Jeune chercheur
LES RESSOURCES
DE L'ANTARCTIQUE
LE MULTIMÉDIA
ENTRE AU MUSÉE
LA SIDÉRURGIE EN
BRETAGNE AU 18e SIÈCLE
François d'Aubert, secrétaire
d'État chargé de la Recherche
aux côtés d'Yvon Bourges
(à gauche), président du Conseil
régional, lors de la remise des
prix Bretagne Jeune chercheur,
le 18 décembre 1995.
ÉDITORIAL
SOMMAIRE
La vie des labos
Les ressources
de l'Antarctique
Le projet Jasmin
La vie des entreprises
Nortia : Notre-Damedes-
Sauvegardes
Les sigles du mois
LE DOSSIER
Les prix Bretagne
Jeune chercheur o~®
La vie des entreprises
Anticipa : le multimédia
entre au musée
Histoire et Société
La sidérurgie en Bretagne
au 18e siècle
Les Brèves
de Réseau
Ces algues
diatomées,
du genre
Chaetoceros sp.,
typiques des
régions côtières
des eaux
tempérées,
illustrent les travaux de recherche
d'Olivier Ragueneau, lauréat
en "Sciences de la vie" du prix
Bretagne Jeune chercheur.
Rectificatif de l'article "Privé/public : une unité
commune de recherche" (Réseau n°118) : l'appareillage
de Résonance magnétique nucléaire de la
nouvelle URA 401 (CNRS-Muséum national d'histoire
naturelle-Girex Mazal) est financé à hauteur
de 1,6 MF par le FNADT (Fonds national d'aménagement
du territoire) et non pas par le FNATH.
RÉSEAU est édité par le Centre de culture scientifique
technique et industrielle (CCSTI).
Tirage mensuel : 4 000 ex. Dépôt légal n°650. ISSN 0769-6264.
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 Rennes.
Tél. 99 35 28 22. Fax 99 35 28 21. e-mail ccsti@univ-rennesl .fr
Antenne Finistère : CCSTI, 40, rue Jim Sévellec, 29608 Brest Cedex.
Tél. 98 05 60 91. Fax 98 0515 02.
o'o
o
o
m
1h
Création de réseaux et
valorisation de la recherche
Lors de la remise des premiers "prix Bretagne Jeune chercheur",
François d'Aubert, le secrétaire d'État chargé de la Recherche, a félicité
notre région pour sa politique de la recherche. Il a aussi insisté sur
l'importance de la culture scientifique "élément essentiel qui contribue
à la valorisation de la recherche, au niveau national et mondial, et favorise
l'accès à la connaissance".
Dans le discours qu'il a prononcé le 18 décembre dernier au Conseil
régional, François d'Aubert a, par ailleurs, prononcé plusieurs fois le mot
"réseau" : "Il faut créer des réseaux de compétences pour valoriser la
recherche" ou encore "Il faut renforcer le travail en réseau afin de
présenter l'image d'une Bretagne scientifique innovatrice et imaginative".
L'emploi de ce vocable n'a, bien entendu, pas échappé à notre rédaction.
En effet, il a parfaitement résumé les objectifs que le CCSTI s'est fixés !
Mais, à propos, qu'est-ce qu'un "réseau" ?
Le dictionnaire Petit Robert nous indique que ce mot, datant du 13e siècle,
provient de "rets" (filet), lui-même issu du latin "retiolus". Pour un
chimiste, un "réseau", c'est une disposition régulière des atomes au sein
d'un cristal. Un électronicien vous expliquera qu'il s'agit d'un ensemble
de fonctions logiques élémentaires interconnectées pour constituer des
fonctions complexes. Un hydrologue vous parlera de réseau
hydrographique : c'est l'ensemble des fleuves et de leurs affluents drainant
une région. Un réseau, c'est aussi un entrelacement de vaisseaux
sanguins, ou un ensemble de nerfs qui se ramifient et s'entrecroisent.
Vous avez déjà probablement emprunté le réseau autoroutier, le réseau
express régional et avez bénéficié des émissions d'un réseau de télévision.
À l'aube de l'ère des autoroutes de l'information, vous ne passerez pas,
non plus, à côté des réseaux informatiques, des réseaux câblés...
Enfin, un "Réseau" (avec une majuscule !), c'est un journal de 24 pages
tout en couleurs, unique en son genre, qui souhaite instaurer, chaque
mois, un véritable échange avec son lectorat et lui offrir une information
de qualité sur la science et l'innovation en Bretagne ! n
Michel CABARET
Directeur du CCSTI
FEBRUARY 1996 • N• 119 MONTHLY MAGAZINE OF RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY
Abstracts for the international issue
~
EDITORIAL
NETWORKS
AND ENHANCEMENT
OF RESEARCH
page 2
In his speech to the Regional
Council on 18th December last,
François d'Aubert, Secretary of
State for Research, congratulated
our region for its policy of
encouraging research and
underlined the importance of
scientific knowledge.
Information: Michel Cabaret,
fax (33) 99 35 28 21,
e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
THE WORLD OF
SCIENTIFIC RESEARCH
NATURAL
RESOURCES
IN ANTARCTICA
t This diatom, a member
of the Chaetoceros sp. genus,
is a common sight in
warm, coastal waters.
It illustrates the research
work undertaken
by Olivier Ragueneau,
winner of the Life Sciences
section in the Brittany
Young Researcher of the
Year awards.
pages 3 and 4
Paul Tréguer, the Director of the new Institut
universitaire européen de la mer (European
Maritime University Institute) in
Brest, paints a picture of the marine
resources found in the oceans of the southern
hemisphere. Antarctica has been
classified as a "world reserve" since 1959.
CO2, diatoms, zooplankton, whales and
fish are just some of the links in the food
chain within this area. French scientists are
working to find out more about the marine
resources and preserve the existing equilibrium.
Information: Yves Frenot, fax (33) 99 07 87 60
or Paul Tréguer, fax (33) 98 0166 36.
THE WORLD OF SCIENTIFIC RESEARCH
JASMIN PROJECT
page 5
At the beginning of 1995, France Télécom
launched the CNET JASMIN project with
a view to defining and developping new
multimedia services such as films, telematic
services etc. This project is just part of
a national program aimed at expanding the
information superhighways.
Information: François Picand, fax (33) 9912 40 98,
e-mail picand@ccett.fr
THE LIFE OF COMPANIES
NORTIA MAKES
DATA SECURE
page 6
The Nortia company in Brest specialises in
data storage for businesses. Didier Flament,
Nortia's Managing Director who originally
set the company up, convinces
potential customers of the usefulness of his
services by saying, quite simply, "Imagine
what would happen if somebody stole your
computer". Nortia is also involved in the
Save the Babies project, a software program
designed to prevent infant cot deaths.
Information: Didier Flament,
fax (33) 98 05 47 67.
THE LIFE OF COMPANIES
ANTICIPA : MULTIMEDIA
FOR MUSEUMS
page 17
The Système G company designs "talking
machines" for museums. By simply pressing
a button, visitors can hear a pre-recorded
commentary. The company has also
developed a new machine which emits
smells! The Faros company specialises in
simulation (ship control, flight etc.). It will
soon be presenting its car driving simulator
as part of the "Automobile" exhibition to
be held in the Cité des Sciences et de l'Industrie
in Paris.
Information: Anticipa,
fax (33) 96 46 49 04.
HISTORY AND SOCIETY
IRON PRODUCTION IN
18TH-CENTURY BRITTANY
page 18
In the 18th Century, the province of Brittany
(which, in those days, also included
what we now know as the département of
Loire-Atlantique) was a major iron producer
with a large number of works, each
employing some two hundred people,
thirty of whom worked on the shop floor.
The remainder were miners, lumberjacks,
charcoal burners, and carters. Iron brought
obvious prosperity to the Châteaubriant
area but very little now remains of this rich
industrial past.
Information: Christian Delaunay,
fax (33) 99 7816 08.
These abstracts in English are sent to
foreign universities that have links with
Brittany and to the Scientific Advisers in
French Embassies, in an effort to widen
the availability of scientific and technical
information and promote the research carried
out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts
on a regular basis, with a copy of the corresponding
issue of "RESEAU", please
contact Hélène Tattevin, Editor, Fax (33)
99 35 28 21, e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
Brittany Regional Council is providing
financial backing for this service.
[ C. I O N
Mallill111111111
-
BRETAGNE I
Brittany is the 7th most-populated
region in France, with 2.8 million
inhabitants, but it is the leading French
region as regards research in the fields of
telecommunications, oceanography,
and agricultural engineering.
SEAU FEBRUARY 1996•N•11
DOSSIER
The "Brittany Young Researcher
of the Year" Awards
THE "BRITTANY YOUNG
RESEARCHER OF THE YEAR"
AWARDS
page 9
Brittany has just organised the first Brittany
Young Researcher of the Year awards which
reflect the dynamism and excellence of
research undertaken in the region.
THE AWARD CEREMONY
page 10
The first Brittany Young Researcher of the Year
awards were made at a ceremony held on 18th
December last in the Regional Council offices
in the presence of François d'Aubert, Secretary
of State for Research. In his speech, he expressed
to all those involved in the Brittany Young
Researcher of the Year scheme his satisfaction
with, and admiration for, the research projects.
Information: Catherine Mallevaës (Brittany Regional
Council), fax (33) 99 38 85 75.
YVON ROCABOY, PRIZEWINNER
IN THE HUMAN AND SOCIAL
SCIENCES SECTION
page 1I
Yvon Rocaboy, aged 33, is a Breton born and
bred (he comes from Saint-Brieuc) and is a lecturer
in the School of Economics in Rennes.
His very wide field of study concerns the determining
factors in local public expenditure, an
area of economic research in which applied
mathematics constitute the main tool.
Information: Yvon Rocaboy, teL (33) 99 25 35 45,
fax (33) 99 38 80 84,
e-mail Yvon.Rocaboy@univ-rennes1.fr
PATRICK PEREZ,
PRIZEWINNER IN THE SCIENCE
OF MATTER SECTION
page 12
Patrick Pérez is a research fellow with INRIA
(Institut national de recherche en informatique
et en automatique, National computer and automation
research institute) in Rennes where he
develops statistical models for use in the automatic
analysis of image sequences provided by
a camera. His main area of research falls within
the framework of the ITR (Informatique - Télécommunications
- Réseaux, Computing/Telecom/
Networks) programme which is backed by
the Regional Council.
Information: Patrick Pérez, fax (33) 99 84 7171,
e-mail pérez@irisa.fr
A
Pictures of Western France taken by
the American NOAA satellite between
May and October 1989, illustrating
the work of Vincent Dubreuil.
OLIVIER RAGUENEAU,
PRIZEWINNER IN THE LIFE
SCIENCES SECTION
page 13
Olivier Ragueneau, aged 28, is a research fellow
in the CNRS (Centre National de
Recherche Scientifique, National scientific
research centre) within the University of Western
Brittany in Brest and has worked at the Institut
universitaire européen de la mer. In
particular, he defined the relationship between
the presence of geochemicals (nitrates, phosphates,
and silicates) in coastal waters and the
growth of phytoplankton.
Information: Olivier Ragueneau, tel (33) 98 0170 02,
fax (33) 98 0166 36,
e-mail raguene@univ-brest.fr.
SIX SPECIAL MENTIONS
pages 14 and 15
In addition to the three first prizes, the jury
awarded two special mentions in each of the
disciplines.
Human and Social Sciences
Vincent Dubreuil has a Ph.D in Geography and
has studied the problem of drought in Western
France. Daniel Leloup has written a thesis on
the history of architecture entitled L'architecture
urbaine dans le Trégor aux XV` et XVI'
siècles (Urban Architecture in the Trégor area
in the 15th and 16th Centuries).
Information: Vincent Dubreuil, fax (33) 99 14 17 85,
e-mail Vincent.Dubreuil@Uhb.Fr
Daniel Leloup, fax (33) 99 14 15 05.
Science of Matter
Nathalie Guillon has a Ph.D in Chemistry and
was awarded a special mention for her work on
the synthesis and definition of nitrates of
cerium (III) and (IV). Marylise Le Cointe, who
has a Ph.D in physics, has studied the understanding
of physical mechanisms behind the
electronic or optical properties of molecular
materials.
Information: Nathalie Guillou, fax (49) 6151/166023,
e-mail djlk@hrzpub.th-darmstadt.de
Marylise Le (ointe, fax (33) 99 28 6717,
e-mail lecointe@univ-rennesl.fr
Life Sciences
Joan van Baaren's research has centred on the
parasitism of certain insects (parasitic Hymenoptera).
Christophe Jamin has written a thesis
on the mechanisms implied in the occurence of
so-called "auto-immune" diseases.
Information: Joan van Baaren, fax (33) 99 28 69 27,
e-mail jpr@univ-rennesl.fr
Christophe Jamin, fax (33) 98 80 10 76,
e-mail Jamin@univ-brest.fr
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. (33) 99 35 28 22 - Fax (33) 99 35 28 21 - e-mail ccsti@univ-rennesl.fr
Antenne Finistère: CCSTI, 40, rue Jim Sevellec, 29608 BREST Cedex. Tél. (33) 98 05 60 91 - Fax (33) 98 05 15 02
La vie des labos
Depuis 1959, le continent
Antarctique est classé
"réserve mondiale". Cette année,
un autre projet se met en place
pour attribuer un statut de réserve
aux îles sub-antarctiques, parmi
lesquelles figurent 4 territoires
français : Kerguelen, Amsterdam,
Saint-Paul et Crozet. Il est important
de savoir comment préserver
les ressources de cette région, et
en particulier sa macrofaune, une
population qui comporte environ
10 millions de phoques, 400 millions
d'oiseaux et 850000
baleines. "Les animaux de cette
région du monde sont parfaitement
adaptés à leur milieu et très
spécialisés. Il existe, par exemple,
des espèces animales, comme la
mouche sans ailes, qui ne vivent
que sur une île. On trouve la
même chose pour la flore : alors
que certaines îles sont couvertes
d'une végétation variée, d'autres
ne possèdent qu'une seule variété
d'herbe : les lapins implantés ici
par les navigateurs à la fin du
siècle dernier ont mangé tout le
reste", explique Yves Frenot,
chercheur à la Station biologique
de Paimpont.
Présentation
de l'océan Austral
Ouvert sur les trois grands
océans du globe, le Pacifique, l'Indien
et l'Atlantique, l'océan Austral
est un océan très agité, redouté
des navigateurs. Ses 76 millions de
kilomètres carrés sont, en quelque
sorte, au centre du monde "vu du
dessous". Le continent Antarctique,
presque entièrement recouvert
de glace, s'étend sur 13 millions
de kilomètres carrés. A sa
périphérie, l'océan Austral se divise
en quatre ceintures, séparées par
des fronts thermiques : ce sont des
lignes de part et d'autre desquelles
la température varie brutalement de
plusieurs degrés. "Ces ceintures
océaniques agissent directement
sur le climat et leur déplacement,
au nord ou au sud, pourrait exercer
une influence considérable sur
la vie antarctique et sub-antarctique",
poursuit Yves Frenot.
La chaîne
alimentaire
Le dioxyde de carbone est au
commencement de toute vie :
contenu dans l'atmosphère, il est
•
Manchots royaux (adultes
et poussins) sur l'Ile de la
Possession (archipel Crozet).
Au fond, on peut voir
le Marion Dufresne
première version, remplacé
aujourd'hui par le Marion
Dufresne 11. Au troisième
plan, on aperçoit I'Ile de
l'Est, distante d'une
trentaine de km de l'Ile de
la Possession.
en partie absorbé par la surface de
l'océan Austral(2'. Les algues
planctoniques et, en particulier, les
algues siliceuses comme les "diatomées",
se nourrissent de ce COz
et sont à leur tour mangées par le
zooplancton, principalement le
krill. Cette crevette vorace, longue
de 4 à 5 cm, se déplace en bancs et
constitue l'aliment de base des
baleines, calmars, phoques et poissons,
qui suivent les bancs de krill
dans tout l'océan Austral, naviguant
entre l'Afrique du Sud,
l'Australie et le Cap Horn.
En colonies denses sur les îles
antarctiques et sub-antarctiques, leesst►"-
Les ressources
de l'Antarctique
Le Marion Dufresne II vient de rencontrer ses premiers
glaçons en Antarctique. Accueilli par Yves Frenot, chercheur
à la Station biologique de Paimpont, dans le cadre
des "Mercredis de la mer""), Paul Tréguer, directeur du
nouvel Institut universitaire européen de la mer à Brest,
présente un tableau des ressources marines de l'océan
Austral. Il décrit en particulier un étrange animal : le
krill...
RRÉÉSSEEAAUU 119 • FÉVRIER 1996
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
oiseaux de mer (manchots,
albatros...) se nourrissent de poissons
et des cadavres des autres
animaux. Comme l'ont montré de
récentes expériences'>, ces oiseaux
parcourent de très longs trajets
pour trouver leur nourriture. Pour
boucler le cycle, les fientes et
cadavres des oiseaux engraissent
la terre des îles, sur lesquelles
pousse une végétation très surprenante,
comme ce fameux "chou
des Kerguelen".
Le cycle du krill
Toutes les populations australes
sont tributaires du krill, c'est pourquoi
les scientifiques s'attachent à
mieux connaître la biologie de
cette crevette. "Elle est présente
en abondance : l'homme pourrait
même se permettre de pêcher
davantage de krill, pour compenser
la diminution des prises de
poissons", explique Paul Tréguer.
Parmi les facteurs qui semblent
empêcher le phytoplancton de se
développer, la turbulence du
milieu joue un grand rôle. Mais en
bordure du "pack" (glace de mer),
au moment du dégel, l'arrivée
d'une eau plus douce dans l'eau
de mer limite ces turbulences, la
mer est plus calme et s'enrichit de
toutes les petites algues qui étaient
prisonnières de la glace. C'est
pour le krill le moment idéal pour
s'épanouir et pondre. "De par leur
gravité, les veufs tombent dans
les eaux profondes de l'océan,
les différents stades larvaires se
développent à l'abri des turbulences
et les jeunes larves remontent
pour se retrouver, quelques
mois plus tard, à nouveau au
bord du pack et de son cortège
phytoplanctonique."
Menaces sur
l'océan Austral
Pour l'instant, les populations
animales ne semblent pas menacées.
Bien sûr, les différents
océans communiquent entre eux
et les polluants déversés sur tous
les rivages du monde se retrouveront
dans l'océan Austral, mais pas
avant quelques centaines d'années,
car le cycle de renouvellement des
océans est très long : par exemple,
au large de Brest, à 4000 m de
profondeur, 10 % de l'eau de mer
vient de l'Antarctique, après un
voyage de 700 à 800 ans !
À propos de la pêche et de la
chasse, leur réglementation, depuis
le traité de l'Antarctique (1959),
permet aux ressources marines de
se renouveler chaque année. `La
surpêche opérée par les navires
usines a provoqué la disparition
quasi totale de certaines espèces
de baleines, mais d'autres se sont
maintenues", reprend Yves Frenot.
Les otaries, après avoir été
décimées pour leur fourrure, vivent
aujourd'hui en paix et sur certaines
îles, leur population double tous
les ans... mettant en péril les autres
animaux : n'oublions pas que
l'équilibre dans ces régions est
extrêmement fragile ! Yves Frenot
met en garde contre une nouvelle
menace : l'essor du tourisme. Près
de 12000 personnes sont venues
"visiter" l'Antarctique en 1994.
Comment ces nouveaux "animaux"
vont-ils être perçus par les
populations en place ? n
H.T.
V Contacts
Yves Frenot Tél. 99 61 81 81
Paul Tréguer Tél. 98 01 61 52
"' Ces conférences sont organisées par le centre
IFREMER de Brest et le CCSTI. '" C'est
d'ailleurs l'une des grandes questions en matière
d'environnement global : dans quelle mesure
l'océan Austral peut-il absorber une partie du surplus
de COs introduit par l'homme dans l'atmosphère
par la combustion des énergies fossiles ?
Des balises Argos, émettant des signaux réguliers
vers des satellites, ont été fixées sur le dos
des oiseaux pour suivre leurs déplacements.
Le Centre Commun d'Etudes
de Télédiffusion et Télécommunications
Le
CClï17,
Centre de Recherche
commun à France
Telecom et à TDF
(Télédiffusion de France),
contribue activement à
l'essor de l'Audiovisuel et de
la Télématique en France et
dans le monde.
Créé à Rennes en 1972 et
organisé en Groupement
d'Intérêt Economique depuis
1983, il accueille dans ses
locaux 400 personnes.
Situé au coeur du Technopole
de Rennes Atalante, le Coe1T
conduit une politique active de
valorisation de ses travaux
auprès des entreprises de la
région.
Les travaux du CCETT portent
sur :
les services de télévision
numérique sur : câble coaxial,
fibre optique, satellite et réseaux
hertziens. Ces thèmes recouvrent
les différentes composantes
techniques des services et des
terminaux, les procédures et outils
de tests associés, ainsi que
l'étude des différents usages.
les services multimédias :
services de consultation de
documents audiovisuels ou
services multimédias à destination
de mobiles s'appuyant sur la
coopération de réseaux de
diffusion et de
télécommunications.
les terminaux multiservices
mettant en synergie différents
services de base tels que la
télécopie, la vidéographie, le
téléphone, la messagerie, etc.
Parmi les innovations
marquantes dont la paternité peut
être, sans contestation, attribuée
au CCETT, il y a la norme X25 et
le réseau TRANSPAC, le MINITEL
et les services du réseau
TELETEL, le premier studio de
Télévision numérique, la norme
Eurocrypt avec le développement
du système Visiopass pour la
télévision payante, les techniques
de base pour la radiodiffusion
sonore numérique et la diffusion
numérique de télévision pour le
câble, l'hertzien et le satellite.
Dans tous ses domaines
d'étude, le CCETT prend
une part active à la promotion
des conceptions françaises
dans les organismes
internationaux de normalisation,
ainsi que dans les programmes
européens de Recherche et
Développement (ESPRIT, RACE,
EUREKA...)
4, rue du Clos Courtel - B.P. 59
35512 CESSON-SÉVIGNÉ Cedex
Tél. (33) 99.12.41.11- Fax : 1331 99.12.40.98
La vie des labos
Une plate-forme générique pour...
Outils d'édition ` S_erv_eu_r .` services mAénnduaiiare tdieos n
Ale AliraWirM11 -.11111114101.
Serveur f<24, Réseau dAeT tMra nsport • ` ortzur
Frontal',tai
op
ti
que
4
Réseaux 1V
paricnibuIerivipik
iiih Fsib re int t
... Services Télétel multimédia
Actualités à la demande
Vidéo à la demande
•
Architecture de la plate-forme Jasmin.
Le projet Jasmin
France Télécom a lancé,
début 1995, le projet CNET"'
Jasmin, dont l'objectif est
de formaliser et de développer
de nouveaux services de
type multimédia : films,
reportages ou actualités à la
demande, services télématiques
enrichis de séquences
audiovisuelles, téléachat... À
Rennes, le CCETT"' assure
la maîtrise d'oeuvre de
ce projet, inscrit parmi
d'autres dans le programme
national de développement
des "autoroutes de l'information".
Jasmin est un projet de plateforme
technique, qui, dès le
milieu de l'année, servira à expérimenter
des services de consultation
multimédias pour plusieurs
milliers d'utilisateurs, particuliers
et professionnels. Derrière Jasmin
se prépare, en particulier, notre
télévision de demain. Non plus
simple support pour des programmes
diffusés, et donc imposés,
mais interface entre les fournisseurs
de services et l'usager,
qui pourra désormais composer
son propre programme.
Cette plate-forme, développée
par le secteur audiovisuel interactif
sous la responsabilité de François
Picand°1, s'appuie sur l'expérience
acquise au CCETT depuis
1993 dans ce domaine. Un premier
démonstrateur, appelé SARI,
a permis de réaliser un prototype
et des maquettes de services vidéo
à la demande, ainsi que les premiers
tests de fonctionnement et
d'usage du système.
Fédérer les réseaux
d'accès
La plate-forme Jasmin prend en
compte tous les maillons de la
chaîne, du producteur au consommateur
: les serveurs, les services
de médiation (ex. : annuaire des
services, paiement...), une interface
technique appelée "frontal" et
enfin, les terminaux, téléviseur ou
PC (voir schéma). Il est également
prévu la mise à disposition d'outils
pour les fournisseurs de services,
comme l'aide à l'édition
pour les menus, les pages d'accueil...
Le réseau ATM (réseau
numérique à haut débit) est utilisé
pour l'interconnexion entre les
différents serveurs et la tête de
réseau. Le frontal, en relation avec
les services de médiation, assure
le lien entre les serveurs et les utilisateurs.
Un des points forts de cette
plate-forme est de fédérer plusieurs
réseaux d'accès. Elle s'appuie
sur les réseaux de distribution
déjà existants, comme les réseaux
câblés et téléphoniques (technologie
ADSL(4) sur support cuivre),
mais aussi sur les futurs réseaux
de distribution en fibre optique,
réseaux hertziens et réseaux
locaux d'entreprises.
Pour se connecter, deux possibilités
: un micro-ordinateur multimédia
ou une télévision avec
décodeur (une petite boîte posée
sur la télé, appelée "set top box").
"La télévision est synonyme de
loisirs, alors que l'ordinateur sert
davantage pour des usages professionnels.
Aussi, la convergence
PC/TV n'est pas pour demain.
Néanmoins, des passerelles sont
envisagées, comme se connecter
au réseau via un décodeur, puis
transférer l'application demandée
sur son ordinateur".
Un maître mot,
l'interactivité
Au salon Télécoms 95, qui s'est
tenu à Genève du 3 au 11 octobre
dernier, le CCETT a présenté
quatre exemples de service : filins
à la demande, informations sur le
cyclisme, informations à la
demande et réservations d'hôtel.
"Chaque soir, le journal de 20 h
de TFl était numérisé, découpé,
indexé et stocké sur le serveur, à
Rennes. Le lendemain à Genève,
les visiteurs pouvaient sélectionner
la séquence de leur choix,
actualités internationales, sport...
La séquence choisie transitait de
Rennes à Genève, via Paris, par
le réseau ATM, puis arrivait sur
deux terminaux via la fibre
optique ou le support cuivre, avec
la même qualité ".
De même, les 23 000 services
Télétel disponibles (3615, 3616...)
sont une source de choix pour proposer
des services télématiques
enrichis de séquences audiovisuelles.
Ainsi, un des services présentés
par le CCETT permettait,
parmi une sélection de 15 hôtels,
de visualiser le quartier, l'hôtel, la
chambre, de connaître les services
proposés et de réserver.
Les aspects ergonomiques sont
étudiés avec soin. "Les ergonomes
préparent des scénarios
d'utilisation, qui mettent en jeu
toutes les fonctions. Puis, sous
caméra vidéo, des utilisateurs testent
ces scénarios en binôme, ce
qui leur permet d'exprimer les
problèmes qu'ils rencontrent ;
80% des difficultés d'utilisation
apparaissent lors de ces séances",
explique François Picand.
Objectif : vendre
Un autre point fort du projet est
la préoccupation commerciale.
"Les services de médiation assurent
le lien entre le prestataire de
service et l'utilisateur final. Il faut
des systèmes qui permettent de
contrôler l'accès aux services :
reconnaissance de l'utilisateur,
vérification de ses droits..., puis de
faire connaître la demande auprès
du fournisseur. Le contrôle du
paiement, que ce soit par abonnement
ou par carte bancaire, est
aussi une de nos préoccupations"
assure François Picand.
Le succès de ces services multimédias
dépendra de l'attitude des
utilisateurs. Sont-ils prêts pour ce
type de service, et à quel prix ?
Pour répondre à ces questions, le
projet Jasmin va prochainement
déboucher sur une expérimentation
technique, auprès d'une population
représentative des utilisateurs
résidentiels et professionnels.
La phase commerciale est prévue
pour 1997. À suivre... n
M.G.
Contact ► Francois Picand
Tel. 99 12 46 91
e-mail picand@ccett.fr
"' CNET : Centre national d' études des télécommunications.
"' CCETT : Centre commun
d'études de télédiffusion et télécommunications.
"'François Picand est chef du projet CNET Jasmin
au CCETT.'') La technologie ADSL (Asymetric
digital subscriber line) permet de transporter
sur le réseau téléphonique commuté (RTC) des
informations avec des débits importants sur de
courtes distances (quelques kilomètres).
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Contact ► Didier Flament
Tél. 98 05 51 59
La vie des entreprises
tt I a société est née suite à une
étude menée lorsque j'étais à
l'Institut d'informatique industrielle
(3i). J'avais constaté que la
sécurité de l'information était, en
général, mal assurée dans les
entreprises. Que ce soit celle des
fichiers informatiques, de certains
papiers jetés dans une poubelle,
des carbones de paye...
C'est cependant au niveau de
l'informatique que résidait la
plus grosse lacune : mauvaise
organisation des machines, au
niveau de la place disque et des
répertoires, sauvegardes mal
faites, trop partielles, ou encore
effectuées sur des disquettes qui
restent à côté de la machine :
imaginons simplement ce qui
peut arriver en cas de dégât des
eaux", explique Didier Flament,
fondateur et directeur de la
société. Pour bien faire comprendre
le type d'aide que la
société peut fournir, Nortia use
d'une proposition qui a le mérite
d'être simple : "Imaginez que l'on
vous vole votre ordinateur..."
L'utilisateur informatique se
rend ainsi compte des éventualités
auxquelles une mauvaise sauvegarde
l'expose. Aussi, le premier
service proposé par Nortia est
celui de la sauvegarde des données
informatiques, voire leur
récupération en cas de pépin.
"Dans les entreprises, nous sauvegardons
tous les 15 jours, pour
des machines supportant la
comptabilité et la paye, par
0 RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
exemple. Pour des postes moins
essentiels, nous réalisons une
sauvegarde mensuelle. Cela se
fait sur un petit enregistreur qui
sauvegarde sur DAN" jusqu'à
8 gigaoctets. À un moment donné,
nous sauvegardons également la
totalité du disque dur, en deux
exemplaires, qui iront ensuite
dans le coffre de la société et
celui de la banque. Le risque de
perdre des données devient ainsi
extrêmement faible", poursuit le
directeur.
Multi-services
À côté des sauvegardes, essentielles
pour les entreprises informatisées
dont l'activité passe souvent
intégralement par l'utilisation
extensive de la micro-informatique,
Nortia s'attaque à tous les
problèmes que connaissent bien
les utilisateurs. Qui n'a jamais
"planté" un traitement de texte ne
comprendra pas le besoin d'une
aide secourable... Pour les autres,
appeler une personne compétente
peut s'avérer indispensable pour
ne pas perdre temps et données.
Dans le cadre d'un contrat annuel,
le spécialiste pourra même se
déplacer, si le problème l'exige.
Bien sûr, un service de ce type va
normalement avec la fourniture de
matériel informatique, mais "nous
ne sommes liés à aucune marque
ni fournisseurs. Nous pouvons
donc intervenir sur du matériel
déjà installé", précise Didier Flament.
Cette indépendance permet
aussi à Nortia de conseiller utilement
l'entreprise soucieuse de
choisir son outil informatique
futur. "Ni 2 CV, ni Rolls", un
credo qui tente d'ajuster la puissance
du matériel aux besoins du
client, sans le bloquer dans une
évolution future. Avec en prime
une formation personnalisée sur le
nouveau produit.
La mort subite
du nourrisson
Avec le directeur, les informaticiens
de la société travaillent
comme développeurs sur bases de
données. Une activité qui leur permet
de participer à un projet de
réseau européen de transfert de
données, "Recite", financé par
Bretagne Innovation.
L'autre projet majeur auquel
collabore Nortia, c'est "Save the
babies". Un programme sur la
prévention de la Mort subite du
nourrisson (MSN), mené localement
avec, entre autres, 3i et
l'ENSTBIzt. Développé par des
stagiaires de ces deux établissements
et repris par Didier Flament,
ce logiciel sous Windows
recueille 1500 renseignements,
tels que : antécédents, grossesse,
données médicales... sur des bébés
victimes de MSN proprement dite,
ou ayant fait des malaises graves,
ou encore, ayant un frère ou une
soeur décédé de MSN. "L'objet est
de centraliser toutes ces données
pour alimenter les chercheurs
1 Didier Flament est
diplômé de 3i, l'Institut
d'informatique industrielle
de Brest. Sa société, Nortia,
est spécialisée dans la
sauvegarde informatique
et dans l'informatique
médicale.
statisticiens et les médecins. Pour
cela, il faut installer un ordinateur
et l'application, à présent
nommée Adeline, dans chaque
centre de référence (il en existe
une trentaine en France). À
Brest, le logiciel est installé depuis
juin et l'idéal serait de pouvoir
établir un "cas témoin". Le
nombre de cas brestois n'étant
pas statistiquement suffisant, le
professeur Carpenter, chercheur
anglais en charge d'un projet
MSN européen, a exigé de ses
partenaires (12 pays européens et
4 ou 5 dans le monde), qu'ils utilisent
tous ce programme", retrace
Didier Flament. À 5 000 F le logiciel,
c'est pour Nortia une action
non lucrative. En revanche, de
telles collaborations lui ont valu
un projet avec le CHU de Brest :
un écho-endoscope dont Nortia
assure l'interfaçage informatique.
Un autre exemple médical pour la
société, qui compte s'orienter, à
l'avenir, vers les applications
réseaux. •
M.-E.p.
DAT : Digital audio tape. "' ENSTB : École
nationale supérieure des télécommunications de
Brest.
QUI A DIT ?
"Je suis jeune, il est vrai, mais aux
âmes bien nées la valeur n'attend
point le nombre des années".
Réponse page 22
Nortia
Notre-Da me-des-
Sauvegardes
Déesse étrusque qui gérait la fortune des gens, Nortia est le
nom qu'a choisi Didier Flament, un ingénieur systèmes et
réseaux, pour baptiser sa société en juin 93. Regroupant
quatre personnes sur le technopôle Brest Iroise, Nortia est
spécialisée dans la sécurité de l'information. Portrait d'une
déesse païenne qui, installée en terre très chrétienne, pourrait
se décliner sous l'appellation de Notre-Dame-des-Sauvegardes...
FORMATION ET MOBILITÉ
DES CHERCHEURS
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996 Les sigles du mois
IUEM Institut universitaire européen de la
mer de l'Université de Bretagne occidentale
Statut juridique : Institut pluridisciplinaire d'université, actuellement
"Programme Pluriformations" de l'Université de Bretagne occidentale
(UBO), à vocation d'Unité de formation et de recherche (UFR). Créé le
1" janvier 1992.
Nombre de membres : 154 permanents (108 enseignants-chercheurs,
46 ingénieurs et techniciens), environ 100 doctorants, 100 étudiants en DEA
et 150 étudiants de 2' cycle.
Objectifs/missions/activités : L'objectif scientifique de l'IUEM est la
compréhension et la modélisation du système couplé atmosphère-océan-géosphère-
biosphère de la planète Terre.
L'IUEM se situe comme : • Pôle d'excellence en recherches marines
regroupant 10 unités de recherche de l'UBO reconnues par le CNRS et/ou
par la DGRT/MENESR • Pôle d'excellence en enseignements marins :
accueil de l'Ecole doctorale des sciences de la mer (EDSM) fédérant 7 DEA
(droit, économie, géographie, sciences de l'univers et de la vie), du DESS
des activités maritimes et d'enseignements d'amont de 2' cycle • Composante
du Centre européen de documentation sur la mer (1800 m2, en projet) avec
l'IFREMER et l'ORSTOM • Composante de l'appui logistique aux équipes
embarquées (en projet), en relation avec l'IFREMER, l'INSU et l'1FRTP.
Implantation immobilière : Les équipes de l'Institut sont actuellement
dispersées à Brest, sur le campus de l'avenue Le Gorgeu • Elles seront
regroupées à partir d'octobre 1996 dans les bâtiments en construction
(7600 m2 de surface utile) au technopôle Brest-Iroise, à proximité de
1'IFREMER et de l'IFRTP.
Manifestation internationale significative en 1995 : Organisation du symposium
sur l'océan Antarctique, Brest, 28-31 août 1995, en commun avec le
CNRS-INSU et l'IFRTP.
Structures : Conseil de direction provisoire (universitaires et personnalités
extérieures), conseil scientifique (11 experts européens).
Correspondant : Professeur Paul Tréguer, directeur.
Adresse : M. le Directeur de l'IUEM, 6, avenue Le Gorgeu, BP 809,
29285 Brest Cedex, France, tél. 98 01 61 52, fax 98 01 66 36.
RÉSEAU FÉVRIER 96 - N°119
PRIN
Statut juridique : Association loi 1901. Création en 1981. Association pour
le développement d'un pôle de recherche et d'innovation à Nantes.
Nombre d'adhérents : Cotisants : environ 80 industriels et chercheurs.
Tissu concerné : environ 3000 personnes dans les secteurs de l'industrie,
recherche (tous secteurs), médias, collectivités et organismes divers.
Budget - Financement: 100 KF sur cotisations adhérents servant au fonctionnement
et à l'animation. 300 KF du Conseil régional des Pays de la Loire.
300 KF des 3 technopôles Nantes, Angers, Le Mans, couvrant l'édition du
"Flash info régional".
Missions : • Initier et mettre en place trois dispositifs aptes à intensifier les
échanges entre la recherche et l'industrie • Susciter des transferts de technologie
et des collaborations • Valoriser des projets en cours de développement
Initier et accompagner des projets nouveaux dans les domaines de la
recherche et de l'innovation.
Activités : 1/ Animation de groupes techniques thématiques comprenant
chercheurs et industriels (matériaux, productique, acoustique - vibrations -
chocs, conditionnement et emballage). Ces 4 groupes fonctionnent essentiellement
sur Nantes et St-Nazaire. 2/ Conception et rédaction du "Flash info
régional". Revue d'information scientifique et technique des Pays de la Loire.
3/ Organisation ou soutien à des manifestations scientifiques et techniques.
Quelques références en 1995 : Conférence-débat sur le Pont de Normandie.
2 revues : • Sciences pour l'ingénieur au sein du CNRS, couvrant
Bretagne-Pays de la Loire (164 p) • Automatique et informatique industrielle
en Pays de la Loire (224 p).
Structures : Président, Jean Garnier • Délégué général, Gérard Masse •
Secrétariat, Anne Depagne.
Correspondant : Gérard Masse, délégué général.
Adresse : PRIN - Chambre de commerce et d'industrie, 16, quai Ernest
Renaud, BP 718, Centre des Salorges, 44027 Nantes Cedex 04,
tél. 40 44 60 70, fax 40 44 63 90.
RÉSEAU FÉVRIER 96 - N°119
~
~
Source : !a lettre d'inhrm
Durée : 1994 -1998.
Montant : 744 millions d'Écus.
Décision : Décision du Conseil du 15.12.1994 arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et des
démonstrations dans le domaine de la formation et de la mobilité des
chercheurs. Ce programme succède au programme "Capital humain et
mobilité".
Objectif : • Stimuler la mobilité des chercheurs et la création de
réseaux de recherche à l'échelle du continent européen • Promouvoir la
coopération transnationale en faveur d'activités de recherche • Faciliter
l'accès des chercheurs aux grandes installations existantes • Répondre
aux initiatives de formation et de coopération proposées par les chercheurs
eux-mêmes • Promouvoir l'innovation dans les régions défavorisées.
L'action doit concerner les sciences exactes et naturelles, les sciences
économiques et de gestion, les sciences sociales et humaines.
Types d'activité couverts : • Réseaux de recherche : le but est de
mettre en place des laboratoires européens "sans murs" destinés à mobiliser
les efforts de plusieurs équipes de recherche, autour d'un thème
commun • Accès aux grandes installations : afin de faciliter l'accès aux
équipements de pointe des chercheurs universitaires • Formation par la
recherche : permettant aux chercheurs européens d'effectuer un stage de
formation de 3 mois à un an, en dehors de leur pays d'origine • Mesures
d'accompagnement : organisation de conférences, évaluation du programme.
Contact : Euro Info Centre : 99 25 4157.
RÉSEAU FÉVRIER 96 - N"I19
Le projet de Budget civil de recherche et de
développement (BCRD) pour 1996 du ministère
de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche (MENESR)
Dotation globale
1996 (MF)
Progression par
rapport à 1995
Établissements publics à caractère scientifique
et technique (EPST)
INRA 3 311 + 6,2%
CEMAGREF 207 + 4,8%
INRETS 217 + 3,1%
INRIA 461 + 5,5%
CNRS et instituts 13 303 + 4,8%
INSERM 2459 + 5,4%
INED 87 + 0,7%
ORSTOM 1054 + 0,9%
Sous-total EPST 21099 + 4,9%
Actions et institutions de recherche biologique
(dont instituts Pasteur)
888 +3,6%
Établissements publics à caractère industriel
et commercial (EPIC)
CEA 2 264 +10,7%
ADEME 202 + 3,8%
IFREMER 943 + 1,9%
CIRAD 689 + 1,5%
Sous-total EPIC 4098 + 6,6%
IFRTP 85 + 1,0%
Autres dotations (dont formation à et par la recherche) 2 687 + 3,2%
Total MENESR 31029 + 4,7%
Total autres ministères 22063 - 2,9%
Montant total 53 093 + 1,4%
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. CEA : Commissariat d l'énergie ato
mique. CEMAGREF : Centre d'étude du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
CIRAI) : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CNRS : Centre national de la recherche scientifique. IFREMER : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer. IFRTP : Institut français pour la recherche et la technologie polaires. INED
Institut national d'études démographiques. INRA : Institut national de la recherche agronomique.
INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. INRIA : Institut national de
recherche en informatique et automatismes. INSERM : Institut national de la santé et de la recherche
médicale. ORSTOM : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération.
~
RÉSEAU FÉVRIER 46 - N`179
Sigles du mois du numéro 118 (Janvier) : l'AFAQ signifie Association française pour l'assurance de la qualité (et non pas agence). O
t„ nuage, pluie r production d'eau p uissellement, captai e' ot
able distribution, consommaton, sali
nettoyage, dépollut ssrire pollution, collecte,
ion rivière, mer, nuage.- I,e cycle de 1 eau est long
le préserver sont de et les techniques pont p
lus en plus compliquées.
pour livrer à toute he
ure une eau potable
au domicile et au travail
de chacun pour la nettoyer
après usage, pour la
ddPolluer, pour protéger
\es réserves d eau, leperso
nnel de la Compagnie
Générale des Eaux veill
e nuit et jour sur le produ~~
alimentaire le plus Contrôlé de France.
pour répondre à la croissance simultanée de la
demande en
eau potable et de la pollution,
ils effectuent en quelques heures le cycle de Peau
que la nature met des années à réaliser;
et à la fin coule une rivière.
COM
NERÂLE
PAG NIE
GE
DES EAUX
Compagnie Générale des Eaux
11, rue Kléber
35020 RENNES Cedex
Tel: 99. 87. 14. 14
05 1.8.
13 h O8
19i06,198'-
3 n .e
17.07.'890 c,
13 h 14
0 4,10,1989
12 h 57
Sulu( du
N. D. U. I. -0 .25
0.3
0.3 5 sur la France d•
0.4 en 1989
= 0.43
0.5
< NORR-11 >
nds32767(c2-cl ,e24e1)
COSTEL Rennes 2
.e
MI
e
:Cages
LEGENOE
LE DOSSIER
Les prix Bretagne
Jeune chercheur
Les prix régionaux de la recherche ont été organisés par
le Conseil régional à l'initiative du président du Comité
consultatif régional de la recherche et du développement
technologique (CCRRDT), Claude Champaud, en partenariat
avec le Centre de culture scientifique technique et industrielle
(CCSTI) et le magazine "La Recherche".
Réalisés dans le cadre d'une politique de soutien actif
à la recherche, les prix attribués aux jeunes permettent
de valoriser ceux qui débutent leur carrière de chercheur et
accomplissent un travail de tout premier plan au sein des
laboratoires. En honorant ainsi les jeunes chercheurs,
la Région assure la promotion de "la Bretagne de demain".
Coup de projecteur sur ces 9 jeunes représentatifs du
dynamisme=e_t de l'excellence de la recherche dans-l'Ouest.
L7
Images de la France de l'ouest prises par le satellite américain NOAA,
entre mai et octobre 1989. Les teintes vertes correspondent à une
végétation dense et peu touchée par la sécheresse et les teintes orangées
et rouges représentent un couvert végétal faible ou frappé par la
sécheresse. Extrait de la thèse de Vincent Dubreuil, mention spéciale de
ces prix Bretagne Jeune chercheur. Ces travaux ont été réalisés au
laboratoire COSTEL (Climat et occupation du sol par télédétection) de
l'université de Rennes 2.
RÉSEAU 119 • FÉVRIER ,.1996 0
LE DOSSIER "6"6"1"")11410 LES PRIX BRETAGNE JEUNE C HEUR
Remise des prix
les félicitations du ministre
Les premiers prix Bretagne Jeune chercheur ont été remis
à leurs lauréats le 18 décembre dernier, lors d'une cérémonie
organisée à l'hôtel de Région, en présence de François
d'Aubert, secrétaire d'État chargé de la Recherche, d'Yvon
Bourges, président du Conseil régional et de Claude Champaud,
président du Comité consultatif régional de la
recherche et du développement technologique.
Une région
` ambitieuse a cérémonie a débuté par
une allocution du président
du Conseil régional. Celui-ci a
d'abord souhaité "rendre hommage
à tous ceux et à toutes celles
qui oeuvrent pour faire progresser
la science et la recherche, et, à travers
elles, le développement de
notre région". Yvon Bourges a
François d'Aubert (à droite)
et Claude Champaud
(à gauche) encadrant les
3 lauréats du prix Bretagne
Jeune chercheur : Olivier
Ragueneau, Patrick Pérez
et Yvon Rocaboy
(de gauche à droite).
également rappelé la politique
active que mène la Région en
matière de soutien à la recherche :
en 1995, 89 millions de francs ont
été alloués, soit 51 millions pour la
subvention directe de la recherche
et 38 millions pour la valorisation
et le transfert de technologies. "Les
trois grands principes guides de
notre politique de la recherche,
sont de soutenir les efforts des
équipes de recherche, de favoriser
les échanges et donc, la mobilité
des chercheurs et d'aider des projets
contribuant au développement
économique de notre région".
Enfin, le président Bourges a rappelé
les ambitions de la Région
Bretagne : accueillir, à l'horizon
2015, environ 5 % des chercheurs
français (contre 2,3 % actuellement).
Des chercheurs
primés
Les trois lauréats du prix, l'économiste
Yvon Rocaboy, le biochimiste
Olivier Ragueneau et l'informaticien
Patrick Pérez, se sont vu
ensuite décerner leur trophée, une
oeuvre du sculpteur Charles Richer
spécialement créée pour la circonstance.
Ce trophée, comme l'a souligné
Claude Champaud, représente
`le vent de la recherche
soufflant sur la Bretagne".
Orchestrée par Claude Champaud,
la remise de ces trophées, ainsi que
des médailles correspondant aux
deux mentions spéciales retenues
pour chaque discipline, a donné
l'occasion à tous les lauréats de
décrire, en quelques mots, l'objet
de leurs recherches et l'intérêt
qu'elles présentent. Ceux-ci ont
reçu leur prix des mains d'Yvon
Bourges, président du Conseil
régional, de Joseph Kergueris,
vice-président du Conseil régional
et de François d'Aubert, secrétaire
d'État chargé de la Recherche.
Outre ces trophées, les trois lauréats
ont reçu un chèque de 30 000
francs et pourront bénéficier du
fmancement d'un voyage d'étude à
l'étranger.
Un ministre
admiratif
La cérémonie s'est conclue par
le discours de François d'Aubert,
qui a tenu à témoigner de sa satisfaction
et de son admiration aux
acteurs de ce prix Bretagne Jeune
chercheur. Le secrétaire d'État, qui
effectuait son premier déplacement
en région depuis son arrivée au
ministère, a rappelé la politique de
l'État et du gouvernement dans le
domaine de la recherche : "Nous
ne baissons pas la garde : l'effort
reste soutenu et les grands programmes
tels qu'Ariane espace ou
le développement des télécommunications
se poursuivent. L'enveloppe
recherche est de 53 milliards
de francs pour 1996, soit
1,5% de plus que pour 1995, ce
qui place la France au quatrième
rang mondial des crédits alloués à
la recherche par rapport au produit
intérieur brut", a-t-il précisé.
François d'Aubert a cependant
déploré que la France ne se place
qu'au 17' rang mondial en ce qui
concerne la valorisation de la
recherche, "ce qui illustre l'ampleur
de la tâche". En appuyant
son propos par une citation du président
Bourges "la recherche
d'aujourd'hui fait les emplois de
demain', le secrétaire d'État a rappelé
son souci de rapprocher le
monde de la recherche de celui de
l'entreprise, en favorisant les
échanges entre les chercheurs des
deux secteurs et les transferts de
technologie. De plus, François
d'Aubert a insisté sur l'importance
de la diffusion de la culture scientifique
et technique, "élément essentiel
qui contribue à la valorisation
de la recherche, au niveau national
et mondial, et favorise l'accès
à la connaissance, ce qui est une
exigence première du bon fonctionnement
de la démocratie.
En Bretagne, les conditions qui
font le succès d'une politique
•
Le trophée remis aux
3 lauréats, une oeuvre du
sculpteur sur verre
Charles Richer, représente
"le vent de la recherche
soufflant sur la Bretagne".
régionale de la recherche sont
largement satisfaites", a ajouté
François d'Aubert. "Ainsi, le programme
de recherche répond bien
aux besoins de l'économie régionale
et le partenariat entre l'État,
les collectivités territoriales et le
monde socio-économique fonctionne
de façon exemplaire". Le
ministre a également salué la qualité
de la gestion du contrat de plan
État-Région et a annoncé la nomination
de Madame Marthe Melguen
au poste de délégué régional à
la recherche et à la technologie.
Pour conclure son discours,
François d'Aubert a rappelé que la
Bretagne avait été la première
région à développer une politique
régionale de la recherche "une
politique souvent enviée, parfois
même copiée" et qu'elle demeurait,
encore aujourd'hui, en tête de
toutes les régions au regard de la
part de son budget recherche rapporté
à son potentiel fiscal. En
comparaison, le budget consacré à
la recherche par la Région Ile de
France, une région pourtant beaucoup
plus riche (en moyens et en
chercheurs), est beaucoup plus
faible !
Venu en Bretagne "en qualité de
secrétaire d'État à la Recherche,
en voisin mayennais et en ami",
François d'Aubert s'est déclaré
"confiant pour la Bretagne et à
travers elle pour le Grand Ouest.
Il constitue bien une terre riche, je
m'en réjouis et vous en félicite." n
C.P.
Contact
Catherine Mallevaés
Tél. 99 02 97 15
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
~
LES X BRETAGNE JEUNE CHERCHEUR LE DOSSIER
Un économiste distingué
Yvon Rocaboy
Breton "pure souche" né à Saint-Brieuc, Yvon Rocaboy,
33 ans, est maître de conférences à la faculté des sciences
économiques de Rennes. Il est l'heureux lauréat 1995 du
prix Bretagne Jeune chercheur pour les sciences humaines
et sociales. Son champ de recherche, très large, concerne
l'étude des déterminants de la dépense publique locale, un
objet d'étude où les mathématiques appliquées constituent
l'outil privilégié de l'économiste.
Ld
'idée d'étudier le comportement
es décideurs publics ne date
pas d'aujourd'hui ; elle a donné
lieu, dans les années 1950, à la
naissance d'une théorie, développée
par l'Américain Samuelson :
"De nombreux déterminants
caractérisent l'évolution de la
dépense publique. Pour la France,
citons, par exemple, les lois de
décentralisation votées en 1984".
Jusqu'à cette date, les dépenses
publiques locales étaient subventionnées
par l'État de manière
proportionnelle. Une part importante
incombe maintenant aux collectivités,
qui, en contrepartie,
bénéficient de nouvelles recettes
fiscales : à elles de "jouer" pour
limiter les dépenses et augmenter
les recettes. Le mot "jouer" n'est
pas fortuit, puisqu'en économie,
l'un des outils favoris empruntés
aux mathématiques appliquées est
la "théorie des jeux". Chacun doit
agir sans savoir ce que vont faire
les autres...
La course aux
implantations
Quel est l'effet de la décentralisation
sur la décision d'implantation
des entreprises ? Les collectivités
ont toujours pris en compte
la mobilité des "agents", mais elles
le font davantage encore depuis
la décentralisation : ce terme
d"`agent" désigne toute entité de
petite taille, dont l'on peut définir
un comportement. Il comprend les
individus, mais aussi les familles
et les entreprises... et est à la base
de la micro-économie, discipline
d'Yvon Rocaboy. La macro-économie,
en revanche, s'intéresse
aux grands agrégats nationaux ou
internationaux : consommation,
taux de chômage, taux d'intérêt...
mais revenons à nos agents.
Afin de bénéficier de nouvelles
recettes, les collectivités cherchent
à attirer sur leur territoire de nouveaux
agents, principalement des
entreprises. Elles se livrent pour
cela à une forte concurrence, en faisant
aux agents mobiles des propositions
alléchantes : offre de logements,
exonération de charges...
Pour comprendre ce qui se passe,
prenons notre boîte à outils mathématiques
: la "théorie des jeux"
explique comment un maire, ignorant
exactement la proposition faite
par le maire de la commune voisine,
baisse son taux d'imposition
pour attirer l'entreprise. L'autre
maire fait évidemment la même
chose et l'entreprise se retrouve
avec le même choix qu'au départ,
le taux d'imposition restant égal
dans les deux communes. En ne
collaborant pas, les deux maires
auront perdu de l'argent.
Le cas de
l'action sociale
Prenons maintenant le cas de
l'action sociale. Avant 1984, elle
était subventionnée à 80 % par
l'État. Cela réduisait d'autant son
prix pour les collectivités. En
1984, la subvention devient forfaitaire
: son montant s'aligne sur
celui de l'année précédente, quelles
que soient les dépenses de l'année
en cours. "Dès les premières
•
Lauréat 1995 du prix
Bretagne Jeune chercheur
pour les sciences humaines
et sociales, Yvon Rocaboy
avait déjà reçu, en 1992,
le "premier prix de thèse
sur les collectivités locales':
années, nous avons constaté
un recul des dépenses d'action
sociale des collectivités", explique
Yvon Rocaboy. "C'est l'effet
«prix» : même si la subvention est
la même, son mode d'attribution
a augmenté le prix de l'action
sociale. Les collectivités sont plus
attentives et reportent leur effort
sur d'autres types d'actions :
enseignement, transports, équipements
culturels et sportifs..."
Autre problème traité dans les
travaux d'Yvon Rocaboy : ce sont
les départements qui fixent le
montant de la prestation sociale,
les communes ayant la charge
d'en identifier les bénéficiaires.
Sans collaboration, comment ces
comportements peuvent-ils se
coordonner ? Diminution de l'action
sociale et concurrence fiscale
ne sont que deux des "effets pervers"
de la décentralisation, qu'il
faut bien se garder de considérer
isolément. Ce contexte étant
impossible à résumer en quelques
lignes, Réseau signale à ses lecteurs
qu'Yvon Rocaboy dispose,
pour les curieux, d'une synthèse
de ses travaux.
L'avenir d'un
jeune chercheur
Aujourd'hui, entre ses enseignements
à Rennes et ses participations
à des colloques dans toute
l'Europe et en Amérique du Nord,
Yvon Rocaboy prépare le concours
d'agrégation, pour devenir professeur
d'université. Le prix Bretagne
Jeune chercheur 95 arrive à point
pour l'aider à s'installer dans sa
nouvelle maison. Quant à la possibilité
de faire imprimer sa thèse, il
hésite : "J'ai soutenu ma thèse en
1992 et le manuscrit est déjà
obsolète par rapport aux travaux
effectués depuis. De plus, ce travail
a fait l'objet de plusieurs
publications (16), au fur et à
mesure de son avancement. Le
publier maintenant dans sa globalité
n'apporterait pas grand
chose."
Yvon Rocaboy hésite d'autant
plus qu'il se sent attiré par l'autre
proposition : le voyage d'études.
"J'aimerais passer quelques mois
chez mon homologue anglais, à
l'université d'York. Travaillant
sur des sujets similaires, nous
avons beaucoup à nous apporter
mutuellement." Le jeune Rennais
met en garde contre les risques de
"consanguinité intellectuelle" qui
menacent les chercheurs confinés
dans leur université : "Une participation
régulière à des colloques
étrangers est nécessaire au renouvellement
des idées". Rappelons
que la dimension internationale
des travaux a été un critère prépondérant
dans l'attribution des
prix Bretagne Jeune chercheur. n
H.T.
Contact ► Yvon Rocaboy
Tél. 99 25 35 45
e-mail Yvon.Rocaboy@
univ-rennes 1.fr
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996 CD
LE DOSSIER LES PRIX BRETAGNE JEUNE CFRCHEUR
Le lauréat
"sciences de la matière"
Chargé de recherche INRIA"' à Rennes, Patrick Pérez met
au point des modèles statistiques pour l'analyse automatique
des séquences d'images fournies par ce capteur privilégié
qu'est la caméra. Après sa thèse et un séjour d'un an
aux États-Unis, il suit à son tour les jeunes doctorants qui
préparent les outils informatiques de demain. Son domaine
de recherche entre dans le cadre du programme ITR (Informatique
télécommunications réseaux), soutenu par le
Conseil régional de Bretagne.
Patrick Pérez est originaire du
sud de la France et diplômé
de l'École centrale de Paris, "un
enseignement très général, où
seule la troisième année aborde
le monde de la recherche". La
recherche... un monde qui passionne
Patrick Pérez : il décide de
faire une thèse sur l'analyse
d'images et adresse sa candidature
dans différents centres de
A
Patrick Pérez, lauréat
du premier prix Bretagne
Jeune chercheur en
"sciences de la matière".
Contact Patrick Pérez
Tél. 99 84 72 73
e-mail pérez@irisa.fr.
recherche spécialisés. `L'IRISA"'
a répondu rapidement et favorablement
à ma demande. L'un
de mes frères, alors étudiant à
l'École de chimie (ENSCR")), me
disait beaucoup de bien de la vie
à Rennes."
C'est ainsi qu'en septembre
1990, Patrick Pérez intègre le projet
Ternis de l'IRISA (voir présentation
dans Réseau n° 114), une
équipe constituée d'une trentaine
de personnes placées sous la responsabilité
de Claude Labit. En
août 93, après sa soutenance de
thèse, il part un an aux États-Unis,
dans le département de Mathématiques
appliquées de Brown University,
proche de Harvard et du
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), deux grands centres
de recherche. "Ce séjour m'a permis
de m'ouvrir à d'autres milieux
scientifiques, et de connaître un
nouveau système, très différent
du nôtre mais pas forcément
meilleur".
L'analyse d'images
dynamiques
Les travaux de recherche de
Ternis concernent principalement
l'image dynamique, c'est-à-dire le
traitement de séquences d'images.
"La caméra, éventuellement
montée sur un robot qui lui permet
de suivre le mouvement, doit
être capable de repérer les objets
qui bougent, d'analyser leur
mouvement, voire de l'interpréter
pour ne transmettre à l'opérateur
humain que les données
significatives." Les applications
sont nombreuses, en robotique,
mais aussi en sécurité (télésurveillance
d'un local ou d'une
autoroute...), dans le domaine
médical (analyse de séquences
d'échocardiographie, par exemple),
en météorologie (détection de perturbations...)
ou dans le secteur
des télécommunications : "Nous
venons d'obtenir un financement
européen pour un travail visant
à améliorer la qualité de la
visiophonie : l'image transmise
actuellement a une faible résolution,
et son mouvement est saccadé."
L'idée consiste à tirer parti des
informations audio pour analyser
au mieux les images (localiser et
"suivre" les lèvres en mouvement),
et à améliorer également la
résolution des points significatifs
de l'image par les techniques de
compression du signal. Ce double
traitement a pour objectif de calculer
des images intermédiaires
supplémentaires, afin d'obtenir
une séquence d'images continue
et de bonne qualité. "Les clients
visés sont d'abord les mal-entendants,
pour qui la visiophonie
doit représenter un moyen fiable
de communiquer à distance,
grâce à la lecture sur les lèvres."
Ce contrat associe l'IRISA aux
industriels Matra et Philips, et à
divers partenaires européens'''.
De nombreux
développements
L'un des points forts des travaux
réalisés par Patrick Pérez,
est de prendre en compte à la fois
leur réalisation matérielle et leur
impact sur des développements
futurs. "Avec d'autres chercheurs,
nous avons travaillé à simplifier
nos algorithmes d'analyse
d'images, pour que leur calcul
par ordinateur soit plus facile et
plus économique."
L'autre souci a donc été d'identifier
les développements possibles.
"Notre modèle déborde
largement de son cadre initial et
intéresse aujourd'hui un certain
nombre de partenaires." Citons,
par exemple, l'École navale à
Brest, où deux thèses sont en
cours sur l'interprétation d'images
de fonds sous-marins. Patrick
Pérez collabore également avec
l'ENSAR°', dans le cadre d'une
thèse sur la fusion d'images satellites
de différentes longueurs
d'ondes : `La fusion de ces
images devrait permettre de délimiter
les foyers infectieux de
divers parasites affectant les
cultures".
Voilà comment, à 27 ans, on
passe d'encadré à encadrant,
d'étudiant à enseignant : "J'aime
beaucoup enseigner, cela m'offre
de nombreux contacts avec les
étudiants en DEA (Patrick Pérez
enseigne à Rennes et à Paris), ou
les futurs ingénieurs de l'IFSIC")."
Le prix Bretagne Jeune
chercheur lui permettra soit d'imprimer
sa thèse, soit de partir en
voyage d'études. "À l'heure des
échanges incessants de documents
(rapports, articles, thèses)
par voie électronique, l'impression
de la thèse offre moins d'intérêt.
Je préfère aller rendre visite
à quelques collègues étrangers,
dont j'ai pu faire la connaissance
parfois uniquement via le courrier
électronique." n
H.T.
"' INRIA : Institut national de recherche en
informatique et en automatique ; IRISA: Institut
de recherche en informatique et systèmes aléatoires
; ENSCR : Ecole nationale supérieure de
chimie de Rennes ; ENSAR : École nationale
supérieure agronomique de Rennes ; IFSIC :
Institut de formation supérieure en informatique
et communication. "' Les partenaires du projet
européen Vidas (Video assisted by audio) : universités
de Genève, de Gênes, de Catalogne, de
Linkoping (Suède), École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), Modis (firme italienne).
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
LE DOSSIER
1 Olivier Ragueneau
devant l'analyseur automatique
servant à ses travaux.
Le grand bloom
Chargé de recherche CNRS au sein de l'URA 1513 "Flux de
matière et réponses du vivant" à l'UBO1'1 à Brest, Olivier
Ragueneau, 28 ans, vient de remporter la palme décernée
par la Région Bretagne et le mensuel "La Recherche" : le
voilà premier prix Bretagne Jeune chercheur pour les
sciences de la vie.
irigé par Paul Tréguer, l'Institut
universitaire européen
de la mer (IDEM) comprend
l'URA 1513 où Olivier Ragueneau
a soutenu sa thèse en janvier 1994.
Son sujet d'étude : "La dynamique
du phytoplancton dans les écosystèmes
côtiers : couplage avec
l'hydrodynamique et le cycle biogéochimique
du silicium". En
quelques mots, Olivier Ragueneau
a déterminé quelles étaient les relations
entre les apports géochimiques
(nitrates, phosphates et silicates)
dans les eaux côtières et la
croissance du phytoplancton.
"Cette croissance est parfois
exponentielle sous certaines conditions,
qui mènent alors à ce que
l'on appelle un «bloom phytoplanctonique
», c'est-à-dire une
véritable explosion de la multiplication
de ces algues", explique-til.
Or, si l'on songe que certaines
micro-algues sont un danger dans
des eaux où l'on pratique des activités
comme l'ostréiculture, on
comprend l'intérêt économique
immédiat de l'approfondissement
de la connaissance de leur cycle de
croissance. Par exemple, la microalgue
"Dinophysis" rend toxiques
les mollusques filtreurs.
Tout est question
d'équilibre
"Le silicium arrive dans les
eaux côtières par les rivières. Cet
apport est la conséquence du lessivage
des roches du bassin versant
par les eaux de ruissellement. Les
silicates, comme les nitrates et les
phosphates, sont des sels nutritifs
pour le phytoplancton. Or, de
plus en plus de composés azotés
(nitrates) et phosphorés (phosphates)
proviennent des activités
humaines (activités domestiques,
agricoles ou industrielles), tandis
que les silicates, ayant une origine
directement liée à l'érosion, et non
à l'homme, restent à peu près
constants. L'activité humaine
induit donc un déséquilibre entre
le rapport silicate/phosphate d'une
part, et silicate/nitrate d'autre
part", pose Olivier Ragueneau.
L'objet de son étude est, entre
autres, de voir en quoi un tel déséquilibre
influe sur la croissance du
phytoplancton en général. Plus
particulièrement, le phytoplancton
est divisé en deux grands groupes :
les diatomées composées de silicium,
et les flagellés, susceptibles
d'être toxiques et de connaître de
grands blooms. Comment l'un et
l'autre réagissent-ils à l'évolution
des apports géochimiques ? :
"Quand il y a un apport d'azote et
de phosphore trop important en
comparaison du silicium disponible,
les diatomées arrêtent de
pousser."
Régénération
"J'ai effectué sur un an le suivi
de la rade de Brest, dans le cadre
du contrat de baie, ainsi que de la
Manche occidentale, au large de
Roscoff, dans le cadre cette fois du
Programme national d'océanologie
côtière. Ce suivi consistait
en des mesures physiques, comme
la température, la densité, la
salinité, des mesures chimiques
comme la concentration en sels
nutritifs et enfin la réponse de la
biomasse : chlorophylle, carbone
et azote particulaires, silice biogénique
(diatomées)..." explique Olivier
Ragueneau.
Pour mener à bien cette comptabilisation,
il a, par exemple, fallu
faire la différence entre la silice
biogénique et celle d'origine minérale
(dite lithogénique). Pour la
rade de Brest, il a fallu calculer les
apports de silicates provenant des
rivières (Elorn, Aulne), de l'Iroise,
ainsi que des sédiments. "Quand
on compare la somme de tous ces
apports à la production printanière
de silice biogénique par
les diatomées, on s'aperçoit qu'il
manque des silicates : ceux-ci
sont liés à la régénération de
la matière biogénique. S'il n'y
a finalement pas prolifération.
d'algues économiquement peu
désirables, comme les dinoflagellés,
en rade de Brest, c'est parce
que la régénération du silicium,
couplée à un brassage important
de la colonne d'eau, favorise le
maintien de populations de diatomées
tout au long du printemps,
en dépit des faibles concentrations
en silicates dans le milieu. Toutefois,
au printemps 1993, la limitation
de la croissance des diatomées
par un manque de silicates
s'est produite alors que la masse
d'eau était très stable du fait d'importantes
pluies ayant engendré
de forts apports d'eau douce.
Dans ces conditions particulières,
le déséquilibre entre les sels nutritifs
a pu entraîner le développement
de plusieurs espèces de dinoflagellés
et la pêche coquillère a
alors été interdite en rade pour
une courte période."
À présent, le chercheur brestois,
qui est revenu d'une année aux
États-Unis dans les laboratoires de
la North Carolina State University,
est devenu le coordonnateur d'un
projet international avec des Européens,
des Américains et un Japonais.
Ce projet est centré sur l'utilisation
des dépôts sédimentaires
siliceux, au fond des océans, pour
reconstruire la productivité passée
des eaux sus-jacentes. La première
étape de ce projet est un colloque
organisé à Brest au début de juin
prochain, qui va réunir des spécialistes
du cycle du silicium dans
l'océan moderne, et des paléoocéanographes.
•
M.-E.P.
Contact Olivier Ragueneau
Tél 98 01 70 02
e-mail raguene@univ-brest.fr
"' UBO : Université de Bretagne occidentale,
implantée d Brest.
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
LE DOSSIER
~y.
LES PRIX BRETAGNE EUNE CHER6IEUR
En plus des trois premiers prix, le jury a décerné 2 mentions
spéciales pour chaque discipline. Ces 6 jeunes chercheurs
ont donc reçu, le 18 décembre dernier, un diplôme et
une médaille, témoignant de la qualité de leurs recherches.
Réseau vous propose un aperçu des travaux de ces 6 chercheurs
"spécialement mentionnés".
Les six
mentions spéciales
Sciences humaines
et sociales :
Vincent Dubreuil
(géographie)
et Daniel Leloup
(histoire de l'architecture)
Sécheresse dans
la France de l'Ouest
Vincent Dubreuil est aujourd'hui
maître de conférences en géographie
physique à l'université de Rennes 2.
Il a réalisé sa thèse, "La sécheresse
dans la France de l'Ouest : étude
d'après les bilans hydriques et les
données des satellites NOAAAVHRR",
au laboratoire COSTEL
(Climat et occupation du sol par télédétection)
de l'université de Rennes
2, sous la direction de Jean Mounier.
Durant les trois années de cette
recherche, Vmcent Dubreuil a étudié
le problème de la sécheresse dans les
régions de Bretagne, basse Normandie
et Pays de la Loire, des régions
pourtant réputées humides.
"Les conflits entre utilisateurs
d'eau n'ont fait que s'accroître au
cours des dernières années en raison
de l'augmentation de la demande,
mais aussi du fait de la succession
d'années sèches, telles que 1976,
1989 ou 1990", explique Vincent
Dubreuil. Son travail s'est attaché à
évaluer les risques de sécheresse à
partir des données météorologiques
et du calcul du bilan de l'eau. De
plus, grâce aux données fournies par
les satellites NOAA-AVHRR, Vincent
Dubreuil a pu réaliser une spatialisation
détaillée des régions sensibles
(voir photos en couverture de
ce dossier). C'est ainsi qu'il a montré
de très fortes disparités régionales :
les hauteurs humides de Bretagne
(Monts d'Arrée, Mené) et du bocage
normand sont beaucoup moins vulnérables
vis-à-vis de la sécheresse
que les régions du centre de la Bretagne,
du Bassin de Rennes ou du
Sud de la Loire.
Vincent Dubreuil a également mis
en évidence des disparités locales
liées au type d'activité dominante :
par exemple, les cultures de maïs,
fortement consommatrices d'eau, ont
été très touchées par les sécheresses
de 1989 et 1990. `La réflexion sur
les problèmes de sécheresse n'est
donc pas seulement un problème
de climatologie, mais pose, bien
au-delà, des questions majeures
quant à l'aménagement régional",
conclut-il. n
Contact : Vincent Dubreuil
Tél. 99 14 18 52
e-mail Vincent.Dubreuil@
Uhb.fr
Architecture
urbaine
"Jeune chercheur" à 46 ans,
Daniel Leloup a, en effet, repris ses
études (en DEA) à 40 ans et il a soutenu
sa thèse en histoire de l'architecture
en 1993. Son travail de
recherche, intitulé "L'architecture
urbaine dans le Trégor aux XV' et
XVI' siècles", a été réalisé sous la
direction de Jean-Yves Andrieux,
professeur d'histoire de l'architecture
à l'université de Rennes 2. Il
s'agit d'une étude très détaillée de
l'habitat dans l'ancien évêché du
Trégor, prenant en compte les
aspects historiques, urbanistiques,
techniques et sociologiques de la
construction.
Pour ses recherches, cet architecte
de formation a réalisé des relevés
systématiques des maisons (plans,
coupes, élévations), qui ont permis
d'émettre de nouvelles conclusions
sur cet habitat. C'est ainsi qu'il a
montré que les principales villes du
Trégor, Guingamp, Morlaix et Lannion,
ont affirmé leur autonomie en
créant des modèles architecturaux
originaux. En revanche, Tréguier,
ville épiscopale dépourvue de château
et d'enceinte fortifiée, ne
semble pas avoir possédé d'atelier
d'architecture autonome. C'est à
Morlaix que l'originalité est la plus
grande, car les commanditaires des
constructions, tous nobles-marchands
travaillant dans le commerce
de la toile, ont voulu affirmer la différence
de leur groupe social et donner
une image forte aux acheteurs
venus de l'étranger.
Daniel Leloup poursuit actuellement
ses études en histoire de l'architecture
à l'université de Rennes 2,
où il est maître de conférences. Les
résultats les plus marquants de son
travail de thèse seront, très prochainement,
publiés par les Presses universitaires
de Rennes. n
Contact : Daniel Leloup
Tél. 99 14 15 13
Sciences de la matière :
Nathalie Guillon (chimie)
et Marylise Le Cointe
(physique)
Cristallographie
des poudres
Nathalie Guillon est diplômée du
magistère "matériaux" et docteur en
chimie de l'université de Rennes 1.
Elle a été primée pour ses travaux
concernant la synthèse et la caractérisation
de nitrates de cérium (III) et
(N), réalisés sous la direction de.
Daniel Louer, dans le laboratoire de
Chimie du solide et inorganique
moléculaire (URA CNRS 1495), au
sein du groupe "Cristallographie-
Réactivité des solides".
Les nitrates de cérium (III) et (N)
sont des précurseurs d'oxyde de
cérium (IV) divisé, dit "nanocristallin".
L'oxyde de cérium divisé est
utilisé dans les pots catalytiques des
automobiles, car, ajouté aux catalyseurs
multifonctionnels, il permet de
réduire les niveaux d'émission des
oxydes d'azote et des imbrûlés. Les
études réalisées par Nathalie Guillou
visent à comprendre les mécanismes
réactionnels subtils mis en jeu lors de
l'obtention de cet oxyde de cérium
divisé, en utilisant notamment la
cristallographie des poudres, discipline
dans laquelle le laboratoire de
Chimie du solide et inorganique
moléculaire possède une notoriété
internationale.
Ces techniques de cristallographie
des poudres ont aussi permis une
caractérisation fine de la microstructure
du produit obtenu : taille des
cristallites (quelques dizaines de
nanomètresPl) et défauts cristallins.
Ces caractéristiques étant corrélées à
la réactivité du produit obtenu (plus
l'oxyde de cérium est divisé, plus il
est réactif), la démarche suivie pourrait
s'avérer utile au plan technologique.
Actuellement en stage postdoctoral,
Nathalie Guillou poursuit
ses travaux de recherche à la "Technische
Hochschule" de Darmstadt en
Allemagne. n
Contact : Nathalie Guillou
Tél. (49) 6151/162894
e-mail dj 1 k @ hrzpub.th-darmstadt.
de
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
LE DOSSIER
t L'ensemble des lauréats et les principaux acteurs
du prix Bretagne Jeune chercheur, lors de la cérémonie
organisée au Conseil régional le 18 décembre 1995.
De gauche à droite : Daniel Leloup, Christophe Jamin
(derrière), Vincent Dubreuil, Olivier Ragueneau,
Yvon Rocaboy, Nathalie Guillou, Patrick Pérez (derrière),
Marylise Le Cointe, Yvon Bourges, président du
Conseil régional, Joan van Baaren et François d'Aubert,
secrétaire d'État chargé de la Recherche.
Matériaux
moléculaires
Diplômée du magistère "matériaux"
et docteur en physique de
l'université de Rennes 1, Marylise
Le Cointe a soutenu sa thèse intitulée
"La transition neutre-ionique
dans le TTF-CA'2 : aspects structuraux",
en 1994. Ce travail, réalisé au
sein du groupe "Matière condensée
et matériaux" (URA CNRS 804)
sous la direction d'Hervé Cailleau,
s'intéresse à la compréhension des
mécanismes physiques à l'origine
des propriétés électroniques ou
optiques des matériaux moléculaires.
Le "TTF-CA" est un solide organique
que l'on qualifie de "semiconducteur
moléculaire". Il est composé,
à la fois, de molécules pouvant
libérer facilement un électron (les
donneurs) et de molécules pouvant
capter un électron (les accepteurs).
La transition "neutre-ionique" correspond
à une modification de l'ionicité
des molécules, c'est-à-dire du
degré de transfert de charge entre
donneurs et accepteurs. Elle peut
intervenir sous l'effet de la température,
de la pression ou de l'irradiation
par un laser et se manifester, par
exemple, par un changement de couleur
du cristal.
À l'état ionique, les molécules du
solide se groupent sous forme de
paires "donneur-accepteur", ce qui
peut conduire à des phénomènes originaux,
comme des instabilités électroniques
sous champ électrique fort.
Ces propriétés pourraient être exploitées
dans le but de réaliser de nouveaux
dispositifs d'électronique
moléculaire.
Marylise Le Cointe est aujourd'hui
maître de conférences de l'université
de Rennes 1 et poursuit ses
travaux de recherche au sein du
groupe "Matière condensée et matériaux".
n
Contact : Marylise Le Cointe
Tél. 99 28 69 88
e-mail lecointe@univ-rennes 1. fr
Sciences de la vie :
Joan van Baaren (zoologie)
et Christophe Jamin
(immunologie)
Parasitisme chez
les insectes
Le titre de la thèse de Joan van
Baaren semble bien avoir été le plus
délicat à annoncer pour Claude
Champaud ! Derrière les termes
"capacité discriminatoire, installation
et régulation du superparasitisme
chez les hyménoptères parasitoïdes :
analyse expérimentale" se cachent
de minuscules insectes de la famille
des guêpes dont la stratégie de reproduction
est remarquablement sophistiquée.
En effet, les femelles des
hyménoptères parasitoïdes pondent
leurs oeufs dans les oeufs, larves ou
adultes d'autres insectes.
Dans son travail de thèse, Joan
van Baaren a particulièrement étudié
les "phéromones de marquage" de
ces insectes : il s'agit du signal chimique
odorant laissé par une femelle
ayant pondu dans un hôte, destiné à
signaler aux autres parasitoïdes que
"la place est déjà occupée". Elle a
ainsi montré que les femelles de
parasitoïdes étaient capables de distinguer,
parmi les phéromones, celles
produites par elles-mêmes, celles
produites par des femelles appartenant
au même biotype (provenant de
la même région), et celles produites
par les femelles d'un biotype ou
d'une espèce différente. L'étude de
Joan van Baaren présente donc à la
fois un intérêt fondamental en biologie
évolutive et un aspect appliqué,
ces hyménoptères parasitoïdes pouvant
être utilisés en lutte biologique.
Joan van Baaren a réalisé ce travail
au sein du laboratoire d'Écobiologie
des parasitoïdes de l'université
de Rennes 1, sous la direction de
Jean-Pierre Nénon. Après sa soutenance
de thèse en février 1994, elle a
effectué un stage post-doctoral au
Québec, à la "Station de recherches
agriculture Canada", grâce à une
bourse de la fondation Fyssen. Joan
van Baaren est aujourd'hui Attaché
temporaire d'enseignement et de
recherche (ATER) au laboratoire
"Éthologie, évolution, écologie" de
l'université de Rennes 1. n
Contact : Joan van Baaren
Tél. 99 36 70 78
e-mail jpr@univ-rennes1.fr
Maladies
auto-immunes
Dans sa thèse, intitulée "Étude du
rôle de la molécule CD5 à la surface
des lymphocytes B", Christophe
Jamin s'est intéressé aux mécanismes
impliqués dans la survenue
des maladies dites "auto-immunes".
Dans ce type de maladie, le système
immunitaire se détourne de son
but original (défendre l'organisme
contre les agressions extérieures)
pour s'attaquer aux propres cellules
de l'individu. La polyarthrite rhumatoïde,
le syndrome sec ou le lupus
érythémateux disséminé en sont
quelques exemples. Elles sont,
d'ailleurs, relativement courantes en
région Bretagne, puisqu'elles affectent
respectivement un Breton sur
100, un Breton sur 250 et un Breton
sur 1000 !
Or, dans ces maladies, un dénominateur
commun a été mis en
évidence : la prolifération de lymphocytes
B d'un type particulier,
porteurs d'une glycoprotéine appelée
CD5. Dans son travail de thèse,
Christophe Jamin a cherché à comprendre
le rôle de cette molécule
CD5 à la surface des lymphocytes B.
Il a notamment observé que cette
molécule était relarguée dans le
sérum des individus malades et
qu'elle était capable de prolonger la
prolifération des lymphocytes B
activés. Ces observations pourraient
ouvrir de nouvelles voies de
recherche en ce qui concerne le traitement
des maladies auto-immunes.
Ces travaux ont été réalisés au
laboratoire d'immunologie du Centre
hospitalier régional universitaire de
Brest, sous la direction de Pierre
Youinou. Christophe Jamin a bénéficié,
durant sa thèse, d'une bourse
accordée par le Conseil régional de
Bretagne, et vient d'être recruté, en
tant qu'attaché scientifique, au laboratoire
d'immunologie. n
Contact : Christophe Jamin
Tél. 98 22 33 84
e-mail Jamin@univ-brest.fr
C.P.
"' Un nanomètre (nm) = un millième de micron =
un millionième de millimètre. (2' TTF-CA: tétrathiafulvalène-
chloranile.
ne technopole
our les entrepris
de l'agroalimentaire
PRÉSENCE BRETAGNE
18, PLACE DE LA GARE
35000 RENNES
TÉL. 99 67 42 05 - FAX 99 67 60 22
Membre du Réseau Interrégional de Diffusion Technologique
Adressezvous
à :
Pour développer
vos produits ou services
à forte valeur ajoutée
Choisissez votre implantation au coeur
du campus agronomique de Rennes,
tout près des laboratoires de recherche
et des écoles d'ingénieurs.
Puisez dans notre matière grise
4 centres de recherche publics :
INRA, INSERM, CNRS, CEMAGREF.
6 écoles d'ingénieurs : ENSA Rennes,
INSFA, ENSP, ENSC Rennes, ISPA,
IESIEL.
2 universités.
Bénéficiez des services disponibles :
ateliers pilotes, équipements analytiques,
analyse sensorielle, centres techniques,
propriété industrielle, documentation
scientifique et technique, locaux locatifs...
Rennes Atalante
Technopole de Rennes District : Rennes Atalante - 11, rue du Clos Courte) - 35700 Rennes - Tél. 99 12 73 73
POUR FAVORISER LA DÉMARCHE D'INNOVATION
OU D'ACCROISSEMENT DU NIVEAU
TECHNOLOGIQUE DE VOTRE ENTREPRISE...
PRESENCE
BRETAGNE
Pour toute PMI, PME de la région Bretagne de moins de 2000 salariés
et ne faisant pas partie d'un grand groupe industriel.
Par tout prestataire public ou privé, au choix de l'entreprise.
Assistance technique
Etude de faisabilité
Calculs
Essais
Modélisation
Etude de marché
Recherche de partenaires
technologiques
Etat de l'art
Recherches d'antériorité
Information scientifique et
technique
Dépôt du premier brevet
Les membres conseillers du réseau vous accompagnent
dans la recherche de compétences technologiques.
Les prestations bénéficient d'un soutien financier
spécifique. Elles sont subventionnées à hauteur de 75 %
de leur montant. L'aide est plafonnée à 35 580 F TTC.
La vie des entreprises
Anticipa : le multimédia
entre au musée
À Lannion, berceau des
technologies de la parole et
des services de communication
du futur, le multimédia
fait école. Deux PME de la
technopole en font la
démonstration : l'une, Systèmes
G, est déjà présente
dans plus de 50 musées
français et européens,
l'autre, Faros, s'exposera
très prochainement à la
Cité de la Villette.
A
Simulateur de conduite
Faros.
t Aquarium de Trégastel :
maquette pilotée par
Systèmes G.
Les machines
parlantes
de Systèmes G
Pour Systèmes G, la muséographie
c'est - presque - de l'histoire
ancienne. Alors que le mot
multimédia n'existait pas encore,
Systèmes G proposait déjà ses
propres cartes sonores pour PC.
Dès la fm des années 80, la société
équipait la grotte de Sam au Pays
basque, puis réalisait l'ensemble
du pilotage de la visite. C'était la
naissance d'une vocation.
Autour de cette carte sonore
se sont greffés d'autres produits
propres comme les boîtiers Tic &
Talk. Ceux-ci, placés en différents
endroits d'un musée, permettent
de restituer, à la demande, un commentaire
enregistré. Une simple
pression sur un bouton-poussoir
déclenche un message de 90 (ou
180) secondes, idéal pour commenter
une vitrine, animer un
stand, informer en langue étrangère...
À tout moment, un nouveau
message peut être enregistré.
La compétence de Systèmes G
ne se limite pas à montrer ou à diffuser
des messages. La société agit
en tant que chef d'orchestre de
tous les périphériques : diaporama,
laser, vidéodisque permettant de
réaliser une véritable mise en
scène du musée ou du site touristique.
Aujourd'hui, les machines parlantes
de Systèmes G sont présentes
partout en Bretagne (Musée
de la Cohue à Vannes, Mémorial
de la ville détruite à Lorient,
Musée de Bretagne à Rennes...) et
équipent plus de 50 sites en
France (Palais de la Découverte à
Paris...) et en Espagne.
L'entreprise de 5 personnes,
dirigée par Christian Barbeau,
poursuit en parallèle son métier
de départ : la R&D appliquée aux
télécommunications. Elle réalise
près de 40 % de son chiffre d'affaires
à l'export, avec ses systèmes
d'observation et de simulation
pour les téléphones portables
DECTt . Mais l'activité "musée"
devrait continuer à faire parler
d'elle. Après la parole, la PME
vient d'intégrer l'odeur dans ses
machines, en utilisant le vaporisateur
de parfum mis au point par la
société trégoroise Novatech. La
nouvelle machine diffusera les
senteurs cassis ou moutarde sur la
foire internationale de Dijon, mais
flattera également les narines des
fidèles habitués des épiceries
Hédiard.
Faros... vers
la route virtuelle
Pour la société Faros, délocalisée
à Lannion en 1992, le parcours
est tout autre. Rien ne destinait
apparemment cette société de 35
personnes, spécialisée en simulatique
légère (simulation sur PC), à
être sollicitée par la Cité des
Sciences et de l'Industrie de la
Villette.
Créée il y a 10 ans par une
équipe d'ingénieurs en aéronautique,
la PME a consacré un budget
de recherche très important à
la mise au point de simulateurs
destinés principalement à la
marine (simulateurs de navigation...)
et à l'aéronautique (simulateur
pour l'Airbus A320...). Ces
systèmes sont aujourd'hui homologués
et ouvrent un vaste marché
potentiel à une société, qui réalise
déjà un quart de son chiffre d'affaires
à l'export.
C'est en fait le dernier produit
repris et développé par la société -
le simulateur Rousseau - qui a
retenu l'attention de la Villette. Ce
système n'a pratiquement pas de
concurrent au monde. Reproduisant
un habitacle complet de
Renault Clio, avec l'ensemble du
tableau de bord et de l'instrumentation,
celui-ci recrée fidèlement
l'environnement de l'apprenti
conducteur : champ de vision,
infrastructure routière, circulation
extérieure, et même les situations
de conduite particulières, comme
la circulation en montagne. Mieux
encore, lorsque le moment est
venu de se lancer sur la route virtuelle,
le logiciel supervise toutes
les manoeuvres et rappelle à
l'ordre tout conducteur récalcitrant.
Ce simulateur, qui s'adresse
à un marché d'au moins 2000
grandes auto-écoles françaises, est
déjà installé chez une centaine de
professionnels et vient d'être commercialisé
en Suède et au Japon.
Mais si son succès commercial
est prometteur, le simulateur de
conduite a également permis à la
société de franchir une étape technologique
supplémentaire. Elle
détient, en effet, au travers de sa
filiale anglaise Real World Simulation,
un générateur d'images en
trois dimensions particulièrement
puissant.
C'est certainement cette avance
technique qui a séduit les concepteurs
de l'exposition "Automobile"
de la Villette. Cette exposition,
qui sera inaugurée en avril
1996, restera en place pendant une
durée d'au moins 5 ans. n
'"DECT : Digital european cordless telephone
(téléphones sans fil).
Cette page est réalisée
par la technopole
Anticipa Lannion-Trégor Anticipa Tél. 96 46 42 28.
1ECNNOPOLE UNNION 7AEGOfl
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Histoire et Société
La sidérurgie en Bretagne
au 18e siècle
Au 18' siècle, la province de Bretagne (qui comprenait à
l'époque l'actuel département de Loire Atlantique) possédait
une importante... industrie sidérurgique !
Après les ères du cuivre, puis
du bronze, la fabrication du
fer fut découverte au cours du 2'
millénaire avant J.-C. Au 13' siècle
(époque de Ramsès II et de
Moïse), les Hittites en Anatolie
semblent être les premiers à disposer
d'outils et d'armes en fer.
Contrairement au cuivre et à
l'étain, le minerai de fer est assez
répandu, mais nécessite des températures
de fusion nettement plus
élevées. Les forges fonctionnaient,
dans l'Antiquité, au bois, avec système
manuel d'aération.
Les hauts fourneaux
Au 13' siècle de notre ère apparurent
les hauts fourneaux, et au
15' siècle naquit la métallurgie en
deux temps : production de fonte
dans un haut fourneau avec soufflerie,
puis affinage en fer dans
une forge par décarburation et
martelage, avec marteau mû par la
force hydraulique ; ce qui fut complété
au 17' siècle par une fenderie
avec rouleaux à taillants.
L'Angleterre était au 18' siècle,
avec la Suède, en pointe pour l'élaboration
de produits métallurgiques
nouveaux, fontes et même
les premiers aciers (coutellerie de
Sheffield). C'est en Angleterre
qu'apparurent les premiers laminoirs,
que l'on construisit le premier
pont en fer (Ironbridge sur la
Severn en 1780) ; :
et que l'on corn-
Projet de la forge
de la Jahotière (1828)
à Abbaretz (44).
mença à utiliser le charbon minéral,
notamment le coke, dans les
hauts fourneaux, faute semble-t-il,
du moins au départ, de ressources
suffisantes en bois.
En effet, le fonctionnement d'un
haut fourneau nécessitait des quantités
énormes de charbon de bois :
il absorbait, chaque année, 150
hectares de taillis de 20 ans. Il fallait
donc une réserve forestière de
3 000 hectares par haut fourneau.
Dans la région de
Châteaubriant
Entre la Vilaine et Pouancé, près
de la limite des actuels départements
d'Ille et Vilaine et de Loire
Atlantique, se situe une bande ferrifère,
dont l'exploitation débuta
plusieurs siècles avant notre ère, et
se poursuivit à l'époque galloromaine.
Les sites miniers de Sionles-
Mines et de Rougé sont connus.
Il y avait aussi dans cette région,
aux terres autrefois peu propices à
la culture, de grandes forêts :
Teillay, La Guerche, Araize, Juigné,
Domnaiche, Vioreau... nettement
plus étendues qu'aujourd'hui.
Tout cela était propice à l'installation
de forges, car les moyens de
transport de l'époque obligeaient à
s'installer à proximité des matières
premières. On créa des réserves
d'eau, on produisit la force hydraulique
avec des barrages-réservoirs
sur les rivières, et les forges s'installèrent
en contrebas des digues.
Les propriétaires des forges
étaient en général de grands seigneurs,
possédant les terres et les
forêts (Le Grand Condé,
Cossé-Brissac...). Chaque
forge employait environ
200 ouvriers dont une
trentaine dans les ateliers, les autres
comme mineurs, bûcherons, charbonniers,
voituriers. Les techniciens
forgerons formaient des corporations
(maîtres-fondeurs, ou
affineurs, ou fendeurs, ou marteleurs,
ou chauffeurs), et se recrutaient
dans des familles se transmettant
les techniques de père en
fils. L'activité des forges donna à
cette époque une indéniable prospérité
à la région de Châteaubriant.
Les principaux sites
Chaque site comprenait un haut
fourneau, et deux ateliers : la forge
(chaufferie, affinerie, martelage) et
la fenderie. À Martigné-Ferchaud
(Ille et Vilaine) fut construit, début
18', l'ensemble ainsi décrit, qui
était à l'époque le plus moderne de
Bretagne. Il fut remplacé fin 19'
par une grande minoterie. Un peu
plus au nord, à Chelun près de la
forêt de La Guerche, un haut fourneau
produisait de la fonte, et l'envoyait
à l'affinage dans des forges
voisines.
À Moisdon-la-Rivière, au sud de
Châteaubriant, fut construit fin 17'
un ensemble complet, dans le cadre
d'un bail de 18 ans, les installations
revenant ensuite à la famille des
Condé. Des ateliers annexes, rattachés
à la forge principale, se développèrent
dans les communes voisines.
L'activité se poursuivit
jusque vers 1860. Aujourd'hui, un
ancien bâtiment restauré est utilisé
comme musée de l'ancienne sidérurgie
de la région.
La forge de la Hunaudière, à
Sion-les-Mines, date du début 17'.
Elle cessa de fonctionner en 1852,
mais le haut fourneau produisit de
la fonte jusqu'en 1883. Plus au
nord, à Pléchâtel, un haut fourneau
fut installé à Plessis-Bardout.
Les autres sites importants de la
région sont ceux de la Jahotière en
Abbaretz, de la Poitevinière à
Riaillé, de Tressé et la Previère à
l'ouest de Pouancé, etc. En Bre-
A
Vue de la fenderie et
coupe du grand fourneau
de la forge (1735)
à Martigné-Ferchaud (35).
tagne, d'autres hauts fourneaux au
bois furent construits ainsi dans le
Morbihan : Pont-Callec, Pluvigner,
Tredion, Nivillac.
L'évolution au
19e siècle
Peu de choses subsistent du
riche passé industriel de la région
de Châteaubriant. Les sidérurgies
au bois s'éteignirent progressivement
au cours du 19' siècle, sous
l'effet des techniques utilisant
la houille, et de l'apparition des
transports ferroviaires. Elles furent
remplacées par de grandes forges à
l'anglaise avec laminoirs, et des
hauts fourneaux plus puissants,
situés dans des bassins charbonniers
(Lorraine, Nord) où le minerai
de fer, soit existait, soit pouvait
être apporté aisément. Les procédés
Bessemer et Thomas permirent
de produire l'acier en quantité.
Les forges de la région de Châteaubriant
s'arrêtèrent, mais les
fontes au bois continuèrent à être
produites pendant quelques décennies
après 1850, avec affinage
dans de nouvelles forges à l'anglaise
créées près de la mer, à
Basse Indre, dans la région nantaise,
ou à Hennebont en 1826,
après canalisation du Blavet.
Un ancien maître fondeur créa
cependant à Châteaubriant une
fonderie de seconde fusion, qui
permit à cette cité de devenir,
début 20' siècle, "la capitale de la
charrue". n
Christian Delaunay
® RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Le nouveau
directeur du CNEVA
Ploufragan (22) : Philippe
Vannier vient d'être nommé
directeur du Centre national
d'études vétérinaires
et alimentaires
(CNEVA)
de Ploufragan. Il
a pris ses fonctions
le 5 janvier 1996, en remplacement
de Georges Bennejean.
Vétérinaire, spécialiste des
pathologies porcines, Philippe
Vannier participe, en tant qu'expert,
à de nombreux conseils ou
commissions scientifiques, aux
niveaux national et européen.
Rens.: CNEVA,
tél. 96 76 0130.
ECONOMIOUE
G~-de
LES BREVES RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Anticipa
1ECIOIO/OlE LYNpX LAEfAR
Photo SARL des Omho Venn.
Du côté des
entreprises
Palmarès
des entreprises
Le mensuel Bretagne Économique
a annoncé, le 21 décembre dernier,
son septième palmarès des entreprises
bretonnes. Plus de 700 entreprises,
réalisant au moins 80 millions
de francs de chiffre d'affaires,
ont été sélectionnées pour cette édition
1995. Parmi les sociétés ayant
réalisé les plus belles marges commerciales
en 1995, citons Dinan
surgélation, CBL (Construction
Bretagne Loire) et le Laboratoire
de biologie marine Daniel Jouvance.
Particulièrement riche en
enseignements sur la vie économique
de la Bretagne,
ce palmarès
est un outil
pour tous les
observateurs et
les décideurs de
la région.
► Rens. : Chambre régionale
de commerce et d'industrie,
tél. 99 25 4195.
Construire
des accélérateurs
Vannes (56) : sur le Pôle d'innovation
de Bretagne Sud (PIBS), l'entreprise
Sigmaphi fabrique des
électroaimants pour accélérateurs
de particules. Parmi ses clients,
citons l'hôpital de Boston, pour un
cyclotron destiné au traitement des
tumeurs, ou un centre de recherche
de Berlin, qui a pris 114 aimants de
60 kilos chacun. "Notre petite
taille (18 salariés) nous permet
d'être plus souples, plus imaginatifs',
explique Henri Le Gal, directeur.
Rens. : Henri Le Gal,
tél. 97 42 55 55.
Internet pour tous
Brest : l'entreprise
Galéode
propose un service
d'accès
national à Internet,
pour un prix
modique de connexion : 74 centimes
les 2 minutes, quel que soit le
lieu d'appel. En effet, une nouvelle
tarification mise en place par
France Télécom permet aux particuliers
et aux entreprises de toute la
France, d'accéder au réseau mondial
à un coût raisonnable. Plusieurs
formules d'abonnement (à
partir de 130 francs par mois) sont
possibles, et Galéode propose également
une assistance téléphonique.
► Rens. : Galéode,
tél. 98 05 10 13.
Crédit
impôt-recherche :
mode d'emploi
Rennes : la cellule "Développement
industriel" de la Chambre de
commerce et d'industrie propose,
sur simple demande, une plaquette
d'information sur le crédit impôtrecherche.
Destiné aux entreprises
industrielles, commerciales ou
agricoles, le crédit impôt-recherche
participe à l'accroissement des
dépenses de recherche et développement.
► Rens. : Loi'c Évain,
tél. 99 33 6619.
Trophée international
de l'alimentation
La Chapelle-des-Fougeretz (35) : la
SARL des Quatre Vents (SICA
Natur'Or) vient de se voir attribuer
le trophée international de l'alimentation
1995, ce qui conforte
les efforts de qualité mis en oeuvre
ces dernières années, pour satisfaire
les consommateurs de tomates
dites "gustatives", sous toutes leurs
formes : tomate apéritif, en salade,
à croquer, à cuire ou pour décorer.
Les tomates gustatives, au goût
sucré et prononcé, sont de moins
en moins cultivées en France, car
elles sont fragiles et leur culture
demande plus de travail que celle
des tomates fermes.
Rens. : Les Quatre Vents,
tél. 99 13 10 00.
CD-Rom Anticipa
Lannion (22) : le CD-Rom présentant
les 70 structures présentes sur
la technopole Anticipa
(voir Réseau
n° 117) vient de se
voir attribuer le prix
du meilleur CD-Rom "Entreprise".
Ce CD-Rom sera prochainement
mis à la disposition du public à
l'aéroport de Lannion.
► Rens. : Sylvie Brichet,
tél. 96 46 42 28.
Une nouvelle librairie
scientifique
Rennes : située rue Edith Cawell,
la nouvelle librairie médicale et
scientifique propose 15 000 titres
et 40 000 références spécialisées,
réunis dans un catalogue distribué
sur les campus. Elle vient remplacer
la librairie des facultés, fermée
récemment.
► Rens. : Jean-Claude Latard,
tél. 99 7810 60.
Du côté des
laboratoires
Deux centres
de la marine
Presqu'île de Crozon (29) : la
Marine nationale fait de la presqu'île
de Crozon un véritable pôle
d'entraînement à la sécurité et au
sauvetage. Ce pôle concerne la
sécurité des sous-mariniers et celle
des personnels de l'aéronautique
navale. Pour ces derniers, c'est
l'école de survie et de sauvetage de
la base aéronavale de Fréjus - Saint-
Raphaël qui a été transférée sur la
base de Lanvéoc-Pouhnic, prenant
le nom de CESSAN (Centre d'entraînement
à la survie et au sauvetage
de l'aéronautique navale).
Son équipement le plus important
consiste en un bassin de 1500 m3
permettant, grâce à des simulateurs,
le treuillage, l'entraînement à l'évacuation
d'une cabine immergée (à
une profondeur de 6 m), et à la
réception en parachute en mer. Pour
les sous-mariniers, une tour d'exercice
sera construite à l'Ile Longue
pour 1996 : le CESI (Centre d'entraînement
au sauvetage individuel).
Il reproduira les conditions de sauvetage
d'un équipage en difficulté.
► Rens. : Capitaine de frégate
Liberge, relations publiques,
tél. 98 22 04 36.
Des algues au chou
Saint-Pol-de-Léon
(29) : Serge Mabeau,
le nouveau directeur
du GIP Bretagne
Biotechnologie,
était pendant
10 ans chargé des applications
industrielles au CEVA (Centre
d'étude et de valorisation des
algues), à Pleubian dans les Côtes
d'Armor. À ce titre, il a noué de
nombreux contacts au sein du tissu
économique régional et participé à
plusieurs projets de recherche européens.
► Rens. : Françoise Le Gall,
tél. 98 29 06 44.
Convention entre
Costel et Météo France
Rennes : Michel Le Quentrec,
directeur interrégional de Météo
France Ouest, et Jean-Pierre Marchand,
directeur du laboratoire
Costel (Climat et occupation du
sol par télédétection, URA CNRS
1687), ont signé, le 16 octobre, une
convention de coopération. Cette
convention prévoit l'échange de
données entre les deux partenaires
et l'accès des enseignements de
l'université aux chercheurs de
Météo France. Des projets communs
de recherche ont également
été définis.
► Rens. : Vincent Dubreuil,
tél. 99 14 18 52.
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Océanf olis; ;
mille et un acons
de voil
raconter la tr
BREST, port de plaisance.
ouE4Fir'~i
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996 LES BRÈVES
Les échos
de l'Ouest
Visiocommunication
Rennes/Cesson : le 19 décembre
dernier, les élèves de terminale
S du lycée Sévigné ont pu visiter,
sans quitter Cesson, l'exposition
"Tous parents... tous différents"
présentée à l'Espace
des Sciences. Les images de
l'exposition et le commentaire
en direct du conférencier ont
voyagé, via le réseau Numéris,
entre Rennes et Cesson. Cette
expérience pilote est très probablement
la première d'une
longue série !
A Photo d'univers prise
par David Malin, réputé au
niveau mondial pour son
"Catalogue de l'univers",
son ouvrage "La couleur
des étoiles" et plus
récemment, "Une vue de
l'univers" qui lui a valu le
prix Eurêka du livre
scientifique en 1994.
12 novembre/
David Malin,
photographe des étoiles
Pleumeur-Bodou (22) : le planétarium
du Trégor (le plus grand de
France avec 20 mètres de diamètre)
a eu le plaisir d'accueillir
l'astronome anglais David Malin,
de l'Observatoire de Sydney en
Australie, pour une conférence sur
"La couleur des astres" : `La mise
en valeur des contrastes nous a
permis de découvrir de nouveaux
objets célestes", a-t-il expliqué.
Rens.: Planétarium du Trégor,
tél. 96 9183 78.
Phare Ouest
Chaque trimestre,
le journal
"Phare Ouest"
présente l'actualité
de la délégation
régionale
Bretagne-Pays de
la Loire du CNRS. Au sommaire,
figurent les événements marquants
de la vie de la délégation régionale
(conventions, point fmancier, formation...),
mais aussi la présentation
des laboratoires et instituts de
recherche de l'Ouest.
► Rens. : Brigitte Delahaie,
tél. 99 28 68 09.
CCSTI et Conseil
général du Finistère : la
convention sur les rails
Brest : le Conseil général du Finistère
et le Centre de culture scientifique
technique et industrielle ont
renouvelé la convention qui les lie
pour trois nouvelles années. Aux
termes de celle-ci, les deux partenaires
s'engagent notamment à
continuer ensemble la mission de
promouvoir la culture scientifique
et technique, en poursuivant dans
le Finistère la diffusion d'expositions
scientifiques itinérantes et en
portant une attention constante à
l'actualité du département dans le
mensuel Réseau. Le Conseil général
s'engage, lui, à poursuivre le
financement de l'antenne fmistérienne
du CCSTI à Brest, et il
prend également à sa charge 30 %
du coût de location des expositions
itinérantes louées par des
emprunteurs fmistériens. Jacques
Berthelot, conseiller général délégué
à l'enseignement supérieur et
à la recherche et Michel Cabaret,
le directeur du CCSTI ont tous
deux présenté, le mois dernier, à la
presse finistérienne, la signature
de l'accord portant sur les trois
prochaines années.
Rens.: Jacques Berthelot,
tél. 98 46 5714 ;
CCSTI, antenne du Finistère,
tél. 98 0515 02.
Océanopolis,
meilleure pub
Brest (29) : nos confrères d'Océanopolis,
le Centre de culture scientifique
technique et industrielle de
la mer, à Brest, se sont vus décerner
une récompense le 16 octobre
dernier, lors du congrès annuel du
Comité régional du tourisme en
Bretagne. C'est un document
recto-verso, paru dans l'un des
supports du comité, qui a valu à
Océanopolis de remporter le trophée
de la publicité 1995, offert
par les Chambres de commerce et
d'industrie de Bretagne. Le slogan-
phare du document primé,
"Océanopolis, mille et une façons
de vous raconter la mer", était
illustré par les deux facétieux
phoques vivant dans les bassins de
l'établissement.
Rens.: Chantal Guilleret,
tél. 98 00 96 00.
Voile-recherche :
un challenge dominé
par des Brestois
Concarneau (29) : le challenge
national Voile-recherche regroupait,
pour la cinquième année
consécutive, des équipages de
régatiers issus des différents laboratoires
ou formations associés au
CNRS. A Concarneau (29), les 13,
14 et 15 octobre, douze équipages
se sont ainsi affrontés, venus de
différentes régions de France. Au
terme des quatre étapes qu'ils ont
dominées, ce sont les membres de
l'équipage du LEST qui ont logiquement
remporté la palme, en
régatiers finistériens qu'ils sont. Le
LEST est en effet le Laboratoire
d'électronique et des systèmes de
télécommunications de Brest, une
URA CNRS (1329) associée à
Télécom Bretagne et à l'Université
de Bretagne occidentale.
Vision Bretagne •
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) :
bravo à la société Vision Vendée,
qui a transformé notre région en
jeu de société, après en avoir fait
autant de la Corse et de la Vendée.
Sorte de "Trivial Pursuit", le jeu
"Vision Bretagne" se compose de
2000 questions-réponses réparties
en 5 domaines : économie, tradition,
histoire, tourisme-géographie
et sport-vie contemporaine.
► Rens. : Bertrand Bernicot,
tél. 99 7815 48.
Signature de la convention CCSTI/Conseil général du
Finistère entre Jacques Berthelot, conseiller général délégué
à l'Enseignement supérieur et à la Recherche (à droite) et
Michel Cabaret, directeur du CCSTI (à gauche).
e) RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
Le big-bang vu \„
par un artiste. r
i 41,11104 44
Exposition
Jusqu'au
3 août/
Aux origines
de l'univers
Rennes : notre histoire est
intimement liée à celle de
l'univers. Elle a commencé
par une gigantesque explosion,
le big-bang, il y a 15 milliards
d'années. Les atomes
d'hydrogène qui entrent dans
la composition des molécules
organiques de notre corps
sont nés quelques minutes
seulement après le big-bang...
Cette exposition est un véritable
voyage à remonter le
temps, en compagnie d'Hubert
Reeves.
► Rens. : Espace des Sciences,
tél. 99 35 28 28.
Ouvert du lundi au vendredi de
12 h30 à 18h30, le samedi de
10hà18h30. Entrée :10F,tarif
réduit : 5 F, gratuit pour les moins
de 12 ans. Groupes k matin sur
réservation uniquement.
Rennes Atalante
Rectificatif :
Guide des stages pour
Bac +2à Bac + 5
Rennes : ce guide, édité par la
technopole Rennes Atalante ne
s'adresse pas aux étudiants, mais
est destiné aux entreprises. Il
recense les stages proposés par les
deux universités de Rennes, huit
écoles d'ingénieurs, l'École supérieure
de commerce et l'Institut
d'études politiques pour permettre
aux entreprises de connaître l'offre
de l'enseignement supérieur.
► Rens. : Corinne Bourdet,
tél. 9912 73 73.
/Zoo eoins,
lieus d'histoire
Dresseurs
de métal
"Dresseurs de métal",
un superbe recueil de photographies
édité chez Dialogues et
signé Dominique Leroux, vient
de paraître. Ce dernier, ancien
ouvrier puis photographe à la
DCN (Direction des constructions
navales), y a passé 15 ans,
de 1977 à 1992. Il a profité de
son affectation sur le chantier
du futur porte-avions nucléaire
Charles de Gaulle, pour saisir
sur le vif tout un peuple au travail.
Les très belles images de
ces dresseurs de métal, travaillant
à une entreprise de
pointe montrent, comme le souligne
Dominique Leroux, "que
la technologie n'a pas encore
remplacé le travail de l'homme
et l'attention qu'il y porte."
► Rens. : Dialogues,
Forum Roull, 29200 Brest,
tél. 98 44 88 68.
"Lieux de soins, lieux
d'histoire". Fruit d'un travail
pluridisciplinaire réunissant
historiens et professionnels hospitaliers,
ce guide vise à fournir
des conseils pratiques et des
pistes de réflexion sur la
manière de faire et d'utiliser
l'histoire d'un établissement de
soins. Comme le souligne Jean-
Yves Andrieux, professeur
d'histoire de l'architecture à
l'université de Rennes 2, dans
la préface de l'ouvrage "on
apprendra ici à réfléchir et,
déjà, à mieux connaître, mieux
accepter et en définitive mieux
vivre l'hôpital, objet d'histoire
et lieu du quotidien."
Ed. ENSP, 224 p, 150 F.
Rens. : GIE éditions
ENSP, tél. 99 54 90 98.
À lire
Formation Continue
Université de Rennes 1
INFORMATIQUE
Formations diplômantes
DESS Informatique Double Compétence
DESS Informatique et Ses Applications
DESS Traitement de l'Information Médicale et
Hospitalière
Formations qualifiantes
L'IFSIC et L'IRISA proposent des formations qualifiantes
de 2 à 8 jours, dans les domaines suivants :
Systèmes
Unix, Systèmes répartis, Distribués, Modélisation
Programmation
C, Objet-C++, Logique, Fonctionnelle, Synchrone
Base de données
Relationnelles, Oracle
Images numériques
Traitement du signal
Méthodologie
Merise, Contrôle statistique de la qualité
Multimédia, Internet, Réseaux
INFORMATIONS
Service d'Education Permanente
4, rue Kléber 35000 RENNES
Tél. 99 84 39 50 Fax 99 63 30 33
Email: Henri.Cuvellier@univ-rennesi.tr
RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996 LES BRÈVES
Photo Monrhu/ Ciel e/ Espae.
Formations
7 février/
Caractérisation des
hydrocolloïdes
Vannes (56) : à l'initiative du
centre de formation et de
recherche Archimex, Bernard
Quémener, ingénieur de recherche
à l'INRA de Nantes, présente les
principales méthodes de caractérisation
des hydrocolloïdes d'origine
végétale (pectines, alginates,
carraghénanes, galactomannanes
et xanthanes). Ces produits sont
largement utilisés comme épaississants
et gélifiants dans la formulation
de produits alimentaires,
cosmétiques et pharmaceutiques.
Leur caractérisation est aujourd'hui
devenue une nécessité.
13-14-15 février/
Rhéologie industrielle
Vannes (56) : ce stage fait le point
sur les comportements théoriques
en rhéologie (propriétés d'écoulement,
viscoélasticité), et propose
l'analyse de cas pratiques dans
l'industrie. Des démonstrations
d'appareillages sont également au
programme.
20-21-22 février/
Outils d'informations
scientifiques
et techniques
Vannes (56) : l'information industrielle,
l'innovation et la veille
technologique sont aujourd'hui
intégrées à la stratégie de l'entreprise.
Ce stage présentera l'interrogation
de bases de données, en
s'appuyant sur des démonstrations.
Rens. pour ces 3 stages :
Archimex, tél. 97 47 06 00.
•
F r l r-1 _. i
`• ION trt6kE`aC.n`.
Jsuel&ûl Blin d'abonnement et chèque à retourner à :
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES.
Tg. 99352820.
Ville
Cade oo.
•
RECk iR9 HE E
® RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
LES BRÈVES RÉSEAU 119 • FÉVRIER 1996
r ,~
, I
~ ~
~l ,711 J
MENSLE PECIOCIE el OF 19.10VAION EN BRETAGNE
Président du CCSTI : Paul Tréhen.
Directeur de la publication : Michel
Cabaret. • Rédacteur en chef: Hélène
Tanevin. n Collaboration : Catherine
Perrot, Marc-Élie Pou, Françoise Boiteux-
Colin, Monique Guéguen. n Comité de
lecture : Louis Rouit, Christian Willaime,
Gilbert Blanchard, Monique Thorei.
Thierry Juteau (pour la géologie et
l'océanographie), Didier Le Morvan
(pour les sciences juridiques), Alain
Hillion (pour les télécommunications),
Michel Branchard (pour la génétique et
la biologie). • Abonnements : Béatrice
Texier. • Promotion/Publicité : Alain
Diard, Danièle Zum-Folo.
RÉSEAU est publié grâce au soutien de
la Région Bretagne, du secrétariat d'État
à la Recherche, des départements du
Finistère et d'Ille et Vilaine, de la Ville de
Rennes et de la Direction régionale des
Affaires culturelles. Edition : CCSTI.
Réalisation : Pierrick Bertôt Création
Graphique, Cesson-Sévigné.
QUI A DIT ?
Réponse de la page 6
Corneille, "Le Cid".
•
Pour recevoir
RÉSEAU,
ABONNEZ-VOUS !
Abonnement pour 1 an (11 numéros)
Tarif : 200 F
Abonnement de soutien : 300 F
Abonnement étudiants : 100 F
Nom
Prénom
Organisme/Société
Adresse
Faites découvrir
RÉSEAU à vos amis
Donnez-nous les coordonnées de
votre ami, il recevra gracieusement
le prochain numéro de Réseau
Nom
Prénom
Organisme/Société
Adresse
Ile
Colloques
19-20 février/
Qualité et
responsabilité en
bloc opératoire
Rennes : ce colloque s'adresse aux
directeurs d'hôpitaux, pharmaciens,
responsables de blocs et
hygiénistes.
Rens. : Gwenaël Bargain,
tél. 99 05 09 00.
Conférences
7 février/
Présentation
des activités du CCSTI
et conférence sur la
sécurité et l'assistance
météorologique en mer
Brest : lors de cette journée, le
CCSTI présente ses expositions
itinérantes et son planétarium à
partir de 15 h, au Quartz (manifestation
réservée aux professionnels).
Cette présentation est suivie
d'une conférence de Claude Fons,
délégué départemental de Météo
France, sur le thème de la sécurité
et l'assistance météorologique en
mer. Cette conférence, ouverte au
grand public, a lieu au Quartz, à
20 h.
Rens.: CCSTI antenne
Finistère, tél. 98 05 60 91.
Les mercredis
de la mer
Ces conférences
sont organisées
par le CCSTI et le
centre IFREMER
de Brest, en collaboration
avec la
fondation Nature & découvertes.
À la Maison du Champ de Mars, à
20 h 30, entrée libre.
Rens.: CCSTI, tél. 99 35 28 20.
7 février/
Énergie marémotrice
et environnement
aquatique
Rennes : Christian Retière dirige le
Laboratoire maritime de Dinard, il
a observé de près l'impact du barrage
de la Rance sur l'écosystème
de l'estuaire : "Aujourd'hui, après
20 années, une flore et une faune
de plus en plus diversifiées se sont
établies".
13 mars/
Bactéries extrêmes
Rennes : les micro-organismes
adaptés aux environnements
marins "extrêmes" (hautes pressions,
températures élevées ou au
contraire très basses) présentent un
intérêt scientifique et peuvent aussi
être utilisés pour certaines applications.
Georges Barbier, chercheur à
l'IFREMER, en présentera plusieurs
exemples.
Conférences
à Océanopolis
À 20 h 30, à l'auditorium
d'Océanopolis,
port du Moulin-
Blanc, entrée
libre.
► Rens. : Chantal Guillerm,
tél. 98 00 96 00.
6 mars/
Antarctique, continent
des extrêmes
Brest : Claude Lorius, président de
l'Institut polaire, présente l'Antarctique
: un observatoire pour la
planète. Continent de l'extrême,
du froid et du vent, l'Antarctique
a attiré chasseurs, explorateurs,
aventuriers et touristes. Aux
franges de la glace, vivent des
espèces uniques remarquablement
adaptées, telles que phoques et
manchots...
Conférences
"Aux origines
de l'univers..."
à l'Espace
des Sciences
Les 24 février
et 23 mars/
Paul Caillet, professeur et responsable
du certificat d'astronomie à
l'université de Rennes 1, présente
des conférences-débats sur les
thèmes d'actualité en astronomie,
illustrées d'images spectaculaires.
À 16 h 30, entrée libre.
MNSA ÉCOLE D'INGENIEURS
Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, sous tutelle du
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
Forme des ingénieurs dans les spécialités :
I Electronique et Systèmes de Communication (ESC)
Génie Civil et Urbanisme (GCU)
a Génie Electrique (GE)
I Génie Mécanique et Automatique (GMA)
1 Génie Physique (GP)
I Informatique (IF)
à la suite d'un premier cycle de deux années (recrutement après le bac sur dossier).
Possibilité de recrutement à bac + 2 (DEUG, DUT, BTS, CPGE) et à bac + 4 (maîtrise) avec intégration en
lère année et 2ème année de spécialité après sélection sur dossier.
RENSEIGNEMENTS : 99.28.65.65.
Les dossiers sont à déposer pour le 15 AVRIL 1996.
AI JOURNEE "PORTES OUVERTES" LE SAMEDI 17 FEVRIER 1996 de 10h à 18h ,)
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCESAPPLIQUEES
20, avenue des Buttes de Coësmes - 35043 RENNES CEDEX - Tél : 99.28.64.00 - Fax : 99.63.67.05
Congres
emunaire
A BREST
Contact : Robert Le Donge
BUREAU DES CONGRÈS
BREST
2-4, AVENUE CLEMENCEAU
BP 411
29275 BREST CEDEX
TÉL. 98 44 33 77
FAX 98 44 05 00
Si Brest accueille un nombre
croissant de congrès et colloques
scientifiques et médicaux, c'est
parce que la ville de la mer
offre aux chercheurs du monde
entier l'environnement idéal
pour des rencontres fructueuses.
Congrès de géophysique,
d'informatique, de technologies
appliquées à la mer...
Quel que soit votre projet, Brest
a déjà la solution et vous offre une
diversité d'espaces complémentaires.
Le Quartz, Centre de congrès confortable,
propose en pleine ville,
un grand théâtre de 1500 places,
un amphithéâtre de 320 places,
une salle de conférence de 350 places,
des salles de réunion et de restauration,
un espace d'exposition.
Le CCSTI a choisi le Quartz pour présenter
aux acteurs de l'animation éducative et
culturelle ses produits d'itinérance destinés
aux centres culturels, aux écoles, aux mairies
et aux entreprises.
Présentation réservée aux professionnels
de 15 h à 18 h le 7 février 1996
Conférence publique à 20 h
SECURITE ET ASSISTANCE
METEOROLOGIQUE
avec Monsieur FONS
Délégué Départemental de METEO FRANCE
ENTREE LIBRE
A Brest, il y a des salles pour le confort,
et du sel pour les temps forts
CIT É LIS
LA CITÉ VIRTUELLE
LA BANQUE ,,)
LE MUSÉE ;,
L'AGENCE DE VOYAGES „)
L'OFFICE DU TOURISME
LA BIBLIOTHÈQUE
L'ÉCOLE
LA GALERIE MARCHANDE
LA PRESSE
AVEC CITÉLIS,
SURFEZ SUR LA PLANÈTE INTERNET
Pour tout renseignement complémentaire,
renseignez-vous auprès de votre Caisse de Crédit Mutuel.
Groupe
Crédit*;Mutuel
de Bretagne
29808 BREST CEDEX 9
Venez nous visiter http://www.eurobretagne.fr/
RÉPONSES :. ASSOCIÉES - ROE
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest