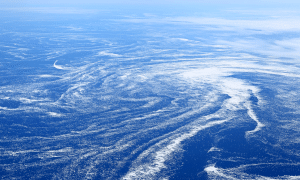Être jeune chercheur en Bretagne
MENSUEL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN BRETAGNE
DOSSIER
L'archéologie
sous-marine
FÉVRIER 97 • N°130 L'ESPACE
DES
SCIENCES
Centre de culture scientifique technique et industrielle
SOMMAIRE
LA VIE DES LABOS
L'archipel de Molène, réserve
de la biosphère
(impartie : les îles,
des sites privilégiés)
Une chronique
de la vache folle
La protéine prion :
faits et incertitudes
o
HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
Les visiteurs
des musées engloutis
LES SIGLES DU MOIS
LE DOSSIER
Être jeune chercheur
en Bretagne
HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
Le campus scientifique
de Beaulieu
0/0
~
LES CENTRES DE TRANSFERT
EN BRETAGNE
Les essais vétérinaires
au CTPA
Les Brèves
de Réseau Q/®
m
t Une partie
de la structure
tridimensionnelle
de la protéine
prion normale de
souris déterminée
par résonance
magnétique
nucléaire.
RÉSEAU est édité par L'Espace des sciences-
Centre de culture scientifique technique et
industrielle (CCSTI).
Tirage dun°130 : 4000 ex. Dépôt légal n°650. ISSN 0769-6264
L'Espace des sciences-CCSTI
6, place des Colombes, 35000 Rennes
Tél. 02 99 35 28 22- Fax 02 99 35 28 21
E-mail : ccsti@univ-rennesl.fr
Antenne Finistère : L'Espace des sciences-CCSTI
40, rue Jim Sévellec, 29608 Brest Cedex
Tél. 02 98 05 60 91 - Fax 02 98 05 15 02'
E-mail : mepau@infini.fr
VOUS cONNA;SSE~
M DEAN; ÈAE ?
i~ FARAiT QUE
F=ItBSinOr
0 rir une
euxième
chance
Durant leur période scolaire, les
jeunes s'écartent quelquefois
des sciences et des techniques.
Si cette première rencontre est manquée,
le second rendez-vous doit être
le bon. Les centres de culture scientifique
peuvent avoir à ce niveau un
rôle essentiel à jouer...
Être cultivé, participer à la culture de son
temps, c'est, à notre époque et plus que jamais,
maîtriser un bagage scientifique et
technique. Avoir accès à la culture est en soi
un avantage inestimable, en termes de qualité
de la vie (bien plus qu'en termes d'armement
pour gagner du pouvoir, de la réussite
ou du prestige). Avoir accès à la culture
scientifique, c'est voir le monde avec les
yeux d'aujourd'hui, comprendre quelle
prise nous avons sur lui, ne pas être exclu de
l'évolution des connaissances, des avancées
de la recherche, des méthodes et des
concepts nouveaux.
On ne peut être que désolé de voir tant de
personnes renoncer à cet élément majeur du
développement et de l'épanouissement personnel
: "ce n'est pas mon truc, je n'y comprends
rien, ça passe au-dessus de ma tête,
je ne suis pas doué". Tout comme le rejet,
par certains, des arts, ou du patrimoine de
l'écrit, cette fermeture est presque toujours
le résultat d'une mauvaise rencontre.
L'âge du refus
Quand on est jeune, on a besoin de définir
son identité, de se différencier, d'affirmer ses
goûts ; et cela passe d'abord par des refus ;
c'est bien plus tard que vient le besoin de
nouveaux essais, ou l'envie de tenter de nouvelles
expériences. Dans ces rejets, le désir
de ressembler à telle personne ou à tel
groupe, d'évacuer tout ce qui ressemble à
telles autres personnes ou à tel autre groupe,
tient une large place, et de façon très durable.
Apprendre, ne l'oublions pas, ce n'est pas
seulement exercer sa mémoire et ses capacités
de raisonnement ; c'est aussi avoir du
goût, de l'attraction pour le savoir. Combien
de fois celui-ci est-il rébarbatif, ennuyeux
ou déplaisant ! Pourquoi faudrait-il donc se
concentrer, se donner du mal, travailler pour
SiCA/ SUR
fuiS4vE
w-~SBcod v
~~
quelque chose qui ne vous dit rien ? Les enseignants
savent bien aussi que tous les esprits
ne sont pas identiques, que les rythmes
de développement et d'ouverture sont individuels
; mais les impératifs de la classe, le
volume des programmes ne permettent pas
beaucoup de différenciation pédagogique.
Une deuxième rencontre...
Il y a donc mille raisons pour renoncer, en
ne faisant plus rien dans une matière, ou en
persistant, mais sans suivre, "largué".
L'abandon est presque toujours le fait d'une
inhibition devant tout ce qui est scientifique,
non celui d'une incapacité. Certes, on peut
très bien développer l'intelligence à travers
les langues, les lettres, les arts ou le droit,
mais pourquoi cette intelligence serait-elle
définitivement inapplicable au domaine si
riche de la science ?
Ces remarques conduisent à penser
qu'après une mauvaise rencontre, il faut offrir
une deuxième chance, et même plusieurs,
se situant à d'autres âges, à d'autres
étapes de la maturation personnelle, en
d'autres occasions, sur d'autres sujets. Ces
nouvelles chances doivent présenter l'objet
scientifique et technique sous un autre aspect
et selon d'autres méthodes. L'expérience
de certains musées scientifiques
montre l'avantage de regarder celui qui apprend
comme un chercheur, les mains dans
la pâte, de lui faire poser des questions,
avancer des hypothèses, douter, contrôler,
prouver. Les meilleurs esprits expérimentaux
ont souvent été, dans un premier temps,
écartés de la science par une présentation
brutalement dogmatique, une théorie imposée
toute faite quand ils n'en avaient pas encore
besoin. Dans cette approche, il s'avère
que travailler à plusieurs sur le même problème
expérimental, expliquer aux autres ce
qu'on vient de comprendre soi-même, amplifie
remarquablement la réussite.
Les centres de culture scientifique et technique,
les associations d'éducation populaire
peuvent jouer, avec le soutien des chercheurs,
un rôle considérable dans cette
grande entreprise d'ouvrir à tous le privilège
d'une culture scientifique. n
Olivier Sabouraud, neurologue.
ÉDITORIAL
® RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Ire partie : les îles, des sites privilégiés
À seulement quelques encablures"" du littoral, l'archipel de
Molène reste un espace relativement préservé des invasions
et des pollutions, grâce aux forts courants qui animent ses
eaux. Un proverbe local bien connu ne dit-il pas "Qui voit
Molène voit sa peine ?" Parcourant les îlots, une poignée de
scientifiques participe à une opération de recherche à portée
internationale, centrée sur la préservation de la biodiversité.
• Al'origine de ces travaux qui
ont concrètement débuté en
1994 sur l'archipel des Sept-Îles,
sont étroitement associés un
groupe de scientifiques de
l'Inra°', de l'Université de Bretagne
occidentale (UBO), de la
faculté de médecine de Rennes,
du CNRS"), et un groupe de gestionnaires
ayant la responsabilité
d'espaces protégés"). Sous l'oeil
un tantinet sceptique et goguenard
des îliens, tout ce petit
monde exécute un ballet étrange
pour le lieu, sous la houlette de
Jean-Yves Le Gall, garde de la réserve
de la mer d'Iroise et grand
responsable de la logistique tant
terrestre que marine.
Intérêt des
écosystèmes insulaires
Notre projet s'intitule "Mammifères
introduits, fonctionnement
des écosystèmes insulaires
et biodiversité". Il s'inscrit dans
un contexte de recherches internationales,
qui intéressent beaucoup
certains pays comme la
Nouvelle-Zélande, l'Australie et
les USA. C'est pourquoi nous
avons d'étroites relations avec
des chercheurs de ces pays, tout
particulièrement ceux de Nouvelle-
Zélande. Mais pourquoi cet
engouement pour les îles ? Les
écosystèmes insulaires présentent
la particularité d'être fragiles. Les
perturbations y ont souvent des
conséquences dramatiques. L'introduction
d'espèces exotiques
constitue l'une des perturbations
majeures, d'origine humaine,
dont les écosystèmes insulaires
ont pâti par le passé et pâtissent
encore de nos jours.
A Les chercheurs de l'Inra, du
CNRS, de I'UBO, du Muséum
national d'histoire naturelle
et de l'École vétérinaire de
Nantes, s'intéressent de
très près aux écosystèmes
insulaires.
Un site
expérimental idéal
Les îles présentent des particularités
qui les placent au premier
rang des écosystèmes candidats
au développement d'une biologie
de la conservation et de la restauration.
En effet, au-delà du fait
que les écosystèmes insulaires
présentent l'intérêt d'être simples
au regard des écosystèmes continentaux
occupant une superficie
équivalente et donc plus faciles à
étudier, les îles sont "entourées
d'eau", nombreuses, peuvent être
regroupées en archipels, et certaines
d'entre elles ont une surface
compatible avec les moyens
expérimentaux actuels. Certaines
îles se prêtent donc à l'expérimentation,
leur nombre permet de
multiplier les expériences et de
fonder la généralisation de leurs
conclusions. Voici quelques raisons
qui permettent d'expliquer
l'engouement de groupes importants
d'écologistes pour les études
expérimentales en milieu insulaire.
La musaraigne musette
et celle des jardins
Rien de tel que de focaliser des
travaux sur un archipel, pour
mettre au jour des problèmes originaux
ou insoupçonnés localement.
C'est ainsi qu'ignorant la
composition spécifique de la
faune de mammifères des îles,
nous avons dû combler cette lacune
avant toute intervention.
Nous avons ainsi mis en évidence
la présence de la musaraigne des
jardins sur toutes les îles de l'archipel
de surface supérieure à un
hectare, à l'exception de Molène
et des Lédenez. Sur ce groupe
d'îles reliées à marée basse, la
musaraigne musette s'est substi-
A Le village de Triélen n'est
plus habité depuis plusieurs
années, mais le surmulot,
rongeur importé par l'homme,
y a proliféré. Ce rongeur a
récemment été éradiqué de
l'île, au nom de la restauration
et de la biodiversité
(voir au prochain numéro).
tuée à l'espèce autochtone. Nous
avons fait la même observation
sur l'île de Sein et, dans ce dernier
cas, nous avons établi que
cette substitution, conséquence
probable d'une introduction involontaire,
a eu lieu dans les 30 dernières
années. Ainsi donc, sur des
îles du proche littoral, peuplées
par l'homme depuis près de
10000 ans, s'opèrent sous nos
yeux des phénomènes de substitution
d'espèces que d'aucuns réservent
intuitivement à des îles océaniques
récemment peuplées. n
Michel Pascal
Animateur du projet et directeur
du Laboratoire de la faune sauvage
du centre laya de Rennes.
," une encablure = 120 brasses = 200 m environ
(en fait, Molène se situe d environ. 12 kilomètres
de la côte). "' Inra : Institut national de
la recherche agronomique. CNRS : Centre national
de la recherche scientifique.'" La Société
d'étude et de protection de la nature en Bretagne
(SEPNB : association responsable de la
gestion de la réserve de la mer d'Iroise) ; la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO :
responsable de la gestion de la réserve des
Sept-Iles) et l'Office national de la chasse
(ONC : responsable de la réserve de chasse et
de faune sauvage de l'île de Béniguet, archipel
de Molène).
Michel Pascal,
tél. 02 99 28 53 79.
Contact ►
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
' 1S;
•
Une chronique
. de la vachefQlle
.~ ~. ,e
•
y
"1,s►
LA VIE DtS LBfS
~
•
A De gauche à droite : Annick Alperovitch, directeur de recherche
à l'Inserm U360 (hôpital La Salpêtrière à Paris), Pierre Thivend,
président du centre Inra de Rennes, Jean-Louis Laplanche, biologiste
à l'hôpital Lariboisière à Paris et Olivier Sabouraud, neurologue.
•
•
•
•
0
.4,
Cette .Micrographie
(grossissement x 370) montre
la structure spongieuse d'un
cerveau humain atteint par la
maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Cette caractéristique se
retrouve dans toutes les
maladies à prions.
Le 17 décembre dernier, au centre culturel Triangle à
Rennes, le CCSTI avait rassemblé trois spécialistes de la biologie,
de l'épidémiologie et de la nutrition animale, pour présenter
à un public nombreux un état des connaissances sur
les maladies dites "à prions"°1 : vache folle, mais aussi
Creutzfeldt-Jakob, kuru de Papouasie, tremblante du mouton...
Sans vouloir entrer dans la description biologique de
ces maladies, nous avons choisi de présenter un bref historique,
montrant que la crise actuelle couvait depuis plus de
5 ans, ce qui lui enlève un peu de son côté "sensationnel".
Pour ce récit historique, nous
avons pris comme référence
un document professionnels~1 :
"L'encéphalopathie spongiforme
n'a pas toujours été bovine",
nous rappellent ces praticiens.
Dès 1730, une maladie appelée
"tremblante" était décrite dans un
élevage de moutons en Angleterre.
Depuis, l'encéphalopathie
spongiforme s'est attaquée à la
chèvre, au vison, et plus récemment
aux bovins. Au début du
siècle, on découvre le kuru, une
autre encéphalopathie spongieuse,
dans une tribu cannibale en Papouasie-
Nouvelle-Guinée.
1985 -1995 :
l'épidémie anglaise
d'ESB
Mais l'espèce la plus touchée
ces dernières années est l'espèce
bovine : le premier cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine
(ESB) est apparu en 1985 en Angleterre
et dès 1988, l'incorporation
de farines de viandes et d'os
dans l'alimentation bovine et
ovine est interdite dans ce pays.
En 1990, l'apparition de cas
d'ESBs" hors du Royaume-Uni
provoquait l'interdiction de vente
de bovins britanniques de plus de
6 mois vers la Communauté européenne.
Dès juillet 1990, un rapport
au Parlement britannique
émettait la possibilité d'une transmission
de l'ESB à l'homme.
La crise de 1996 :
relation MCJ-ESB
La maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) a été identifiée en
1922 par les deux Allemands qui
lui ont donné son nom. Cette maladie
humaine appartient à la
même famille des encéphalopathies
spongiformes, qui se traduisent
par une dégénérescence
du cerveau. Le premier cas de
conjonction entre l'ESB et une
nouvelle forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob est publié par
The Lancet, la revue médicale anglaise,
en mars 1996 : certaines
similitudes génétiques entre les
deux protéines en cause sont clairement
identifiées.
Aujourd'hui, les données de
l'épidémiologie permettent de
comparer l'évolution parallèle de
ces deux maladies. Au Royaume-
Uni, le nombre de cas d'ESB a
culminé autour de 800000 animaux
malades en 1993, il est aujourd'hui
en nette récession.
Quant aux malades atteints du variant
de la MCJ, seize cas ont été
signalés à ce jour. Rien de bien
inquiétant a priori... le problème
est que pour les maladies à
prions,'le temps d'incubation
entre la contamination et la déclaration
de la maladie serait très
long : supérieur à 10 ans dans le
cas du kuru. On peut donc
craindre une augmentation des
cas de ce variant de la MCJ dans
les prochaines années, même si
l'épidémie d'ESB est en passe
d'être enrayée.
Le dispositif français
En France, le réseau d'épidémiosurveillance
de l'ESB est très
rigoureux : il associe étroitement
les vétérinaires sanitaires, le
Groupement technique vétérinaire,
les Services vétérinaires départementaux
et le Cneva(3) :
"Nous suggérons de mettre en
place des réseaux similaires pour
toute autre maladie animale susceptible
d'avoir une incidence
sur la santé humaine, comme la
salmonelloset2"'.
Aujourd'hui, toutes les viandes
d'élevage risquent d'être suspectées,
puisque le problème semble
venir, au départ, de la fabrication
industrielle des aliments. Selon
Pierre Thivend, président du
centre Inra et directeur de l'Ensar,
le consommateur doit se protéger
en exigeant d'être informé de manière
lisible, sur l'alimentation
des animaux qu'il consomme.
Cela peut paraître utopiste, mais
attention : la crise de la vache
folle incite les pays développés à
contrôler leur mode de production
de viandes, céréales, légumes et
autres "fruits de la terre". C'est
pourquoi l'objectif "qualité des
produits alimentaires", affiché
tant par les grands groupes industriels
(Coopagri, Even...) que par
les laboratoires et organismes de
recherche (Inra, Cneva...), n'est
pas seulement un nouvel outil de
communication, mais devient une
nécessité. n H.T.
"' Le rôle du prion en tant qu'agent infectant de
ces maladies n'est pas encore certifié : une hypothèse
virale reste plausible. " Source : La lettre
d'information du Groupement technique vétérinaire,
GTV contact, n° 12, mai 1996. (" Cneva :
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
Contact ► Pierre Thivend,
tél. 02 99 28 75 02.
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
kDa 1 2
21.5
14.4 —
LA VIE DES LABOS
La protéine prion
faits et incertitudes
Les maladies à prions sont atypiques. Les prions, des protéines
dont la structure tridimensionnelle est anormale dans
les tissus cérébraux infectés, s'accumulent et provoquent la
mort des cellules nerveuses. Si ces molécules sont des acteurs
essentiels de la maladie, la nature réelle de l'agent infectieux
transmissible reste encore à déterminer.
, N aive, 382, 11ju illet 1996, page 186182.
ean-Louis Laplanche, biologiste
à l'hôpital Lariboisière
à Paris, a présenté, suite à l'invitation
de l'Espace des sciences-
CCSTI, les connaissances actuelles
sur les prions et les
incertitudes qui pèsent sur la nature
de l'agent infectieux. "On
emploie soit le terme d'encéphalopathie
spongiforme soit celui
de maladie à prions, le premier
correspondant à une définition
anatomo-pathologique tandis
que le second correspond à une
description biochimique de la
maladie". La caractéristique principale
de ces maladies est l'aspect
spongieux du cerveau infecté, ce
qui traduit une dégénérescence
des cellules nerveuses. La mort
des neurones semble essentiellement
due à l'accumulation d'une
protéine anormale, connue sous le
nom de prion.
La biologie du prion
Dès 1980, Stanley B. Prusiner
met en évidence la nature protéique
de particules en bâtonnets,
visibles après le traitement par
des détergents et des protéases
d'un cerveau malade (maladie de
Creutzfeldt-Jakob). Il nomme
cette particule infectieuse "prion".
"Nous sommes tous porteurs de
la protéine prion normale, appelée
PrPc. Chez les malades, la
structure tridimensionnelle de la
protéine est différente", précise
Jean-Louis Laplanche. Devenus
résistants aux mécanismes de
dégradation des protéines, ces
prions anormaux, appelés PrPsc
(protéine prion "scrapie" 0)) ou
PrPres (résistante aux protéases),
s'accumulent dans la cellule nerveuse.
Pour se multiplier, la pro-
QUI A DIT ?
"Les bêtises qu'il a faites et les
bêtises qu'il n'a pas faites se
partagent les regrets de l'homme."
Réponse page 22
A Une partie de la structure
tridimensionnelle de la protéine
prion normale de souris
déterminée par résonance
magnétique nucléaire.
téine anormale interagirait avec
une protéine prion normale et imposerait
un changement de forme
à celle-ci. "Dans ce modèle, il
n'y a pas multiplication de
l'agent infectieux, comme dans
le cas d'un virus, mais modification
de protéines normales de
l'hôte". La protéine prion est localisée
à la surface des cellules
mais ses fonctions sont inconnues.
Récemment, un morceau de
la structure tridimensionnelle de
la protéine normale a été déterminé.
Maladies à prions
Selon Jean-Louis Laplanche,
"le chapitre des maladies à
prions humaines pourraient,
semble-t-il, être en extension".
Qu'elles soient animales ou humaines,
ces maladies sont des
pathologies dégénératives du système
nerveux central, transmissibles
et rapidement mortelles.
Outre les symptômes cliniques, la
présence d'une protéine prion
anormale dans le cerveau malade
est la seule caractéristique commune
au niveau biochimique. De
plus, en inoculant du tissu infecté,
par voie intracérébrale, sous-cutanée
ou encore orale, cette dernière
étant la moins efficace, il est possible
de transmettre la maladie.
"Cette transmission se heurte
parfois à la barrière d'espèce, le
lapin est, par exemple, résistant
à n'importe quelle encéphalopathie
spongiforme". Si dans la
plupart des cas, la maladie de
Creutzfeldt-Jakob est sporadique,
des études récentes sur la nouvelle
forme de la maladie apparue
en Angleterre montrent que tous
les malades ont un point commun
au niveau génétique. Il est toutefois
trop tôt pour donner des
conclusions.
Le prion est-il
l'agent infectieux
transmissible ?
S'il existe dans la communauté
scientifique mondiale, différentes
hypothèses sur la nature de
l'agent infectieux de ces maladies
(virus inconnu, prion, particule
hybride virus-prion...), les études
actuelles établissent uniquement
un lien étroit entre la pathologie
et l'accumulation d'une protéine
anormale dans le cerveau infecté.
De plus, "le tissu n'est plus infectieux
lorsque la protéine
anormale est éliminée par des
méthodes très drastiques". Toutefois,
il reste à découvrir l'origine
de l'apparition d'une forme anormale
du prion. En effet, aucune
protéine étrangère n'ayant été
identifiée dans le cerveau malade,
un autre facteur, aujourd'hui inconnu,
pourrait être l'agent infectieux.
L'importance des protéines et
de leur structure tridimensionnelle
est de plus en plus soulignée.
Les maladies à prions sont
un exemple frappant de leurs
propriétés complexes. Les recherches
médicales permettront
d'identifier clairement l'agent
infectieux transmissible. Cette
étape sera essentielle pour dépister
la maladie et pour aboutir à
une thérapie. n P.H.
"' Scrapie est le nom anglais de la tremblante
du mouton.
A Profil de migration
électrophorétique de protéines
prions anormales chez
deux patients atteints de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
(Western-blot).
Un agent
transmissible non
conventionnel
L'agent transmissible des
maladies à prions présente
différentes particularités qui
le rendent atypique : le temps
d'incubation de la maladie est
élevé, il n'y a ni réponse inflammatoire
ni réaction immunitaire,
la maladie est toujours
fatale... De plus, aucun acide
nucléique étranger (ADN ou
ARN) n'ayant été, à l'heure
actuelle, clairement identifié,
l'hypothèse d'un virus est peu
reconnue par les scientifiques.
Ainsi, la nature réelle de
l'agent transmissible est inconnue.
Cet agent est résistant au
formol, aux protéases, aux nucléases,
à la chaleur, aux UV,
aux radiations ionisantes et
aux ultrasons. Les moyens
d'élimination, pratiqués en
milieu hospitalier pour décontaminer
le matériel, sont très
drastiques : autoclavage à 134
et 138°C pendant 18 minutes,
utilisation de la soude normale
pendant 1 heure à la température
ambiante ou traitement à
l'eau de Javel à 2 %. n
Contact ► Jean-Louis Laplanche,
tél./fax 01 48 00 55 46.
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Paul Marec se prépare à descendre visiter un musée englouti.
Bruno Jonin
Paul Math
Mémoires englouties
Plongées - Histoires sur les
épaves du Finistère.
,,,-11 1,Luo,
Un chantier à la
dimension d'un
département côtier
Aidés notamment dans leurs
recherches par le Conseil général
du Finistère, mais aussi
par l'Institut culturel de Bretagne,
les auteurs de "Mémoires
englouties" ne sont pas
seuls dans cette prospection
méthodique des fonds finistériens.
D'autres équipes s'activent
et les autorisations de
sondages et de fouilles délivrées
par la Drassmt ) se multiplient.
Ainsi l'association
Archisub est-elle spécialisée
dans la reconnaissance
d'épaves profondes autour
d'Ouessant (Columbian naufragé
en 1865, European en
1877, Drummont Castle en
1896). L'Association pour
l'étude des épaves en Bretagne
(Aseb) fouille quant à
elle l'épave du sloop(2) anglais
Arab naufragé aux Glénan en
1796, et les membres d'Arhamis,
une autre association,
s'intéressent aux vestiges engloutis
autour de Sein et de sa
chaussée... n
ALes "Mémoires englouties"
sont disponibles aux éditions
Aseb, 20 rue de Verdun,
29000 Quimper
(120F: 100F+20F d'envoi).
. H ISTOIRE ET SOCIÉTÉ
Les visiteurs des musées engloutis
Les navires conservés à flot
ne sont pas la seule manifestation
du patrimoine maritime
mis en valeur lors
d'opérations telles que Brest
96. La plongée sous-marine
constitue un moyen d'accès
à l'un des musées les plus exclusifs
du monde : celui que
les naufrages ont disséminé
au cours des siècles le long
de la façade maritime du Finistère.
Un musée englouti
"dont la mer, la houle et les
courants sont les seuls gardiens"
(Paul Marec).
a révolution industrielle du
XIX' siècle, celle de l'acier et
de la vapeur, s'est traduite par une
explosion du commerce international
et a lancé des milliers de
navires sur les routes maritimes.
Affranchis des caprices du vent,
ces navires étaient censés affronter
toutes les conditions de mer.
En dépit des coques de fer puis
d'acier des machines à vapeur, les
moyens de navigation dont disposaient
leurs capitaines demeuraient
les mêmes que ceux du
siècle précédent : compas, sondes
à main, lochs remorqués, estimations
et relevés astronomiques...
Passage obligé des routes maritimes
entre les ports nord-européens
et ceux de l'Afrique, de
l'Amérique du Sud et de l'Extrême-
Orient, la pointe de Bretagne
a été le théâtre de centaines
de naufrages. "Pour tous ces navires,
les côtes découpées du Finistère,
parsemées de récifs à
fleur d'eau, parcourues de courants
violents, et masquées par la
brume, ont longtemps constitué
un piège mortel. Deux conflits
mondiaux ont encore augmenté
l'inventaire, laissant sous les
eaux les carcasses rouillées de
plusieurs dizaines de grands cargos",
retrace Paul Marec.
C'est essentiellement à la redécouverte
de ces grands navires
aux coques métalliques, témoins
de la révolution industrielle et
disparus au cours des XP(' et XX'
siècles, que s'est attaché Paul
Marec. Le credo de ce moniteur
de plongée est que le musée des
grands vapeurs se trouve sous la
mer et se visite palmes aux pieds.
Nombreuses sont en effet les
coques et les machines gisant
sous la surface, fantastique patrimoine
immergé, d'un intérêt à la
fois historique et technique.
Le prix Rouquayrol
et Denayrouze
Le travail de Paul Marec tend à
rendre moins exclusive la visite
de ces témoins d'une époque révolue.
Avec son coauteur Bruno
Jonin, il s'est vu décerner en 1994
par la Fédération française
d'études et de sports sous-marins,
le prix Rouquayrol et Denayrouze
pour "Mémoires englouties", un
ouvrage contant l'histoire et la fin
prématurée, parfois tragique, parfois
étonnante, de onze navires
disparus entre Ouessant et l'archipel
des Glénan. Dans ce livreguide,
les auteurs, non contents
de puiser aux meilleures sources
historiques les relations officielles
des naufrages, indiquent avec précision
les moyens pratiques de visiter
ces épaves, de manière indépendante
ou avec l'appui de
centres de plongée. Un tel guide
permet à ceux qui disposent déjà
d'une expérience subaquatique,
d'approcher certaines des épaves
parmi les moins profondes, laissant
aux plus chevronnés le soin
d'admirer celles couchées plus
loin sous la surface des flots.
Enfm, le guide offre encore plus :
des croquis d'ensemble de
l'épave, dus au crayon de Paul
Marec, des photos sous-marines
et de nombreux documents
d'époque, plans et photographies
représentant le navire à flot, fruit
d'années de travail et de patientes
recherches... n M.-E.P.
"' Drassm : Département de recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines, dépend
du ministère de la Culture. "' Sloop : voilier
à un mât.
Contact ► Paul Marec,
tél./fax 02 98 05 16 16,
e-mail : Paul.Marec@univ-brest.fr
® RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
CRI
Centre relais innovation
Statut juridique : Le Centre relais innovation est rattaché juridiquement à
Bretagne Innovation, association loi 1901.
Budget-Financement : Le CRI est financé pour 70% de son budget par le
programme Innovation de la Commission européenne (DGXIII).
Mission : Favoriser le développement technologique des entreprises de
basse Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, en les aidant à valoriser ou
acquérir une compétence au niveau européen, et à monter un projet de recherche
et développement européen.
Activités : 1/Recherche de partenaires (industriels, centres techniques,
laboratoires de recherche) : plus de 200 recherches de partenaires en un an.
2/Conseil sur le montage de projets européens de recherche et développement
technologique : environ 40 projets assistés. 3/Veille technologique
: 20 prestations en cours. 4/Diffusion d'informations (lettre-fax
Europe Innovation).
Ces services sont entièrement gratuits. Ils s'adressent principalement aux
entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
5/Financement et organisation d'opérations collectives : bourses techno
logiques, déplacements d'entreprises à l'étranger, formations, etc.
Moyens : Le réseau de 52 Centres relais innovation couvrant 17 pays
d'Europe • Des relations privilégiées avec la Commission européenne
(DGXIII) • L'appui des Réseaux de diffusion technologique, comptant plus
de 230 chargés de mission.
Clients : Plus de 80 entreprises ont bénéficié de l'une ou l'autre de nos prestations.
Ce chiffre est en forte augmentation, suite à un mailing adressé aux
entreprises industrielles de la région, aux centres de recherche, laboratoires
universitaires, centres techniques, membres des Réseaux de diffusion technologique,
etc.
Contacts : Benoît Nicol, chef de projet • Claire Mac Gowan, assistante.
Adresse : Centre relais innovation (CRI), 18, place de la Gare, 35000
Rennes, tél. 02 99 67 42 00, fax 02 99 67 60 22, e-mail : benoit.nicol@
cyberbretagne.tm.fr
RÉSEAU FÉVRIER 97 - N°130 J
LES SIGLES DU MOIS RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
IRPa
Institut régional du patrimoine
Statut juridique : Association loi 1901, créée le 20 juillet 1990 dans le
cadre du X` plan État-Région.
Nombre d'adhérents : 30 répartis en 3 collèges : élus du Conseil régional,
représentants des administrations, personnes qualifiées.
Structures représentées au conseil d'administration : Présidente :
Yvonne Sauvet, conseiller régional • Membres : élus du Conseil régional,
représentants des ministères de l'Environnement, de la Culture, de l'Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme, enseignants des
universités de Haute Bretagne et de Bretagne occidentale, représentants
d'associations de sauvegarde du patrimoine.
Budget-Financement : 700000 F/an (contrat de plan État-Région :
Conseil régional • Ministères de l'Environnement, de la Culture • Participation
de stagiaires).
Missions : 1/Assurer la sensibilisation et la formation des responsables,
des professionnels et des bénévoles qui, par fonction ou profession, ont vocation
à gérer et à faire connaître le patrimoine régional • 2/Être un lieu
d'échanges sur les questions suscitées par le patrimoine architectural, mobilier
et naturel de Bretagne.
Activités : Organisation de stages courts de formation continue, de rencontres
et de conférences selon un programme annuel élaboré avec différents
partenaires et diffusé en septembre, soit pour accompagner des démarches
de réflexion et des projets concernant un territoire donné, un site,
ou un domaine patrimonial particulier, soit pour des publics précis ayant
des attentes spécifiques • Édition d'ouvrages.
Publics visés : Les gestionnaires du patrimoine, les médiateurs du patrimoine,
les concepteurs de projets.
Effectif : 2 postes 1/2.
Correspondants : Yves Monnier, Patricia Bell, chargés de mission.
Adresse : Institut régional du patrimoine, Hôtel de Blossac, 6, rue du
Chapitre, 35044 Rennes Cedex, tél. 02 99 79 39 31, fax 02 99 29 67 99.
RÉSEAU FÉVRIER 97 - N°130
"Inventer demain" Les chiffres du mois
La recherche européenne au service du citoyen
"Nous voulons que la science, au-delà des connaissances nouvelles qu'elle apporte,
participe au bien-être et d l'équité sociale. Nous voulons que le progrès scientifique et
l' innovation contribuent pour une large part à l'avenir de l'Europe"
Ministres européens de la Recherche, 1996
Ce document "Inventer demain" (disponible à l'Euro Info Centre) se veut le reflet d'un vaste
débat rendu public très en amont, pour stimuler les échanges de vues avant sa mise au point défmitive.
Il s'agit là des orientations proposées parla Commission : elles serviront de base à l'élaboration
du 5' programme-cadre de recherche et de développement technologique pour la période
1998-2003.
Décision : Proposition de décision du Conseil du 10/07/96 Corn (96) 332.
Domaines prioritaires identifiés : IlDécouverte des ressources du vivant et de l'écosystème.
Le vivant et l'environnement sont des domaines qui devraient avoir un impact sur la
qualité de vie et la santé des citoyens. L'Europe a dans ces domaines des atouts scientifiques et
techniques prometteurs en termes de créations, de marchés et d'emplois. L'accent sera mis sur
l'étude des mécanismes de base du vivant et leurs applications sur la santé et l'alimentation, une
meilleure compréhension des mécanismes environnementaux, la généralisation du principe de
responsabilité, la maîtrise des questions de pollution et de déchets. 2/Développer une société de
l'information conviviale. Le concept de société de l'information est un concept européen qui
doit s'efforcer de concilier les aspects techniques, économiques et industriels avec la dimension
sociale. Ce concept donne lieu à des applications dans tous les domaines d'activité. L'émergence
des systèmes numériques et multimédia ne fait qu'accroître l'importance des aspects immatériels.
Il s'agira alors d'identifier les travaux de recherche liés à la société de l'information. 3/Favoriser
une croissance compétitive et durable concourant à la réorganisation des systèmes de production
et mettant en jeu de nombreux emplois. Les notions de cycle de vie de moindre coût, de préparation
des nonnes, devront être prises en compte dès le départ. Par ailleurs, il faudra mettre au
point des systèmes énergétiques sûrs dans une perspective de développement durable. On cherchera
à optimiser l'efficacité et la sûreté des systèmes de transport (intermodalité), à concrétiser
le concept de "politique rurale intégrée" et à retrouver les équilibres halieutiques.
Les actions horizontales : Afm d'assurer la coordination d'ensemble, ces actions auront
pour priorité d'accroître le potentiel humain parla formation et la mobilité des chercheurs, l'extension
des réseaux de recherche et l'accès aux grandes installations ; de faire participer les
PME ; d'affirmer le rôle international de la recherche européenne.
Mise en oeuvre : Afm de limiter le "saupoudrage" des fmancements vers une multiplicité
de projets, seront instaurées une plus grande sélectivité dans les thèmes et une plus grande
concentration dans les moyens, assorties d'un élargissement de la gamme des modalités de mise
en ouvre. En clair, il est souhaitable de réduire fortement le nombre des programmes et le
nombre des comités pour une gestion plus efficace. Sur le fond, il s'agira de passer d'une
recherche basée sur la seule performance technologique à une recherche centrée sur le citoyen et
la réponse aux besoins économiques.
Contact Euro Info Centre : 02 99 25 41 57.
RESEAU FEVRIER 97 - N 130
Répartition des équipes
universitaires de recherche
par discipline en 1993
- Mathématiques et applications
I 1 Sciences juridiques, politiques, économiques
Nombre d'équipes
--1 Sciences beenenes et sociales
Sciences de la vic et de la santé
Mil Sciences pour l'ingénieur
Sciences de la terre et de l'univers
Sciences de la matière et génie des procédés
Mécanique. génie électrique. productique.
transports et génie civil
RÉSEAU FÉVRIER 97 - N°130
I 164
53
23
e
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
11 rue Kléber
33020 RENNES
, Téléphone : 99 87 14 14
Télécopie : 99 63 76 69
COMPA
ERALS
G N I E
GEN
DES EAUX
De quoi sera fait demain
Anticiper
Capitale des télécommunications, ANTICIPA
a toujours eu une technologie d'avance :
hier la téléphonie temporelle, Numéris, la
fibre optique, aujourd'hui l'ATM, les services
multimédias, le réseau tout optique...
Créer
Vous développez des technologies de pointe :
optronique, électronique, informatique. ANTICIPA
est faite pour vous. 3000 chercheurs et
ingénieurs l'ont déjà choisie* Ils vous atten-O
dent pour inventer avec vous les technologies
et les marchés du futur.
*CNET et Laboratoire d'essais des télécommunications, Alcatel
CIT, TRT Philips, SAT, Centre de Météo Spatiale, SVFO Pirelli, et
100 PMI high tech.
1/ Aupa
0~
C
a
> •
TECHNOPOLE LANNION TREGOR
Capitale des télécommunications
B.P. 155.22300 LANNION • Tél. 02 96 05 82 50
LE DOSSIER, PRIX RÉGIONAUX DE LA RECHERCHE
C omme l'an dernier, le Conseil régional de Bretagne veut rendre
hommage aux jeunes chercheurs en décernant des prix à trois lauréats,
et en distinguant six "mentions spéciales". Rendus publics le
14 janvier dernier, les résultats de cette deuxième édition du Prix Bretagne
Jeune Chercheur surprennent cette année par le nombre de jeunes femmes,
largement majoritaires (7 sur 9) ! Mais pour chacune d'entre elles, la somme
et la qualité des travaux de recherche effectués ces dernières années, pendant
et après la thèse, n'ont rien à envier à ceux des chercheurs les plus chevronnés.
Voici, par discipline, la liste de ces heureux lauréats 96 :
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Lauréat : Nathalie Molines, docteur en archéologie et archéométrie de
l'université de Rennes 1. Mentions Spéciales : Véronique Labrot, maître de
conférences en droit public à l'Université de Bretagne occidentale. Hélène
Rainelli-Le Montagner, maître de conférences à l'Institut de gestion de Rennes.
STRUCTURES ET PROPRIÉTÉS DE LA MATIÈRE
Lauréat : Eric Pouliquen, chercheur au Saclant Undersea Research Centre, La
Spezia (Italie). Mentions Spéciales : Jean-Charles Cotteverte, ingénieur de
recherche à Corning SA à Avon (77). Fabienne Nouvel, docteur en électronique à
l'Institut national des sciences appliquées de Rennes.
SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES
Lauréat : Sophie Langouët-Prigent, post-doctorante au département de
Biochimie du Centre de toxicologie moléculaire de l'université de Vanderbilt
(États-Unis). Mentions Spéciales : Michelle Le Tonqueze, ingénieur biochimiste
au laboratoire Sébia à Evry (94). Nathalie Quiniou, ingénieur de recherche à
l'Institut technique du porc au Rheu (35).
A Les membres du jury des Prix Bretagne
Jeune Chercheur 1996 : Claude Champaud,
président du Conseil consultatif régional de la
recherche et du développement technologique,
conseiller régional (devant), et au 1' rang, de
gauche à droite : Paul Renaud, conseiller
régional, Pierre Pinard, directeur du Laboratoire
de physique de la matière à l'Insa de Lyon,
Michel Le Normand, chef du département
Sciences biologiques et agronomiques de l'Ensa de
Rennes, Charles Riou, président du centre Inra
de Bordeaux ; 2e rang, de gauche à droite :
Philippe Dupuis, directeur du Critt électronique
à Lannion, Jean-Yves Andrieux, professeur
d'histoire de l'architecture à Rennes, Roger
Percerou, professeur de droit des affaires, ancien
doyen de la faculté de droit de Rennes, Pierre
Youinou, directeur du Laboratoire d'immunologie
au CHU de Brest, Daniel Thomas, professeur en
génie enzymatique et cellulaire à l'université de
Compiègne, Alain Le Gall, professeur
d'économie, vice-président de l'Université de
Bretagne occidentale à Brest, Roger Leprohon,
conseiller régional, René Dabard, président de la
technopole Rennes Atalante, non présents sur la
photographie : Jean-Luc Gaffard, économiste à
l'université de Nice, Jean Jerphagnon, directeur
scientifique Alcatel-Paris.
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997 0
LE DOSSIER elitiA itE0
y~~, q~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ LA kÊtJF~N~.CHERCHEUREN ifETt~CÿIE
Jean-Marie Lehn, président du jury
du Prix Bretagne de la Recherche
L e jury du Prix
Bretagne de la Recherche,
organisé par le
Conseil régional de Bretagne
est présidé par
Jean-Marie Lehn, professeur
à l'université
Louis Pasteur de Strasbourg
et au Collège de
France à Paris. Il coprésidera
le même jour la
remise des Prix Bretagne
Jeune Chercheur. Ses
travaux sur la chimie des
molécules ont donné
naissance à la "chimie
supramoléculaire". Ce
nouveau domaine, à ne
pas confondre avec la
chimie moléculaire"),
concerne l'association de
deux ou plusieurs espèces
chimiques, liées
entre elles par des forces
intermoléculaires. C'est
dans ce contexte que
Jean-Marie Lehn a étudié
la "reconnaissance
moléculaire", une étape
importante de tout processus
biologique : c'est
la propriété qu'une molécule
a de reconnaître et
de retenir un substrat.
Ces travaux lui ont valu
le prix Nobel de chimie
en 1987j2).
RECHERCHE
Réseau : Pourquoi est-il important
de soutenir l'activité scientifique
en région ?
Jean-Marie Lehn : Ce qui est
important, c'est d'encourager les
chercheurs, où qu'ils se trouvent,
partout dans le monde, en Bretagne
comme en Alsace. Dans
cette optique, la démarche du
CCRRDT(" de Bretagne est remarquable.
J'ai accepté de présider
le jury du Prix Bretagne de la
Recherche, parce que je souhaite
encourager cette initiative : elle
montre que les responsables des
collectivités sont conscients de
l'importance de la recherche pour
le développement de leur région.
Les recherches fondamentales
peuvent aboutir à la mise au point
de nouveaux produits et procédés
et à la création d'entreprises de
haute technologie, qui génèrent
des emplois très qualifiés.
Réseau : La première série de
prix récompense de jeunes chercheurs.
Ont-ils une place particulière
dans le monde de la recherche
?
J.-M.L. : Le terme "jeune chercheur"
me fait sourire : je connais
des chercheurs de 25 ans aux
idées très conservatrices, d'autres
de 60 ans ou plus qui ont su rester
jeunes d'esprit. Dans le monde de
la recherche, c'est l'âge des neurones
qui compte, pas celui marqué
sur la carte d'identité ! Ceci
dit, les "jeunes" chercheurs sont
particulièrement importants,
parce qu'ils sont les chercheurs
chevronnés de demain. Nous
sommes dans un contexte national
où le renouvellement des
postes de recherche se ralentit,
provoquant, d'une part, un
vieillissement de la population
scientifique active et, d'autre part,
t Outre le prix Nobel de
chimie, Jean-Marie Lehn est
lauréat de plus de 20 prix
scientifiques, et membres de
27 académies et sociétés
savantes dans le monde
entier : un palmarès dont le
prestige rejaillit aujourd'hui
sur le lauréat du Prix Bretagne
de la Recherche.
un délai de plus en plus long entre
la fm des études et l'incorporation
dans un organisme de recherche.
Par le Prix Bretagne Jeune Chercheur,
la Région aide de jeunes
diplômés à poursuivre une activité
scientifique de qualité, en attendant
leur recrutement.
Réseau : Quels conseils donnezvous
à ces jeunes lauréats ?
J.-M.L.: D'abord faites ce qui
vous plaît : la passion doit être le
premier moteur de la recherche
fondamentale. Essayez de travailler
en toute liberté d'esprit,
sans aucune oeillère conjoncturelle
ou économique. C'est toujours de
cette passion de la recherche, que
sont nées les plus grandes avancées
scientifiques. Les recherches
les plus fondamentales peuvent
avoir les applications les plus
vastes. Dites-vous bien que si vos
travaux sont bons, ils serviront de
toute façon, et pas forcément dans
le domaine où vous attendiez des
applications ! n
Propos recueillis par H.T.
"' La chimie moléculaire étudie les propriétés
des entités construites d partir d'atomes liés
par des forces covalentes. "' A lire : "Supramolecular
chemistry - Concepts and perspectives",
Éditions VCH Weinheim, 1995. "' CCRRDT :
Comité consultatif régional de la recherche et
du développement technologique. Présidé par
Claude Champaud, le CCRRDT a été mis en
place par le Conseil régional de Bretagne en
1984, pour émettre des avis sur les orientations
de la politique régionale de la recherche. 1l
comporte 83 membres, représentant le monde
de la recherche (43), les organisations représentatives
des salariés et des employeurs (20) et
des personnalités qualifiées (20).
Jean-Marie Lehn,
tél. 03 88 41 60 56,
e-mail : lehn@chimie. u-strasbg. fr
Conhlct ►
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
r t P‘Ill
L'identification rapide de la nature des fonds crins depuis
la surface, c'est ce que les chercheurs en acoustique sousmarine
tentent de maîtriser. Éric Pouliquen, 29 ans, a mis au
point un système de traitement du signal qui permet d'y parvenir,
à partir d'un simple sondeur de pêche. Le Finistérien a
bénéficié dans ses travaux de l'environnement du Laboratoire
d'acoustique sous-marine de l'Ifremert'".
Les fonds marins
identifiés
~Jv
A Eric Pouliquen :
"Mon directeur de thèse,
Xavier Lurton, est l'un des
leaders au niveau mondial
dans ces recherches."
40
45
iur;u:er , avf?rlinIn
Profil caractéristique de fonds marins de différentes natures.
PR XHEuR V ONAUX DE LA RECHERCHE LE DOSSIER
Pour identifier la nature du
fond de la mer, on utilise généralement
une méthode basée
sur l'énergie de la réponse acoustique.
En un mot, les sondages
acoustiques effectués reposent
sur le principe que la quantité
d'énergie réfléchie par les fonds
est en corrélation avec la nature
de celui-ci : à fond dur, haut niveau
d'énergie, à fond meuble,
bas niveau. En analysant ainsi la
réponse acoustique, on peut déterminer
quelle est la nature des
réflecteurs, et par là même, des
fonds. Mais pour Eric Pouliquen,
le lauréat 96 du Prix Bretagne
Jeune Chercheur, catégorie
"Structures et propriétés de la
matière", ce type d'approche
n'est pas suffisamment significatif.
Il a donc mis au point une
méthode, qui par l'analyse du signal
renvoyé, autorise une bien
meilleure classification du sol
marin. "La complète originalité
de sa démarche, c'est de s'appuyer
sur la forme des échos
temporels obtenus", note Xavier
Lurton, son maître de thèse au
Laboratoire d'acoustique sousmarine
de l'Ifremer, qui a accueilli
Eric Pouliquen en 1989.
La forme
des échos temporels
Après avoir passé une maîtrise
de physique à l'Université de
Bretagne occidentale à Brest, sa
ville natale, le futur lauréat s'engage
en effet dans un DEA, "Méthodes
physiques de télédétection",
à Paris VII. Un moment
stagiaire à l'Ifremer, où il travaille
dans l'océanographie spatiale,
il y retourne dans le cadre
de la thèse qui lui vaut son prix.
Le thème ? "Identification des
fonds marins superficiels à l'aide
de signaux d'écho-sondeurs", un
thème proposé par le département
"Technologies des pêches" de
l'Ifremer. Son financement sera
assuré par le ministère de la Recherche,
pour les deux premières
années, et ensuite, à parts égales,
par l'Ifremer et par la Région
Bretagne. Le concept qui distinguera
le lauréat, c'est l'analyse de
la forme des échos temporels.
Schématiquement, à chaque impulsion
du sondeur, le fond renvoie
un écho en forme de pic qui
s'affaisse avec le temps (on parle
ici en dixième de milliseconde).
Or, la forme du pic, c'est-à-dire la
réponse en fonction du temps,
varie suivant la nature du fond :
c'est l'enveloppe temporelle.
"Cela peut sembler simple, mais
c'est une approche que personne
dans le monde n'avait adoptée à
ma connaissance. Peut-être que
venant de la télédétection, il a
adapté cette méthode, proche
dans le principe de la mesure du
relief de la mer par satellite...",
s'étonne encore Xavier Lurton. Il
poursuit : `Le tour de force, c'est
d'avoir élaboré une construction
théorique d'identification, valable
pour tous les sondeurs. Il a
modélisé une approche qui lui
permet de simuler les enveloppes
temporelles moyennes, par types
de fond, puis l'a expérimentée
sur le terrain, à bord du navire
océanographique Thalassa, notamment.
C'est un chercheur
très complet : actif à bord et très
peu malade !"
Retour aux sources...
acoustiques
Par cette modélisation, Eric
Pouliquen évite les pièges de
l'approche empirique, qui est
d'observer quelle réponse se
produit avec tel type de fond dans
une configuration particulière, et
généraliser. Car alors, forme du
fond, caractéristiques du sondeur
et hauteur d'eau interviennent
pour risquer de fausser le résultat.
Sa thèse soutenue en 1992 et
obtenue avec les félicitations du
jury, le jeune chercheur fréquente
à nouveau ses premières amours
en technologie spatiale, comme
coopérant à la Scripps Institution
of Oceanography de San Diego. Il
est depuis revenu à ses sources...
acoustiques. "Depuis un an, je
travaille au Saclant" Undersea
research center de La Spezia en
Italie, à quelques heures de route
de Nice", explique-t-il. Définir,
développer de futures méthodes
d'identification des fonds marins,
grâce à l'utilisation de sondeurs
mono et multifaisceaux, "C'est
exactement dans la lignée de ma
thèse", reconnaît-il.
Passés ou actuels, ses travaux
sont non-classifiés"'. Ils intéressent
les pêcheurs soucieux de traquer
sélectivement des espèces
liées à un certain type de fond. Et
Micrel, fabricant à Hennebont
(56) du sondeur Ossian qui a servi
pour la majorité des tests, se
penche sur l'avenir du procédé.
Mais les militaires sont également
concernés : "Après la guerre du
Golfe, on a constaté qu'il était
difficile de distinguer une mine
sur un fond dont on ne connaît
pas la nature. Elle peut être enfoncée
dans la vase...", conclut
Eric Pouliquen. n M.-E.P.
Ifremer : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer. "' Saclant : Supreme
Allied Commander Atlantic (Commandement en
chef des marines de l'Otan). Le centre de La
Spezia compte 40 chercheurs des 15 pays de
l'Otan (dont 3 Bretons sur 4 Francais). "' classifiés
confidentiels.
Contacts Éric Pouliquen,
tél. 00 39 187 540 417,
e-mail : pouliq@saclantc.nato.int
Xavier Lurton, tél. 02 98 22 40 88.
35
Iragis le apport de stage 'AméliaNion et essai d'un système d'idemdisadion de lo nonne des Imds ma
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
ÊTRE JEUNE CHERCHEUR EN BRETAGNE
L
Galet aménagé provenant
du site de Menez-Dregan I
à Plouhinec (Finistère).
t Vue du chantier de fouilles
de Menez-Dregan L
Les premiers hommes de MeriezPregaii
Pour Nathalie Molines, l'attributionu Prix Bretagne Jeune
Chercheur dans le domaine des sciences humaines et sociales
est une grande et heureuse surprise : "L'archéologie est rarement
récompensée =!c'est une discipline scientifique ambiguë,
située à mi-chemin entre les sciences humaines et celles de la
De plus, son sujet de recherche, le paléolithique infé-
'rieur, souffre encore de l'extraordinaire popularité de son
plus jeune frère, le néolithique, qui a donné à la Bretagne ses
célèbres sites mégalithiques.
Nathalie
Molines.
On‘riginaire d'Hennebont (56),
Nathalie a hésité, après un
bac D, entre la médecine et l'archéologie...
Elle a choisi cette
deuxième voie en s'inscrivant
d'abord à l'université de Rennes 2,
en Deug puis en licence d'histoire
de l'art... avant de venir s'installer
dans l'unité de recherche dirigée
par Jean-Laurent Monnier, sur le
campus de Beaulieu (voir encadré).
"Mon objectif était de recenser
et d'étudier l'ensemble
des galets aménagés du littoral
armoricain." Ces "galets aménagés"
sont des pierres grossièrement
taillées, significatives d'une
époque très ancienne de l'histoire
de l'homme qui se retrouvent en
effet disséminées sur nos côtes,
avec toutefois de fortes concentrations
à Saint-Colomban, dans
le Morbihan, et au Menez-Dregan,
dans le Finistère, d'où proviennent
plus de 20000 pièces,
toutes décrites et archivées sur ordinateur
!
Les nouveaux outils
de l'archéologie
Les galets aménagés s'accompagnent
généralement d'outils
plus petits, en silex finement
taillés. `Le silex n'est pas une
roche naturellement présente
dans le Massif armoricain, mais
on en trouve fréquemment sur la
plage, apporté par la mer. C'est
sans doute ce qui explique la
répartition des populations du
paléolithique sur l'ensemble du
littoral armoricain", explique
Nathalie Molines.
Les sites étudiés sont parmi
les plus vieux d'Europe : entre
350000 et 500000 ans, ces âges
étant obtenus par résonance paramagnétique
électronique. Les
couches les plus récentes contiennent
des traces de feu. Dans les
couches les plus anciennes, on
trouve des restes osseux : une
étude de l'ADN contenu dans ces
os semble indiquer que ces restes
proviennent d'équidés, mais cela
reste à confirmer et l'étude génétique,
faute de moyens, n'a pu
être poursuivie. "En tout cas,
nous savons désormais que
les hommes de Menez-Dregan
consommaient de grands mammifères",
commente la jeune
chercheuse, avant de poursuivre :
"les progrès de l'archéomagnétisme,
la naissance de nouvelles
disciplines telles que la paléogénétique,
de nouveaux outils
comme le théodolite à laser"),
peuvent apporter à l'archéologue
de nombreuses informations essentielles
à son travail. Mais ces
nouvelles technologies sont aujourd'hui
très coûteuses, ce qui
limite leur emploi".
Le paléolithique
inférieur dans
le monde
Aujourd'hui, grâce au Prix
Bretagne Jeune Chercheur et au
voyage d'études proposé, Nathalie
va pouvoir rendre visite à ses
collègues européens travaillant
sur des sites contemporains. C'est
une étape essentielle dans sa recherche,
mais il lui manquait les
moyens d'accomplir ces missions.
"J'irai en Allemagne, à l'université
de Cologne, où le professeur
Bosinski dirige un prestigieux
institut de la préhistoire... Je suis
aussi tentée par un voyage
d'études en Italie, car la recherche
là-bas accorde une
grande place à l'archéologie en
général et au paléolithique inférieur
en particulier". Nathalie
rédige en ce moment un article
important sur l'ensemble de l'industrie
des galets aménagés de
l'Europe au paléolithique inférieur,
article qu'elle soumettra à
la revue internationale "World
Archeology"... Elle prépare en
Créée le 1" janvier 1995,
l'UMR "Civilisations atlantiques
et archéosciences" regroupe
le Laboratoire d'anthropologie
et d'archéométrie
(université de Rennes 1), le
Laboratoire d'archéologie
Pierre Merlat (université de
Rennes 2), et les Laboratoires
de préhistoire armoricaine et
d'écologie-paléoenvironnements
atlantiques (université
de Nantes). C'est une unité
mixte du CNRS, des universités
de Rennes 1, Rennes 2 et
Nantes et du ministère de la
Culture. Fondée sur une forte
thématique interrégionale, elle
comprend 58 personnes, dont
25 conservateurs, chercheurs
et enseignants-chercheurs,
10 personnels techniques et
administratifs et 23 stagiaires,
doctorants et visiteurs. n
même temps sa candidature au
CNRS, car malgré ses brillants
résultats et les félicitations de son
jury de thèse, la recherche ne lui
procure aucun revenu, ce qui
l'oblige à travailler en dehors de
ses horaires de laboratoire. Dans
l'archéologie peut-être plus encore
que dans d'autres disciplines
scientifiques, la passion est obligatoire
! n H.T.
"' Théodolite à laser : qui permet d'enregistrer
la position des objets sur le terrain.
mtaal Nathalie Molines,
tél. 02 99 28 61 09.
®
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
SUBSTANCES CHIMIQUES
(Procarcinogènes, autres)
Cancer
ADN
Cytochromes P-450
Composés METABOLITE
Chimioprotecteurs ACTIVE Protéines
Lipides
2
+ Glutathion transférases,
METABOLITE
INACTIF
1
Elimination
Toxicité
2
A
Schéma sur la détoxication des cancérogènes.
P{EU IXEURKEGIONAUX Dit LA Ri 1-iitiftclik LE DOSSIER
Cancer : comment aider
les cellules â se défendre
Durant sa thèse de doctorat,
Sophie Langouet-Prigent
s'est intéressée aux mécanismes
biochimiques capables
de protéger contre
certaines formes de cancer
du foie. Une étape de compréhension
indispensable
pour progresser dans le traitement
de ces maladies.
C 'est à Nashville, Tennessee,
que Sophie Langouêt-Prigent
a appris la bonne nouvelle. En
effet, la lauréate du Prix Bretagne
Jeune Chercheur en sciences biologiques
et médicales, réalise actuellement
un stage post-doctoral
dans le département de Biochimie
du Centre de toxicologie moléculaire
de l'université de Vanderbilt
à Nashville.
De Rennes à Nashville, le parcours
de Sophie est des plus
brillants : une licence et une maîtrise
de biochimie obtenues à
Rennes avec mention, un DEA de
toxicologie de l'université Paris V
où elle se classe dans les toutes
premières places (ce qui lui permet
d'obtenir une bourse du ministère
de la Recherche) et une
thèse "européenne""), soutenue en
décembre 95, couronnée par les
félicitations du jury.
"Déjà toute petite, j'étais attirée
par la recherche. C'est en lisant
la biographie de Marie
Curie, à l'âge de 13 ans, que j'ai
décidé de devenir chercheur", raconte-
t-elle. "Elle est faite pour
ce métier", confirme André
Guillouzo, professeur à la faculté
de pharmacie à Rennes, qui a encadré
Sophie Langouêt-Prigent en
DEA puis lors de sa thèse, au sein
de l'unité Inserm de recherches
hépatologiques (U 49).
Dans cette unité, un groupe de
chercheurs s'intéresse aux produits
chimiques potentiellement
toxiques pour le foie : médicaments,
contaminants de l'alimentation
et de l'environnement...
Certains produits peuvent se fixer
sur l'ADN des cellules et altérer
leur patrimoine génétique : ces
produits sont dits cancérogènes.
C'est dans ce thème de recherche
que s'inscrit le travail de thèse de
Sophie.
Des défenses naturelles
face au cancer
Le parcours d'un produit dans
une cellule est assez complexe ;
pour simplifier, disons qu'il
existe, au sein de la cellule, des
"outils" de transformation chimique
: ce sont les enzymes. Certaines
enzymes "activent" le
toxique (étape "1" sur le schéma) ;
d'autres, au contraire, participent
à l'élimination et à la neutralisation
du produit (étapes "2" et
"3"). Ainsi, lorsqu'une cellule est
attaquée par un produit, elle peut
se défendre de deux manières :
soit en diminuant l'activité des
enzymes responsables de l'activation
du toxique, soit en augmentant
l'activité des enzymes participant
à son élimination.
La cellule peut, en plus, recevoir
des "aides extérieures" : certaines
molécules présentes dans
les végétaux et certains médicaments
augmentent les capacités
de défense des cellules. Ces cornposés
sont dits "chimioprotecteurs".
C'est en particulier le cas
d'un médicament appelé Oltipraz,
une molécule de synthèse dérivée
de composés naturels extraits de
végétaux crucifères°.
Des résultats inédits
Sophie Langouet-Prigent s'est
attachée à comprendre comment
l'Oltipraz exerçait son action préventive
sur le cancer provoqué
par l'aflatoxine B10). Des chercheurs
américains s'étaient déjà
intéressés à cette molécule et
avaient découvert qu'elle agissait,
chez le rat, en augmentant la capacité
d'élimination des composés
toxiques de la cellule. La recherche
réalisée à Rennes avait
pour but de vérifier cette hypothèse
chez l'homme. Or les travaux
rennais ont partiellement
remis en cause les précédents résultats
: chez l'homme, l'Oltipraz
agit surtout en empêchant la formation
de produit toxique, c'està-
dire en inhibant les enzymes
responsables de l'activation du
toxique. De plus, ces travaux ont
montré que seulement 50 % des
humains sont capables d'éliminer
le produit toxique ; les autres ne
possèdent pas l'enzyme nécessaire.
Ce résultat est dû au "polymorphisme
génétique" chez
l'homme et il engage à être plus
prudent dans l'extrapolation, à
l'homme, de résultats obtenus
chez l'animal.
Ces travaux ont été publiés notamment
dans "Cancer research",
une revue prestigieuse, ce qui a
permis à Sophie Langouêt-Prigent
de se faire un nom dans le domaine
de la cancérologie.
Acquérir de
nouveaux savoirs
Dans le laboratoire américain
où elle réalise actuellement son
stage post-doctoral, Sophie Langouët-
Prigent s'intéresse aux effets
du chlorure de vinyle, un
composé capable, après transformation,
de se fixer sur l'ADN des
cellules. Elle cherche à déterminer
quel type de fixation est le plus
susceptible d'entraîner la formation
de cancer. Elle utilise notamment
une technique appelée "mutagenèse
site spécifique", apprise
dans le laboratoire américain,
dont elle espère pouvoir faire bénéficier
ses collègues rennais.
En effet, à son retour de Nashville,
Sophie préparera activement
les concours de chargé de
recherche, de l'Inserm et du
CNRS, afin d'intégrer la toute
nouvelle unité Inserm créée par
André Guillouzo, intitulée "Détoxication
et réparation tissulaire"
(U 456)'4'. Les candidats à de tels
concours doivent avoir des dossiers
solides contenant un bon
nombre de publications scientifiques.
Espérons que l'attribution
de ce prix régional agisse aussi en
faveur de la candidate ! n C.P.
"' Une partie du travail a été réalisée dans un
laboratoire anglais. "' Famille du chou et du
colza. "' Cette toxine est produite par des moisissures
du mais ou des cacahuètes dans des
conditions de mauvaise conservation. Elle provoque
des cancers hépatiques, surtout dans des
populations africaines et asiatiques. "' Implantée
dans les locaux de la faculté de pharmacie,
université de Rennes I.
Sophie
Langouët-
Prigent.
Contacts ► Sophie Langouët-Prigent, tél. (00) 1 615 322 31 60,
e-mail : langouet@toxicology.mc.vanderbilt.edu
André Guillouzo, tél. 02 99 33 62 40,
e-mail: andre.Guillouzo@univ-rennesl.fr
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS
DE
Résealu
embarqués
dans les
automobiles
magnétique en ligne de montage.
En plus de la reconnaissance de
la Région, elle vient également
d'avoir un prix de très grande valeur
en janvier : un troisième enfant.
n P.H.
A Système de commande de
rétroviseur testé au LCST.
LE DOSSIER 'tut. itktiitINALJii L ~ erm`ERïIte HIE
Fabienne Nouvel est un bel
exemple de réorientation d'un
ingénieur vers une carrière universitaire.
Après 5 années passées
dans une société de service spécialisée
dans les réseaux, en qualité
de chef de projet, elle rejoint
en 1991 le Laboratoire composants
et systèmes pour télécommunications
(LCST) de l'Insa01
de Rennes, dirigé par Jacques Citerne.
À l'époque, le laboratoire
proposait pour le groupe PSA -
Automobiles Citroën un nouveau
concept de réseau embarqué, dit
"par étalement de spectre", visant
à diviser par deux le nombre de
fils nécessaires à la communication
intra-véhicule. Fabienne
Nouvel s'est intéressée aux performances
de ce système, notamment
vis-à-vis des parasites électriques
et électromagnétiques de
la voiture et de l'environnement
extérieur. Elle a ainsi réalisé un
prototype très élaboré et démontré
sa robustesse face à tous ces
parasites. Ses travaux ont non
seulement résolu les problèmes
liés à l'embarquement de systèmes
électroniques à bord des
automobiles, mais aussi fait progresser
la connaissance des récepteurs
à "étalement de spectre", en
particulier sur la synchronisation.
En écho à ses résultats innovants,
présentés lors de conférences nationales
et européennes, d'autres
constructeurs automobiles français
et étrangers sont en contact
avec l'équipe du LCST.
Aujourd'hui, Fabienne Nouvel
dirige trois chercheurs au LCST
sur les problèmes de compatibilité
électromagnétique, et notamment
ceux posés par la qualité électro-
IZMCI Fabienne Nouvel,
tél. 02 99 28 65 10,
e-mail: Fabienne.nouvel@insarennesfr
STRUCTURES ET PROPRIÉTÉS
DE LA MATIÈRE
Le laser :
une boussole
optique ?
Jean-Charles
Cotteverte
Jean-Charles Cotteverte est
primé pour ses travaux innovants
sur l'instabilité de polarisation
dans les lasers, réalisés sous
la direction d'Albert Le Floch, au
Laboratoire de physique des lasers
de l'université de Rennes 1. "Ces
résultats sont ceux d'une
équipe", souligne d'emblée le
chercheur. Reprenant l'expérience
de la boussole (vecteur magnétique)
placée dans un champ magnétique
tournant qui tente de
s'orienter sur ce champ, l'équipe a
démontré que la vitesse de rotation
du vecteur lumineux d'un
laser est, elle, proportionnelle à la
valeur du champ magnétique. De
là est né, avec la Sagem, un magnétomètre...
breveté. Le groupe
Géosciences de Rennes peut ainsi
mesurer la valeur du champ magnétique
mémorisé dans des laves.
Ce jeune chercheur s'est également
intéressé aux effets de l'injection
d'un laser-maître (de
faible puissance) dans un laseresclave
(de forte puissance), méthode
utilisée pour stabiliser la
fréquence de ce dernier. Sortant
des sentiers battus, il a démontré
le transfert de la polarisation et
du moment cinétique du lasermaître
vers le laser-esclave dans
certaines conditions. De plus,
contrairement aux méthodes classiques,
il est possible d'obtenir
une phase stable entre les 2 lasers.
Ceci pourrait être intéressant
pour le projet européen
Virgo12 .
A Le magnétomètre mis au
point au Laboratoire physique
des lasers de Rennes avec
la collaboration de la Sagem.
Depuis juillet 96, Jean-Charles
Cotteverte est ingénieur de recherche
à Corning S.A. à Avon
(77), leader américain dans le domaine
des fibres optiques, des
verres et céramiques. Du laser à
l'hologramme, il travaille sur la
mise au point de nouveaux composants
optiques. n P.H.
Contact ► Jean-Charles
Cotteverte, tél. 01 64 69 73 94,
e-mail : Cotteverte_J@cri02.
corning.com
SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
L'environnement
marin comme
laboratoire
juridique
a mer est un espace soumis
à différents régimes. Mais
l'environnement marin, lui, ne
connaît pas de frontières. C'est
un patrimoine que doit conserver
l'humanité entière. Véronique
Labrot démontre comment la notion
de patrimoine, extraite d'un
droit privé destiné à protéger la
propriété de personnes existantes,
s'adapte au devenir de l'humanité,
et à l'humanité en devenir.
"Réflexions sur une «incarnation
progressive» du droit : l'environnement
marin, patrimoine
naturel de l'humanité", c'est le
titre de la thèse présentée par Véronique
Labrot en septembre
1994, à l'Université de Bretagne
occidentale. La jeune Brestoise y
enseignait sous divers statuts depuis
1989, après son DESS en
"Droit des activités maritimes".
Depuis 1995, elle est devenue
maître de conférences. "J'ai
cherché à clarifier le statut de
l'environnement", explique-telle.
Traditionnellement, le droit
de la mer est un laboratoire pour
le droit international tout entier,
et le droit de l'environnement
en particulier. On trouve en fait
dans la mer, espace homogène,
une hétérogénéité de statuts :
territoire, espace sous juridiction,
mer libre...
La protection de cet espace
par la "patrimonialisation" se
construit progressivement -
"s'incarne", préfère dire la lauréate
- par l'accumulation de déclarations,
résolutions, conventions
internationales... Et si
l'environnement marin est un
territoire, il est alors celui de
l'humanité, pour les générations
à venir et un temps indéfini. A la
notion de patrimoine commun de
l'humanité, qui concerne par
exemple la Lune ou l'espace
extra-atmosphérique, elle oppose
audacieusement un patrimoine
naturel de l'humanité, pour la
transmission duquel chaque Étatcôtier
doit agir, comme s'il en
était dépositaire pour le compte
de la Terre entière et à venir... n
M.-E.P.
Véronique Labrot,
tél. 02 98 01 69 27.
Contact ►
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Hélène
Rainelli-
Le Montagner
Un exemple de structure
par terme de taux de swaps.
5 ans '71s133 02 1992
swaps
012
01
0.08
006
0 04
0.02
swaps
tans
20 01 1994
2101.1984
1202'
n>ois
Structure par terme des taux
d'intérêt sur la même période.
0.15
0125
0.1
0075
005
0.025
tx 15 are
Nathalie
Quiniou
PRiX"RtGIONAUX DE LA RECHERCEL LE DOSSIER
E~
SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
Evaluer les
risques
des "Swaps"
Sous ce terme étrange pour les
non initiés, les swaps sont en
fait des produits financiers très
répandus : des contrats d'échange
de taux d'intérêt négociés entre
les grandes entreprises et les
banques. Hélène Rainelli-Le
Montagner s'est penchée sur les
risques de ces produits complexes
lors de sa thèse, sous la direction
du professeur Navatte, au
Laboratoire de recherche en gestion
des organisations de l'Institut
de gestion de Rennes (IGR).
"Il convient de mieux comprendre
ces produits, et notamment
les risques qu'ils comportent",
souligne cette jeune
chercheuse. Après une synthèse
des théories financières, elle a
mis au point des modèles d'évaluation
des risques des swaps,
afin de déterminer notamment le
juste taux d'échange. Confrontés
au marché financier réel, ces modèles
mathématifflee révèlent
parfois difficilement généralisables.
Néanmoins, une analyse
au cas par cas reste possible.
"Actuellement, seules les
banques utilisent de tels modèles.
Les entreprises pourraient,
à l'avenir, s'en servir
pour mieux comprendre les produits
financiers."
Après sa thèse, Hélène Rainelli-
Le Montagner s'est intéressée
aux risques du marché des
actions. Aujourd'hui maître de
conférences à l'IGR, elle approfondit
la finance des entreprises
dans plusieurs pays, et plus particulièrement
le problème du taux
d'endettement. n P.H.
contact ► Hélène Rainelli-
Le Montagner, tél. 02 99 84 78 37,
e-mail : Helene.Rainelli@univrennesl.
fr
SCIENCES BIOLOGIQUES
ET MÉDICALES
Mieux
comprendre
les maladies
auto-immunes
Après avoir obtenu une maîtrise
de biochimie à l'université
de Rennes 1, Michelle Le
Tonqueze a poursuivi son parcours
universitaire à Brest où elle
a été accueillie en DEA puis en
thèse, par le professeur Youinou,
dans le laboratoire d'immunologie
du Centre hospitalier régional.
Le travail de recherche
qu'elle a mené durant sa thèse
vise à comprendre les mécanismes
biochimiques impliqués
dans les maladies auto-immunes,
pathologies dans lesquelles le
système immunitaire d'un individu
s'attaque à ses propres celluls
récisément, son travail'a
-contfibué à l'identification
des cibles des anticorps anti-cellules
endothéliales, des anticorps
particuliers présents en grande
quantité au cours de ces affec-
A Différents stades de
développement de cellules de
veines de cordon ombilical
hybridées avec des cellules
épithéliales immortelles.
tions. Les cibles des anticorps,
que l'on appelle antigènes, sont
des motifs chimiques présents à
la surface des cellules, auxquelles
les anticorps se lient de manière
spécifique. Durant sa thèse, Michelle
Le Tonqueze a notamment
utilisé des techniques de clonage
cellulaire et a obtenu plusieurs lignées
différentes de cellules endothéliales
dont elle a caractérisé
les antigènes. Cette caractérisation
établie, les travaux d'identification
devraient se poursuivre
avec l'objectif d'associer chaque
type de pathologie à un antigène
spécifique.
Michelle Le Tonqueze est
aujourd'hui ingénieur biochimiste
dans le laboratoire Sébia,
un laboratoire de recherche appliquée
situé à Évry en région
parisienne. n C.P.
contact ► Michelle Le Tonqueze,
tél. 01 69 89 83 30.
SCIENCES BIOLOGIQUES
ET MÉDICALES
Prévoir
la croissance
du porc
athalie Quiniou, docteur et
ingénieur de l'École nationale
supérieure agronomique de
Rennes, a réalisé son travail de
recherche au sein de la station
de recherches porcines de l'Inra
(Saint-Gilles), sous la direction de
Jean Noblet. La thèse de Nathalie
Quiniou visait à mieux connaître
la croissance du porc d'élevage,
de manière à pouvoir la modéliser
(et donc la prévoir). En effet,
quand on élève un animal pour sa
viande, il est important de comprendre
comment se déroule sa
croissance : fait-il préférentiellement
du gras ou du muscle ? Valorise-
t-il toute sa ration alimentaire
ou bien en rejette-t-il une
partie ? Plusieurs facteurs sont
à prendre en compte : l'âge de
l'animal, son type génétique, son
sexe, son alimentation et ses
conditions d'élevage. Les résultats
obtenus par Nathalie améliorent
sensiblement les modèles
actuels de prévision de la croissance
et de la qualité des animaux.
L'objectif de ce type de
travail est de pouvoir maîtriser la
composition des porcs au moment
de l'abattage et d'optimiser l'utilisation
des aliments.
Depuis janvier 1996, Nathalie
Quiniou travaille comme ingénieur
de recherche à l'ITP (Institut
technique du porc) au Rheu
(35). En liaison avec l'Inra, cette
spécialiste de la nutrition porcine
s'intéresse maintenant à l'influence
des facteurs d'ambiance
(comme la température des bâtiments)
sur les performances des
porcs en croissance et des truies
en lactation. n C.P.
Contact ► Nathalie Quiniou,
tél. 02 99 28 72 40,
e-mail: quiniou@st-gilles.rennes.
inra.fr
"' Insu : Institut national des sciences appliquées.
"' Le but est de détecter les ondes gravitationnelles,
un des derniers effets prévus par la
théorie de la relativité générale d'Einstein.
Le mois prochain dans Réseau
LES AUTOROUTES
DE L'INFORMATION
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
VILLAGE
PLANÉTAIRE
Formation Continue
Université de Rennes 1
INFORMATIQUE
Formations diplômantes
DESS Compétence Complémentaire en
Informatique (CCI)
DESS Informatique et Ses Applications (ISA)
Formation préparatoire au DESS ISA
DESS Traitement de l'Information Médicale et
Hospitalière (TIMH)
Maîtrise Méthodes Informatiques Appliquées à
la Gestion des Entreprises (MIAGE)
Formations qualifiantes
L'IFSIC propose des formations qualifiantes
de 2 à 8 jours, dans les domaines suivants :
Introduction à Unix
Langage C
Programmation par objets en C++
Initiation à Internet
INFORMATIONS
SERVICE D'EDUCATION PERMANENTE
4, rue Kléber 35000 Rennes
Tél. 02 99 84 39 50 Fax 02 99 63 30 33
A Brest, il y a des salles pour le confort,
et du sel pour les temps forts.
Si Brest accueille un nombre
croissant de congrès et colloques
scientifiques et médicaux, c'est
parce que la ville de la mer
offre aux chercheurs du monde `
entier l'environnement idéal
pour des rencontres fructueuses.
Le Quartz, Centre de congrès,
propose en pleine ville, un grand théâtre
de 1500 places, un amphithéâtre de 320 places, une salle de conférence
de 350 places, des espaces de restauration et d'exposition et aussi des
salles de réunion de 20 à 120 places avec accès indépendant.
Contact : LE QUARTZ - Solange PELLEN
2-4, AVENUE CLEMENCEAU - BP 411
29275 BREST CEDEX
Tél.: 02 98 44 33 77 - Fax : 02 98 44 05 00
Le Quartz est membre du réseau OUEST CONGRES
Donnez du sel
â vos réunions
FORFAIT JOURNEE
A partir de 220 F TTC*
Salle, équipement audiovisuel,
équipe technique et d'accueil,
déjeuner et pauses-café.
* par jour et par personne
'DMadie z99
Coupon â renvoyer au Quartz, par courrier ou par fax au 02 98 44 05 00
Je suis intéressé(e) par votre forfait
Je souhaite recevoir une documentation complète sur LE QUARTZ et ses prestations
Mes coordonnées : q M. q Mme
Société : Activité •
Adresse
Tél.: Fax BREST
Dans l'obligation de répondre aux besoins du progrès scientifique
d'une part, et d'autre part d'accueillir un nombre
croissant d'étudiants (2300 en 1955), la faculté des sciences
de Rennes se voit attribuer des bâtiments beaucoup plus importants
et mieux équipés sur le site de Beaulieu.
ès 1958, Henri Le Moal,
gri doyen de la faculté de 1958 à
1960 puis recteur de l'Académie,
décide avec le maire, Henri Fréville,
la création du campus de
Beaulieu. Ce déménagement correspond
à une période de réorganisation,
de modernisation et de
construction massive des bâtiments
scolaires et à une intention
politique quant à la formation générale
et professionnelle.
Le baby-boom
Dans les années qui suivent la
Seconde Guerre mondiale, après
la reconstruction nécessaire des
écoles sinistrées, l'effort se porte
en premier lieu sur l'enseignement
primaire. L'accroissement
soudain de la natalité, et par
conséquent du taux de scolarisation,
pose un problème immédiat.
Dans l'enseignement supérieur, la
vague démographique ne se fait
sentir que vers 1965, année d'ouverture
du campus de Beaulieu.
Ces changements dans le monde
éducatif vont avoir des répercussions
importantes sur la démocratisation
de l'enseignement, l'atmosphère
des études et même
leur nature.
Un campus
à l'américaine
Les bâtiments scolaires sont
construits selon un certain nombre
de principes déterminés, d'une
part par des objectifs pédagogiques,
et d'autre part par des
contraintes techniques qui déterminent
le prix de revient. La
conception du campus scientifique
de Beaulieu est l'ceuvre de
l'architecte Louis Arretche (reconstructeur
de Saint-Malo), urbaniste
de la ville de 1963 à sa
mort en 1991. "Figure archétype
du professeur des Beaux-Arts, libéré
de l'académisme mais restant
attaché aux vertus de l'élégance
formelle et du bon sens, il
manque à son oeuvre construite
l'assise théorique qui permet une
liberté créative véritable.'x"
Les quelque 200 000 m2 édifiés
à Rennes, dont la faculté des
sciences, n'ont pour identité remarquable
qu'une certaine vérité
des matériaux. Cependant, la
place réservée aux espaces verts
sur le site de Beaulieu reflète
peut-être la volonté de ressembler
A Le 6 octobre 1966,
l'administration et
l'enseignement fonctionnent
depuis un an. Les premiers
occupants des bâtiments de
recherche arrivent suite à
l'inondation des locaux du
sous-sol sur le quai Dujardin.
à un campus américain. Cette
année la faculté des sciences, qui
fête son 31' anniversaire sur les
Buttes de Coësmes, ne cesse de
s'agrandir, offrant aujourd'hui un
peu moins de verdure mais une
renommée importante pour l'éducation
dans le grand Ouest ! n
Anne Le Roux
Le campus de Beaulieu ne
cesse d'évoluer, tout en
essayant de préserver au
mieux ses espaces verts (ici le
nouveau bâtiment de l'Ifsic).
"' Tiré du "Moniteur Architecture AMC", n°28,
Fév. 1992, p.11.
Contact ► Anne Le Roux,
tél. 02 97 23 23 23.
1958 : Premiers projets de création d'une nouvelle faculté.
13 mai 1958 : Désignation de L. Arretche comme architecte.
1959 : Agrément de principe du ministère pour une occupation sur 80 ha et évaluation
des dépenses à 12,7 millions de francs. Réunion pour la définition du programme
pédagogique.
11 mars 1960 : Arrêté ministériel prononçant la déclaration d'utilité publique de
l'acquisition de 39 ha par voie d'expropriation.
20 octobre 1960 : Dossier d'avant projet.
4 juillet 1961 : Approbation de l'avant-projet par le Conseil général des Bâtiments
de France.
1" trimestre 1963 Début des travaux de terrassement.
Novembre 1963: Pose officielle de la première pierre pour la construction de la
nouvelle faculté ; édification des cités et du restaurant universitaires.
Rentrée 1965.1966: Première occupation du bâtiment administration-enseignement.
1966 à 1968: Le second cycle de la faculté des sciences est terminé ; construction de
l'Institut national des sciences appliquées (Insa), de l'École de chimie (ENSCR) et de
l'Institut universitaire de technologie (IUT).
1970 : Fin des travaux du premier cycle et de l'essentiel de l'ensemble sportif.
1996 : zone sud : le centre d'animation socio-culturel ; extension de l'Institut des
sciences informatiques et communication (Ifsic) ; zone nord : l'Irem/CCAFE ; extension
du bâtiment "recherche en chimie des matériaux".
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
111/ -
ZOOPOLE
dFveloppement
Le CTPA et l'association
Zoopôle développement ont
emménagé en octobre 1996
dans un tout nouveau bâtiment
situé à l'entrée du Zoopôle
St-Brieuc - Ploufragan.
LES CENTRES DE TRANSFERT EN BRETAGNE
Les essais vétérinaires au CTPA
Situé sur le Zoopôle de St-Brieuc - Ploufragan (22), le Centre
technique des productions animales et agroalimentaires
(CTPA) s'est bâti une solide réputation dans le domaine des
essais cliniques vétérinaires. Depuis 1985, il a travaillé pour les
plus grands noms de l'industrie du médicament vétérinaire.
Patrick Pommier, le directeur
technique du CTPA, passe
plus de temps dans les élevages
que dans son bureau du tout nouveau
bâtiment de Zoopôle développement
! Vétérinaire formé à
l'école nationale d'Alfort, cet
homme de terrain possède aussi
une solide formation en statistiques
biomédicales "un outil indispensable
lorsque l'on veut obtenir
des résultats fiables à partir
d'essais cliniques".
Chaque année, Patrick Pommier
et ses collègues vétérinaires
réalisent une dizaine d'essais cliniques,
en majorité sur les porcs
et sur les bovins, parfois sur les
volailles. "Les essais cliniques
sont souvent la dernière étape de
développement d'un médicament
vétérinaire", explique-t-il. La
mise sur le marché d'un nouveau
médicament vétérinaire nécessite
plusieurs années de recherches,
d'abord au sein d'un laboratoire
pharmaceutique, puis sur le terrain.
Les essais réalisés au CTPA
rejoindront ainsi le dossier de demande
d'autorisation de mise sur
le marché du nouveau médicament
; c'est l'Agence nationale
du médicament vétérinaire, située
à Fougères, qui sera chargée
d'examiner ce dossier et de délivrer
(ou non) l'autorisation demandée.
Chez des éleveurs
bretons
Qui dit "essais cliniques" dit
forcément "patients" : ceux-ci
sont recrutés dans des élevages, le
plus souvent locaux. "Lorsque
nous souhaitons essayer un médicament
actif contre une maladie,
nous recherchons un élevage
qui connaît fréquemment
ce type de pathologie. Cette recherche
se fait par l'intermédiaire
de groupements de producteurs
et de fabricants d'aliments
ou avec l'aide de nos collègues
du Cnevaw".
Un éleveur qui accueille un
essai clinique ne change rien à la
conduite de son élevage. Le
CTPA prend en charge tous les
actes vétérinaires et les observations.
"Nous sommes souvent
bien acceptés par les éleveurs. Ils
ne sont pas rémunérés, mais seront
indemnisés en cas de pertes
ou de travail supplémentaire. De
plus, ils bénéficient ainsi d'un
suivi approfondi de leur élevage.
Les principales données sanitaires
recueillies sont portées à la
connaissance de leurs vétérinaires
traitants, avec lesquels
nous travaillons".
Rigueur et
confidentialité
La confidentialité est l'une des
règles de base du métier du
CTPA. Si Patrick Pommier nous
cite le nom de Pfizer, le n° 1 mondial
du médicament vétérinaire,
c'est parce qu'un programme
d'essais mené pour cet industriel
est aujourd'hui achevé et que les
résultats vont bientôt en être publiés.
Plusieurs années de travaux
réalisés par le CTPA vont ainsi
aboutir prochainement à la mise
sur le marché d'un nouvel antiparasitaire,
destiné aux bovins et
aux porcins. À côté de géants de
la pharmacie comme Pfizer, le
CTPA travaille également pour de
petites entreprises locales comme
Guildali (voir Réseau n° 108).
La qualité du travail du CTPA
est reconnue par ses clients, mais
aussi par la communauté scientifique
à travers ses publications.
Patrick Pommier souligne néanmoins
que "le client reste propriétaire
des résultats et c'est lui
qui décide de publier, ou non, les
résultats de nos travaux". n C.P.
"' Cneva : Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires. "' Mission accomplie, avec la
création, en 1993, de l'Ispaia, Institut supérieur
des productions animales et des industries --
agroalimentaires.
Patrick Pommier,
tél. 02 96 76 61 61,
e-mail : Patrick.POMMIER@
zoopole.assofr
` aeS Qvv Genèse et évolution du CTPA
°•° En 1985, sur le site de Saint-Brieuc, coexistaient
c
s
~eQ o9
~~z oie
plusieurs organismes s'intéressant aux productions aniô~.~
males : la station d'aviculture et celle de pathologie porcine
étaient présentes depuis de nombreuses années à Ploufragan,
tandis que le Laboratoire départemental d'analyse (LDA 22), la Direction
des services vétérinaires (DSV) et le Groupement de défense
sanitaire (GDS), se situaient à quelques kilomètres de là, à Saint-
Brieuc. Ces organismes ont alors imaginé, avec le soutien du
Conseil général des Côtes d'Armor, "une structure capable de les
faire travailler en commun". Cette structure privée, appelée "Centre
technique des productions animales et agroalimentaires" avait plusieurs
missions : élaborer les dossiers de financements de programmes
de recherche, mettre sur pied un institut de formationt2',
monter un centre de documentation, assurer la promotion du site et
enfin réaliser des essais cliniques vétérinaires. Au fil des années, ces
missions se sont développées, et si en 1985, elles occupaient 2 personnes,
ce sont aujourd'hui 17 personnes qui les assurent, au sein du
nouveau Zoopôle St-Brieuc -Ploufragan, créé en 1989 et animé par
l'association "Zoopôle développement". Aujourd'hui donc, le nom
de "CTPA" est désormais réservé aux essais cliniques vétérinaires, à
la veille technologique et au conseil aux entreprises. Son effectif
comprend trois vétérinaires, un technicien, un conseiller technologique
docteur en sciences et une secrétaire. n
l'o t
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Photo J.M. Rémois/France iélécom.
De gauche à droite : Jean-Marie Touret, directeur de l'Ocisi,
Jean-Jacques Souchotte, directeur régional de France Télécom
Rennes, Jacques Grandame, société Olivetti et à droite, Nicolas
Rousseau, directeur de l'unité Ouest d'Ocisi.
LES BRÈVES RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Du côté des
entreprises
A Vue aérienne de la
technopole Rennes Atalante.
1996: une bonne
année pour
Rennes Atalante
Rennes : malgré un
climat d'inquiétude
autour des secteurs
de l'audiovisuel et des télécommunications,
les entreprises de la
technopole Rennes Atalante affichent
un bilan largement positif :
72 suppressions d'emplois contre
492 créations ! Le site d'Atalante-
Beaulieu arrivant à saturation, une
extension est envisagée de l'autre
côté du nouveau périphérique.
L'année 97 s'annonce bien, car
plusieurs chantiers sont en cours :
un nouveau centre de développement
de logiciels (Mitsubishi), le
centre de recherche de Comatlas
(composants pour la transmission
de données numériques) et celui
de Wandel et Goltermann, l'extension
de Sema Group et celle
de Krier Conseil Informatique,
l'agence locale de Schneider, les
laboratoires Richier et la société
Adequat... soit encore plus de 160
emplois hautement qualifiés attendus
sur la technopole dans les
prochains mois.
► Rens. : Corinne Bourdet,
tél. 02 99 12 73 73.
Prix "Produit en
Bretagne"
Rennes : l'une lance une campagne
de promotion de la cuisine
bretonne auprès des enfants.
L'autre sensibilise la clientèle des
supermarchés au patrimoine régional,
en exposant des photos des
1i.z,numents locaux. Ces deux
équipes de huit étudiants de l'Institut
de gestion de Rennes ont ainsi
gagné le prix de 4 000 F remis par
l'association "Produit en Bretagne".
Ils auront en plus la possibilité
de faire un stage rémunéré
dans la vente ou le marketing.
Rens. : Anne Le Hénanff,
tél. 02 98 47 94 88.
Prix Innovation
défense : appel
à candidature
Paris : le prix "Innovation
défense" récompense
des entreprises de qualité,
petites et moyennes, intervenant
dans les domaines tels que l'informatique,
la robotique,, l'électronique,
l'optronique, les télécommunications
et les matériaux... Tous
ces domaines étant particulièrement
développés en Bretagne, plusieurs
lauréats des années précédentes
sont des entreprises de notre région,
comme llog et AQL.
► Rens. : Edouard Valensi,
chargé de mission Industrie,
tél. 01 45 52 43 21.
La société Narvik
récompensée
Rennes : le prix Qualité Bretagne
1996 a été remis à l'entreprise
Narvik, implantée à Landivisiau
(29), lors d'une cérémonie présidée
par le préfet de la Région
Bretagne, Yves Mansillon. Créée
en 1988, cette entreprise est aujourd'hui
le leader français pour
la production de saumons fumés.
Cette récompense témoigne du
souci de Narvik et de son président,
René Gad, à l'égard de la
qualité de ses produits, véritable
pilier de la politique de l'entreprise.
Rens : Agnès Loin, attachée
de presse, tél. 02 98 63 43 17.
50 informaticiens
à France ; lécom
Rennes : installé dans de nouveaux
locaux depuis le 19 décembre
dernier, l'Organisme central
d'intégration et de soutien
informatique (Ocisi) a pour mission
la maintenance et l'amélioration
de la qualité des applications
informatiques de France Télécom.
En quelques mois, 50 nouveaux
collaborateurs, en majorité des informaticiens,
sont venus rejoindre
cette unité stratégique.
► Rens. : Maxime Le Padellec,
tél. 02 99 01 58 68.
Les prix Crisalide sont
décernés par la Chambre de
commerce et d'industrie de
Rennes et par Créat'IV.
10 décembre/
Crisalide 1996
Rennes : mis en place par
Créat'IV et la Chambre de commerce
et d'industrie dans l'optique
d'une concrétisation technique
et commerciale, les prix
Crisalide consistent à mettre à la
disposition des lauréats des compétences
et des moyens logistiques
et techniques adaptés à
leurs projets. Dans le domaine
des techniques de l'information et
de la communication, les lauréats
sont Olivier Delépine, pour son
projet de centre culturel réunissant
architecture gothique et images
virtuelles, et Loïc Nouyou et
Serge Milon, concepteurs d'une
borne d'information basée sur CD
interactif. Les projets liés à la
santé sont ceux d'Anita Lucas,
qui a conçu un biomatériau de
substitution des os, et de Jacques
Le Bozec, inventeur d'une pince
automatique pour clips hémostatiques.
Hubert Pircher et Jacques
Bossu ont par ailleurs reçu les
mentions spéciales du jury.
► Rens. : Bénédicte Cam,
tél. 02 99 23 79 00.
Du côté des
laboratoires
Abio :
un mariage mixte...
Rennes : sur le campus
de Beaulieu, il arrive de
plus en plus souvent
qu'informaticiens et biologistes
aient besoin les uns des autres,
pour comparer des séquences génétiques,
ou créer des ordinateurs
biologiques... Nouvellement créée,
l'association bio-informatique de
l'Ouest regroupe les chercheurs
de ces deux disciplines et organise
des séminaires et des formations.
Rens. : Pascale Guerdoux-
Jamet, tél. 02 99 84 71 00,
http: llwww. irisa. fr/abio
Le Pôle analytique
des eaux veillera à Brest
Brest : le maire de Brest, Pierre
Maille, a posé une symbolique
première pierre du futur PAE : le
Pôle analytique des eaux, qui
verra le jour d'ici la rentrée 97. Il
aura pour vocation de participer
au développement du Technopôle
Brest-Iroise en offrant une large
compétence dans le domaine de la
qualité des eaux. À Brest, où la
question est très présente, notamment
avec le contrat de baie pour
la rade, ce super-laboratoire sera à
la disposition des pouvoirs publics,
mais aussi des industriels et
des particuliers. Contrôle des produits
alimentaires, analyses d'effluents,
recherche de contaminants,
suivis des eaux de rivières
et plans d'eau, le PAE est destiné
à devenir l'élément central du
Pôle des eaux littorales regroupant
à terme diverses structures
comme l'Ifremer, l'université, le
Cedre (pollutions marines), Micromer...
► Rens. : Jean-Luc Jégou,
directeur du PAE,
tél. 02 98 44 45 95.
Rennes Atalante
G
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Du côté
d'Internet
%ercreni 18 (Décan
Inauguration Officielle du Serveur Web
du
Conseil Général du Finistère
L'inauguration sur écran
du serveur du Conseil
général du Finistère.
Le Conseil
général du Finistère
a son serveur !
Quimper : le Finistère
avance : son Conseil général
vient de se doter d'un serveur
Web, http://www.cg29.
fr, c'est désormais le site Internet
où le monde entier
pourra venir visiter virtuellement
le département, et se
tenir au courant des politiques
en cours. Hébergé par
l'association Infini (comme
INternet-FINIstère), le serveur
permet de trouver des
informations significatives
sur le Conseil général luimême,
mais aussi sur l'histoire,
la géographie, l'économie,
la culture ou le tourisme
du département... Le tout est
largement illustré de photos.
Charles Miossec, président
du Conseil général du Finistère,
a coupé symboliquement
un ruban virtuel, secondé
en l'occurrence par
ceux qui soutiennent particulièrement
la nécessaire adaptation
aux évolutions de la
technologie : le vice-président,
le sénateur Alain Gérard,
et le conseiller général
délégué à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche,
Jacques Berthelot.
Contact : e-mail :
Antenne.Brest@cg29.fr
http:11www.cg29.fr
LES BRÈVES RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Les prix Roberval
,j ' Paris : décerné par
—ï l'université technologigue
de Compiègne,
sous la présidence de René Monory,
président du Sénat, le prix
francophone du livre et de la
communication en technologie a
fêté ses dix ans le 5 décembre
dernier, en désignant quatre nouveaux
lauréats : Michel Rival
pour son livre Les apprentis-sorciers
(prix grand public), André
Fortin pour son manuel Analyse
numérique pour ingénieurs (prix
enseignement supérieur) et la production
Lazennec Bretagne pour
un reportage sur les ponts dans le
magazine C'est pas sorcier, diffusé
sur France 3. Une mention
spéciale a été attribuée à Benelim
Djimadoumbaye pour son reportage
sur La brique stabilisée, produit
et diffusé par Télé-Tchad.
Rens.: Prix Roberval,
tél. 03 44 23 43 58.
Xavier Drouet est
aujourd'hui le directeur
général de l'Adria.
Le nouveau directeur
général de l'Adria
Quimper (29) : depuis
janvier 1997, Xavier
Drouet est à la tête de
l'Association pour le développement
de la recherche appliquée
aux industries agricoles et alimentaires,
l'Adria, après avoir
occupé la fonction de directeur de
la recherche. Il succède à Claude
Bourgeois qui occupait cette
fonction depuis 23 ans. Normalien,
docteur en médecine et lauréat
de la faculté de médecine de
Paris, Xavier Drouet, âgé de 38
ans, s'est d'abord consacré à des
travaux de recherche puis a rejoint,
en 1989, la société Transia
en qualité de directeur scientifique.
En 1991, il prend la direction
générale de cette société et
assure le développement commercial
de ses produits en Europe. En
juillet 1995, Xavier Drouet intègre
l'Adria.
Rens.: Jean-Robert Geoffroy,
tél. 02 98 90 80 12.
Les échos
de l'Ouest
L'exposition "Bord de mer"
a fasciné plus d'une jeune tête.
L'Espace des sciences-
CCSTI, le nez
dans les bouquins !
Quimper : décembre accueillait
le 4' salon du livre pour la jeunesse.
Fidèle à son engagement
auprès des jeunes, qui participaient
nombreux à la manifestation,
L'Espace des sciences-
CCSTI présentait au public une
exposition, un stand d'information
et le planétarium itinérant.
Enfants et adultes ont une fois de
plus pu apprécier la poésie de la
science astronomique sous le
dôme gonflable, tandis que l'exposition
"Bord de mer" attirait
largement les classes et les professeurs.
A destination de ceuxci,
et de tous les adultes participants,
le stand d'information
permettait de répondre aux questions
concernant la quarantaine
d'expositions scientifiques itinérantes
du CCSTI, ainsi que votre
mensuel Réseau. Présidé par Éric
Hussenot, le directeur scientifique
d'Océanopolis, le CCSTI de la
mer à Brest, le salon a prouvé que
la culture scientifique fait bon
ménage, chez les enfants, avec
l'imaginaire de la littérature.
► Rens. : L'Espace des
sciences-CCSTI,
Rennes, tél. 02 99 35 28 20,
Brest, tél. 02 98 05 60 91.
Animé par Magali Colin
pour le salon du livre, le stand
de L'Espace des sciences-CCSTI
a su marier les sciences et la
culture !
Du côté
de l'Euro • e
La lettre du CRI
Rennes : deux fois par mois, le
Centre relais innovation (voir les
sigles du mois, page 7) publie un
bulletin d'information sur la recherche
et l'innovation en Europe
: dans le dernier numéro figuraient,
par exemple, un nouvel
appel de propositions du programme
Fair (agriculture et
pêche) et l'annonce d'un colloque
international de technologie marine
(IMBC97) en septembre 97
dans le sud de l'Italie.
Pour recevoir ces bulletins,
contacter : Benoît Nicol,
tél. 02 99 67 42 00.
Passeports Bretagne
pour l'an 2000
Rennes : depuis 1993, 263 jeunes
Bretons ont bénéficié de l'opération
"Passeports Bretagne pour
l'an 2000", qui leur apporte à la
fois un soutien financier et un encadrement
professionnel, pour
mener à bien leur projet de formation.
Cette opération a été
mise en place par le Conseil régional,
le Crédit agricole et le
Crédit mutuel de Bretagne, la
Chambre régionale de commerce
et d'industrie et des entreprises.
La promotion 96-97 comprend
56 étudiants (13 filles et 43 garçons).
Huit sont originaires des
Côtes d'Armor, 22 du Finistère,
14 d'Ille-et-Vilaine et 12 du Morbihan.
Rens.: Catherine Mallevaës,
tél. 02 99 27 13 56.
® RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Découvrez une sélection de.
meilleurs produits de format ,
adoptés 8 votre activité
TAU, MER, ENV '.T
BIOLOGIE, f;IOTECHNOLOGILS
Rennes : le Centre national (pôle européen) d'enseignement à distance
(CNED), au titre de pôle européen d'enseignement à distance, vient de
publier un catalogue de ses vidéos et CD-Rom. Ces produits intéressent
non seulement les milieux de la formation et de l'enseignement, mais
aussi le monde économique, comme le montrent les sujets suivants :
l'eau et le droit, utilisation de la RMN en agroalimentaire, les biotechnologies
végétales, statistiques et maths pour l'entreprise, l'anglais
comme langue d'affaires...
Pour le recevoir, contactez : Jean-Luc Gargadennec, tél. 02 99 25 13 32.
RÉSEAU 130• FÉVRIER 1997 LES BRÈVES
Expositions
À L'Espace des sciences
Jusqu'au 30 avril/
Les autoroutes
de l'information
Rennes : pénétrez au coeur d'une
fibre optique et retrouvez-vous
sur la place d'un village, où François
Morel et Olivier Saladin (des
Deschiens) vous expliquent, en
mots de tous les jours, ce que sont
les autoroutes de l'information.
Pour en savoir plus, une visite à la
mairie, une station au cybercafé
et un passage à l'office de tourisme
vous renseignent sur les
points essentiels : que sont les
autoroutes de l'information ? Sur
quelles technologies reposentelles
? Quelles sont leurs applications
? Leur enjeux ? Cela peut-il
améliorer nos conditions de vie ?
de travail ? Tous ces thèmes sont
abordés lors de cette exposition
très grand public, dans laquelle
un animateur se tient en permanence
à votre disposition... Une
visite guidée est proposée chaque
jour à 16h.
► Rens. : L'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 28.
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h30
à 18h30,le samedi de10hà18h30.
Entrée :10 F, tarif réduit : 5 F, gratuit
pour les moins de 12 ans. Groupes le
matin sur réservation uniquement.
Expositions itinérantes
"Cerveau l'Enchanteur"
Cette exposition présente
les résultats les
plus récents de la
recherche médicale sur le cerveau
: matière grise et substance
blanche, influx nerveux et signaux
chimiques, les scientifiques commencent
seulement à comprendre
comment fonctionne le cerveau.
Cette exposition, comprenant 12
panneaux et un document d'accompagnement,
est une bonne entrée
en matière pour des sujets
parfois difficiles à aborder : effets
des drogues et toxicomanie, stress,
vieillissement cérébral et Alzheimer,
douleur, sommeil et rêve...
Tarif de location : 500 F la semaine,
1500 F le mois, transport
et assurance à la charge de l'emprunteur
(réductions dans le Finistère
et dans certaines communes
d'Ille-et-Vilaine).
Rens. : L'Espace des sciences-
CCSTI, Benoît Bigotte,
tél. 02 99 35 28 23.
Formations
ENST de Bretagne,
terre d'accueil
Brest : à la rentrée de la Toussaint,
le campus de Télécom Bretagne
à Brest a accueilli des étudiants
de l'école franco-polonaise
en nouvelles technologies de l'information
et de la communication
(Poznan), suite à sa mise en liquidation
en septembre dernier. Les
élèves des mastères spécialisés
ont intégré les mastères proposés
par l'ENST et les étudiants polonais
de troisième année ont pu
terminer leur stage en entreprise.
De plus, cinq étudiants polonais
de deuxième année ont rejoint
l'ENST de Bretagne.
Rens. : Catherine Le Riguer,
ENST de Bretagne,
tél. 02 98 00 10 15.
La nouvelle de Ker Lann
Bruz (35) : en novembre dernier,
l'École nationale de la statistique
et de l'analyse de l'information
(Ensai) a pris place dans ses nouveaux
locaux sur le campus de
Ker Lann à Bruz. L'Ensai, l'une
des deux écoles dépendant de
l'Insee, accueillera environ 300
élèves admis sur titre ou sur
concours. La formation prépare
aux métiers de la collecte et de
l'analyse de l'information en
3 ans, ou 2 ans pour les élèves
fonctionnaires de l'Insee.
Rens. : Chantal Granier,
tél. 02 99 05 91 90.
Formations
Archimex 1997
Vannes : ces sessions
proposées font le point
sur un produit ou une
technique avec les meilleurs spécialistes
et donnent lieu à des
échanges d'informations techniques,
scientifiques et réglementaires.
Vannes : 4 et 7 février,
Épaississants et gélifiants.
Avignon : 26 et 27 février,
Composés indésirables dans
les produits végétaux.
Vannes : 5 et 6 mars 1997,
Protéines végétales.
Paris : du 11 au 13 mars,
Émulsions et mousses.
Vannes : du 19 au 21 mars,
Plans expérimentaux.
Paris : 25 et 26 mars,
Colorants et pigments.
► Rens. : Philippe Masson,
Archimex, tél. 02 97 47 06 00.
Formation continue
à I'UBO
Brest : le département de Chimie
de l'Université de Bretagne occidentale
propose deux cycles de
Formation à distance
formation continue sur la maîtrise
de la qualité au laboratoire, à destination
des ingénieurs et techniciens
supérieurs des laboratoires
d'analyses : l'un sur la validation
statistique des méthodes (3 jours
en février, 4 jours en juin), l'autre
sur la méthode des plans d'expériences
(4 jours en avril et 4 jours
en juin). Un troisième cycle sur le
contrôle qualité est à l'étude.
Rens. : Jean-Pierre Glémarec,
tél. 02 98 01 63 32.
Formations Ispaia
Ploufragan (22) :
voici le programme
des formations proposées
par 1 Institut supérieur des
productions animales et des industries
agroalimentaires (Ispaia)
dans les prochains mois :
Du 4 au 6 février :
L'audit qualité dans les IAA.
Du 18 au 20 février :
Les facteurs à maîtriser en salle
blanche.
Les 5et 6 mars :
Gestion de l'environnement.
Les 5 et 6 mars :
Sensibilisation du personnel à
la démarche qualité.
Du 12 au 14 mars:
Être acteur dans sa démarche
qualité.
Les 18 et 19 mars :
Plan de nettoyage et assurance
qualité.
Du25au27 mars :
Prélèvements microbiologiques
et conseils.
► Rens. : Véronique Voisin,
tél. 02 96 78 61 30.
L'ESPACE
DES
SCIENCES
ISPAIA
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
À lire
pow les annep.i.n, tes services • los innov:mv..
Guide des
laboratoires pour
les entreprises,
les services et
les innovateurs
A l'initiative du Centre national
de la recherche scientifique,
la Mission des relations
avec les entreprises (MREN)
édite, sous forme d'un guide,
la présentation des compétences
de ses laboratoires.
Près d'un millier d'unités de
recherche font ainsi connaître
leur savoir-faire et leurs
moyens techniques, en vue de
nouer des partenariats avec
les entreprises soucieuses
d'innover ou simplement
d'améliorer leurs technologies
ou leurs produits.
Éditions CNRS, 270 F.
► Rens. : Christelle Poulain,
tél. 01 44 96 43 52.
RESEAU
est à l'écoute
de vos informations
et commentaires.
Si vous êtes situé en Bretagne,
nous annoncerons vos colloques
et conférences scientifiques,
parlerons de vos recherches, de
vos innovations.
Appelez la rédaction
à Rennes au 02 99 35 28 22,
fax 02 99 35 28 21,
e-mail : ccsti@univ-rennesl.fr,
à Brest au 02 98 05 60 91,
fax 02 98 05 15 02,
e-mail : mepau@infini.fr
Prochains dossiers : les autoroutes
de l'information, le journalisme
scientifique, la qualité
des produits agroalimentaires...
LES RENCONTRES R
E
N
N
HALIEUTIQUESE
QUI A DIT ?
Réponse de la page 5
Paul Valéry, Tel quel, 1.
LES BRÈVES RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Mutation Delage/2ozimut.
Colloques
Du 6 au 8 février/
Salon du lycéen
Rennes : le salon du lycéen et de
l'étudiant se tiendra au parc des
expositions, Rennes aéroport. Un
pôle "métiers" organisé par le
Conseil régional de Bretagne sera
présenté au salon de Rennes et
fournira aux jeunes des indications
sur les formations et les métiers.
► Rens. : Isabelle Mazureau,
tél. 02 99 36 37 37.
13 février/
Échanges et dialogues
en Europe
Rennes : le Conseil régional
de Bretagne organise
un débat sur les
possibilités d'échanges, de stages
et d'études avec les pays de la
Communauté européenne, en présence
notamment d'Yves Thibault
de Silguy, commissaire européen.
Rens.: Catherine Mallevaës,
tél. 02 99 27 13 67.
14 février/
Remise des Prix Bretagne
Jeune Chercheur
Rennes : les lauréats du Prix
Bretagne Jeune Chercheur (voir
notre dossier) recevront, en même
temps que leur trophée, les félicitations
du président du Conseil
régional, Yvon Bourges, et de
Jean-Marie Lehn, président du
jury du Prix "Bretagne de la Recherche",
réunis ce même jour.
► Rens. : Laurence Gad,
tél. 02 99 27 13 62.
Du 5 au 7 mars/
Prodial
Rennes Saint-Jacques : premier
salon des fournisseurs du secteur
agroalimentaire, Prodial est un
lieu de rencontre entre les entreprises
agroalimentaires du grand
Ouest et les professionnels de la
distribution, de la restauration
hors foyer et du commerce de
gros. L'objectif pour cette 2' édition
est d'accueillir 25000 visiteurs
pour 250 exposants.
► Rens. : Michèle Moreau,
tél. 02 99 29 59 01.
14-15 mars/
Rencontres halieutiques
Rennes : l'association Agrohalieuthes
et l'École nationale supérieure
d'agronomie (Ensar) ont
cho'si cette année le thème du développement
durable pour les activités
halieutiques. L'objectif de
ces rencontres entre professionnels
et chercheurs, est de dégager
des pistes de réflexion et de
mettre en place des actions utiles,
notamment au niveau de la région.
Rens.: Odile Roussot,
tél. 02 99 28 75 36,
http: //www.rennes.inra.fr/halieute,
e-mail: halieut@roazhon.inra.fr
19 mars/
Les enzymes à l'échelle
industrielle
Rennes : l'association
Profil, centre de
transfert de technologie
sur les lipides,
organise avec le concours du
Conseil régional de Bretagne, du
Conseil général d'Ille-et-Vilaine
et du district de Rennes, ses 2"
rencontres Industrie-Recherche,
sur l'application industrielle des
techniques enzymatiques au domaine
des lipides.
Rens. : Florent Yvergnaux,
tél. 02 99 87 13 69.
19-20 mars/
Sus aux nuisances
agricoles
Rennes : le Groupement de
recherche universitaire sur les
techniques de traitement et
d'épuration (Grutte) organise,
avec l'École nationale supérieure
de chimie (ENSCR), un congrès
international intitulé : "Nuisances
agricoles et agroalimentaires :
constats et solutions". Près de
400 participants sont attendus,
dont la moitié d'étrangers, pour
faire le point sur la recherche
dans le domaine du traitement
des effluents.
► Rens. : Alain Laplanche,
tél. 02 99 87 13 01.
Conférences
Conférence Irisa
7 février/
Systèmes mal conditionnés
Rennes : Claude Brezinski, de
l'université des sciences et technologies
de Lille, présente une
conférence sur les méthodes
d'extrapolation pour la régularisation
de systèmes linéaires mal
conditionnés. A 14h dans la salle
"Michel Métivier" de l'Irisa,
campus de Beaulieu.
► Rens. : Daniel Le Métayer,
tél. 02 99 84 71 00.
5 février/
Les monstres marins,
mythes et réalité...
Rennes : terriens et marins ont
toujours imaginé la mer peuplée
de monstres. Certains sont les représentations
outrées d'espèces
réelles, tandis que d'autres sont
le pur fruit de l'imagination créatrice
de l'homme. Etranges poissons
abyssaux, kraken géant, sirènes
sont les représentations
savantes ou populaires du mystérieux
monde marin. Patrick
Geistdoerfer, directeur de recherche
au CNRS et Aliette
Geistdoerfer, chargée de recherche
au CNRS, nous feront
découvrir ce monde étrange. A la
maison du Champ de Mars à
20h 30, entrée libre.
Rens. : L'Espace des sciences-
CCSTI, tél. 02 99 35 28 20.
e RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
RÉSEAU 130 • FÉVRIER 1997
Patrimoine et société
Rennes : l'université de Rennes 2
- Haute Bretagne propose un
cycle de conférences ouvertes au
grand public, autour du thème
"Patrimoine et société". Présentées
une première fois à Rennes,
elles sont ensuite programmées à
Saint-Brieuc.
3 février/L'architecte
et le patrimoine,
par Frédéric Seitz, ingénieur de
recherche à l'École des hautes
études en sciences sociales, professeur
à l'École spéciale d'architecture,
Paris.
10 février/Patrimoine
et création :
le goût XVIII' dans la France du
XX' siècle, par Pierre Derrien,
professeur agrégé d'histoire, université
Rennes 2.
Rens.: Anne-Marie Cons,
Service culturel,
tél. 02 99 14 11 40.
13 février/
La dendrochronologie
Rennes : invité par l'Institut régional
du patrimoine, Georges
Lambert, directeur du laboratoire
de chrono-écologie à l'université
de Besançon (25), explique comment
on peut dater du bois et
comprendre l'évolution climatique
d'une région, simplement en
analysant les anneaux de croissance
des arbres. A la maison du
Champ de Mars à 20h 30, entrée
20 F, étudiants et demandeurs
d'emploi 10 F.
Rens. : Irpa,
tél. 02 99 79 39 31.
14 février/
La monnaie unique
européenne
Rennes : dans le cadre "Les rendez-
vous du futur", organisés par
la Chambre de commerce et d'industrie
de Rennes et par la faculté
de droit et de science politique de
Rennes 1, le commissaire européen
chargé des affaires économiques,
fmancières et monétaires,
Yves-Thibault de Silguy, présente
une conférence sur les enjeux de
la monnaie unique à l'horizon
2000. Conférence à la faculté de
droit et de science politique, 9,
rue Jean Macé à 17 h 30, entrée
libre.
Rens. : Anne-Claude Millet,
CCI, tél. 02 99 33 66 08.
OÙ TROUVER RÉSEAU EN KIOSQUE ?
Librairie Breizh - 17, rue de Penhoët - Rennes
Colombier Presse - 7, dalle du Colombier - Rennes
Librairie médicale et scientifique - 3, rue Édith Cavell - Rennes
Librairie Dialogues - Forum Roull - Brest
Président du CCSTI : Paul Tréhen. n Directeur de la publication : Michel Cabaret.
Rédacteur en chef : Hélène Tattevin. n Rédaction : Philippe Hervé, Anne Le Roux, Michel
Pascal, Marc-Élie Pau, Catherine Perrot. n Comité de lecture : Christian Willaime
(physique-chimie-matériaux), Gilbert Blanchard (biotechnologies-environn
Pour découvrir
Réseau, chaque mois,
c'est facile...
Abonnez-vous!
2 ANS (22 numéros) 1 AN (11 numéros)
Tarif normal
360 F au lieu de .4.40-F-* 200 F au lieu de220 *
soit 4 numéros gratuits soit 1 numéro gratuit
Tarif étudiants (joindre un justificatif)
180 F au lieu de 440-* 100 F au lieu de221Er5*
soit 13 numéros gratuits soit 6 numéros gratuits
Tarif étranger ou abonnement de soutien
500 F 300 F
*prix de vente au numéro.
BULLETIN D'ABONNEMENT
OUI, je souhaite m'abonner à Réseau
1 AN q 2 ANS
Tarif normal
Tarif étudiant (joindre un justificatif)
Tarif étranger ou abonnement de soutien
Nom
Prénom
Organisme/Société
Secteur d'activité
Adresse
Tél. Fax
Je désire recevoir une facture
Code postal Ville
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre du CCSTI, à retourner à :
Espace des sciences - CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 Rennes.
L
QUALITE DES PRODUCTIONS
SANTE ANIMALE
nouvelle
Rejoignez le ZOOPOLE.
Implantez votre entreprise
dans l'univers de performance
et d'innovation d'un technopôle
européen de très haut
niveau.
Au coeur du premier' bassin
agro-alimentaire français, le
ZOOPOLE est la plate-forme
de votre développement
international. Sur un parc de
50 ha, nous accompagnons
votre installation et nous
vous offrons sur place tous
les services scientifiques et
technologiques nécessaires à
votre essor : de la mise au
point à l'expérimentation
(500 chercheurs et techniciens)
en passant par l'infrastructure
utile au quotidien.
Pour commencer votre visite
des lieux, découvrez en
avant-première ceux qui
créent chaque jour "la
nouvelle aventure de
l'homme". aventure
QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT
QUALITE EN IAA
SECURITE ALIMENTAIRE
FORMATION SUPERIEURE
Côtes d'Irma
ZOOPOLE
SAINT-BRIEUC - PLOUFRAGAN
Un univers de performance et d'innovation
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest