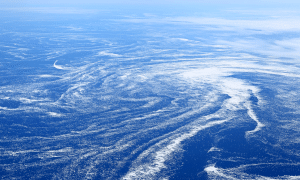L'os vivant
o L'ESPACE
DES
SCIENCES
t
Recherche et innovation en Bretagne
DO SI
*a e -
viva
Janvier 2000
N°162 20 F/3,05 €
A La culture scientifique contribue à faire partager les
connaissances et les richesses qu'elles engendrent.
raire recul
l'obscurantisme...
es cinquante dernières années ont connu une accéléra-
& tion sans précédent du rythme des découvertes scientifiques.
L'exploration de l'univers se poursuit et ses limites
connues reculent sans cesse ; la découverte du code génétique
a entraîné une multitude d'avancées déterminantes
dans tous les secteurs de la biologie et de la médecine. La
chimie, la physique, les mathématiques, l'informatique
connaissent le même essor et les retombées pratiques des
découvertes sont immenses... La revue Réseau contribue
mois après mois à leur diffusion, mais aussi à soulever
de nombreuses questions dont j'ai choisi de rappeler
quelques-unes :
Sommes-nous prêts à accompagner cette progression
fulgurante ?
Sommes-nous en mesure de réagir de manière responsable
aux transformations induites par les technologies qui
en sont les moyens de vie pour les générations futures ?
Serons-nous assez perspicaces pour faire la distinction
entre les effets bénéfiques du progrès, dans le domaine de
la santé ou la lutte contre l'exclusion, et les dangers d'une
exploitation nuisible, mercantile ?
De nombreux événements récents nous ont permis de
soupçonner les risques, mais aussi d'envisager les nombreuses
raisons d'être optimiste. Pour réussir ce pari, il
faudra également apprendre à mieux faire partager ces
connaissances et les richesses qu'elles engendrent. La
diffusion de la culture scientifique doit accompagner ce
processus et contribuer à faire reculer toutes les formes
d'obscurantisme.
Je souhaite à tous mes meilleurs voeux de bonne et
heureuse année. n
Paul Tréhen, président de l'Espace des sciences
© RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
LA VIE DES ENTREPRISES
"Algologie" et "Fleur de mer"
Des algues dans la peau
4 HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
Simon Sirodot 1825-1903
La fouille du Mont-Dol
LES SIGLES DU MOIS P7
P5
P6
r, Pour découvrir Réseau,
chaque mois,
c'est facile...
Abonnez-vous
Tirage du n 162: 3600 ex. Dépôt légal n°650. ISSN 1281-2749
ÉDITORIAL SOMMAIRE JANVIER 2000
HISTOIRE E JOCLTE
Un "panel des citoyens" pour débattre
de l'expérimentation animale
PORTRAIT DE CHERCHEUR
fl Daniel Boujard
Comment interagissent molécules
et cellules
P3
P4
LE DOSSIER
L'os vivant
La recherche en direct P 9
La croissance, meilleure alliée de l'os P 10
Os réparé, les espoirs pour l'ostéoporose P 11
Une exposition pour tout savoir sur l'os P 12/13
Greffes d'os : ça marche... ! P 14
Prothèses : une histoire à tenir debout P 15
Os... mis au clou ! P 16
Pour en savoir plus P 17
LES BRÈVES P 18 À 22
À L'ESPACE DES SCIENCES EN JANVIER P. 23
Réseau sur Internet : www.espace-sciences.org
RÉSEAU est rédigé et édité par l'Espace des sciences, (entre de culture scientifique technique et
industrielle (Association loi de 1901), centre associé au Palais de la découverte L'Espace des sciences,
6, place des Colombes, 35000 Rennes - E-mail lespace-des-sciences@wanadoo.fr - http://www.espacesciences.
org - Tel. 02 99 35 28 22 - Fax 02 99 35 28 21 Antenne Finistère :L'Espace des silences, Technopôle
Brest-Iroise, 40, rue Jim Sévellec, 29200 Brest - Tél. 02 98 05 60 91 - Fax 02 98 05 15 02.
President de L'Espace des sciences -COI : Paul Tréhen. Directeur de Ia pubication : Michel Cabaret. Mainte en Bref: Hélène Tattevin.
Rédaction : JRonfmnçois Cotmot, Sandrine Le Guen, Michèle le Goff, Bernadette Ramel. Comité de lecture : Chlition %Roime (physique
chimiematérioux), Gilbert Blanchard (biotechnologies-environnement), Carole Duigou (sciences humaines), Thierry Juteau (géologieocéanographie),
géologie
océanographie), Didier Le Morvan (sciences juridiques), Phis 616m (télécammunkattonsimitenlent du signal), Michel Brandwrd (génétiquebiologie),
génétique
biologie), Thierry Puffre1 van der Kemp (biologie). Abonnements : Béatrice Tecier. Promotion : Magali Colin, Danièle Oumtolo. Publicité :
AD Media Alain Perd, tél. 02 99 67 76 61, mal infa8odmedia.6 Réseau est publié grace au soutien de lo Région Bretagne, du ministère
de l'Éduattion nationale, de la Recherdre et de la Technologie, des départements du Finistère et d'IIIeeWlaine, de lo Ville de Rennes, de la
Direction régionale des affaires cuhumlles et du Fonds sonal européen. lésion : L'Espace des sciencesüSTI. Réalisation : Penck Bectât
création graphique, 35510 Casson-Sévigné. Impression : TPI, BP 2, 35830 Belton.
de
FINISTERE
Palais
découverte
MINISTeRE DE L'RDUCATION NATIONALE, Perinar-eed
DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE
BRETAGNE
.1:11;ld
RENNES
ESEAU JANUARY 2000• N'16
AN IN-DEPTH LOOK AT
Living bones in Brittany
INTRODUCTION
Page 9
MORE THAN 10,000 VISITORS FOR
THE "LIVING BONE" EXHIBITION
The "Living Bone" exhibition being held at
the Espace des sciences in Rennes from 6th
September to 31st December 1999 is
designed first and foremost as a hands-on
event so that visitors can make new
discoveries for themselves. An in-depth
look at this topic is presented in this month's
Réseau. It highlights the research being
carried out in Brittany in the clinical
orthopaedic sector. We hope you enjoy the
articles and wish you all the very best for
this first year in the new millennium!
Information: L'Espace des sciences, fax +33 2 99 35 28 21,
hilp://www.espoce-sciences.org
GROWTH, BONE'S BEST FRIEND
page 10
Orthopaedists, the specialists who "get
children to stand and sit up straight", treat
the morphological deformities of bones
during the period of growth. Such
deformities are likely to have consequences
on motor development. Often, all that is
required is "to use growth at the right
time as a simple means of correcting
deformities", explains Professor Bracq.
Information: Service de chimrgie pédiatrique
du CHU de Rennes, fax +33 2 99 28 41 98.
BONE REPAIRS: A HOPE FOR
OSTEOPOROSIS
Page 11
Professor Gérard
Chalès, Senior
Consultant in the
rheumatology
department at
the Hôpital Sud in
Rennes, describes
the prevention
and treatment of
osteoporosis, a
t disease that renders
bones more fragile and is often the cause of
fractures in post-menopausal women.
Information: Professeur Gérard halés,
fax +33 2 99 26 71 90.
AN EXHIBITION THAT REVEALS
EVERYTHING ABOUT BONES
page 12/13
Bones and skeletons - this anatomical topic
could have been anathema to the general
public. Moreover, visitors might have feared
that the exhibition brought them face to face
with a sinister illustration of their own
certain end. Yet the 10,000 people' who
attended the exhibition in the Espace des
sciences have been enthusiastic and the
exhibition's demonstrators have done their
utmost to make the human bone structure a
living entity full of useful information rather
than a terrifying macabre skeleton.
Information: Frédéric Primault, fax +33 2 99 31 80 10.
BONE GRAFTS WORK!
page 14
Over the past 20 years, bone tissue grafts
have proved their worth and have benefited
from the remarkable advances in orthopaedic
surgery. The graft is not only effective in
certain fractures; it can also be used to treat
bone cancer. Three specialists, Professors
Frantz Langlais, Dominique Poitout and
Philippe Chiron, described the alternatives
available to medical experts during a
conference organised by the Espace des
sciences.
PROSTHESES:
A FINE UPSTANDING STORY
Page 15
"The development of technologies and
materials has been such that a young person
given a hip or knee replacement operation
today has every chance of being able to lead
a normal professional and family life, on
condition that he or she undergoes the
operation every 10 or 15 years", explain
Professors Philippe Hernigou, Frantz
Langlais and Hervé Thomazeau.
Infomlation: Frantz Langlais, fax +33 2 99 32 42 42.
PINNING DOWN BONES
page 16
On certain fractures, plaster
is not effective. Professor
Christian Lefèvre, Senior
Consultant in Orthopaedics
and Traumatology of
the Hôpital de la Cavale
Blanche in Brest, has adapted an amazing
technique to forearm fractures - the use of
pins. "To implement the technique
successfully, we use highly sophisticated
3D imaging technology developed jointly
with the Ecole nationale supérieure des
télécommunications de Bretagne (ENSI)."
Information: Professeur Christian Lefèvre,
fax +33 2 98 34 78 13.
L'Espace des sciences-CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES - E-mail: lespace-des-sciences@wanadoo.(r - Tél. +33 2 99 35 28 22 - Fax +33 2 99 35 28 21
Antenne Finistère : L'Espace des sciences-CCSTI, 40, rue Jim Sevellec, 29608 BREST Cedex - Tél. +33 2 98 05 60 91 - Fax +33 2 98 05 15 02
These abstracts in English are sent to foreign
universities that have links with Brittany and to
the Scientific Advisers in French Embassies, in
an effort to widen the availability of scientific
and technical information and promote the
research carried out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts on a
regular basis, with a copy of the corresponding
issue of "RESEAU", please contact Hélène
Tattevin, Editor, fax +33 2 99 35 28 21,
E-mail: lespace-des-sciences@wanadoofr
Brittany Regional Council is providing
financial backing for this service.
Brittany is the 7th most-populated region in France,
with 2.8 million inhabitants, but it is the leading
French region as regards research in the fields
of telecommunications, oceanography,
and agricultural engineering.
JANUARY 2000• N' 162 RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY
Abstracts for the international issue
HISTORY AND SOCIETY
SIMON SIRODOT (1825-1903)
AND THE DIG ON MONT-DOL:
A PRECURSOR OF
MODERN
ARCHAEOLOGY
page 6
Although a naturalist by
training, Simon Sirodot
was very interested
in discoveries and
discussions relating
to the new science of
prehistory and, in
particular, in the animals of the Quaternary
Era. He rose to fame through the dig carried
out on the prehistoric site on Mont-Dol (Me-
1 et-Vilaine) which uncovered the remains of
mammoths and woolly rhinoceroses. For
the time, he showed great rigour and a
decidedly innovative spirit.
Information: Nathalie Molines, fax +33 2 99 28 69 34.
EDITORIAL
HAPPY NEW YEAR 2000!
During the last fifty years, rythm of
scientific discovery has strongly increased...
Recent events have shown the possible
dangers due to technological progress, but
also the reasons to be optimistic. In order to
act with more responsibility in the future, we
should improve our share-out of scientific
knowledge and its benefits. Diffusion of
scientific culture, as through the Réseau
magazine, has to force back every kind of
obscurantism. I wish everybody a good and
happy new year 2000...
Information: Paul Tréhen, president of !'Space des sciences,
fax +33 2 99 25 28 21.
HISTORY AND SOCIETY
A CITIZENS' JURY PUTS ANIMAL
EXPERIMENTS ON TRIAL
page 3
2P
In partnership with the third "Scientific
Interviews" event in Brest, the Cité des
sciences et de l'industrie and 3B Conseils
organised "deliberations" during which
scientists were questioned by a group of
citizens who, prior to the event, had already
carried out a survey in research centres in
Brittany.
A summary of the event is available on the Internet:
http://www.sciences-museo.tm.fr/debats/index/body/corps/
synthese.htnr#
Information: Michèle Le Goff, michele.legoff@voila.fr
PORTRAIT OF RESEARCHER
DANIEL BOUJARD, FROM CELLS
TO MOLECULES
page 4
Daniel Boujard directs one of the largest
research units involving the CNRS and the
University of Rennes 1, specialising in
"Molecular and cellular interactions". Due
to begin operation on 1st January 2000 after
the re-organisation of the "Cell biology and
reproduction" unit, the
superlab employing 100
people will be exploring
the highly complex world
of the mechanisms used by
cells to adapt to changes in
their environment.
Information: Daniel Boujard, fax +33 2 99 28 67 94,
daniel.boujard@univ-rennes 1. fr
THE LIFE OF COMPANIES
ALGAE UNDER YOUR SKIN...
page 5
"Algologie" and
"Fleur de mer"
are two brands
of cosmetics
made with algae
and distributed
by Godefroy
Diffusion SARL,
a company in
Tréguier (Côtesd'Armor).
We met its Chief Executive
Officer, Alain Thibaux.
hffp://www.algologie.com
Information: Alain Thibaux, fax +33 2 96 92 91 99,
infos@algologie.com
0 L'ESPACE
DES
SCIENCES
Centre de culture scientifique technique et industrielle
ISTOIRE ET SOCIETE
Un "panel des citoyens"
pour débattre de
l'expérimentation animale
En partenariat avec les troisièmes
"Entretiens scientifiques"
de Brest, la Cité des
sciences et de l'industrie et
3B Conseils ont organisé une
"démarche délibérative", qui
consiste à faire interroger
des scientifiques par un
panel de citoyens sur un
sujet précis : l'expérimentation
animale.
Au cours de cette
démarche, le panel
de citoyens a eu la
chance de rencontrer
le professeur Peter
Doherty, Prix Nobel
de médecine 1996,
et Charles Pilet,
président de
l'Académie nationale
de médecine.
i. 'enjeu de la "démarche délibérative"
(une première en France,
selon les organisateurs !) est la
rédaction d'une synthèse consensuelle
sur un problème de société,
par des profanes, à partir d'informations
puisées auprès d'experts. Les
cinq profanes sont tous des habitants
de Brest, où se sont déroulés les
"Entretiens scientifiques" en octobre
dernier sur le thème "De l'animal à
l'homme" (voir Réseau n° 158).
Une méthode originale
Les cinq Brestois ont d'abord
effectué un travail préparatif, pour
s'informer sur l'expérimentation
animale. Ils ont ainsi visité des laboratoires,
questionné des scientifiques
et beaucoup discuté entre eux. Ce
travail de groupe leur a permis de
confronter leurs argumentations et
de définir leurs préoccupations
quant au sujet.
Geneviève, Yvonne et
Louisette échangent leurs
impressions lors de la visite de
l'Afssa, à Ploufragan (22).
Dans un second temps, les cinq
citoyens ont pu dialoguer avec un
panel d'experts, à l'occasion d'un
débat public organisé à la Cité
des sciences et de l'industrie. Les
citoyens, plus vraiment profanes,
ont alors rédigé un texte de synthèse
consensuelle, dressant un bilan et
formulant leurs interrogations.
Les résultats obtenus
"En ce qui concerne les animaux
génétiquement modifiés, les
experts interrogés ont avoué leur
incompétence et leur absence de
connaissances précises sur le
sujet", note le groupe de citoyens,
déçu de ne pas avoir obtenu de
réponses à toutes leurs questions,
tant il est vrai que les scientifiques
ont, à tort, la réputation de tout
savoir !
Autre extrait : "En ce qui
concerne l'acceptable et l'inacceptable,
il faut des limites. Celles-ci ne
peuvent provenir que de la société.
C'est la société qui tranche. C'est
donc aux citoyens de se mobiliser.
Les scientifiques réagissent selon
les contraintes données par la
société. Ils ne sont qu'un des bras
de celle-ci."En ce début de siècle où
le mot "responsabilité" fait peur, nos
chercheurs ne seront sans doute pas
malheureux de redescendre de ce
piédestal, bien inconfortable.
Autres réflexions de bon sens :
"On peut se poser la question de la
nécessité d'expérimenter sur l'animal
des régimes ne respectant pas
l'ordre naturel de la chaîne alimentaire.
Ex : la vache herbivore
ne doit pas être nourrie de farines
issues d'autres animaux."
Ou encore : "La surpopulation va
bientôt être un problème pour l'humanité.
Il nous semble que faire des
expérimentations sur les animaux
à des fins d'élevage intensif, ne
repose pas sur la réalité des besoins
humains, qui sont relativement
pauvres en protéines animales."
Un texte bien
dans ses mots
Bien ancré dans son contexte
scientifique, économique, politique,
social et culturel, le texte final
montre à la fois les convictions
propres de ses auteurs et leur évolution
au cours de la démarche, en
fonction de l'information reçue.
Chacun a pu se rendre compte qu'il
est difficile d'émettre un avis tranché
sur un sujet aussi important. Bien
que sensible au problème de la souffrance
de l'animal, le panel estime
qu'il n'est pas possible d'aniter ces
expérimentations, nécessaires à la
santé humaine, mais souligne que,
chaque fois que cela est possible, les
scientifiques doivent favoriser les
méthodes alternatives, telles que les
cultures cellulaires. • M.LG.
Louisette Abiven, Yvonne
Babin, Geneviève Couffin,
Michèle Le Goff, Jacques
Salaun.
Germaine Dorange (UBO'''),
Peter Doherty (Prix Nobel de
médecine 1996), Jacques de
Gerlache (Solvay), François
Lachapelle (Inserm), Jean-Paul
Laplace (Inra°'), Henri Maurin-
Blanchet (Inserm01), Claude
Milhaud (Académie vétérinaire
de France, Gircor), Dominique
Parent-Massin (UBO), André-
Laurent Parodi (École vétérinaire
de Maisons-Alfort,
Académie nationale de médecine),
Charles Pilet (président
de l'Académie nationale de
médecine).
Ifremerw Brest, Unité de culture
cellulaire de l'UBO, Afssa"' de
Ploufragan.
UBO : Université de Bretagne occidentale.
Inra : Institut national de recherche agronomique.
Inserm : Institut national de la santé et de la
recherche médicale. Ifremer : Institut français pour
la recherche et l'exploitation des mers. Afssa :
Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Contacts •
Jean-Paul Natali : natali@cite-sciences.fr,
Magali Galant : m.galant@cite-sciences.fr
Le texte : http://www.sciences-museo.tm.fr/debars/index/body/corps/synthese.htrn#
Compte rendu des Entretiens scientifiques : http://science-ethique.enst-bretagne.fr
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Les équipes constituant l'unité
"Interactions cellulaires et moléculaires"
Daniel Boujard, directeur.
1. Endocrinologie moléculaire de la reproduction. Olivier Kali, directeur
de recherche au CNRS.
2. Information et programmation cellulaire. Denis Michel, professeur.
3. Canaux et récepteurs membranaires. Daniel Thomas, directeur de
recherche.
4. Interactions entre molécules amphiphiles dans les biomembranes.
Henri Wroblewski, professeur.
5. Osmoadaptation chez les bactéries. Carlos Blanco, professeur.
6. Osmoadaptation et métabolisme de stress. Alain Bouchereau, maître
de conférences.
Daniel Boujard,
161. 02 99 28 61 31,
e-mail daniel.boulard©univ-rennesl.fr
QUI A DIT ?
" Le meilleur médecin est la nature :
elle guérit les trois quarts
des maladies et ne dit jamais.
de mal de ses confrères."
Réponse page 22
Contact 111.
PORTRAIT DE CHERCHEUR
Daniel Boujard
Comment interagissent
molécules et cellules
C'est autour de cette problématique
qu'est en train
de cristalliser l'une des
plus importantes unités de
recherche associant le CNRS
et l'université Rennes 1. Né le
1- janvier 2000 de la réorganisation
de l'unité "Biologie
cellulaire et reproduction"),
ce superlabo de 100 personnes
s'appelle "Interactions
cellulaires et moléculaires".
Piloté par Daniel Boujard, il
explore l'univers très complexe
des mécanismes utilisés
par les cellules pour s'adapter
aux modifications de leur
environnement.
tt La même molécule (une hormone,
par exemple) peut avoir
des effets très différents en fonction
de sa localisation dans l'organisme.
Nous étudions comment
une molécule peut interagir avec
son environnement cellulaire",
explique Daniel Boujard. Pour cerner
ces mécanismes, il mise sur
la diversité des compétences présentes,
soit près de 100 personnes
(dont 70 chercheurs) réparties en
6 équipes : "La diversité de ces
équipes est suffisante pour que
tous les angles d'étude puissent
être explorés simultanément."
Plusieurs rôles pour
un même acteur
Certaines molécules jouent un
rôle primordial dans la différenciation")
cellulaire. "Elles sont apparues
en même temps que la
pluricellularité, et ont peu évolué
depuis", indique Daniel Boujard.
"Elles varient très peu d'une
espèce à l'autre, et sont présentes
dans tout le monde vivant."
Ces molécules seraient donc des
éléments clés dans les processus
qui permettent, à partir de la cellule
oeuf, de donner l'ensemble des tissus
caractéristiques de l'organisme
adulte. Mais leur étude a apporté de
drôles de surprises : dans certaines
ORÉSEAU 162 • JANVIER 2000
A "Grâce au regroupement de
nos six équipes de recherche, nous
pouvons explorer simultanément
tous les angles d'étude'; explique
Daniel Boujard, directeur de
l'unité "Interactions cellulaires et
moléculaires".
4 Les aquaporines sont des
protéines membranaires qui
permettent le passage rapide et
sélectif de l'eau au travers de la
membrane plasmique de certaines
cellules (échelle :1 nm (nanomètre)
= 10-9 mètre = un millionième de
millimètre).
cules au sein d'une cellule. "Autrefois,
la cellule était considérée
comme un sac plein d'objets.
Aujourd'hui, c'est un organisme à
part entière constitué de plusieurs
compartiments qui sont tous impliqués
dans les nombreux échanges
entre la cellule et son environnement"
À cette échelle, les outils du
biologiste s'avèrent parfois insuffisants
: empruntées à la physique, les
techniques employées relèvent des
nanotechnologiest". Pour les biologistes
et les physiciens, situés côte à
côte sur le campus de Beaulieu, c'est
un nouveau défi à relever ensemble :
appelée "biophysique", cette nouvelle
discipline touche de très près à
la compréhension des mécanismes
primordiaux de la vie. n H.T.
°i Unité propre de recherche de l'enseignement supérieur
associée au CNRS (UPRES A 6026). °' Dif jérenciation
: à partir de cellules embryonnaires semblables,
les cellules de l'organisme pluricellulaire deviennent
différentes et se spécialisent : cellules sanguines, cellules
nerveuses, cellules osseuses... °' Nanotechnologies
: manipulations d'éléments de taille nanométrique
(10-9 mètre= un millionième de millimètre).
conditions, ces mêmes molécules
abandonnent leur mission de "différenciation"
pour participer activement
à la prolifération cellulaire.
C'est le cas lors de certaines étapes
du développement embryonnaire,
mais aussi lors du développement
de tumeurs cancéreuses.
Plusieurs voies pour
un même effet
La même complexité se retrouve
du côté de la génétique, autre axe de
recherche : "Même lorsque la fonction
d'un gène est formellement
identifiée, on se rend compte qu'en
inactivant ce gène, dans une souris
par exemple, lafonction est conservée
en partie, car d'autres gènes
prennent le relais en son absence
pour accomplir «à peu près» la
même fonction."
C'est cet "à peu près", pas très
scientifique, qui montre la cornplexité
de ces cascades d'actions et
d'interactions : une même molécule
peut interagir avec plusieurs autres,
provoquant des cascades de réactions
extrêmement complexes,
impliquant des centaines de molécules
différentes. C'est le modèle du
domino, qui en tombant provoque la
chute de tous les dominos placés
derrière lui.
Aux frontières
de la physique
De plus en plus, les biologistes se
rendent compte que la spécificité des
molécules n'est pas seulement liée à
leur séquence, mais aussi à leurs différentes
formes : une même molécule
peut être active sous une forme
et inactive sous une autre. Les biologistes
frappent régulièrement à la
porte des physiciens, pour élucider
des problèmes de structure de molécules
ou de déplacement de moléRéseau
: Pourriez-vous nous
présenter votre entreprise ?
Main Thibaux : En fait, il y a deux
entreprises distinctes. D'une part, le
Laboratoire d'Armor (NDLR : à
Pleubian, 12 salariés) qui façonne,
prépare et conditionne les produits,
que ce soit pour nous ou pour toute
autre entreprise qui le souhaite.
Ensuite, il y a Godefroy Diffusion
(NDLR : 7 salariés, CA environ
4,5 MF dont 90% à l'exportation)
qui diffuse les gammes "Algologie"
et "Fleur de mer", des produits cosmétiques
vendus essentiellement
aux professionnels des instituts de
beauté.
Réseau : Quelles sont les algues
que vous utilisez ?
A.T. : Il n'y en a pas tant que cela...
Nous dépendons en effet de trois
paramètres incontournables : il faut
que l'algue soit fréquente et répandue,
afin de ne pas détruire l'environnement
ou une espèce ; il faut
que l'algue soit disponible à la
collecté et, enfin il faut qu'elle
contienne un principe actif ou une
propriété intéressante. Du coup,
nous n'en utilisons qu'une douzaine
environ (cf. encadré).
Des algues dans la peau
"Algologie" et
"Fleur de mer"...
sont deux marques
de produits
cosmétiques fabriqués à partir
d'algues, et diffusés par la
société Godefroy Diffusion
SARL, de Tréguier, dans les
Côtes d'Armor. Rencontre
avec son PDG, Alain Thibaux.
.G
Fleur
de
Mer
1\.r\ 0=7--:
Parmi les algues utilisées,
les laminaires sont récoltées par
bateau au large de Pleubian,
grâce à un outil, le scoubidou,
qui s'enroule autour des grandes
algues et les arrache du fond.
Les produits "Algologie" et
"Fleur de mer" ne sont utilisés
qu'en institut de beauté.
Réseau : Quels sont les principes
actifs que vous recherchez dans
ces algues ?
A.T. : Les algues ont plusieurs
constituants d'intérêt économique :
des colorants, des alginates (gélifiants),
de l'iode, des minéraux, des
oligo-éléments et des vitamines. Les
principes actifs recherchés pour la
cosmétique se répartissent en trois
familles : les polyphénoles et les
flavonoïdes qui sont des antiradicalaires
(antirides) et les polysaccharides,
aux propriétés hydratantes.
Réseau : Qu'est-ce qui vous
permet de dire que tel ou tel
produit est réellement actif ?
A.T. : Il y a plusieurs réponses...
Tout d'abord, nous ne vendons
pratiquement qu'à des instituts de
beauté. Si nous n'avions pas de
résultats ou d'efficacité, la sanction
des professionnels serait immédiate !
Ensuite, nous avons des données
scientifiques cliniques, parfaitement
connues. Nous savons, par exemple,
que le collagène des cellules de la
peau a tendance à se rigidifier progressivement
avec l'âge. C'est un
processus inévitable, qui est dû,
pour une part, à une oxydation. Or,
les polyphénoles et les flavonoïdes
1. sont des antioxydants... Ils sont donc
capables, non pas d'arrêter le processus,
mais de le ralentir.
Réseau : Vous êtes à la marge de
la pharmacie ?
A.T. : Oui... et non. En cosmétique,
on n'a pas le droit de modifier la cellule,
et nous n'avons pas le droit
d'utiliser les mêmes molécules
que celles utilisées en pharmacie.
Mais, en même temps, nous savons
que certains produits sont actifs...
Nombre de gens se sont ainsi rendu
compte que l'un de nos produits est
un accélérateur de cicatrisation et un
calmant efficace pour les petites
brûlures... Ça, c'est un fait. Mais
nous ne pouvons pas l'utiliser dans
notre communication.
Réseau : Nombre de scientifiques
contestent l'efficacité des
cosmétiques...
A.T. : En plus des faits que je viens
de citer, il faut rappeler que les cosmétiques,
c'est aussi et surtout de
la psychologie ! Se "faire" belle, se
"sentir" belle, s'occuper de soi... ce
sont de très importants facteurs
d'équilibre et de bonne santé. Quant
aux principes actifs énoncés plus
haut... Personne ne conteste le
pouvoir apaisant d'une infusion
de tilleul, excitant d'un thé... Les
algues, les plantes... ont les mêmes
capacités. Après, c'est une question
de dosages, d'études...
Réseau : Avec quels scientifiques
travaillez-vous ?
A.T. : Toute la recherche est soustraitée,
sous le contrôle de notre
ingénieur, Sandrine Cagnet. Notre
principal partenaire est le Centre
d'études et de valorisation des
algues (Ceva) de Pleubian. Il y a
également plusieurs écoles : le DUDESS
"Algologie et cosmétologie"
Au Laboratoire
d'Armor à Pleubian, les
techniciens travaillent avec vue
sur mer : ici un mélangeur sous
vide, pour produire les crèmes
de soin (émulsions) à base
d'algues des marques
"Algologie" et "Fleur de mer".
de Nantes, l'Institut supérieur des
industries du parfum, de la cosmétique
et des arômes (Isipca) de
Versailles, plusieurs facultés de
pharmacie... Enfin, il y a tous les
organismes accrédités, qui ont la
charge de délivrer les autorisations
de mise sur le marché. Tous les produits
sont en effet testés sur des
volontaires, afin de s'assurer qu'il
n'y a pas de problèmes d'irritation,
par exemple. Ces tests sont faits
avec des patchs sur 24 ou 48 h.
Réseau : Quels sont vos projets ?
A.T. : Chaque année, nous développons
une nouvelle ligne de produits.
La dernière était destinée aux peaux
sensibles. Ensuite, nous travaillons
sur le développement de trois nouvelles
molécules en collaboration
avec le Ceva : deux principes actifs
algaux et une technique d'encapsulation.
Enfin, nous continuons notre
veille technologique... n
J.F.C.
Les algues utilisées
Fucus : vesiculus et serratus
Laminaria : digitata, hyperborea,
saccharina • Palmaria palmata
Ulva lactuca • Enteromorpha
compressa n Codium • Chondrus
crispus • Ascophyllum nodosum
Delesseria sanguinea.
Alain Thibaux,
tél. 02 96 92 91 90,
e-mail infos@algologie.com
http://www.algologie.com
~
Contact ►
I1111 e Cette page est réalisée en collaboration aver la technopole Anticipa Lannion-Trégor, tél 02 96 05 82 50, hflp.//www.tedmopole-antidpa.com
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
"Les mammouths du Mont-Dol",
d'après les fouilles de Simon
Sirodot et de l'abbé Hamard,
est une oeuvre réalisée par
Mathurin Méheut pour
l'Institut de géologie de Rennes
entre 1942 et 1946.
Simon Sirodot est le plus atypique des archéologues bretons
du 19e siècle. Naturaliste de formation, il s'illustra dans la
fouille du gisement préhistorique du Mont-Dol (111e-et-Vilaine)
et fit preuve pour l'époque d'une grande rigueur et d'un
esprit novateur. Ses travaux n'échappèrent cependant pas à
la polémique sur "l'antiquité de l'Homme", thème récurrent
au 19e siècle et qui, malgré la naissance des sciences préhistoriques
et la reconnaissance en 1860 de l'homme
quaternaire, restera encore longtemps vivace.
RR
Contrairement à la
plupart des archéologues
du siècle
dernier, Simon
Sirodot (né en
1825 à Longeau,
Haute-
Marne), ne
fait pas partie
r de ceux que
V. Audren de Kerdrel qualifiait
d"`hommes de riches loisirs", gens
lettrés et aisés, n'exerçant pas leur
profession et pour qui l'archéologie
constituait un agréable passe-temps.
Simon Sirodot, d'abord professeur
de lycée, occupa par la suite la
chaire de Zoologie et de botanique
de la faculté des sciences de Rennes
de 1860 à 1878, puis la chaire de
Zoologie jusqu'à sa retraite en 1894.
Son ouvrage sur les algues Batrachospemies
publié en 1884 fit référence.
Il occupa également de 1869
à 1894 la fonction de doyen de la
faculté des sciences.
La fouille du site
du Mont-Dol
Par sa formation, Simon Sirodot
devait très certainement être au fait
des découvertes et des débats liés à
la préhistoire naissante et, en parti-
ORÉSEAU 162 • JANVIER 2000
culier, des travaux sur la faune quaternaire.
Sa curiosité dut donc être
éveillée lorsqu'il apprit en 1872, par
son préparateur J. Gallée, que depuis
quelques années, des ossements
étaient découverts dans une tranchée
de carrière au Mont-Dol. Le Mont-
Dol est un ancien îlot granitique de
la baie du Mont-Saint-Michel, qui
suite à des variations du niveau de
la mer, est actuellement isolé dans
les marais. Son sommet culmine à
65 mètres au-dessus du niveau
actuel de la mer. Simon Sirodot
fouilla au Mont-Dol du 12 juin au
30 septembre 1872 et dans le courant
de l'année suivante. La fouille
se traduisit par un décapage intensif
et le creusement de quatre excavations
profondes. Ceci devait lui
permettre d'établir des profils stratigraphiques.
Il s'agit ici d'une attitude
exceptionnelle pour l'époque,
où l'on se contentait généralement
de récolter les plus beaux objets sans
tenir compte du contexte dans lequel
ils se trouvaient. L'autre innovation
notable fut de lever les plans, coupes
et profils au niveau et à la chaîne, ce
qui nous donne des documents
d'une grande précision.
Outre des données stratigraphiques,
les fouilles lui fournirent
une quantité impressionnante d'ossements
et de nombreux silex taillés,
qu'il rattacha sans erreur au "type du
MoustierP7". Il put déterminer les
ossements grâce aux collections
conservées au musée de Rennes et
reconnut qu'ils appartenaient à
"l'époque du mammouth".
La polémique
1872 est également l'année où
le site préhistorique du Bois-du-
Rocher (Côtes-d'Armor) est présenté
par E. Former et V. Micault
lors du congrès scientifique de
France qui se tint à Saint-Brieuc,
communication particulièrement
remarquée où l'on y trouve mention
des travaux réalisés au Mont-Dol.
Par la suite, E. Fomier et V. Micault,
tous deux magistrats, invitèrent
Simon Sirodot à présenter devant
la Société d'émulation des Côtesdu-
Nord une conférence sur le site
du Mont-Dol. Celle-ci eut lieu le 17
mai 1873 et sa publication déclencha
une vive polémique sur "l'antiquité
de l'Homme" en Bretagne.
L'abbé P. Hamard se distingua par la
parution de deux pamphlets en 1877
et 1880, visant la chronologie établie
au Mont-Dol.
Un précurseur de
l'archéologie moderne
Simon Sirodot ne pratiqua pas
d'autres fouilles en Bretagne. A sa
mort en 1903, ses collections furent
léguées à la galerie de Paléontologie
du Muséum d'histoire naturelle et à
la faculté des sciences de Rennes.
Même si les travaux désordonnés
qui suivirent ceux de Simon Sirodot
au Mont-Dol achevèrent de détruire
ce qui restait du site, c'est grâce à
ces collections et aux comptes rendus
minutieux de Simon Sirodot que
l'étude du site a pu être reprise en
1995. Par sa grande rigueur et ses
nombreuses innovations, Simon
Sirodot apparaît comme un des précurseurs
de la recherche archéologique
moderne. n
Nathalie Molines
Bibliographie
Jean-Laurent Monnier et al.
Baie du Mont-Saint-Michel
et marais de Dol, centre
archéologique d'Alet, 1995, 3-26.
Simon Sirodot.
Conférence faite le 17 mai 1873
à la Société d'émulation des
Côtes-du-Nord sur les fouilles
exécutées au Mont-Dol
(Ille-et-Vilaine) en 1872,
éditeur Francisque Guyon, 49 p.
L'abbé Hamard.
Le gisement préhistorique
du Mont-Dol (Ille-et-Vilaine)
et les conséquences de cette
découverte au point de vue
de l'ancienneté de l'Homme
et de l'Histoire,
éditeur Plihon, 1877, 270 p.
L'abbé Hamard.
Études critiques d'archéologie
préhistorique à propos du
gisement du Mont-Dol
(I11e-et-Vilaine),
éditeur Haton, 1880, 270 p.
"' Le Moustérien est un facies culturel du paléolithique
moyen.
Nathalie Malines,
tél. 02 99 28 61 09, UMR 6566 CNRS,
Laboratoire d'anthropologie,
université Rennes 1.
Contact ►
Mortalité prématurée hommes
Mortalité prématurée femmes
Cardiopathies hommes
Cardiopathies femmes
Maladies cérébrovasculaires hommes
Maladies cérébrovasculaires femmes
Tumeurs hommes
Tumeurs femmes
Suicides hommes
Suicides femmes
+14%
-3%
Moyenne nationale
Appel à propositions pour des actions :
"Environnement et développement durable"
Référence : EESD-ENV-99-2.Call, I999/C 330/10.
Durée : Période 1999-2002.
Montant : À titre indicatif, le budget s'élèvera à 233 millions d'euros.
Objectif : Établir la base scientifique, technologique et socio-économique sur
les changements planétaires et climatiques.
Domaines ciblés de recherche :
Gestion durable et qualité de l'eau : gestion intégrée et utilisation durable des
ressources hydriques à l'échelle des bassins, technologies de traitement et de
purification, systèmes de surveillance, d'alerte rapide et de communication,
régulation des stocks et technologies pour régions arides et semi-arides.
Changements planétaires, climat et biodiversité : compréhension, détection,
évaluation et prédiction des processus de changements planétaires, encouragement
d'une meilleure compréhension des écosystèmes terrestres et marins et de
leurs interactions, scénarios et stratégies pour répondre aux problèmes mondiaux.
Écosystèmes marins durables : amélioration des connaissances sur les interactions,
les processus et les écosystèmes marins, réduction de l'incidence
anthropique sur la biodiversité et le fonctionnement durable des écosystèmes
marins, et encouragement du développement de technologies d'exploitation
sûres, économiques et durables, surveillance et gestion des processus côtiers et
de la zone côtière.
Ville de demain et patrimoine culturel : Aménagement durable des villes et
gestion rationnelle des ressources, protection, préservation et amélioration du
patrimoine culturel européen, développement et démonstration de technologies
pour la préservation, la réhabilitation, la rénovation, la construction, le démantèlement
et la démolition, en particulier pour les grands complexes immobiliers,
évaluation comparative et mise en oeuvre rentable de stratégies pour des systèmes
de transport.
Participants : Il s'agit de promouvoir la coopération entre centres de
recherche, laboratoires et universités, organismes et chercheurs des pays tiers et
de l'Union européenne.
Date limite de soumission : 15 février 2000.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter
Ivan Libert au 02 99 25 41 57 ou par e-mail : eic@bretagne.cci.fr A INFO CENTRE
FRM Fondation pour la recherche
médicale
Statut juridique : L'association pour la recherche médicale dont est issue la
fondation a été créée en 1947, par les professeurs Jean Bernard et Jean Hamburger.
En 1962, le docteur Claudine Escoffier-Lambiotte, responsable de la
rubrique santé du quotidien "le Monde", l'a transformée en fondation à l'occasion
d'un appel à l'aide privée, signé par 132 des plus célèbres chercheurs français,
dont les Prix Nobel Jean Dosset et François Jacob. La fondation a été
reconnue d'utilité publique par décret du 14 mai 1965.
Structure : Président : Pierre Joly • Directeur général : Claire Dadou-
Willmann.
Budget : 157 114 millions de francs en 1998.
Objectif : Son rôle est de faire appel à la générosité du public pour apporter à
la recherche médicale, dans toutes ses disciplines, les financements indispensables,
souples et rapides. La fondation a pour but de promouvoir la recherche
sur les sciences de la vie et de la santé se rapportant directement et indirectement
aux progrès de la médecine. L'aide à la recherche intervient autour de trois
grands axes principaux : aide aux jeunes chercheurs, en France et à l'étranger,
aide à l'implantation de nouvelles équipes, aide aux laboratoires sous forme de
subventions. Les attributions d'aides aux activités de recherche médicale en
France sont décidées par le conseil scientifique de la fondation, dont la principale
préoccupation est que ces décisions soient fondées sur des dossiers solides.
Référence : C'est la seule fondation qui se préoccupe, au nom des donateurs,
d'examiner toutes les demandes, dans tous les domaines de la recherche médicale,
et de prendre en compte les besoins de la médecine dans son ensemble.
Édition : La fondation édite une revue trimestrielle, "Recherche & Santé",
abonnement : 60 F/an.
Site Internet : http://www.frm.org
Contact : Comité d'action régional, professeur Jean Guenel, 28, bd Langevin,
44100 Nantes, tél. 02 40 73 42 51.
Adresse : 54, rue de Varennes, 75335 Paris Cedex 07, tél. 01 44 35 75 75,
fax 01 44 39 75 99.
RÉSEAU JANVIER 2000 - N`162
DRASS Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales
Statut juridique : Service déconcentré du ministère de l'Emploi et de la
Solidarité, créé en 1977 grâce à une fusion des Directions régionales de
sécurité sociale (DRSS) avec les services régionaux d'action sanitaire.
Structure : Directeur : Élie Gueguen.
Effectif : 159 personnes.
Budget (1998) : 83 millions de francs, dont 9 millions de fonctionnement.
Objectifs : • La lutte contre les exclusions • Le développement des
actions de santé publique • L'évolution de la gestion de la protection sociale
La rénovation du dispositif d'allocation de ressources aux services déconcentrés
• L'inspection, le contrôle, l'évaluation • La politique d'offre de
soins hospitaliers • La mobilisation des ressources.
Ces thèmes sont évoqués notamment dans le cadre de l'élaboration des
schémas d'organisation collective qui ont offert, en 1999, l'opportunité
d'une analyse stratégique interministérielle dans laquelle la Drass est résolument
impliquée.
Missions : Placée sous l'autorité du préfet de Région, la Drass assure la
mise en oeuvre des politiques nationales, l'animation et la définition des
actions régionales et départementales en matière médico-sociale et sociale.
Elle constitue le pôle essentiel d'action de l'État en mettant en place autour
des services de véritables moyens de coordination et d'animation des politiques
publiques. De plus, la Drass apporte son concours à l'agence régionale
d'hospitalisation et est le partenaire privilégié des collectivités locales.
des responsables sociaux et des mouvements associatifs, lorsqu'ils participent
à l'élaboration des politiques locales de santé publique, d'action
sociale et d'insertion.
Adresse : 20, rue d'Isly, 35042 Rennes Cedex, tél. 02 99 35 29 00,
fax 02 99 30 59 03.
RÉSEAU JANVIER 2000 - N°162
Les chiffres du mois
Mortalité en Bretagne :
écarts par rapport
à la moyenne nationale
Les maladies du coeur (surtout chez les femmes) et de l'appareil
circulatoire (surtout chez les hommes), ainsi que les tumeurs, occasionnent
une surmortalité importante en Bretagne, par rapport à la
moyenne nationale. La surmortalité bretonne est surtout très forte en
ce qui concerne les suicides (autour de 900 par an), dont les causes
sont difficiles à détemvner. Ces constats justifient les priorités à donner
à l'organisation régionale des services de soins, des services
médico-sociaux et des actions de prévention.
Source : Étude de mortalité en Bretagne 1991-1995, août 1998,
Observatoire régional de santé (ORS) de Bretagne.
Contact ► Odile Picquet, tél. 02 99 33 98 94.
RÉSEAU JANVIER 2000 - N°162 RÉSEAU JANVIER 2000 - N°162
LES SIGLES DU MOIS
o
011
•
•
•
.
.
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
L'ESPACE
DES
SCIENCES
Ex.osition du 10 anvier au 8 avril 2000
..3 MOUVEMENTS
L'Espace des sciences
Centre Colombia - Rennes
DOSSIER
1 f,4
Dossier réalisé sous la
coordination scientifique
de Frantz Langlais
(CHU Rennes).
9 000 visiteurs/
à l'exposition, ~~ _ ~• . 2200 person nes~
v}
.
aux conf< ~rencés- ~. :~~
L'exposition "L'os vivant"
t
aété coprpduite par l'Espace
Iles sciences en partenariat
avec la Fondation pour la
yecherche médicale et le
balais de la découverte.
OP FONDATION POUR
p~A LA RECHERCHE MÉDICALE
FMI DECoume vaut cut.e
L'ESPACE
DES
SCIENCES
lors que l'on pensait qu'il serait difficile de toucher un très
large public en prenant l'os pour thème de cette fin d'année,
t il s'avère que la participation du public se situe bien au-delà de
nos prévisions.
L'exposition "L'os vivant" a privilégié la participation active des
visiteurs afin de les rendre eux-mêmes partie prenante de leurs
découvertes. Nous avons souhaité privilégier les questions scientifiques
actuelles sur le tissu osseux qui est caractérisé par un processus continuel
de résorption et de reconstitution. Notre squelette est en perpétuel
remaniement, mais les perturbations de cet équilibre dynamique sont
nombreuses : fractures, maladies, vieillissement. L'os est un matériau
vivant aux performances mécaniques et biologiques exceptionnelles, il
est par exemple au moins aussi résistant que le béton et le granit.
Après Rennes, cette exposition itinérante, qui est une première en
France, sera présentée à Laval, Paris, Vannes puis Nantes. En plus des
animations présentées durant l'exposition, nous avons organisé une
série de sept conférences scientifiques avec la participation de 17 des
meilleurs spécialistes français sur les grands sujets d'actualité : imagerie
médicale, ostéoporose, prothèses, greffes, développement et déclin de
l'os, le mal de dos...
Le dossier spécial "L'os vivant", présenté ce mois-ci dans Réseau,
met en valeur les travaux de recherche clinique orthopédique,
ainsi que les études sur la croissance ou sur l'ostéoporose. La Bretagne
dispose d'excellentes équipes qu'il était opportun de présenter à nos
lecteurs.
Le défi de modifier la représentation que se fait le grand public
de l'os, à savoir un matériau inerte, symbole de la mort, est levé.
L'exposition et les conférences auront eu par ailleurs le mérite de
présenter, en direct au public, une recherche particulièrement vivante.
Le succès de cette action de diffusion de la culture scientifique sur un
thème de santé démontre une nouvelle fois que nos visiteurs, aussi
bien que nos lecteurs et auditeurs, prennent plaisir en participant à
nos animations, à écouter, comprendre, lire et à s'émerveiller en
dialoguant avec les médiateurs scientifiques et les chercheurs. Cela
constitue un encouragement pour la tâche que nous avons à accomplir.
Au moment du passage à l'an 2000, souhaitons qu'un public de
plus en plus large accède à la culture scientifique. C'est avec cette
orientation que l'Espace des sciences entre dans le troisième millénaire.
Bonne année et bonne santé !
découverte, Christelle # "Matthieu"
(le squelette), animateurs de
l'exposition "L'os vivant" à
l'Espace des sciences, sônt en
pleine explication gestuelle :
r à quoi sert notre squelette ?
"À vivre !", répondent les
enfants du CE1 de l'école
Villeneuve de Rennes.
Michel Cabaret, directeur de l'Espace des sciences
La croissance,
meilleure alliée de l'os
A Les professeurs Henri Bracq et Pierre Rochcongar, respectivement
chef du service de chirugie pédiatrique et chef du service médecine du
sport au CHU de Rennes, aux côtés du professeur Olivier Sabouraud,
neurologue et animateur de la conférence.
Chacun dans leur spécialité, au CHU de Rennes, les professeurs
Henri Bracq, chef du service de chirurgie orthopédique et infantile,
et Pierre Rochcongar, chef du service de médecine du sport,
"se servent de la faculté de l'os, tissu vivant, à se reconstruire et
ils intègrent la notion de temps dans le traitement des pathologies."
C'est ce que soulignait le professeur Olivier Sabouraud,
neurologue et animateur de la conférence qu'organisait
l'Espace des sciences le 30 novembre dernier. Regardons de plus
près l'exemple de la chirurgie orthopédique chez l'enfant.
Utiliser la croissance
Concrètement, le travail de l'orthopédiste,
celui "qui remet les
enfants droit", consiste à traiter les
déformations morphologiques des
os en pleine croissance ; celles-ci
sont en effet susceptibles d'avoir des
conséquences négatives pour la
motricité. Bien souvent, il suffit
"d'utiliser la croissance au bon
moment et de façon simple pour
corriger les déformations" , poursuit
le professeur Bracq. "Dans la
mesure du possible, on utilise le
temps et on évite d'avoir recours
à des interventions chirurgicales
qui nécessiteraient des sections
osseuses." Un exemple : le "genu
varum", relativement fréquent chez
les enfants de 1 à 3 ans, est une
déformation des membres inférieurs
qui se traduit par des jambes arquées.
Dans la majorité des cas, la croissance
corrigera naturellement ce
défaut, même s'il faut parfois avoir
recours à la chirurgie.
Fractures et
"malformations vraies"
"Chez l'enfant, l'os n'est pas
plus fragile que chez l'adulte, mais
son activité physique souvent
«désordonnée» entraîne un nombre
plus important de fractures", souligne
le professeur Bracq. Là
encore, il faut prendre en compte
l'action correctrice de la croissance.
Chez les enfants, on se contente
fréquemment de plâtrer, alors
qu'on opère les adultes avec une
plaque ou un clou. Il reste cependant
nécessaire de corriger parfaitement
certaines fractures chez
l'enfant (fracture du coude, fracture
articulaire...) avec broche ou vis,
mais celles-ci ne doivent pas traverser
les zones de croissances de l'os,
sous peine de générer un défaut
ultérieur.
Les "malformations vraies"
nécessitent quant à elles un traitement
plus lourd : ce sont des anomalies
présentes dès le stade de
l'embryon, comme le fait d'avoir
un membre plus court que l'autre.
Si la différence de taille entre deux
membres inférieurs peut sembler
minime chez le nourrisson, il faut
savoir que l'écart augmentera de
façon proportionnelle. Un écart de
5 cm à l'âge adulte pourrait s'avérer
très pénalisant. Il y a une solution :
le chirurgien peut faire gagner
quelques centimètres au membre le
plus court, en sectionnant l'os puis
en posant un fixateur externe qui
permet d'écarter les deux extrémités.
Le tissu osseux grandit alors
sans défaut au niveau de la section.
La "malformation
luxante de la hanche"
La luxation"' congénitale de la
hanche est connue comme un phénomène
spécifiquement breton, lié
à la consanguinité importante des
générations précédentes, mais aussi
à de mauvaises habitudes de positionnement
de l'enfant. Pour la
prévenir, il n'est cette fois pas question
de laisser agir la nature et la
croissance. Outre les causes génétiques,
cette pathologie résulte de
contraintes mécaniques qui, dans
l'utérus, tendent à forcer la tête
fémorale hors de son "chapeau", le
cotyle. Sur l'échographie du nourrisson,
la malformation se traduit
par un décalage entre la tête fémorale
et l'aile iliaque. Il faut impérativement
que ce défaut soit prévenu
très tôt. Si le diagnostic est précoce
(avant 4 mois) le traitement est
simple, à domicile. Sinon le traitement
devient très lourd : par
exemple, à 6 mois, le bébé doit être
hospitalisé puis plâtré, et enfin
opéré vers 2 ans, opération chirurgicale
qui nécessite une section du
bassin. Encore une fois, la croissance
de l'articulation remise en
bonne position corrigera alors le
défaut en 2 à 6 mois. n B.R.
"' Luxation : déplacement permanent de deux
surfaces articulaires qui ont perdu complètement
leur rapport.
Service de chirurgie pédiatrique
du CHU de Rennes.
A En haut : un fixateur externe
est posé sur le membre trop court,
dont le fémur a été sectionné.
En bas : l'os a pu grandir au
niveau de la section et l'opération
a permis de gagner 5 cm.
Contact ►
0 RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
L'ostéoporose
se caractérise
non seulement par
une baisse de la masse
osseuse, mais aussi par une
modification de l'architecture
de l'os : plaques (horizontales)
plus petites, moins nombreuses,
il avec des trous... et piliers (verticaux)
amincis. La perte osseuse est un
processus normal du vieillissement,
mais elle peut être aggravée par une
carence en hormones sexuelles, un
manque d'exercice physique, un régime
alimentaire pauvre en calcium,
en vitamine D et en protéines...
Évolution de la masse osseuse avec l'âge
masse osseuse
maximale
accélération
postménopausique
z HOMME
"seuil fracturaire" théorique
o ~
masse osseuse
FEMME
20 40 60 80 âge
~~
La courbe de la masse osseuse montre un maximum vers 20 ans, suivi
d'une lente décrue régulière (homme et femme) d'environ 0,5% par an,
puis d'une chute nettement plus rapide (de 1 à 10 % par an) dans les
années suivant la ménopause pour les femmes sujettes à l'ostéoporose
et ne suivant aucun traitement.
Les espoirs pour
l'ostéoporose
Chef du service de rhumatologie de l'hôpital Sud à Rennes, le
professeur Gérard Chalès nous livre un état des lieux de la prévention
et des traitements de l'ostéoporose, cette maladie
osseuse fragilisante souvent responsable de fractures chez les
femmes après la ménopause.
L'ostéoporose se traduit non seulement
par une diminution de la
masse osseuse, mais aussi par des
anomalies de la micro-architecture
des os. La forme la plus courante de
cette maladie est celle liée à la
ménopauses". "Sur 10 femmes
âgées de 50 ans aujourd'hui,
quatre d'entre elles auront une
fracture dans les 32 années leur
restant à vivre." Fracture du
poignet, de vertèbres, du col du
fémur... Avec le vieillissement de
la population et la diminution de
l'activité physique, les fractures
dues à l'ostéoporose seront de plus
en plus nombreuses. Alors que
faire, docteur ?
A Une alimentation riche en
calcium est essentielle tout au
long de la vie, car il est faux de
dire qu'à partir d'un certain âge,
le calcium n'est plus fixé par le
squelette.
Avant 50 ans :
la prévention
L'ostéoporose primitive féminine
est principalement liée à un déficit
en hormones (oestrogènes), déficit
se produisant naturellement à partir
de la ménopause, mais de manière
très irrégulière d'une femme à
l'autre (voir schéma). Les facteurs
intervenant sont pour 60 à 70 %
d'origine génétique, ce qui exclut
toute action, mais la femme peut
agir sur les 30 à 40 % de perte
osseuse liée à son hygiène de vie.
Cela consiste d'abord à mieux s'alimenter,
pour apporter à l'organisme
du calcium et de la vitamine D en
quantité suffisante. Car contrairement
aux idées reçues, la construction
du squelette se poursuit à tout
âge, même si les cellules de destruction
(ostéoclastes) prennent peu à
peu le pas sur les cellules de
construction (ostéoblastes). Les personnes
âgées sujettes à l'ostéoporose
auront parfois intérêt à
supplémenter leur alimentation par
des comprimés de calcium et de
vitamine D, car avec l'âge, le système
digestif perd en partie sa capacité
à assimiler le calcium présent
dans les aliments.
L'autre règle de vie concerne la
pratique d'une activité physique
régulière, à tout âge : ce n'est pas à
60 ans que l'on doit commencer à
pratiquer un sport, mais une heure
de marche quotidienne peut suffire,
si elle est régulière. Enfui, sachez
que si les femmes dotées d'un excès
de poids sont moins affectées par
l'ostéoporose, c'est parce que leurs
rétablissent la masse osseuse ! Les
traditionnels compléments hormonaux
sont toujours d'actualité,
même s'ils sont soupçonnés d'augmenter
légèrement (risque relatif :
1,32 %) les risques de cancer du sein
après 10 ans de traitement Viennent
ensuite les étonnants biphosphonates,
proches des agents utilisés
dans les lessives pour dissoudre le
calcaire de l'eau : "Testés dans un
premier temps pour dissoudre le
calcaire tapissant les vaisseaux
sanguins et traiter ainsi l'athérosclérose,
ils ont surpris les chercheurs
en participant nettement à
la reconstruction osseuse", raconte
le professeur Chalès Enfin les tout
nouveaux "simili oestrogènes", disponibles
depuis novembre 1998, ont
toutes les qualités des oestrogènes
pour la reconstruction osseuse, mais
sans aucun risque pour le sein ou
l'utérus. n H.T.
"' Il existe de multiples ostéoporoses "secondaires",
liées d d'autres maladies : maladie endocriniennes,
maladies du foie (dont l'intoxication
alcoolique)... À Rennes, l'équipe dirigée parle professeur
Chalès participe à des recherches sur les
ostéporoses liées à l'hématochromatose : très présente
en Bretagne, cette affection génétique se
caractérise par une surcharge de fer dans le sang.
Professeur (halés,
tél. 02 99 26 71 40.
cellules adipeuses ont la capacité de
synthétiser des oestrogènes.
Après la ménopause :
le traitement
"Les traitements de l'ostéoporose
ont beaucoup progressé ces
dernières années", constate le professeur
Chalès. Les traitements non
seulement stoppent la destruction
(ou résorption) mais souvent même
Contact ►
Une exposition
pour tout savoir
L'os, le squelette : ce thème anatomique
aurait pu rebuter le commun des mortels, qui
peut craindre que cette exposition lui renvoie
l'image sinistre de sa fin proche et certaine.
C'est pourtant avec un bel enthousiasme que
9000 personnes se sont rendues à l'invitation
de l'Espace des sciences, du 6 septembre au 31
décembre dernier. Les concepteurs de l'exposition"',
comme ensuite les animateurs et le
Cccoommmmee toutes les animations
mises au point à l'Espace des
sciences, le principe consiste à
inverser les rôles "enseignantélève"
: l'animateur interroge le
public de manière à lui faire comprendre
ce qu'il sait déjà. À quoi
sert le squelette ? Est-il vivant ou
inerte ? Toute l'exposition est basée
sur une série de questions simples,
chacune étant énoncée et traitée sur
l'un des 21 panneaux, pour lesquels
ont volontairement été choisies des
couleurs claires et lumineuses (bleu
des mers du Sud et cuivre), afin de
"réchauffer" le sujet.
L'os, un matériau
plastique
La première partie de l'exposition
nous fait découvrir le "matériau
osseux". Étudié par les techniques
les plus modernes (microscope élecg
~
L'OS
nt
n direct
du 6 septembre
au 31 décembre 1999 -- -
t'Espaci: des sciences ---
SttCpl9mbia(14':F~••••)—.':
La pratique sportive
influe-t-elle sur la croissance ?
"Aucune activité physique n'a de conséquences tangibles
sur la croissance”, affirme d'emblée le pro$
fesseur Pierre Rochcongar, chef du service de
médecine du sport du CHU de Rennes. Si à chaque
sport semble correspondre un morphotypeu)
(grands basketteurs, gymnastes fluettes...), celui-ci
"est préexistant et détermine le choix de l'activité
physique." Cependant, la pratique bien encadrée
d'un sport, quel qu'il soit et à tous les âges, est bénéfique
pour le maintien du capital osseux. L'absence
totale de stimulation physique sur les os a même un
effet délétère : il y a d'abord perte de force musculaire,
ce qui entraîne ensuite la perte osseuse. Les stimulations
mécaniques favorisent le développement et le
maintien de la masse osseuse ; on constate d'ailleurs que
1- celle des sportifs est généralement supérieure à celle des
sédentaires. "Les activités les plus efficaces sont celles qui amènent
des stimulations brèves mais intenses et qui font varier les
contraintes exercées sur les os (compression, traction...), comme
par exemple le volley-ball ou le basket." n
L'os vivant :
une exposition
vivante
(voir page 23)
À l'heure où paraît ce "Réseau", l'exposition
"L'os vivant" quitte l'Espace des
sciences pour laisser la place à "2 temps
3 mouvements", une approche ludique
de la physique à travers les moyens
de transports. Dès le 17 janvier, "L'os
vivant" reçoit un nouveau public au
CCSTI (Centre de culture scientifique,
technique et industrielle) de Laval (53), jusqu'au 9 avril 2000. Elle
part ensuite au Palais de la découverte à
Paris, pour y être présentée de juin à
septembre, avant de revenir en Bretagne
à l'Espace Enfance de Vannes
(56), où elle restera de janvier à avril
2001. Son périple se poursuit à Nantes
(au Muséum d'histoire naturelle), qui
l'a d'ores et déjà réservée à partir de
mai 2001... Parallèlement, une version
légère composée uniquement des panneaux
et des vidéos, est mise en circulation
dans toute la France, avec un tarif
privilégié pour les communes bretonnes, grâce aux aides du
Conseil régional et de la Confédération
régionale du Crédit agricole. Les contenus
ont fait l'objet de l'édition d'un
cahier d'activités pédagogiques, à destination
des enseignants, et restent également
disponibles en version multimédia
sur Intemet, à l'adresse http://www.espacesciences.
org/osvivant/index.htm n
Service diffusion, Frédéric Primoult,
tél. 02 99 31 7910.
"' Morphotype : catégorie dans laquelle est placé un individu
d'après son physique (taille, poids...).
Contact ►
„of ,
DOSSIER
-~9 ir+~irAR~~`'
personnel d'accueil, ont tout fait pour rendre
l'aura du squelette non plus macabre et terrifiante, mais
vivante et riche d'enseignements.
® RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
En tournant une
molette, l'enfant peut
moduler la pression
s'exerçant sur un fémur,
et visualiser, en vert sur
l'image, les zones où
peuvent se produire des
fractures, en particulier
celle du col du fémur, si
fréquente chez les
personnes âgées.
Quelques
techniques
d'imagerie
médicale
appliqu â,
à l'os
Imagerie à résonance
magnétique : cette technique
récente associe des informations
sur le métabolisme à une résolution
anatomique très performante.
Ostéodensitométrie : mesure
la densité minérale osseuse sur
la colonne lombaire et le fémur.
Cette technique est très utile
pour prévenir et suivre le traitement
de l'ostéoporose.
A La main de Mme Röntgen,
l'épouse de Wilhelm Conrad
Röntgen (physicien allemand,
1845-1923) qui a découvert
les rayons X en 1895, ce qui
lui a valu l'obtention du prix
Nobel de physique en 1901.
a Radiographie : découverte
en 1895 par Wilhelm Conrad
Röntgen, c'est la plus ancienne
des techniques d'observation
de l'os, mais c'est toujours la
plus utilisée, avec toutefois
des doses d'irradiation bien
moindres qu'il y a 100 ans.
Scanner : permet d'étudier la
structure osseuse. Les images
reconstruites en 3D autorisent
une analyse des éléments squelettiques
dans l'espace.
Scintigraphie osseuse : cette
technique utilise les traceurs
radioactifs pour la localisation
des zones de croissance excessive
de tissu osseux.
L'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 20.
Contact ►
sur l'os
Ironique, imagerie médicale...), l'os
se révèle être une structure de type
lamellaire, compacte à la périphérie
et spongieuse à l'intérieur. Cette
architecture et la nature chimique
des constituants de l'os confèrent à
ce matériau naturel de remarquables
capacités mécaniques de résistance
à la traction, à la compression et au
cisaillement.
La vie de l'os
Bien que plus grand, un adulte a
moins d'os qu'un enfant (200 au
lieu de 300) : en effet, au cours de la
croissance, certains os comme par
exemple ceux de la main, du pied
ou du crâne, se soudent progressivement
les uns aux autres, ce qui
s'observe très nettement sur des
radiographies de main de bébé,
d'enfant et d'adulte (photos cidessous).
L'os est donc vivant :
deux cédéroms viennent expliquer
l'un, ce qui contribue à la croissance
de l'os (hormones, vitamines,
calcium...) et l'autre, les règles
d'hygiène et de vie qui permettront
au public d'apprendre à mieux
gérer son "capital osseux". Car à
travers cette exposition, l'Espace
des sciences comme ses deux principaux
partenaires, le Palais de la
découverte et la Fondation pour la
recherche médicale se livrent à une
véritable mission d'éducation à la
santé. Les supports sont multipliés
d'un patient ayant subi une greffe de
l'os ou une implantation de prothèse.
Nombreux sont les visiteurs qui
ont ainsi reconnu, sur une vidéo, le
chirurgien à qui ils doivent d'avoir
retrouvé une certaine mobilité :
le professeur Frantz Langlais, qui
dirige le service d'orthopédie de
l'hôpital Sud à Rennes et qui dans
le cadre de cette exposition, a participé
à deux conférences, l'une sur
le thème des prothèses, l'autre sur
le thème des greffes (voir articles
pages 14 et 15). n H.T.
"' "L'os vivant" a été réalisée par Marie-Agnès
Tran Thi Ngoc (Palais de la découverte), Franck
Raffegeau et Nelly Le Mée (Espace des sciences),
sous la direction de Thierry Auffret van der Kemp
(Palais de la découverte et Espace des sciences) et
Marie-Christine Rebourcet (Fondation pour la
recherche médicale).
L'examen radiologique de la
main et du poignet permet aux
pédiatres de suivre la
maturation du squelette et de
suivre l'âge osseux" de
l'enfant. En effet, le tissu osseux
est opaque aux rayons X, mais
pas le cartilage, qui paraît
transparent sur les radios.
À 1 an et à 3 ans, de larges
espaces semblent séparer les os
des doigts. Ils correspondent
aux zones de croissance
cartilagineuse et aux espaces
articulaires. À 13 ans, l'os a
presque totalement remplacé le
cartilage. En fin de croissance,
les pièces osseuses sont bien
distinctes et séparées par un
mince espace articulaire.
(exposition multimédia), pour rencontrer
les multiples modes d'acquisition
des connaissances.
L'os réparé
Enfin, une fois admis que l'os est
vivant et donc apte à croître, à se
développer, il faut hélas accepter le
corollaire de cette vie : la maladie et
la mort. Cette troisième partie sur le
vieillissement osseux, l'ostéoporose,
le cancer de l'os... attire beaucoup
d'adultes, chacun étant personnellement
concerné, lui-même ou dans
son entourage, par l'aspect médical
de l'os et du squelette. Ici, chaque
maladie est exposée en compagnie
de son traitement, avec une petite
vidéo présentant les explications
d'un médecin, ou le témoignage
ti z , .~ ~ u ij2 -"ià.i•Jv t t 2,400 13
~~ ,
~ ~~ k ~.4 -
r
,47
Greffes d'os : ça marche... !
Les professeurs Philippe Chiron, chef du service orthopédie de
l'hôpital Rangueil de Toulouse, Frantz Langlais, chef du service
orthopédie du CHU Sud de Rennes et Dominique Poitout, chef du
service orthopédie de l'hôpital Nord de Marseille.
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Sécurité des greffes r on
n'est jamais trop prudent...
À la différence d'organes vitaux
comme le coeur ou les poumons,
"le tissu osseux peut être
conservé jusqu'à 5 ans sans
altération, grâce à un procédé
complexe de cryopréservation",
comme l'expose le professeur
Dominique Poitout. Comment
s'assure-t-on que les tissus
conservés ne présentent pas de
danger d'infection pour le receveur
? Deux cas se présentent :
Le donneur peut être vivant ;
c'est le cas pour un os comme la
tête fémorale, que l'on récupère
après une pose de prothèse de la
hanche. Le médecin effectue
alors de multiples tests bactériologiques
sur le donneur.
Mais le plus souvent, les os
susceptibles d'être greffés sont
prélevés en même temps que
d'autres organes vitaux sur des
individus en état de mort cérébrale.
Pour s'assurer que le
donneur ne présentait aucune
infection, on suit les sujets chez
qui ont été transplantés ses
organes. Les os ne pourront être
greffés que si les receveurs ne
présentent aucun signe d'infection
passé le délai de rigueur. n
sement, le nombre limité de greffons
disponibles ne permet pas de faire
face à tous ces besoins.
L'avenir : biomatériaux
et os artificiel
Qu'on évoque la notion de "greffe", et intuitivement, c'est
aux greffes d'organes (coeur, poumons, rein...) que l'on songe.
Et pourtant... depuis près de 20 ans, la greffe de tissu osseux a
fait ses preuves, tirant parti des progrès remarquables de la
chirurgie orthopédique. La greffe n'est pas seulement efficace
pour certaines fractures, elle l'est aussi dans le traitement du
cancer des os. Trois spécialistes, les professeurs Frantz Langlais,
Dominique Poitout et Philippe Chiron ont exposé, lors
d'une conférence organisée par l'Espace des sciences, les alternatives
qui s'offrent aux praticiens.
ttL'os est un tissu vivant qui a la
faculté de se reconsolider. C'est
pourquoi, chaque fois que nous
pouvons utiliser une technique
sans apport de greffon extérieur,
nous le faisons", assure le professeur
Philippe Chiron. Si la greffe
s'avère indispensable, on privilégie
l'autogreffe (voir illustration). Un
exemple parlant : un patient victime
d'une fracture importante de l'humérus
s'est vu greffer une partie de
son propre péroné à la place... (il
faut savoir que l'on peut très bien se
passer de la partie médiane du
péroné). Cependant, l'allogreffe
(voir illustration) est parfois la seule
alternative, notamment chez des
sujets âgés.
Une compatibilité
assurée
La greffe de tissu osseux présente
l'avantage de ne pas nécessiter la
compatibilité tissulaie" entre donneur
et receveur. En effet, la matrice
osseuse est très bien tolérée, car elle
est composée à 69 % de substances
inorganiques et compte peu de cellules.
Le patient n'a donc pas besoin
de traitement antirejet, généralement
lourd et dangereux pour la santé.
"C'est pourquoi on ne greffe pas le
tissu avec ses vaisseaux nourriciers",
souligne le professeur Philippe
Chiron. "En somme, dans son
principe, la greffe d'os reste comme
l'implantation d'une prothèse, à la
différence que l'os se reconstruit."
Les cellules mortes du greffon sont
en effet remplacées par les cellules
du receveur.
Des besoins
non satisfaits
La greffe osseuse trouve son
application la plus prometteuse
dans le traitement des cancers de
l'os. "Au début des années 80,
9 cas sur 10 de cancers de l'os chez
l'adolescent avaient une issue
fatale, malgré l'amputation.
Aujourd'hui, grâce à la greffe
osseuse, les malades survivent près
de 3 fois sur 4, et en conservant
leur membre I", avance le professeur
Frantz Langlais. La greffe d'os
est aussi indiquée en complément
desnéopérations de prothèses articulaires,
car elle permet souvent d'éviter
les interventions ultérieures liées
à l'usure des prothèses. Malheureu-
C'est pourquoi la recherche met
aujourd'hui tous ses espoirs dans
des matériaux de remplacement. Les
biomatériaux donnent des résultats
encourageants, comme le corail des
madrépores ; on travaille aussi sur
l'os de synthèse, en céramique de
phosphate de calcium. Mais la solution
idéale réside, dit-on, dans une
"molécule inductrice", présente
naturellement dans la moelle
osseuse et capable de faire repousser
l'os chez le receveur. Elle existe bel
et bien, et de plus, les chercheurs
sont maintenant capables de la synthétiser
par génie génétique. "Le
plus dur reste à faire", tempère le
professeur Philippe Chiron, "il faut
s'assurer de son efficacité et de son
innocuité." n B.R.
Autogreffe : type de greffe
pour laquelle le greffon provient
du sujet lui-même. Ici, un
morceau du tibia d'une jambe a
été remplacé par un morceau du
péroné de l'autre jambe.
A Allogreffe : le greffon est
prélevé sur un individu
appartenant à la même espèce,
mais dont l'identité génétique est
différente de celle du sujet. Ici le
greffon (prélevé sur un donneur)
est maintenu en place à l'aide
d'une plaque.
"' Compatibilité tissulaire (ou histocompatibilité) :
plus ou moins grande similitude biologique des tissus
du donneur avec ceux du receveur. Pour certains
organes, l'absence de compatibilité entraîne
le rejet du greffon et réchec de la greffe.
Frantz Langlais, chef du service
orthopédie de l'hôpital Sud à Rennes,
tél. 02 99 26 71 67 ou 72.
Contact ►
Prothèse tota
de hanche
tige métallique
ciment chirurg ça
en résine
ka,
i'
RÉSEAU 162 • JANVIER 200
a 4 .
C'est au niveau des pratiques
opératoires que les progrès
sont les plus marquants ces 20
dernières années. L'hygiène est
absolue (port d'un scaphandre
pour éviter toute contamination),
le personnel est de mieux en
mieux formé, notamment les
infirmières de bloc opératoire,
que l'on voit ici à l'oeuvre pour
une démonstration en direct,
lors d'une conférence-animation
au Triangle à Rennes,
le 16 novembre dernier.
Le palmarès des prothèses
articulaires en France
Prothèses : une histoire
à tenir debout
Lors de cette troisième conférence du cycle "L'os vivant"
organisé par l'Espace des sciences, les professeurs Philippe
Hernigou"', Frantz Langlais et Hervé Thomazeau121 ont offert à
un public important (plus de 300 personnes), une soirée très
animée sur le thème des prothèses osseuses, avec matériel et
démonstrations à l'appui.
Après quelques essais anecdotiques
(premières prothèses
en ivoire !) au début du 20' siècle,
l'orthopédie n'émerge vraiment que
dans les années 60-70. Elle suit
depuis une progression constante,
mais sans grande révolution. "Les
premières prothèses ont des durées
de vie au moins égales à celles obtenues
aujourd'hui", explique le professeur
Philippe Hemigou. "Même
relativement lente, l'évolution des
technologies et des matériaux est
telle qu'une personne jeune opérée
aujourd'hui a toutes les chances de
pouvoir mener toute sa vie des activités
professionnelles et familiales
normales, à condition de se faire
réopérer tous les 10 a 15 ans."
De quoi dépend
la durée de vie
d'une prothèse ?
"Une prothèse est une pièce
mécanique", rappelle le professeur
Frantz Langlais. "Comme une pièce
de voiture, elle s'use en fonction de
l'usage qui en est fait. Une voiture
est usée au bout de 150 000 km,
une prothèse est usée au bout de
15 millions de mouvements. C'est
au patient de gérer son capital de
mouvements, pour faire durer sa
prothèse le plus longtemps possible."
Plus une personne est âgée,
moins elle est active et sa prothèse
durera plus longtemps que chez un
sujet jeune. Quand une prothèse est
usée, il faut réopérer. "Aujourd'hui,
les reprises sont presque aussi efficaces
que les premières opérations."
La prothèse
en dernier recours
"Aussi au point soit-elle, l'implantation
d'une prothèse ne doit
être décidée que lorsqu'il n'existe
aucune alternative", insiste Frantz
Langlais. Pour les sujets les plus
jeunes, la chirurgie réparatrice, en
modifiant les surfaces osseuses,
redonne une nouvelle jeunesse aux
articulations défaillantes. Pour le
genou, on peut injecter du liquide
synovial artificiel. Mais s'il n'a
d'autre choix que de se faire installer
une prothèse, le patient aura intérêt à
effectuer d'abord un bilan de santé
complet, afin de limiter les risques
d'infection. Il peut aussi être encouragé
à perdre un peu de poids, pour
faciliter sa rééducation et améliorer
la durée de sa prothèse en réduisant
sa sollicitation.
La hanche :
une opération
commune
mais lourde !
Pour la mise en place d'une prothèse
de la hanche, l'opération dure
deux heures, pendant lesquelles la
hanche est déboîtée, la tête de fémur
sectionnée et le tube de l'os foré,
afin d'y introduire la tige de la prothèse.
Dans la cavité du bassin sera
insérée une cupule en matériau plastique
ou en céramique, dans laquelle
viendra pivoter la tête de la prothèse.
C'est surtout après l'opération que
le "patient" mérite son nom, car il
marchera après plusieurs semaines
avec des cannes et attendra plusieurs
mois pour retrouver une mobilité
satisfaisante, mais toujours inférieure
à la mobilité normale.
Apprendre à vivre
avec une prothèse
Après l'implantation d'une prothèse
de la hanche, le patient ne
retrouve qu'une mobilité partielle :
les mouvements de rotation sont
en particulier déconseillés, car la
forme de la prothèse, beaucoup plus
"ouverte" que l'articulation initiale,
est propice au déboîtement de la
hanche, accident postopératoire
Prothèses de la hanche
Entre 50 000 poses de prothèses
et 400000 interventions sur la
hanche par an (surtout des
femmes).
Prothèses du genou
20000 à 30000 par an.
Prothèses de l'épaule
3 à 4000 par an.
Prothèses du coude
Quelques dizaines par an.
spectaculaire et très douloureux,
même s'il est relativement bénin.
Ce déboîtement (luxation) est particulièrement
redouté dans les
semaines qui suivent l'opération,
mais il peut survenir de nombreuses
années plus tard, d'où la nécessité
de renoncer définitivement à certains
mouvements : le patient devra
toute sa vie veiller à ménager son
articulation. n H.T.
" Service d'orthopédie de l'hôpital Henri Mondor
d Créteil."' Service d'orthopédie du CHU Sud de
Rennes.
Frantz Langlois, chef du service
d'orthopédie de l'hôpital Sud ô Rennes,
tél. 02 99 26 71 67 ou 72.
Contact ►
L'enclouage : une technique d'avenir
Réseau : Combien d'enclouages pratiquez-vous chaque année ?
Christian Lefèvre : Entre 150 et 200 par an, tous os longs confondus
(NDLR : humérus, radius, cubitus, tibias, péroné, fémur).
Réseau : Cette technique n'est-elle pas coûteuse ?
C.L.: Bien sûr, cela coûte plus cher qu'un plâtre... Mais, grâce à l'enclouage,
nous évitons les cals vicieux et les pseudarthroses (mobilité persistante
et anormale d'une fracture qui ne se consolide pas) et nous
réduisons beaucoup les déviations angulaires de l'os. Ce qui signifie que
les patients qui auraient connu ces séquelles autrefois, ne les connaissent
plus aujourd'hui. C'est donc une nette amélioration de confort pour le
patient.
Réseau : Comment voyez-vous le développement de cette technique ?
C.L. : Les clous sont très au point maintenant. Je pense que le vrai développement
résidera dans l'imagerie 3D et 4D (NDLR : qui analyse le
mouvement). En effet, je ne vous dirai pas la quantité de surprises désagréables
préopératoires, lorsque le chirurgien découvre que les os sont en
réalité plus abîmés que ne l'avait fait imaginer l'imagerie classique (scanner,
radiologie). Cela est particulièrement vrai pour les hanches qui ont
reçu des prothèses, lorsque ces dernières se sont déplacées dans le bassin
ou le fémur ! Grâce à l'imagerie 3D, on parvient à reconstituer en résine
des bassins, au millimètre près, ce qui nous permet de savoir exactement,
par exemple, quelle quantité d'os nous allons devoir prélever sur le
patient, pour reconstituer les parties abîmées de la hanche. Dans ce
domaine, il y a des progrès fantastiques qui vont être réalisés ! n
Le clou de ►
radius est
courbe.
Cela lui
permet de
suivre la
forme
naturelle du
radius qu'il
faut restituer
lors de la
réparation de
la fracture,
afin de
permettre
à la rotation
de l'avantbras
(pronosupination)
de s'effectuer
correctement.
Os... mis au clou !
Pour certaines fractures, le "plâtre" est inefficace.
Le professeur Christian Lefèvre, chef du service
d'orthopédie-traumatologie de l'hôpital de la
Cavale Blanche de Brest, a adapté aux fractures
de l'avant-bras une technique étonnante : l'enclouage.
Rencontre et explications.
Le traditionnel "plâtre" couvert de
signatures n'est pas près de disparaître.
Dans la majorité des cas de
fracture, c'est en effet le traitement
le plus simple, le plus rapide et le
plus efficace. Mais quelquefois, les
choses peuvent se compliquer.
"Lorsqu'il y a fracture", explique
le professeur Christian Lefèvre, "il y
a toujours oedème. Lorsque celui-ci
se résorbe, le plâtre peut se mettre à
«avoir du jeu» par rapport à l'os.
Ce qui peut entraîner un déplacement
secondaire de la fracture." Et
qui dit déplacement secondaire, dit...
nombreux problèmes, comme des
cals, des déformations de l'os, des
déplacements secondaires des fragments
avec un risque de cals vicieux
(cals en mauvaise position)...
Un clou dans le canal
Jusqu'aux années 80, la solution
était alors de recasser l'os (sous
anesthésie !), et de pratiquer une
opération chirurgicale, afin de visser
dessus une plaque métallique de
maintien. Une solution certes efficace,
mais handicapante pour le
patient et qui ne règle pas tous les
problèmes. Notamment lorsque la
fracture ne se consolide pas. C'est
ainsi qu'il y a dix ans, le professeur
Lefèvre a eu une idée très originale :
au lieu de fixer la plaque à l'extérieur
de l'os, il a fait pénétrer un
"clou" dans le canal médullaire.
"La difficulté", explique-t-il,
"était de fabriquer une pièce parfaitement
adaptée à l'os à traiter,
en épousant au mieux les formes et
les dimensions du canal." Pour
parvenir à un résultat optimum, "il
a fallu choisir un alliage relativement
malléable, car le canal
médullaire n'est pas absolument
droit. C'est ainsi que le choix s'est
fixé sur l'inox médical recuit
(NDLR : afin de lui donner une
certaine malléabilité)". L'alliage
choisi, restait à fabriquer la pièce,
mais de façon à ce qu'elle s'adapte
au millimètre près à l'os à traiter.
"Pour cela, nous faisons appel à
une technologie d'imagerie 3D
très sophistiquée, mise au point en
coopération avec le Centre hospitalo-
universitaire de Brest et
l'École nationale supérieure des
télécommunications de Bretagne
(ENST). L'os à traiter est imagé
numériquement avec une résolution
inférieure au millimètre !"
Une technique
sans séquelle
Le clou ainsi préparé est alors
inséré dans le canal médullaire de
l'os, canal qui ne contient qu'une
moelle graisseuse, sans rapport
avec la moelle rouge, productrice
d'hématies (les globules rouges), et
qui se situe dans l'épiphyse. Il n'y a
donc aucune séquelle de la moelle
et, lorsque la fracture est parfaitement
consolidée, le chirurgien peut
A Ces deux radios montrent,
à gauche : une fracture du cubitus
et à droite : sa réparation par
enclouage. Souvent employé
pour les fractures du fémur
(cuisse) ou du tibia (jambe),
l'enclouage s'applique depuis peu
au traitement des fractures du
cubitus et du radius (avant-bras).
C'est le professeur Christian
Lefèvre, chef du service
d'orthopédie-traumatologie du
centre hospitalier de Brest, qui
a conçu ces clous spécifiques des
os de l'avant-bras.
retirer l'implant métallique. Si le
patient est un jeune en fin de croissance,
on peut utiliser des clous
télescopiques, que l'on allonge par
fractions de quart de mm ! Mais,
chez les sujets les plus jeunes, la
technique est hélas inutilisable. Il
est en effet impossible de toucher
aux cartilages de croissance. •
J.F.C.
1 Le clou de
cubitus
est droit.
Cependant,
il peut se
déformer lors
de sa mise en
place pour
épouser la
forme interne
de l'os. Très
ingénieux, ce clou permet de
rapprocher deux fragments d'un
os fracturé pour comprimer la
fracture et accélérer la réparation.
Mais il permet aussi d'allonger le
cubitus si une maladie particulière
le nécessite.
Professeur Christian Lefèvre,
tél. 02 98 34 78 74.
Contact Io.
0 RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
L'organisation mondiale de la santé :
http://www.oms.ch
La Fondation pour la recherche médicale :
http://www.frm.org
L'Institut national pour la santé et
la recherche médicale (Inserm) :
http://www.inserm.fr
•
Quelques sites
web sur le thème
de l'os
Glossaire
Guide des animations
Cahier d'activités pédagogiques
Que sais-je ? Le mal de dos
par Jean-Marie Maigne
(Fd. Presses universitaires de France)
L'arthrose
par le docteur Jason Théodosalis
(Ed. De Fallois)
Le squelette et re y°ei°n~
le mouvement
collection "Le corps
humain", 48 p.
(Ed. Gamma -
École e
Livre de poche
de rhumatologie
collection Médecine Science
(Ed. Flammarion)
de l'osa uueleue
11.gr;' g,".érel
Cédéroms
Os compact
Dur et dense, il se situe à la périphérie des
os et se compose de couches concentriques
de lamelles et de cellules osseuses, autour
de canaux par lesquels passent les
vaisseaux sanguins et les fibres nerveuses.
Os spongieux
Situé au centre des os, l'os spongieux se
caractérise par un treillis de travées minces
et irrégulières.
Le site de l'exposition "L'os vivant" :
http://www.espace-sciences.org/
osvivant/index.htm
Le squelette humain expliqué
aux enfants :
http://www.clparc-beauvais.fr/
Serveur/ESANTE/Enfants/Lesos/
Anat.htm
Diapositives de tissu osseux :
http://www.medvet.umontreal.ca/
histologie/Toss/cadres7.htm
L'association pour la promotion
de l'informatique et de la
communication en médecine :
http://www.intermedic.org
De l'os au
squelette
collection "Les yeux
de la découverte",
64 p., 85 F,
(Ed. Gallimard)
La leçon d'anatomie
par l'lnserm, bibliothèque nationale de
France (BNF)
Histoire d'os
présente les
mouvements du
squelette, au
/ travers de l'étude
de la forme et
de la fonction
des os et des
articulations.
Disponible sur
demande à
l'ENST Bretagne,
il est réalisé par l'Espace des sciences et le
Latim (Laboratoire de traitement de
l'information médicale à Brest).
c«lm ► Valérie Burdin, ENSI Bretagne,
tél. 02 98 00 11 04 ou Hélène Tattevin,
l'Espace des sciences, tél. 02 98 35 28 22.
Ostéoblaste
Cellules spécialisées assurant le
renouvellement du tissu osseux. Les
ostéoblastes édifient la matrice protéique
osseuse (fibres de collagène) et assurent
la formation du cristal osseux de phosphate
de calcium (microscopie électronique à
balayage).
Ostéoclaste
Les ostéoclastes creusent des lacunes et
détruisent l'os (microscopie électronique à
balayage).
Le mois prochain dans Réseau : Les déchets en Bretagne
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000 17
Du côté des
entreprises
STMicroelectronics
se développe
Rennes : Afin de
satisfaire la demande
croissante en circuits
intégrés mixtes destinés aux marchés
des télécommunications, de
l'automobile et de l'informatique,
l'entreprise STMicroelectronics a
décidé d'augmenter de 30% ses
capacités de production. Cette
démarche donnera lieu à la création
de 30 postes supplémentaires, afin
de porter l'effectif du site à plus de
550 personnes.
Rens.: Christine Léonard,
tél. 01 47 40 77 57.
Appartenant au groupe André Glon,
la société Le Cam conditionne et transforme
chaque année 400 millions d'oeufs.
Lannion (22) Le 3 novembre dernier, le président du Conseil régional
de Bretagne, Josselin de Rohan, a remis à l'entreprise de production
d'oeufs Le Cam de Naizin (56), le prix Acanthe, prix mis en
place par la Caisse régionale d'assurance maladie (Cram) pour
récompenser les actions de prévention des risques professionnels.
Le jury a accordé un prix spécial aux établissements Gueguen (meunerie)
situés à Malestroit (56). L'après-midi a été animé par un débat
sur le thème de "La conduite de projet en construction neuve".
Rem. : Ghislaine Le Roux, Cram, tél. 09 99 26 70 20.
BRÈVES
De gauche à droite : René Troalain, président de la
technopole, la styliste Sophie Colnet et Jean-Philippe
Lenclos.
Un petit déjeuner
de bon goût
Quimper (29) : Invités par la
technopole Quimper-Cornouaille
à l'hôtel Novotel, quelque 75 chefs
d'entreprise de Bretagne sud ont
suivi avec beaucoup d'intérêt les
démonstrations de Sophie Colnet
(styliste à Pont-l'Abbé) et de Jean-
Philippe Lenclos (Atelier 3D Couleur),
sur l'usage des couleurs et des
matières dans le monde industriel.
Qu'il s'agisse d'urbanisme ou de
produits, couleurs et matières sont
des valeurs d'attrait sur lesquelles
se penchent les plus grands groupes
de l'automobile, de l'électroménager
et des autres secteurs de la
consommation.
Rens.: Michelle lequel-Mignon,
tél. 02 98 10 02 00,
http://www.tech-quimper.fr
Contribution au
développement des
entreprises bretonnes
Rennes : Bretagne Innovation s'est
lancé dans une nouvelle mission,
celle d'aider les entreprises à accéder
à des sources de financement
privé pour leurs projets d'innovation.
Ce service sera gratuit pour les
entreprises.
► Rem. : Bretagne Innovation,
tél. 02 99 61 42 00.
Créations d'entreprises :
la Bretagne
en bonne santé
Selon l'Insee, la Bretagne a enregistré
2700 créations d'entreprises
au cours du troisième trimestre
1999 (1361 créations pures ; 671
reprises ; 668 réactivations), contre
2 631 durant la même période de
La société brestoise Océalys a choisi trois partenaires
japonais pour développer son activité.
Océalys en pleine
expansion
Brest : Le 26 novembre dernier,
la société Océalys, spécialisée dans
la cosmétologie et la diététique
marines, a signé une convention
avec trois sociétés japonaises (Chifure,
Aquamer et Toa Kasei, qui
apportent 18 % de capitaux), ainsi
qu'avec la société islandaise Blue
Lagoon (qui apporte 5 % de capitaux).
Une usine de 2 000 m2 sera
bientôt construite à côté de l'actuel
siège d'Océalys et devrait être opérationnelle
en septembre 2000.
Rens. : Fabienne Bresdin-Le Foll,
tél. 02 98 05 25 36.
1998, et 2 760 en 1997. La Bretagne
s'affiche donc 10' sur les
22 régions en progression de
créations.
Rens.: Insee Bretagne,
tél. 02 99 29 33 33.
Far Ouest au secours
des inventeurs
Louannec (22) : En commercialisant le "détaupeur"
inventé par son père, Christophe Milon
s'est trouvé confronté aux problèmes de la
fabrication de série et de mise en valeur d'une
invention. Il a donc créé Far Ouest, afin d'aider
les inventeurs à mobiliser des financeurs,
industriels, et distributeurs autour d'un nouveau
produit, avant de prendre en charge sa
commercialisation. L'idée de Far Ouest a
enthousiasmé deux prospecteurs de Présence
Bretagne, ce qui a permis à Christophe Milon
de bénéficier d'une prestation technologique
Réseau.
Rem. : Christophe Milon, tél. 02 96 91 28 65,
Christophe.milon@farouest.com
t Inventé parle père de Christophe Milon, le "détaupeur"
élimine les taupes par déflagration.
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Du côté
d'Internet
Crocsciences fête
son 1" anniversaire
Crocsciences est
un portail mensuel
faisant le tour des
sites scientifiques présentant un
intérêt pédagogique. Destiné
aux professeurs comme aux
élèves, il comporte une liste des
articles parus récemment au
bulletin officiel dans le domaine
de l'enseignement, ainsi qu'un
choix de sites sélectionnés pour
leur valeur pédagogique, dans
les quatre rubriques mathématiques,
sciences physiques,
sciences naturelles et technologies.
Le n° 12 de décembre
1999 propose par exemple des
tests de mathématiques et un
site sur le "nombre d'or", ainsi
qu'un très beau site canadien
sur la forêt virtuelle.
Rens.: http://www.franco-sciente.org/
crocsciences
Altema.com
Soutenu par la
Commission
européenne,
www.altema.com est un site
réalisé par Resis, le réseau d'informations
stratégiques créé par
les chambres de commerce et
d'industrie pour informer les
entreprises sur les tendances et
les marchés. Outre de nombreuses
informations pratiques
(flash info), Alterna propose
plusieurs dossiers interactifs sur
des thèmes très actuels : le
sport, la "génération X" (jeunes
adultes entre 20 et 30 ans
aujourd'hui), l'alimentationsanté,
le commerce électronique...
► Rens. : http://www.altema.com
Les professions libérales
sur Internet
Depuis le 14 décembre dernier,
les 1,3 million de personnes
exerçant une profession libérale
peuvent accéder au site de l'Association
pour la promotion de
l'Internet pour les professions
libérales (APIPL). C'est le premier
site en France de ce type.
► Rens. : Thierry Bouchard,
tél. 08 26 80 03 04,
http://www.infosud.com/apipl
(alterna
Les échos
de l'Ouest
RLGION
....111111111111
BRETAGNE
17 déc./Passeport
Bretagne pour
entreprendre
Rennes : Gérard Pourchet,
vice-président du Conseil
régional de Bretagne
chargé de l'enseignement,
et Jean-Luc Le Douarin ont
remis les "passeports Bretagne
pour entreprendre"
aux 52 lauréats de la
promotion 1999/2000. Ce
passeport est un visa pour
des jeunes engagés dans
les études longues, aux
moyens fmanciers limités,
soucieux de créer une
entreprise.
► Rens. : Catherine Mallevaës,
tél. 02 99 21 13 56.
Le Centre relais innovait& (CRI) de Breta fü,
Basse Normandie et Pa33ede la Loire informe qu', 11,
industriel espagnol reMerche une technologie`
d'emballage pour améliorer la conservatiop des figues fraîche f.
991012B). Une société italienne a dével16 pé,un aliment,liq r
pour porcelet facilitant le passage du lait ma'ie L'all nt en
poudre (réf. 991025E). Un centre technique israélien ropose une
méthode pour augmenter la production d'antioxydant à partir de
micro-algues (réf. 991111H).
Aider les innovateurs à exploiter leurs résultats
de recherche
Afin que les chercheurs européens prennent conscience de l'importance
de leurs droits de propriété intellectuelle (DPI), la commission
européenne a récemment créé un bureau d'assistance DPI, dont
l'objectif est d'aider les innovateurs à tirer le meilleur parti de leur
travail.
Rens.: Centre relais innovation, tél. 02 99 67 42 00.
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise,
vos travaux de recherche, vos innovations ?
Contactez-nous pour paraître dans
le prochain Réseau !
Tél. 02 99 35 28 22, fax 02 99 35 28 21,
e-mail lespace-des-sciences@wanadoo.fr
Du côté de l'Europe
Du côté des
laboratoires
Un pack de l'innovation
Rennes : Bretagne
innovation vient
d'éditer un cédérom
de présentation des centres d'innovation
technologique bretons. La
démarche d'innovation est expliquée
par de nombreux témoignages,
sous forme de courtes
séquences vidéos. Quant à la présentation
des centres d'innovation,
elle est à chaque fois illustrée par
des exemples de réalisations dans
tous les secteurs clés de l'économie
bretonne : les productions animales,
les biotechnologies, la valorisation
des produits de la mer... Un grand
bravo aux réalisateurs de cet outil à
la fois convivial et précieux par les
informations qu'il fournit !
Rens.: Adeline Oziel,
tél. 02 99 67 42 03.
Une échelle de la douleur
Saint-Brieuc (22) : À l'occasion de
la journée régionale sur la douleur
et les soins palliatifs le 16 novembre
dernier, Loïc Revillon, gériatre au
centre hospitalier de Saint-Malo, a
présenté Dolopus 2, un outil destiné
à l'évaluation de la douleur chez les
personnes âgées non communicantes.
► Rens. : Loi Revillon,
tél. 02 99 21 21 21.
Jacques Villain a reçu le premier Prix "grand public"
pour À la conquête de la Lune".
Le prix Roberval 1999
Compiègne (60) : Remis le 2
décembre dernier par le Conseil
général de l'Oise et l'université de
technologie de Compiègne, ce prix
francophone a récompensé les
meilleurs livres et autres oeuvres de
la communication en technologie :
Prix "grand public" :
Jacques Villain ("À la conquête de
la Lune") et Ariane Mallender
("Écrire pour le multimédia").
Prix "enseignement public" :
Claude Flanzy ("Oenologie : fondements
scientifiques et technologiques"),
Michel Pappaz, Michel
Bellet, Michel Deville ("Modélisation
numérique en science et génie
des matériaux"), Jean-Claude
Geffioy et Gilles Motet ("Sûreté de
fonctionnement des systèmes informatiques").
Prix télévision :
Mario Masson, Yves Lévesque
("Hibernia, la merveille de la
mer").
Prix multimédia :
Georges Charpak, Bella Bouaziz,
Coco Djossou, Robert Germinet,
Josiane Hamy, Yves Janin, Ludovic
Klein, Carl Rauch, Main Schmitt,
Henri Verdier ("L'eau dans la vie
quotidienne : la main à la pâte"),
André Sippel ("CD2i : cours de
dessin interactif').
► Rens. : Prix Roberval,
tél. 03 44 23 43 58.
BRETAGNE
INNOVATION
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Surveillance de la qualité
de l'environnement
littoral
'lamer
Surveillance de la qualité de
l'environnement littoral : proposition pour une
meilleure coordination des réseaux
Ce manuscrit fait le bilan de la surveillance
actuelle, positionne les différents
réseaux et zonages existants sur
un ensemble de cartes en couleurs. Il
met l'accent sur la nécessité d'une
optimisation et d'une coordination
des réseaux, par l'élaboration d'un
référentiel géographique reconnu par
tous les acteurs.
Éditions Ifremer, 76 pages, 120 F.
► Rens. : Marc Morel, tél. 02 98 02 34 12.
Expositions
La culture scientifique
au pays de Lorient
Lorient (56) : La Sellor gère les trois
équipements de loisirs du pays de
Lorient : Odyssaum (espace de
découverte du saumon sauvage),
Thalassa (navire de découverte de
l'océanologie) et le Haras national
d'Hennebont (espace de découverte
du cheval en Bretagne). Elle propose
chaque mois un programme
d'animations.
En janvier :
Dimanche 16 janvier à la Thalassa :
animation "initiation météo" pour
les enfants ; dimanche 23 janvier
à Odyssaum : M. Dessaigne de
la société Ragot viendra faire
une démonstration de montage
de mouche ; samedi 29 janvier
au Haras d'Hennebont : dressage
humoristique de chevaux. Dimanche
30 janvier au Haras d'Hennebont
: retransmission du Grand
Prix d'Amérique.
► Rem. : Karine Devillard, Sellor,
tél. 02 97 65 43 21.
Jusqu'au 14 janvier 2000/
Au musée des
télécommunications :
Les télécoms et la philatélie
Pleumeur-
Bodou (22) :
Cette exposition
présente
une vingtaine de collections :
870 feuilles de timbres racontent le
télégramme, la TSF, les radioamateurs,
la radiodiffusion, les télécoms
par satellite... Elle a été réalisée par
l'union des philatélistes et télécartistes
de La Poste et France Télécom
de Bretagne, associée aux Amis du
musée. Pour commémorer l'événement,
une télécarte est tirée à
100000 exemplaires.
Rem. : Bernard Charmentray,
tél. 02 96 46 63 88,
http://www.musee-des-telecommunicationsasso.
fr/
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
de mouche à Odyssaum
lnstrafion le 23 janvier).
J. Comhet/Fa e ééa i
Aquaculture et environnement :
réglementation des élevages de poissons
Ce livre résume les principales
conclusions issues de communications
et de débats sur : le constat d'une
maîtrise de plus en plus grande de
l'aquaculture et de son impact sur
l'environnement, un effort de
réflexion sur une meilleure insertion
de l'aquaculture dans l'aménagement
du littoral, le besoin d'information au
niveau local et régional, et, enfin, des
pistes d'action tant pour la recherche
que pour la re ementahon. Cette synthèse est suivie par quinze
communications regroupées par thèmes : cadre technique, économique
et réglementaire ; aquaculture et aménagement du littoral
; prévention et contrôle de l'impact sur l'environnement ;
expérience des principaux pays producteurs européens.
Éditions Ifremer, 188 pages, 180 F.
Rem.: Éditions Rimer, tél. 02 98 22 40 13.
Retour aux sources
Rennes : Dans le cadre du
contrat de plan 1994-1999,
l'État et la Région, en association
avec de nombreux
partenaires, ont voulu renforcer
leurs actions en
faveur des poissons migrateurs
en éditant un document
technique, afin de
présenter les acteurs et les
différents volets de ce programme,
et de mieux faire
connaître les réalisations
financées dans ce cadre.
► Rem. : Guillaume Lesage, Conseil régional,
tél. 02 99 27 10 10.
Économies d'énergie avec l'Ademe
Rennes : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (Ademe) vient de publier le "Guide
de la famille Econocroc'h", destiné au grand public.
Grâce à ce petit manuel très bien fait, il est possible
de réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie par an !
► Rem. : Ademe, tél. 02 98 85 87 00.
tour
aux sources
d •• mis iii fave ur
des -poissons migrateurs
À lire BRÈVES
Jusqu'au 31 janvier 2000/
Le savoir est dans le pré
~
~
Rennes : Réalisée par l'écomusée,
centre d'interprétation de l'histoire
de l'agriculture et du monde rural,
cette exposition raconte la lente
structuration du système de formation
agricole, depuis l'ouverture de
l'école d'agronomie de Gros Malhon,
à Rennes en 1832. C'est aussi
l'occasion de retracer l'évolution
des rapports entre l'homme, l'animal
domestique, le monde végétal
cultivé et les changements qui ont
affecté notre société et déterminé
l'évolution rurale de notre pays.
Rens.: Alison Clarke,
tél. 02 99 51 38 15.
Ouverture en mars 2000/
Haliotika
Le Guilvinec (29) :
En partenariat
avec les acteurs de
la filière pêche, la ville du Guilvinec
a décidé de se doter d'un espace de
découverte et d'interprétation de la
pêche en mer. Cet espace d'exposition
novateur sera le lieu privilégié
pour comprendre, sentir et vivre le
métier de marin-pêcheur, ainsi
qu'un lieu de promotion des entreprises
de la filière pêche et des produits
de la mer.
► Rens. :Philippe Gredat,
tel. 02 98 58 28 38.
Formation
Un IUT à Pontivy
Pontivy (56) : Bernard Baucher,
PDG de Linpac Plastics, ainsi que
Michel Houdebine, PDG de Houdebine
SA, président de Loudéac-
Pontivy Plus, ont présenté le
contenu du nouveau département
d'IUT (Institut universitaire technologique)
de Pontivy : Génie chimique-
génie des procédés : option
"Bio-procédés". Gilles Prado, responsable
du projet, est désormais
affecté à l'UBS (Université Bretagne
sud).
► Rem. : Agnès Loin,
tél. 02 98 63 43 17.
Haliotika
Vous organisez une
conférence, un colloque,
une exposition ou une
formation scientifique ?
Vous souhaitez faire
connaître vos travaux
de recherche,
vos innovations ?
Contactez-nous
pour paraître dans le
prochain Réseau !
Tél. 02 99
fax 02 99
35
35
28
28
22,
21,
e-mail lespace-dessciences@
wanadoo.fr
Les rendez-vous du futur
Pour la quatrième année consécutive,
l'université Rennes 1
organise "Les rendez-vous du
futur" : cycle de conférences
pour mieux comprendre les
mutations d'aujourd'hui et les
enjeux de demain, face à l'évolution
des technologies, à la mondialisation
de l'économie et à
l'accélération des avancées scientifiques
et techniques.
31 janv./
Les médicaments du futur
Rennes : L'université Rennes 1
organise une conférence avec
Pierre Potier, pharmacien, médaille
d'or du CNRS 1998, en partenariat
avec la Chambre de commerce et
d'industrie de Rennes. Elle se
déroulera à 18 h 30 à la faculté de
droit et de science politique, entrée
libre.
► Rens. : Clarence Cormier,
tél. 02 99 25 36 11.
Rennes Atalante
o L'ESPACE
DES
SCIENCES
Rennes
Atalante et
l'Espace
des sciences
signent une
convention
Le président de la technopole
Rennes Atalante, Jacques de
Certaines, et le président de
l'Espace des sciences, Paul
Tréhen, viennent d'unir leurs
deux structures de promotion et
d'animation des sciences et des
technologies. La convention
signée ce mardi 14 décembre
tend à formaliser les synergies
existantes entre la technopole
rennaise, qui représente aujourd'hui
quelque 6000 emplois
répartis dans 121 entreprises, et
l'Espace des sciences, qui met
au service de la technopole son
expérience en matière d'information,
de vulgarisation et
d'animation scientifique.
Parmi les nouvelles actions
envisagées par la convention,
citons la réalisation systématique,
à chaque nouvelle exposition
présentée à l'Espace des
sciences, d'un panneau présentant
les entreprises de Rennes
Atalante concernées par le
thème de l'exposition. Citons
également l'offre d'un abonnement
de découverte de 6 mois à
la revue Réseau pour chaque
nouvelle entreprise qui s'implante
sur le site.
Rens. : Magali Cohn,
tél. 02 99 35 27 71,
http://www.espace-sdences.org
► Rens. : Corinne Bourdet,
tél. 02 99 12 73 73,
http://www.rennes-atalante.fr
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Conférences
À l'université
Rennes 1
Jusqu'à mai 2000/NTIC: nouveaux usages, nouveaux métiers
L'IUT de Lannion, le Critt Électronique, la technopole Anticipa,
l'ENST Bretagne et le musée des télécommunications de Pleumeur-
Bodou organisent un cycle de 6 séminaires scientifiques, de décembre
1999 à mai 2000, sur le thème : Nouvelles technologies de communication
: nouveaux usages ? nouveaux métiers ?
20 janvfrélévisions locales et de pays
Pleumeur-Bodou (22) : Le musée des télécommunications propose une
conférence sur les mutations et développements technologiques des télévisions
régionales, d'une région européenne à l'autre. Guy Pineau, chercheur à
l'Institut national de l'audiovisuel (INA), interviendra au cours de cet aprèsmidi,
qui sera animé par Philippe Dupuis du Critt Électronique.
Rens. et inscriptions : Sylvie Brichet, tél. 02 96 05 82 50,
http://www.technopole-anticipa.com
FORMATION CONTINUE
E nrerem T
.sb
~~J ERS/T5
•Cr.
~ m
\~S. c;çN~~•
UNIVERSITE DE RENNES 1
UNE ÉCOLE D'INGÉNIEUR
VOUS OUVRE SES PORTES...
OJ~JO jj~~j~j ~I v
JV[1n El1VZZlrti1J
Diplôme d'ingénieur dans l'une des 3 filières
suivantes :
J Electronique et Informatique Industielle (EII)
Logiciel et Système Informatique (LSI)
Optronique
Formation ouverte aux techniciens ayant au
moins 3 ans d'expérience professionnelle
Cycle préparatoire à temps partiel adapté
à chaque candidat
Cycle terminal à plein temps : 15 mois de
formation + un stage long en entreprise
http://www.enssat.fr
Claudine LEGRAND tél. 02 96 46 66 33
QUI A DIT ?
I.
Louis Pasteur, 1822-1895. •
Réponse de la page 4
BRÈVES
Du 18 au 22 janv./Des villes d'avenir, des villes pour tous
Rennes : L'Office social et culturel Rennes organise, en collaboration avec de
nombreux partenaires dont la ville de Rennes, les premières rencontres régionales
des villes et des agglomérations bretonnes. Cet événement aura lieu à la
maison du Champ-de-Mars et traitera du développement durable des villes,
sans compromettre les capacités des générations futures, à répondre à leurs
propres besoins.
Rem.: Cécile Sourice, tél. 02 99 85 89 52.
® L
Pour découvrir Réseau,
chaque mois, c'est facile...
Abonnez-vous!
2 ANS (22 numéros) 1 AN (11 numéros)
Tarif normal
360 F au lieu dei`* 200 F au lieu de220 *
soit 4 numéros gratuits soit 1 numéro gratuit
Tarif étudiants (joindre un justificatif)
180 F au lieu de 440-V 100F au lieu de228-*
soit 13 numéros gratuits soit 6 numéros gratuits
Tarif étranger ou abonnement de soutien
500 F 300 F
*prix de vente au numéro.
BULLETIN D'ABONNEMENT
OUI, je souhaite m'abonner à Réseau
1 AN q 2ANS
Tarif normal
Tarif étudiant (joindre un justificatif)
Tarif étranger ou abonnement de soutien
Nom
Prénom
Organisme/Société
Secteur d'activité
Adresse
Tél. Fax
Je désire recevoir une facture
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de l'Espace des sciences-CCSTI,
à retourner à : L'Espace des sciences-CCSII, 6, place des Colombes, 35000 Rennes. (J t
19 et 20 janv./
Les gestions locales de l'eau
Rennes : Proposé par la Région Bretagne,
en partenariat avec le réseau
Ideal (Information sur le développement
de l'environnement et de
l'aménagement local), l'Agence de
l'eau ainsi que la ville de Rennes, ce
salon se tiendra au parc des expositions.
Son objectif est de mettre en
place un véritable lieu de rencontres
et d'échanges, sur la thématique de
l'eau, pour les collectivités et leurs
partenaires.
O. Rens.: M. Advacat,
tel 01 45 15 09 09.
Du 20 au 22 janv./
Azimut
IIIMMUT Brest : Les responsables
des lycées
et des Centres d'information et
d'orientation du Finistère s'associent
pour organiser Azimut qui se
tiendra au parc de Penfeld. Ce salon
a pour but d'informer les lycéens sur
les différentes formations et orientations
professionnelles par le biais de
rencontres avec des enseignants du
supérieur, des étudiants, des professionnels
ainsi que des chefs d'entreprises.
► Rets. : Yves Jullien,
tél. 02 98 44 31 74.
Du 3 au 5 fév./
Le patrimoine culturel
et la mer
Nantes : Le groupe de recherche sur
le droit du patrimoine culturel et
naturel, composé de l'université de
Paris sud et de l'université de
Nantes, organise un colloque inter-
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
national sur les aspects juridiques et
institutionnels du patrimoine culturel
et de la mer. Ce colloque se tiendra
dans l'amphithéâtre D de la
faculté de droit.
Rens.: Fabienne Leroy,
tél. 02 40 20 65 06.
Du10 au12févJ
Salon du lycéen et de
l'étudiant (11e édition)
Rennes : Situé au parc des expositions,
ce salon est une bonne occasion
pour s'informer sur les filières
et formations de l'enseignement
supérieur, ainsi que sur les débouchés
et métiers correspondants.
► Rens. : Mme Mazureau,
tél 02 99 36 37 37.
Code postal Ville
o L'ESPACE
SCIENCES
Les rendez-vous de l'an 2000
Les prochaines expositions de l'Espace des sciences
Du 10 janvier au 8 avril/
2 temps 3 mouvements (voir ci-dessus)
Du 17 avril au 12 août/
En route pour la science, avec le ticket d'Archimède
Présentée dans les couloirs des métros parisiens (d'où le titre "ticket
d'Archimède"), cette exposition de panneaux répond aux questions
les plus fréquentes : pourquoi la mer est-elle salée ? Comment se forment
les tornades ? Questions et réponses s'interpellent autour de six
thèmes : le bestiaire, les illusions, la couleur, le foot, la météo et l'eau.
Du 4 septembre au 30 décembre/
Électricité : qu'y a-t-il derrière la prise ?
Réalisée en collaboration avec la Cité des sciences et de l'industrie et
EDF, cette exposition retrace l'histoire de l'électricité, avant d'entraîner
le visiteur à la découverte d'une vingtaine de manipulations interactives,
pour petits et grands.
► Rens. : L'Espace des sciences, tél. 02 99 35 28 20, http://www.espace-sciences.org
Exposition
Exposition du 10 janvier au 8 avril 2000
0 2 TEMPS
~, 3 MOUVEMENTS
L'Espace des sciences
Centre Colombia - Rennes
Exposition itinérante
L'os vivant
Notre squelette, alliance du minéral
et de l'organique, est l'objet
d'un processus ininterrompu
de formation et de destruction
osseuses. Ce n'est pas une charpente
inerte. Ne nous fions donc
pas à son apparence : l'os est bien
vivant ! Les étapes de sa vie, ses
performances mécaniques et biologiques
sont présentées dans cette
exposition. La prévention et le traitement
de l'ostéoporose y sont
abordés, ainsi que les réponses
actuelles de la médecine aux maladies
de l'os : prothèses, greffes, biomatériaux.
Cette exposition est disponible auprès de l'Espace des sciences au tarif
de 1500 F par semaine, 5 000 F par mois, transport et assurance à
votre charge. Possibilités de réduction pour les communes bretonnes.
Rens.: Frédéric Primaue, service diffusion, tél. 02 99 31 79 10,
e-mail lespace-des-sciences.diffusion@wanadoo.fr
Le nouveau
stand parapluie
de l'Espace des
sciences.
o L'ESPACE
DES
SCIENCES
cene. d.
~itr
Sci.nc'il9ur
r.chnia•.
Industrielle
e spec
r4A
sciences• org ~
9
EN JANVIER, L'ESPACE DES SCIENCES VOUS PROPOSE...
Rennes, Colombia,
du 10 janvier au 8 avril/
2 temps, 3 mouvements
Rennes : L'Espace des sciences présente
sa nouvelle exposition intitulée
"2 temps, 3 mouvements :
découvrir la physique en s'amusant".
Cette exposition permet de
comprendre comment un avion
vole, comment les fusées sont propulsées
ou quel est le principe de la
roue. L'Espace des sciences vous
invite à découvrir ces principales
lois physiques et les liens que l'on
peut établir entre force, énergie et
mouvement. Cette exposition est
réalisée par l'Espace culturel lyonnais
d'animation technologique et
scientifique (Eclats).
Rens.: L'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 28,
http://www.espace-sciences.org
L'Espace des sciences
s'affiche...
Afm d'être mieux signalé dans les
salons, colloques et manifestations
de culture scientifique, en Bretagne
et ailleurs, l'Espace des sciences
vient d'acquérir un nouveau "stand
parapluie", sorte de toile décorée par
"Ad'Hoc Communication" et tendue
sur une armature se dépliant,
comme un parapluie, pour communiquer
sur les différentes activités :
animations, expositions, éditions,
itinérance et conférences.
Rens.: Magali Colin, tél. 02 99 35 21 71,
http://www.espace-sciences.org
Conférences
Les mercredis
de la mer
L'Ifremer (Institut français de
recherche pour
l'exploitation de
la mer) et l'Espace
des sciences
s'associent pour
vous présenter
les recherches
menées dans le
domaine marin,
à la maison du Champ-de-Mars à
20 h 30, entrée libre.
12 janvier/
Information géographique
et mise en valeur de la mer
côtière
Lionel Loubersac, chercheur au
service "Applications opérationnelles"
de la direction de l'environnement
littoral du centre Ifremer de
Brest
Rennes : L'évolution des connaissances
scientifiques, comme des
technologies associées, permet
désormais de mieux représenter le
territoire côtier en combinant ses
grandes composantes et les relations
qui s'y exercent entre processus
physiques, biologiques et humains,
en accord avec les réglementations.
9 février/
Activité hydrothermale
sous-marine et ressources
minérales potentielles
des océans profonds
Yves Fouquet, chercheur
au département Géosciences
marines du centre Ifremer de Brest
Rennes : L'activité hydrothermale
dans les océans profonds est connue
depuis 20 ans. Aujourd'hui, plusieurs
compagnies minières internationales
commencent à s'intéresser à
ces ressources minérales potentielles,
afin d'en faire l'inventaire et
l'évaluation. De nouveaux enjeux
sont ouverts entre une recherche
fondamentale et une recherche
appliquée.
Rens.: l'Espace des sciences,
tél. 02 99 35 28 20,
http://www.espace-sciences.org
Prochains dossiers dans Réseau : Les déchets en Bretagne,
l'année des mathématiques, l'automobile communicante...
RÉSEAU 162 • JANVIER 2000
Générale des Eaux Direct
un nouveau service pour être encore
plus proche de vous
'1"
0
Aujourd'hui, vous pouvez simplifier et accélérer de chez vous toutes les démarches
concernant votre eau. Il vous suffit d'appeler Générale des Eaux Direct, le nouveau
service de Générale des Eaux. Une équipe connaissant parfaitement votre dossier et
votre région est à votre disposition au 0801 463 972*. Informations sur votre eau ou
sur votre compte, demande de branchement, de nouvel abonnement, de résiliation ou
de rendez-vous avec l'un de nos techniciens, interventions urgentes, qualité de l'eau...
Avec Générale des Eaux Direct, vos demandes sont traitées immédiatement et toutes
vos questions trouvent leur réponse.
'Numéro Azur. Prix d'un appel local. Service étendu progressivement à l'ensemble des habitants des communes desservies par Générale des Eaux.
o8oi 463 972
7
~o
~
o
~
GÉNÉRALE ~
deseaux
V
3
â
o-
~
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest