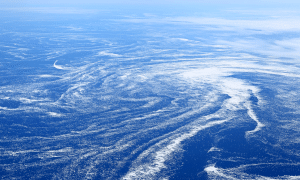Les innondations
~ ~L ~1 ~• . ' r •
E ET INNOVATION EN 6RETAGNE
,.. . . ~-
la
chimie
naturellement
Du 11 septembre 2002
au 22 février 2003
IIALeat fr°ancéÎ~ BRETAGNE
~• MET OnPoOesLE
'.7 Où emest la Bretagne? r)
réé en 1990, l'Institut français de l'environnement (Ifen)
publie, tous les quatre ans, un épais rapport (600 pages)
faisant-te point sur l'état de l'environnement. À l'occasion de la
sortie de l'édition 2002, Découvrir a voulu faire le point, avec l'aide
de l'Ifen, sur la situation de notre région. Paysage en cartes.
Supplément de la revue Sciences Ouest N°195 Janvier 2003
espace
des sciences
0
4
4 KJHJ
/20z -KJHOH
-54-POLL4C
H/55/657t
JLJKLKJFIT*i
L'Ifen
en._;
réé il y a dix ans, l'Institutfafiçais de
l'environnement est un établissement
public national, basé à Orléans, placé sous la
tutelle du ministre de l'Environnement. Cet
organisme anime et coordonne la collecte, le
traitement et la diffusion des données
scientifiques etcstatistiques concernant
l'enyironnement et les risques naturels et
technologiques.
"L'environnement en France 2002" est le
troisième rdppôrt publié par cet organisme. Il'
couvre la période allant des tempêtes de '.
1999 à la catastrophe Total-AZF de Toulouse,
en passant ppr le naufrage de l'Erjka, la crise
de la vache f6Né,_l'aocidént du tunnel du Mont-
Blanc, les inondations de la Somme,
l'apparition d'OGM dans nos champs...
Curieusement, et malgré cette "richesse"
en événements catastrophiques, on ne
constate pas d'aggravation dans les chiffres
relatant les émissions ou la concentration de
pollution (malgré un fort accroissement des
transports -jusqu'à +8%o pour le trafic aérienet
une forte croissance économique,: +4%).
Une explication pourrait venir de"ce que Ta
période 1999-2001 correspond à la phase de
mise en peace des directives_européèrines sur
la protection de l'eau et.le réduction des
pollutions automobiles.
Mais attention, s'il n'y a pas aggravation de
la situation, il' ne faut pas croire cependant
que tout va bien ! 30 % des eaux
superficielles sont de mauvaise ou très
mauvaise quâtlté;et, en la matière, la
Bretagne fait figure de championne. Les
qua ttEéS de déchets ne cessent de croître,
leS eaux marines sont en mauvais état et
40% des stocks de poissons commerciaux
sont surexploités. Bref, si l'on devait donner
une appréciation à l'élève France : en progrès
mais peut et doit mieux faire. •
"r; 03 r!
l
• E-,11. vars. • Vlan du set • Coritocts • Piouvoeutbs • ...m. •
institutfrançais
de l'environnement
vublicallons
Basas d'Inlonuall.,
Indic/fleurs
ml.
;~~,z~,
, .
Copyright e.F,, • Inform
Toutes les cartes présentées dans ces pages
sont extraites de L'environnement en France,
Éd. La Découverte, 600 p., 42 €. Elles nous ont
aimablement été fournies par l'Ifen.
Pour en savoir plus : Ifen, 61, bd Alexandre-
Martin, 45058 Orléans Cedex 1. Vous pouvez
également consulter le site : http://www.ifen.fr
2
~
ifen
Index général de qualité de l'eau
des cours d'eau, 1997-1999
Excelail (8. 10) f?f •
ID Bon (6 -8)11.31
D Moyen (4 • 6) po(
13 M2doueQ- 47f/r1
M3Waa(6.2)f0f
D Non dAtgmn2 f01
[nombre de bassrr,[
rY/4eQA1.
l'eau
Voici trois cartes qu'il est intéressant de comparer. Tout d'abord, on
le constate, la qualité des eaux (rivières) de Bretagne est
"médiocre". Cela tient essentiellement au fait qu'en Bretagne, une
quantité énorme d'azote organique (l'azote contenu dans les lisiers issus
des élevages est directement assimilable par les plantes) est épandue
comme engrais. Notre région est leader en matière d'élevage, et il faut
bien éliminer les déjections ainsi produites. À titre d'exemple, un porc de
70 kg produit quotidiennement, selon son mode d'alimentation, environ
6 litres de lisier. Sachant que l'on dénombre chaque année 20 millions
de porcs, on peut estimer la production régionale de lisier à plus de
43,8 milliards de litres/an ! Par ailleurs, pour nourrir ces animaux, les
agriculteurs font pousser maïs, pommes de terre... Et pour que ces
plantes croissent, ils épandent du lisier..., mais utilisent également des
produits chimiques contre les mauvaises herbes et contre les nuisibles
(insectes, champignons...). Si une partie de ces produits est absorbée
par les plantes, une plus large partie est lessivée par les pluies, et vient
s'accumuler dans le sol et dans les rivières.
L'état physico-chimique des cours d'eau
Les nitrates dans les eaux souterraines L'azote répandu par région en 1997
Altération de la qualité de l'eau par les MBates, réseau national
des eaux souterraines, 1998-2000
Nikê Seub Nombre de
ires bane <10mg4 249
Bonne 10-20m94 117
O Passable 20-50mg4 410
i Mldnae 50.100mg1 85
O Memmm > 100 mgt 6
Pant 14vE5
cru J vites
Sala u,a RANI des rdrmrsxu eirarmrc
.....f ra0.teea 4 s aere Mers)
406
Quantité d'azote
en kilogrammes
par hectare
fertilisable
n 170 sa
1111 150 a 170
1005150
D 42 4100
re.991 KM
0 50 160 150 260 250 300 350 400
Nombre de soes
AlV anKA?I mqenQM,nKn tl[. SAS
P. p.Ge ,Pr~.'a+pcMa
~~.
O ACar'rl.•
03 ara task`
Ama ma,os
Asia rat
Ama Vos Sal
tiras os km&na .
ai -
Nad-Parer £a'w~
ItePe-Prasce
NhOneAlpes
1042.64
Aq 12ine
MkPyse4tm
Pto.ence- Alpes.
Caed'Atu4
1farM-Normmde
Ch2mpagi4ALdPme
AISMe
harde
Coire
Parsde;a-ione
Franche-Congé
Base.Namatde
bOrgDgle
Pulal~Ch3enles
trgledocarasvllar
BW.P°
Arm+gre
Umaain
Cale
0064101.1
Une solution consisterait à transformer le lisier en engrais, et à
exporter celui-ci dans les régions manquant d'azote organique.
Cette solution est cependant difficile à mettre en oeuvre. Outre le
coût de telles installations (plus de 10 millions d'euros en
moyenne), il n'est pas aisé de collecter les lisiers, fientes et
autres matières organiques issus de l'industrie agroalimentaire ;
et puis, peu de communes acceptent d'accueillir de telles usines
sur leur territoire notamment par peur des odeurs, des
pollutions...*
Sur la troisième carte, on a la surprise de voir que les nitrates
(sel d'azote) ne sont pas connus en ce qui concerne les eaux
souterraines. Première explication : le sol granitique de la
Bretagne est imperméable et il n'existe donc pas de nappes
souterraines. Deuxième explication sur laquelle travaillent des
scientifiques bretons (Inra, Caren, Géosciences) : les échanges
entre les nappes souterraines et les eaux superficielles en
période de crue et la dénitrification des aquifères profonds. •
*Cette question est très complexe et a fait l'objet de différents rapports en
Bretagne, par l'Inra ou le Conseil scientifique régional de l'environnement.
Les sols Les sites pollués
sur le territoire français L'aléa d'érosion des sols
i la qualité de l'eau est médiocre, on a
plaisir à constater que notre région
compte assez peu de sites pollués en ce
qui concerne les sols (moins de 50). Attention
cependant à ne pas se réjouir trop
vite... Cela tient au fait qu'il y a peu d'industries
polluantes (comme c'est le cas
dans le Nord avec le charbon), mais cela ne
signifie pas pour autant que les sols sont
en bonne santé. L'érosion due à l'activité
agricole est moyenne à très forte en Bretagne.
Par ailleurs, toujours du fait des
épandages de lisier, on constate que les
sols contiennent de plus en plus de phosphore
et de métaux lourds, comme le
cuivre, le zinc ou le cadmium. Alors que,
dans les années 60, les sols bretons
étaient réputés pour leur déficit, notamment
en cuivre, on constate aujourd'hui,
dans de nombreux endroits, des excédents.
Certes, on est encore loin des
doses toxiques, mais si rien n'est fait, on
considère que d'ici 20 ans, de nombreuses
terres seront inutilisables... •
Les principales catastrophes
pétrolières
a Bretagne possède le triste record
du plus grand nombre de catastrophes
pétrolières dans l'hémisphère nord. Il est vrai
que sa situation géographique la place à une
charnière importante du transit entre le nord
et le sud de l'Europe. Près de 700 millions de
tonnes de produits chimiques et pétroliers
transitent chaque année au large de ses
côtes ! Ce sont plus de 50000 bateaux qui
empruntent chaque année le rail d'Ouessant,
là où se sont produites la plupart des catastrophes.
Ce trafic, en continuelle expansion,
fait qu'en 2000, 321 pollutions marines
(essentiellement dues à des "dégazages"
sauvages, c'est-à-dire le nettoyage en pleine
mer des cuves des pétroliers) ont été constatées
contre... 195 en 1999 ! Cette année-là,
la catastrophe de l'Erika a souillé 450 km de
côtes.
Le littoral
~., .
out est lié... Le phytoplancton (ensemble des algues microscopiques qui
flottent dans les eaux) est le premier maillon de la chaîne alimentaire
marine. Sur 4 000 espèces connues, 250 environ sont capables de se
développer de façon importante, au point de former des eaux rouges, brunes ou
vertes. Ces "explosions" (que les scientifiques appellent "blooms") sont, dans
le cas des marées vertes, particulièrement amplifiées par l'apport d'éléments
nutritifs, comme... l'azote organique, arrivant en mer dans l'eau des rivières !
Ces blooms causent de nombreux dégâts : consommation excessive de
l'oxygène dissout (eutrophisation) qui peut entraîner la mort par asphyxie des
animaux marins ; mais surtout, 70 espèces de phytoplanctons produisent des
toxines (phycotoxines). Certaines sont nocives, d'autres sont mortelles pour la
faune marine ; d'autres, enfin, en s'accumulant dans les coquillages, peuvent
être dangereuses pour les consommateurs. À noter toutefois : les excédents
de nitrates et phosphates ne seraient pas les seuls responsables de ces
pullulations qui pourraient aussi résulter de la convergence d'autres facteurs
comme le transport de nouvelles souches dans les milieux.
Les phycotoxines sur le littoral Nombre de blooms par site
(période 1991-2000) (période 1991-2000)
•
MAI
http://www.ifen.fr
Vous retrouverez sur le site de l'Ifen un certain
nombre de cartes issues du rapport annuel, ainsi
que plusieurs textes explicatifs. Passionnant.
http://www.ode22.org
Un nouveau site en Bretagne, très intelligent, qui
présente de nombreux indicateurs sur l'environnement
dans la région.
http://futura-sciences.com
Ce site offre de nombreux dossiers destinés aux
6-14 ans, dont plusieurs sur l'environnement. Une
belle encyclopédie, visitée par 3 500 personnes
chaque jour.
http://www.bretagne-environnement.org
Une version toute neuve du portail Internet sur l'environnement
en Bretagne qui propose notamment
des articles sur l'eau, le littoral, le patrimoine naturel,
le sol, le sous-sol, l'air...
Découvrir, supplément gratuit de Sciences Ouest. ISSN 16293185. CEspacedes sciences, 6, place des Colombes, 35000 Rennes -redaction@espace-sciences.org - httpih u tespace-scie Président del'Espace des sciences: Paul Tréhen. Directeur de la publication: Michel
Cabaret Rédacteur en chef délégué : lean François Collinot (ré). 02 96 67 79 74 102 96 67 71 38). Dessinateur: Nicolaz. Crédit photos : DR, JFC. Découvrir est publié grâce au soutien de la Région Bretagne, du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie,
des départements du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes, de la Direction régionale des affaires culturelles et du Fonds social européen. Edition: l'Espace des sciences. Réalisation: Pierrick Remit création graphique, 35510 Cesson-Sévigné. Impression: CPI, 35830 Bettors.
rARVli7F Z'OLi
Tirage du n°195:
4 500 ex.
Dépôt légal n°650
ISSN 1623-7110
EN BREF 4/5
GROS PLANActua lité
6e édition des Entretiens science et
éthique de Brest
Les milieux extrêmes, d'un monde
à l'autre 6/7
GROS PLANLaboratoire
Météorologie
MétéoSat : deuxième génération 8
DOSSIER
Le risque inondation 9
Comment s'exprime le risque
inondation en Bretagne 10
Les PPRI : Plans de prévention
du risque inondation 11
Le Service d'annonce de crues
du bassin de la Vilaine 12/13
Équipe pluridisciplinaire Plan Loire :
des spécialistes du risque inondation ....14
Institution d'aménagement de
la Vilaine : des propositions
d'aménagement contre les crues 14
L'implication de chercheurs bretons
dans la compréhension
des inondations 15
"On n'a jamais connu ça" 16
Pour en savoir plus 17
GROS PLANComment ça marche ?
Le moteur à air comprimé 18
À L'ESPACE DES SCIENCES 19
AGENDA 20/21
L'environnement
en France
0:~
SrïOnrPç f31)P•ct ,c!r tntPrlint
www.espace-sciences.org
4
1110ak
MOTO COUVE ANAECxWSi
PAUL TRÉHEN, PRÉSIDENT DE L'ESPACE DES SCIENCES
LES CATASTROPHES
NATVRELLES SONT-ELLES
PRÉVISIBLES
Les ouragans, les sécheresses estivales et les inondations ont frappé la Bretagne à
plusieurs reprises depuis quelques décennies. Ces événements catastrophiques
marquent profondément ceux qui les subissent. Des efforts importants sont faits en
matière de prévisions météorologiques afin d'en diminuer les effets dévastateurs. Les
progrès réalisés dans ce domaine ne suffisent encore pas et de nombreux exemples
récents montrent la brutalité et souvent la soudaineté des éléments ainsi déchaînés.
La fréquence et la nature des épisodes climatiques que nous connaissons depuis une
dizaine d'années constituent des coïncidences qu'il est de plus en plus difficile de classer,
par habitude, sous la rubrique des événements purement aléatoires. Les analyses
statistiques portant sur plus d'un siècle de mesures n'autorisent à ce jour aucune relation
significative, car l'échelle de temps est encore insuffisante et le restera longtemps encore.
Par ailleurs, les aménagements qui ont bouleversé les paysages bretons depuis 50 ans
ont profondément modifié la circulation des eaux de surface et les capacités de
régulations des bassins versants et des sols dans les espaces urbanisés ou remembrés.
Il existe des modèles hydrodynamiques pour en rendre compte.
Qu'il s'agisse de changements climatiques, de la circulation des eaux, ou des paysages,
les processus mis en jeu sont très complexes. Ils résultent de la convergence de
nombreux facteurs dont la connaissance nécessite l'élaboration et la maîtrise de réseaux
de données aujourd'hui encore cloisonnées et sous-exploitées.
Nous devons être informés des efforts de la recherche dans ces domaines et c'est le
rôle de l'Espace des sciences que d'y contribuer par l'intermédiaire de ce dossier, mais
aussi grâce à une exposition itinérante réalisée récemment et tout juste disponible à la
location.
La qualité des outils de prévision des intempéries est également importante et ce
numéro de Sciences Ouest montre que la Bretagne est active sur tous les fronts, comme en
témoignent les travaux de l'Institut supérieur d'électronique de Brest, avec la mise au
point des stations de réception des données d'un satellite destiné à Météo France.
Enfin, vous trouverez également au sommaire de la revue une très belle double page
sur les milieux extrêmes -terre, mer, espace-, thème des derniers entretiens scientifiques
qui ont eu lieu à Brest à la fin de l'année dernière.
Bonne lecture et meilleurs voeux de bonne année à toutes et à tous. n
ap /J-/ cP 47,
-d,s-moi c'est-quoi ce.
dé,$uisement- SvoYesque e,n cas d +nandahon... c1ifuiseves en Père Nloët?
SCIENCES OUEST est rédigé et édité par l'Espace des sciences, Centre de culture scientifique technique et industrielle (Association)
Espace des sciences, 6, place des Colombes, 35000 Rennes - nathalie.blanc@espace-sciences.org - http://www.espace-sciences.org -
Tél. 02 99 35 28 22 - Fax 02 99 35 28 21 n Président de l'Espace des sciences : Paul Tréhen. Directeur de la publication : Michel Cabaret.
Rédactrice en chef: Nathalie Blanc. Rédaction : Christelle Jourdren, Vincent Derrien. Comité de lecture. Christian Willaime (physique-chimie-matériaux),
Gilbert Blanchard (biotechnologies-environnement), Michel Branchard (génétique-biologie). Abonnements : Béatrice Texier. Promotion : Magali Colin.
Publicité : AD Media - Alain Diard, tél. 02 99 67 76 67, e-mail info@admedia.fr n Sciences Ouest est publié grace au soutien de la Région Bretagne, du
ministère délégué Recherche et Nouvelles technologies, des départements du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de la Direction régionale
des affaires culturelles et du Fonds social européen. Édition : l'Espace des sciences. Réalisation : Pierrick Bertôt création graphique, 35510 Cesson-Sévigné.
Impression : TPI, 35830 Betton. • ,.ar-e.n
-it Pteur •. i me prépare... - el- s'a, r1eitc,
FINISTERE .iu„ rr.
1111,1*
tet6ercee et uoeelles
tetleolepes
Rennes Atalante : enquête emploi 2002
Pour son enquête emploi 2002, la technopole Rennes Atalante
a interrogé 222 entreprises de technologies, l'ensemble de ces
sociétés totalisant 13 002 personnes. Résultats : entre octobre
2001 et 2002, 888 emplois ont été créés, pour 370 supprimés, ce qui fait un
solde positif de 518 nouveaux emplois. Et si la technopole a vu 12 de ses
entreprises cesser leur activité (dont Actema qui, avec ses 43 emplois en
moins, a représenté la suppression la plus importante), les activités
technologies et de recherche résistent cependant à la crise. En effet, même si
beaucoup de projets ont été annulés ou reportés, 12 nouvelles entreprises
se sont quand même implantées : 9 étant des créations, 3 des entreprises
extérieures. Par ailleurs, Rennes Atalante dynamise l'immobilier
d'entreprises rennais : plusieurs bâtiments sont en cours de construction sur
le site agroalimentaire - environnement de Rennes Atalante Champeaux,
l'extension de Rennes Atalante Beaulieu sur la Zac Saint-Sulpice se poursuit
et le site Rennes Atalante Villejean, dédié au biomédical, connaît également
des évolutions.
-►Rens.: Rennes Atalante, tél. 02 99 12 73 73, www.rennes-atalante.fr
Du côté des labos
roulis très faibles, vitesse relative fidèle
à nos prévisions et aucun problème de
matériel", relate Nicolas Seube, responsable
du projet. Et même si les
performances du planeur sont
encore perfectibles, cette réussite
prouve aux partenaires scientifiques
(Marine nationale, Ifremer) et industriels
de l'Ensieta, la capacité de
l'école à concevoir, intégrer et
mettre au point jusqu'au bout un
système au concept original.
-►Rens.: Nicolas Seube,
tél. 02 98 34 88 88,
seube@ensieta.fr
Premier vol en mer
réussi !
Le Service hydrographique
et océanographique
de
la Marine (Shom)
a organisé en
rade de Brest, le
3 décembre dernier, une mission
d'essais du prototype de planeur
développé par le département
d'automatique de l'Ensieta"' (voir
Sciences Ouest n° 190, juillet/août
2002, page 18). Un premier "vol" en
mer réussi, "en totale conformité avec
4 nos attentes : dérives de cap et de
Échos
Planète sciences
A l'occasion du 40' anniversaire, de l'association nationale,
l'Association nationale sciences techniques jeunesse
(ANSTJ) -et l'ensemble des associations du réseau Sciences techniques
jeunesse - changent de nom pour devenir : Planète sciences. Un choix
déterminé par un besoin de lisibilité et une volonté de mieux communiquer,
d'affirmer une appartenance à un réseau qui a pour but de participer en tant
qu'acteur citoyen à la diffusion de la culture scientifique et technique pour
les jeunes en France et en Europe. Une phrase signature renforce ce nouveau
nom : une aventure pour les jeunes. LANSTJ est en effet née en 1962 avec cet
objectif de développer la pratique des sciences et techniques chez les 8 à
25 ans. Et chaque année, 100000 jeunes participent aux activités : séjours
de vacances, interventions polaires, nuits des étoiles, concours de robotique
E = M6, festival européen de l'espace, rencontre météo jeunes, rencontres
nationales de l'environnement..., le tout avec de nombreux partenariats avec
diverses institutions : musées, entreprises du monde scientifique...
-'gens.: Planète sciences, tél. 01 69 02 76 10, www.planete-sciences.org
nncés Si~e
Du côté des entreprises Les échos de l'Ouest
Sensibiliser
la population au
"bien manger"
L'enseigne rennaise "La Mouette" a
organisé, le 5 décembre dernier,
une journée événement sur le
thème du "bien manger", au lycée
Saint-Vincent de la Providence
(Rennes). L'objectif : replacer l'acte
quotidien du repas dans un
contexte de plaisir et de sérénité
tout en apportant des réponses
concrètes aux questions des
consommateurs, notamment en
terme de traçabilité. Le débat fut
ouvert dès le début de l'après-midi
entre le docteur Christian Recchia,
expert en qualité et sécurité des
filières agroalimentaires et enseignant
à l'École centrale, le professeur
Christian Cabrol, chirurgien
émérite du coeur, membre de l'Académie
nationale de médecine et
des élèves de seconde du lycée, sur
la question : "Pourquoi est-il important
de manger équilibré ?". Autre
temps fort de la journée, la conférence
sur les enjeux de l'équilibre et
de la sécurité alimentaire, avec la
participation du docteur Recchia,
du professeur Cabrol et de Patrice
Roche, P-dg de La Mouette, a été
suivie par plus de 500 personnes.
-,gens.: Christian Recchia,
ca:prepar@wanaddo.fr,
Patrice Roche,
patrice.roche@lamouette.fr
Le 6e PCRDT a pour objectif de
renforcer la compétitivité et le dynamisme
de la recherche européenne
et met pour cela en avant les
domaines suivants : génomique et
biotechnologies pour la santé,
technologies de la société de
l'information, nanotechnologies et
nanosciences, matériaux multifonctionnels
basés sur la connaissance,
nouveaux procédés et dispositifs de
production, aéronautique et espace,
qualité et sûreté alimentaires, développement
durable, changement
planétaire et écosystèmes, citoyens
et gouvernance dans une société
basée sur la connaissance.
-,gens.: Université de Rennes 1,
service communication, Clarence
Cormier, tél. 02 23 23 36 12,
clarence.cormier@univ-rennesl.fr
La Chine en Bretagne
Une délégation d'universitaires
chinois a passé
cinq jours dans notre
région, dans le cadre d'un partenariat
existant depuis 1985 entre la
Bretagne et la province du Shandong
en Chine. Xu lianpei, président
de l'université de Qingdao et
trois professeurs respectivement en
charge du département de biologie,
de l'Institut des langues étrangères
et d'un enseignement du français,
ont sillonné la Bretagne visitant le
Ciel"' à Brest, l'Isuga'°' à Quimper,
ainsi que l'UBO151, l'École supérieure
de commerce de Brest et un lycée
de Pontivy (56). Leur parcours s'est
achevé le 10 décembre au Conseil
régional de Bretagne avec la signature
de lettres d'intention entre ces
Visite du commissaire
européen de la recherche
à Rennes
Le lancement du
UNNERSqE DE RENNES 1 6' Programme cadre
de recherche et développement
technologique (PCRDT) a été l'occasion
de la première visite à Rennes
de Philippe Busquin, commissaire
européen chargé de la recherche.
Il a été reçu, le 6 décembre dernier,
par Patrick Navatte, président de
l'Université de Rennes 1, qui a présenté
la mise en place des préparatifs
des établissements supérieurs et
des structures constituées à cet effet.
Le cidre en labo
Un nouveau laboratoire d'analyses
cidricoles a été ouvert, en
novembre 2002, par la Chambre
d'agriculture des Côtes-d'Armor,
dans les locaux du Laboratoire
départemental d'analyses (LDA 22),
le plus grand laboratoire vétérinaire
de France, sur le zoopôle de Ploufragan.
Différent de la halle technologique
de l'Inra, inaugurée en
septembre demier au Rheu et tournée
vers la recherche (voir Sciences
Ouest n° 192, octobre 2002, page 4),
la vocation de ce laboratoire est de
réaliser des analyses de routine
mais aussi d'apporter un appui technique
aux fermiers et producteurs
de Bretagne pour les aider à valoriser
leurs produits, comme dans le
cadre de l'obtention d'une AOC"',
par exemple. Sur le terrain, un
conseiller cidricole, Alain Lepage,
intervient sur la Bretagne et les Pays
de la Loire auprès de 45 artisans.
-►Kens.: Alain Lepage, conseiller
cidricole, tél. 02 96 79 22 86,
06 83 44 97 39.
"'AOC : Appellation d'origine contrôlée. "École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement. 'Ciel : Centre international d'étude des langues. "'kuga : Institut de management Europe Asie. "UBO : Université de Bretagne occidentale.
L'Europe soutient
les régions touchées par les inondations
Suite aux inondations ayant sinistré plusieurs régions d'Europe, la
Commission a adopté en septembre une proposition de création d'un
fonds de solidarité communautaire. Ce fonds apportera une aide rapide
en cas de catastrophes majeures (naturelle, technologique ou
environnementale) survenant dans un État membre ou un pays candidat
en cours de négociation, et sera réservé aux besoins les plus urgents. Le
montant annuel maximum mobilisable s'élèverait à 1 milliard d'euros,
dont 500 millions devraient être disponibles pour répondre aux
événements de ces derniers mois. Les fonds nécessaires ne seraient
réclamés aux États membres qu'en cas de nouvelle catastrophe. Les
commissaires européens ont également confirmé l'instauration de
mesures complémentaires d'aide aux régions sinistrées. L'Allemagne et
l'Autriche pourront ainsi redéployer une partie des fonds structurels leur
ayant été attribués pour 2000-2006, tandis que les pays candidats touchés
par les inondations bénéficieront d'une réallocation des fonds
de préadhésion non utilisés.
-~Rens. : Caroline Robert, Euro Info Centre,
tél. 02 99 25 41 57, eic@bretagne.cci.fr
C~
Ôroc ~
Internet
www.bretagne-environnement.org
Du nouveau sur la toile de Bretagne environnement
Bretagne environnement rassemble les acteurs de l'environnement en
Bretagne, producteurs de données (voir Sciences Ouest n°184 - janvier 2002).
Son objectif : diffuser de l'information régionale
et locale, participer au développement d'une
culture environnementale, notamment via un
portail Internet, dont la nouvelle version est en
ligne. Ce portail propose des articles rédigés
en collaboration avec les experts régionaux
sur les thématiques de l'eau, du littoral, du
patrimoine naturel, du sol et du sous-sol, de
l'air..., ainsi que des services destinés à faciliter
ôla recherche d'informations : annuaire
!thématique des acteurs, catalogue des
données, agenda régional de l'environnement,
références bibliographiques, cartothèque, photothèque, bases de données.
Des outils de gestion des données sont également réalisés et/ou diffusés :
atlas des zones inondables de Bretagne (premier trimestre 2003), réseau
d'annonce de crues (en cours), base de données sur les espaces naturels
protégés (en ligne), espace dédié à la qualité des cours d'eau (en ligne).
Voir plaquette de présentation de Bretagne environnement jointe à ce
numéro.
-'Rens.: Bretagne environnement, Ronan Lucas, tél. 02 99 35 45 82,
ronan.lucas@espace-sciences.org
établissements bretons et l'université
chinoise, symbolisant la volonté
des deux partenaires d'intensifier
leur coopération, soit par des
échanges d'étudiants ou d'enseignants,
soit par l'appui à la création
de classes de français en Chine.
-'Rens. : Sylvie Couratin,
Conseil régional de Bretagne,
tél. 02 99 27 13 52.
Des nouveaux
bâtiments pour l'Irisa
IRISA Pour faire face à sa
croissance, l'Institut
de recherche en informatique et
systèmes aléatoires (Irisa), situé sur
le campus de Beaulieu à Rennes, va
s'agrandir et passer de 6 900 à près
de 10000 m2 de surface utile. Le projet
d'extension a été présenté le
19 décembre dernier par Catherine
Malleret du cabinet nantais d'architecte
Forma6, retenu pour la réalisation
du futur bâtiment, et Claude
Labit, directeur de l'Irisa.
Une première tranche de travaux
constituée d'un bâtiment de 2 800 m2
comprendra pour l'essentiel des
espaces de travail et des locaux
techniques et devrait être achevée
en 2005. Une seconde tranche
conditionnelle prévoit la construction
d'un bâtiment neuf ainsi que le
réaménagement des locaux existants,
d'une surface utile de 1 400 m2.
Cette tranche comportera un espace
de conférences, un centre de documentation,
une cafétéria et divers
locaux de vie.
- Rens.: Irisa, Gérard Paget,
tél. 02 99 84 73 61, Catherine
Godest, tél. 02 99 84 72 06.
Internet et vous
en Côtes-d'Armor
Une enquête sur les
usages actuels d'Intemet
au sein de la cellule
familiale a été réalisée
par l'Union départementale
des associations
familiales (Udaf) et le Conseil général
des Côtes-d'Armor. 250 000 foyers
du département ont été sollicités et
plus de 2% ont répondu -ce qui
constitue une bonne mobilisation -
donnant des informations sur la perception
des usages d'Internet sur
les plans familial, social, éducatif et
politique. La méthodologie, l'analyse
et les résultats complets de
l'enquête sont disponibles sur les
sites suivants :
-►www. cotesd a rm or.fr
et www.udaf.fr
Quel climat pour demain ?
Comment expliquer la brutalité des tempêtes qui
ont secoué la France ces dernières années ? Peut-on
dire qu'on est en train de vivre un dérèglement
climatique ? Qu'en est-il du réchauffement de la planète et de l'effet de
serre ? Sylvestre Huet a décrypté pour nous le langage des scientifiques
et examine les scénarios possibles pour le climat de demain.
-iSylvestre Huet, Calmann-Lévy, 2000.
~
~
Les eaux du ciel
Après avoir exploré les origines de l'eau sur la Terre et
dans l'univers, cet ouvrage propose une approche de la
molécule H20 dans tous ses états, qu'elle soit gazeuse,
liquide ou solide. Mais l'originalité de ce texte est
d'aborder la question des relations développées entre les
hommes et cet élément fondamental, avec les conséquences
géopolitiques que l'on peut supposer à l'échelle de la planète.
-►Robert Kandel, Hachette Littératures, 1998.
Quelques autres titres disponibles sur le sujet
à la bibliothèque Colombia
Les caprices du climat, Barbara Sendling, Flammarion "castor doc", 1999.
Seule l'eau est éternelle... après Dieu, Robert Amhoggi, Onep, 1997.
La météo, questions de temps, René Chaboud, Nathan, 1996.
Le cycle de l'eau, jean-Luc Prévost, Haroun Tazieff , VHS, Film office, 1996.
Quelle eau boirons-nous demain ?, Pierre Hubert, Michèle Marin,
Hachette, 2001.
Les "coups de coeur" sont disponibles à la bibliothèque Colombia (Rennes).
Actualités marines : www.ifremer.fr
Le centre Ifremer de Brest organise
chaque année une semaine d'information
sur l'aquaculture et l'environnement,
destinée aux étudiants et enseignants.
Les présentations 2002 ont fait l'objet
d'un site Web dédié présentant les
chiffres et les perspectives des productions
aquacoles mondiale, européenne et française et ceci pour les filières
conchyliculture, crustacés, algues, pisciculture... : www.ifremerfr/aquaculture/
Par ailleurs, le site propose divers dossiers pédagogiques comme celui sur
l'océanographie physique "l'océan en mouvement" : www.ifremer.fr/lpo/cours/
-,Rens.: Alain Laponche, webmaster Ifremer, tél. 02 98 22 41 90,
alain.laponche@ifremer.fr
• UTA DIT ? Il faudra s'efforcer d'apprendre aux hommes étonnés que le bonheur
ne consiste point à parcourir cent kilomètres en une heure, à s'élever dans
l'atmosphère dans une machine ou à converser par-dessus les océans. 5
ij
g
Les extrêmes
se rapprochent
+ Chaque année à Brest, les Entretiens science et éthique sont l'occasion
pour tous de venir côtoyer et interroger les scientifiques et experts
venus débattre autour du thème choisi. Cette année, pour leur sixième
édition sous la présidence de Michel Glémarec, professeur honoraire
d'océanographie à l'UBO, quarante spécialistes ont animé les six tables
rondes programmées au Quartz les 21 et 22 novembre derniers. Le sujet
portait cette année sur "Les milieux extrêmes, d'un monde à l'autre". Sur
terre, en mer et dans l'espace, tous les extrêmes ont convergé durant
deux jours, sur la cité brestoise...
Le Finistère, et particulièrement le pays de Brest, possède un important
pool de chercheurs sur ces milieux hors normes. De nombreux intervenants
étaient donc tout simplement des scientifiques "locaux", que
l'on a l'habitude de croiser, sans réellement savoir ce qu'ils font, ce qu'ils
découvrent, les questions éthiques qu'ils se posent, les problèmes qu'ils
rencontrent..
Les entretiens ont permis de voir que ça n'était pas parce que le milieu
est extrême, inhospitalier pour l'Homme, que les scientifiques ne se
posent pas des questions d'ordre plus général. Mieux, il n'y a pas que les
scientifiques qui ont le droit (le devoir ?) de se poser ces questions. Les
juristes, les professionnels, les philosophes, les associations, les
citoyens... ont éclairé ces entretiens et démontré la nécessité d'un débat
public. Cette année encore le devoir de parole a été honoré. n V.D.
Contact 4 3B Conseils, tel. 01 40 51 83 87, troisbconseils@noos.fr,
http://sciences-ethique.enst-bretagne.fr
Emmanuel Morucci,
directeur de la Maison
de l'Europe à Brest
I
a lancé l'idée de
la création de comités
d'éthique locaux.
os vale Co mmun s s
I. Pa.lewrm eu. l./ dh.~Mrt 1eN i Ane
Ce ,me r:uni Peur I, >mite Iw.f.nwW dniw. p5 ..u.nda,1,,..
SOCRATES
~^'',
Contact 4 Emmanuel Morucci, directeur de la Maison de L'Europe à Brest,
tél. 02 98 46 60 09, maison-de-leurope-guideeurope@libertysurf.fr
Actualité
SCIENCES OUEST 195/JANVIER 2003
6e édition des Entretiens science et éthique de Brest
Michel
Glémarec,
professeur
honoraire de
l'Université
de Bretagne
occidentale,
a présidé la
sixième édition
des Entretiens
science et
éthique.
Les milieux extrêmes,
L'éthique au quotidien
+ Une idée originale et innovante
a vu le jour lors de la dernière table
ronde consacrée aux rapports entre
politique, science et éthique. Emmanuel
Morucci, sociologue et directeur
de la Maison de l'Europe à Brest, a
en effet lancé l'idée de la création de
comités d'éthique locaux.
Une idée pas si farfelue que ça. En
effet, tout le monde connaît le
comité d'éthique français qui est
consulté sur des "grandes" questions
concernant l'humanité, l'environnement,
la médecine... Il s'agit d'une
instance constituée d'experts indépendants
de plusieurs disciplines,
scientifiques ou non. Des avis sont
également émis au niveau européen
sur ces mêmes questions. Mais estce
que l'éthique s'arrête à ça ? Est-ce
qu'il n'y a pas une place pour un avis
indépendant à un niveau inférieur ?
L'éthique devrait-elle être confinée
dans les hautes sphères ? Pour
Emmanuel Morucci, la réponse est
claire. "Le comité d'éthique national
est indispensable pour réfléchir sur les
questions importantes des OGM, de
l'embryon, du clonage... Mais à un
niveau local, des questions éthiques se
posent également. Les politiques n'ont
pas forcément toutes les cartes en
main pour décider. De plus, ils sont
forcément partisans." La création de
comités d'éthique locaux permettrait
une consultation neutre et objective
dans les affaires quotidiennes des
citoyens.
Les situations peuvent être nombreuses.
Par exemple, lorsqu'il s'agit
de transformer un sentier pour y
faire passer des engins motorisés.
Et puis, les exemples pour lesquels
un comité d'éthique aurait pu être
consulté ne manquent pas : le parc
marin d'Iroise, une affaire très politisée
qui aurait peut-être gagné à être
étudiée d'une manière éthique,
objective, avec une démarche scientifique.
À Brest, la construction du
tramway est quelque chose qui va
engager les générations à venir (ne
serait-ce que d'un point de vue
pécuniaire). Il semblerait là encore
logique qu'un comité d'éthique
indépendant des intérêts économiques
et politiques puisse émettre
un avis sur le sujet.
Il existe déjà au niveau local des
comités économiques et sociaux. Ils
pourraient être dans un premier
temps un modèle pour ces comités
d'éthique. La dimension du département
ou du pays semble être une
taille idéale. L'équipe serait alors
constituée d'une douzaine de personnes
non impliquées politiquement
(scientifiques, philosophes...),
nommées le temps d'un mandat
municipal.
L'Europe semble pour l'instant
être favorable à ce type de projet.
Certainement parce qu'au début,
personne ne croyait en elle non
plus... n (D.
d'un monde à l'autre
Délinquance maritime et escroqueries spatiales
Le thème des sixièmes Entretiens science et éthique a vu se rassembler autour d'une même table des spécialistes
des milieux extrêmes (espace, milieu marin, pôles...). lci, au premier plan, Jean-Loup Chrétien. simplement à contrôler les navires
non désirés et à leur interdire d'approcher
des côtes. Un succès qui,
pour être appliqué en Europe,
nécessiterait un cadre plus fédératif
car les ports européens sont en
concurrence : si un bateau poubelle
ne peut accoster dans l'un d'eux, il
n'a pas longue route à tracer pour
trouver un autre port d'accueil pour
décharger sa cargaison. Mais une
Europe fédérale poserait bien sûr
d'autres problèmes plus complexes.
Achètera-t-on la Lune ?
Armel Kerrest est professeur à l'Idei (Institut de droit
des espaces internationaux) à l'UBO. Il fait partie de la
poignée de juristes qui, au niveau mondial, s'intéresse au droit
de l'espace. Un droit qui pourrait inspirer le droit maritime
bien qu'il n'ait pas eu pour l'instant à être appliqué pour des
catastrophes. Il connaît pourtant ses petits délinquants.
'4A chaque conquête d'un
endroit dangereux, le droit a dû
suivre. Il y a une centaine d'années,
la mer était encore un endroit hostile
à l'Homme. Les règles étaient avant
tout basées sur la solidarité entre
gens de mer. Armel Kerrest, professeur
de droit au Cedem* et à l'Idei :
"Avec l'arrivée des moteurs, le droit
est devenu plus «ordinaire». Il s'apparente
plus à la réglementation automobile.
Le transport régulier de
produits dangereux et les catastrophes
qui y sont associées nécessiteraient
aujourd'hui quelques adaptations.
Notamment en matière de responsabilité
des dommages et donc d'indemnisation."
En effet, aujourd'hui, lors
d'une marée noire, par exemple,
c'est l'État qui indemnise. Une aberration
juridique qui fait que c'est la
victime qui paie pour les dommages
qui lui ont été causés ! Dans le
même temps, les compagnies pétrolières
contribuent à alimenter le
Fipol qui, lui, indemnise à hauteur
d'un plafond dont l'altitude paraît
bien minime.
Alors, après avoir été un modèle
de droit "éthique", le maritime européen
serait-il le mauvais élève de la
classe ? La solution, une fois n'est
pas coutume, serait peut-être de
copier sur son voisin : le droit de l'espace.
C'est autorisé et même recommandé.
Au moins d'y jeter un oeil.
Copier sur le voisin
"Le droit de l'espace a été ébauché
dès 1963 dans la déclaration des
Nations Unies pour l'espace et repose
aujourd'hui sur les bases du traité
de l'espace qui date de 1967. Armel
Kerrest est optimiste : pour encore,
l'espace n'a pas connu de grande
catastrophe. Aucun satellite n'est
tombé sur une grande ville. Si cela
venait à se produire, les règles de
responsabilité sont très différentes de
ce qui se passe en mer actuellement"
En effet, dans l'éventualité d'une
catastrophe spatiale, tous les États
ayant participé au projet de près ou
de loin sont conjointement responsables.
De plus, cette responsabilité
est non plafonnée. Concrètement, la
victime choisit, parmi les responsables
conjoints, l'État qui devra
indemniser les dommages. Imaginerait-
on de devoir payer les réparations
de sa maison détruite par le
satellite du voisin ? Un simple bon
sens qui, appliqué au droit maritime,
pourrait faire avancer les choses.
Cette responsabilité conjointe
permettrait d'impliquer non seulement
le propriétaire du bateau, mais
également le propriétaire de la cargaison
et surtout, les pays fournissant
des pavillons de complaisance
qui réfléchiraient probablement
à deux fois avant d'accepter des
navires poubelles.
Chercher les idées ailleurs
En matière de pollution maritime,
la Bretagne a déjà payé son tribut et
elle continuera malheureusement à
le faire dans les années à venir. Il est
intéressant de noter que, malgré
l'impression de premier de la classe
que donne la France au travers des
médias, elle est le plus mauvais
élève en matière de contrôle des
navires. Et de loin ! En 2000, moins
de 10% des navires ont été contrôlés.
Juste devant se trouve l'Irlande
avec 22%. La réglementation européenne
impose un quota de 25 %...
De plus, les contrôles sont des
"contrôles papiers" effectués dans
des bureaux.
La sécurité sur les routes de
France est aujourd'hui sous les
projecteurs. Peut-être demain viendra
le tour des routes maritimes au
niveau européen. Car le problème
ne peut être résolu qu'à cette
échelle. Les États-Unis ont adopté
depuis longtemps des règles draconiennes
rassemblées dans le "Oil
Pollution Act". Elles consistent tout
Ce n'est pas parce que le droit de
l'espace est un droit de l'extrême et
qu'il est, à la manière de ce qu'était
le droit maritime à ses débuts,
"éthique", qu'il n'a pas, lui aussi, ses
petits délinquants et autres escrocs.
En effet, plusieurs sociétés ayant
"pignon sur Web" vendent aujourd'hui
la Lune. À très bon marché et à
tout le monde. Une plaisanterie, un
"clin d'oeil" ou une escroquerie rentable
? Pour Armel Kerrest, la question
est vite tranchée. "Personne n'a
le droit de vendre la Lune. La Lune
n'est, et ne sera à personne ! Le traité
de 1967 est très clair là-dessus. Les
soi-disant vendeurs s'appuient sur
une partie d'un article de la loi américaine
qui date de la conquête de
l'Ouest. Mais sur la Lune, ce n'est
pas «premier arrivé, premier servi».
Tout va être mis en oeuvre pour stopper
ce genre de trafic." Mauvaise
nouvelle donc pour les rêveurs pour
qui il reste toutefois une solution :
devenir le troisième touriste officiel
de l'espace. Le douanier vous
accueillera même avec le sourire,
ravi qu'il sera de rentabiliser son
lanceur... n V.D.
. Centre de droit et d'économie de la mer.
Contact 4 Armel Kerrest, Institut
de droit des espaces internationaux,
Université de Bretagne occidentale,
tél. 02 98 01 66 09,
Armel. Kerrest@univ-brest.fr,
http://www.univ-brest.fr/espace
7
Iseb, Météo France (MF) et Inta. L'intervention de trois équipes traduit bien
la dimension industrielle du projet (de gauche à droite, Y Louis (MF), P Cambon
(à l'avant, chef de projet Iseb), S. Prevost (derrière, Inta), F. Gaulupeau (au fond,
Inta), K. Crochart (devant, chef de projet Inta), F. Le Roy (arrière, Iseb),
J. Jegou MF), J. Corbel (Iseb), M. Sénotier (chef de projet MF).
Météorologie
• at : deuxième génération
À partir des images fournies
par MSG, les météorologues de
Météo France pourront affiner
leurs prévisions grâce aux
nombreux canaux disponibles.
e satellite météorologique MétéoSat 7 arrivant en fin de
vie, il était nécessaire de lui trouver un remplaçant. Un
appel d'offres a donc été lancé au niveau européen par
Eumetsat. Résultat : un nouveau satellite a été mis en orbite
par Ariane 4 et les stations de réception des données ont été
conçues par une équipe de chercheurs bretons.
0 Le remplaçant du célèbre satellite
météorologique MétéoSat 7 se
nomme MSG (MétéoSat seconde
génération). Deux exemplaires
ont été mis au point et devraient
apporter, en 2005, des informations
toujours plus précises aux météorologues.
Le premier a été lancé en
août dernier par Ariane 4 et, après
quelques légers déboires techniques,
devrait fonctionner normalement
courant janvier 2003.
d'observer avec précision la vapeur
d'eau, l'ozone ou le dioxyde de carbone
présents dans l'atmosphère. Ces
données sont transmises à une station
au sol pour être interprétées. Elles
peuvent alors être acheminées vers les
postes clients via Internet ou en repassant
par l'intermédiaire du satellite
qui joue alors le rôle de relais. Nous
sommes intervenus sur la conception
des stations de réception clients chargées
de récupérer les données traitées
réémises par le satellite."
Le satellite redistribue donc des
données traitées à ses clients. Deux
voies sont alors possibles : une liaison
bas débit, qui correspond à la liaison
actuelle établie par MétéoSat 7 et
une liaison haut débit qui permet
un rendement accru. La voie du bas
débit permet d'avoir une compatibilité
entre les deux satellites.
Et les clients sont nombreux !
Météo France, bien sûr, mais également
des sociétés de météorologie
privées, les routeurs des concurrents
des courses au large, les aéroports,
les ports... Ainsi, deux prototypes
ont été livrés en juillet et novembre
derniers. Chez Météo France à
Lannion, on attend les premières
images officielles d'ici peu.
Nourrir une recherche
plus prospective
Le projet a mobilisé jusqu'à
quatre personnes à l'Iseb, sans
compter les étudiants. "Ce projet
était très intéressant à plusieurs titres,
explique Pierre Cambon. Nous avons
pu impliquer les étudiants et avoir un
support de cours très concret. Du côté
des enseignants chercheurs, cela nous
a permis de nous maintenir à niveau.
Et même si le caractère innovant
était très réduit, cela a fait naître
dans l'équipe des idées de recherches
neuves."
En effet, les projets d'ingénierie
sont une aubaine pour les équipes
d'enseignants chercheurs et sont
généralement bienvenus dans les
laboratoires. Il permettent, d'une
part, d'introduire des problèmes
pratiques dans les cours des futurs
ingénieurs et, d'autre part, de faire
Test à l'Iseb le jour de la livraison
par Météo France et Inta du
prototype de la station de réception
conçu au laboratoire Doli
(Département d'optoélectronique
de l'Iseb). Sur la table au fond, le PC
d'acquisition équipé des deux cartes
numériques conçues à l'Iseb, posée
dessus, la tête radiofréquence à
1,69 GHz qui se trouve au foyer de
la parabole de 3,40 m de diamètre
installée à Lannion au Centre de
météorologie spatiale. Au premier
plan, sur la table à côté du clavier,
le tiroir à fréquence intermédiaire
(140 MHz) conçu par Doli).
profiter les industriels d'un savoirfaire
et enfin -et surtout- de faire
vivre financièrement une recherche
plus prospective. À partir de ce projet
très industriel, Pierre Cambon
et son équipe ont pu développer
d'autres pistes de recherche. De
par leurs origines, les fruits de ces
recherches pourraient être, bien sûr,
applicables très facilement.
L'industrie qui alimente la
recherche, voilà une évolution qui
devrait réjouir les partisans d'une
recherche "appliquée", opérationnelle,
source de richesses économiques
pour un territoire. n V.D.
Contact 9 Pierre Cambon,
responsable du département
optoélectronique, Iseb,
20, Cuirassé Bretagne, 29604 Brest,
tel. 02 98 03 84 03,
pierre.cambon@iseb.fr
La construction de MSG a eu
lieu dans le cadre d'un programme
européen Eumetsat. Puis au niveau
national, Météo France a lancé un
appel d'offres pour sa construction.
C'est Alcatel Espace qui s'est chargé
de la conception et de la fabrication
du satellite, et la réalisation des
stations de réception au sol a été
confiée aux informaticiens d'une
entreprise française : Inta. La partie
électronique a été mise au point à
Brest, dans les locaux de l'Institut
supérieur d'électronique de Bretagne
(Iseb), sous la responsabilité
de Pierre Cambon, responsable du
département d'optoélectronique
(Doli). "MSG est beaucoup plus puissant
que MétéoSat 7. Il dispose de
douze canaux : trois pour le visible et
8 neuf pour l'infrarouge. Cela permet
DOSSII SCIENCES OUEST 195/JANVIER 2003
•
Le risque
inondation
A .\ ~ `
r~•i'
I
,_ J 1\ : n :‘
-.
'
F(
•
~_^~'.^
•
epuis une dizaine d'années, en France, pas un seul hiver sans que lés •
médias ne relayent des images de routes envahies par l'eau et de
maisons inondées. L'Aude, la Bretagne, la Saône, le Doubs, le Rhône, là
Seine et l'Oise, la Somme et aujourd'hui encore le Gard subissent tour à tour
des événements qui nous rappellent que le risque inondation est le risque le
plus fréquent auquel sont soumis les Français (une commune sur trois est
inondable). C'est aussi celui qui coûte le plus cher à la collectivité (il représente
80 % des fonds consacrés aux catastrophes naturelles). Notre société est de
plus en plus vulnérable vis-à-vis de ce risque, car de plus en plus urbanisée.
Le dossier de ce mois de janvier propose de faire le point sur le risque
inondation en Bretagne, sur les conditions dans lesquelles l'inondation
survient et sur les moyens qui sont mis en oeuvre pour prévenir le risque, le
maîtriser et en limiter les conséquences. Les inondations que la Bretagne
a connues pendant l'hiver 2001 ont été un déclencheur, en matière de
prévention avec la prescription de nombreux plans de prévention du risque.
Quant à la surveillance du réseau hydrographique, elle s'exerce au quotidien
depuis de très nombreuses années, parfois même depuis plus d'un siècle, ne
sortant de l'ombre que lorsque les rivières dépassent leur cote d'alerte.
Outre que le phénomène inondation est très visuel, donc très "médiatisable",
ce qui amplifie ses effets dans nos esprits, sa répétition ces dernières années a
amené de légitimes questions, et le souhait de comprendre ces catastrophes
que la mémoire oublie. C.J.
T^
, - i~.`4~~..•.
•
rtgLitrii~~.
=` E6LFeFSIIIt
.. ~.
L'ensemble de ce dossier a été réalisé par Christelle Jourdren 9
Carte des villes
inondées plus de trois fois aw
(déclarées en catastrophe
naturelle) depuis 1995.
Carte des
précipitations
normales
(moyenne sur trente ans).
1400 mm
1200 mm
1000 mm
000 mm
800 mm
700 mm
800 mm
580mm
400 mrn
300 mm Carte des précipitations
200 mm de l'hiver 2001-2002.
DOSSIER SCIENCES OUEST 195/IANVIER2003
Comment s'exprime le risque
inondation en Bretagne
10
L'inondation est un risque naturel, qui concerne 258 des 1268 communes
en Bretagne. C'est de loin le risque naturel le plus fréquent, devant les feux
de forêts (69 communes concernées), les barrages et mouvements de terrain
(pour une cinquantaine de communes) et les cyclones et tempêtes qui sont
référencés comme risque majeur pour 12 communes du Finistère. Les villes
situées dans les vallées le long des principales rivières bretonnes sont
inondables. En Ille-et-Vilaine, 142 communes sont concernées (40% des
communes du département), elles sont 54 dans le Morbihan (autour du
Blavet et de l'Oust), 46 dans le Finistère (Odet, Ellé, Aulne, Elorn, larlo) et
36 dans les Côtes-d'Armor.
Mais qu'appelle-t-on risque
fk arp' "7
Le risque naturel recouvre deux notions : la probabilité, ou aléa, qu'un
phénomène naturel se produise (une tempête, un feu de forêt, une
inondation), et la vulnérabilité d'un territoire vis-à-vis de ce phénomène. Une
tempête sur les landes désertiques des monts d'Arrée n'aura pas les mêmes
conséquences qu'une tempête dans le goulet de Brest : les landes sont
moins vulnérables que les installations humaines de la rade.
La facture totale des inondations de l'hiver 2000-2001 a dépassé les
152 millions d'euros. Lors de ces inondations, alors que les particuliers
représentaient les 2/3 des sinistrés, près de 70% du montant des dégâts
concernaient les professionnels. Évolution préoccupante : le coût moyen
d'un sinistre chez les professionnels est en augmentation par rapport aux
précédentes inondations de 1995, une augmentation parfois spectaculaire
(275 à 460% pour le Finistère et le Morbihan). Ce qui pose la question de la
prévention et de la protection.
longtemps
Le phénomène inondation est lié aux conditions météo. En Bretagne,
l'inondation est en général le résultat de précipitations hivernales régulières
et plus abondantes que la normale.
Cela entraîne une remontée de la nappe d'eau souterraine puis une
saturation des sols qui laissent alors ruisseler toutes les précipitations vers
les cours d'eau. Les crues des rivières sont lentes et longues (par opposition
aux crues dues aux pluies d'orage qui sont brutales et brèves, comme celle
de Vaison-la-Romaine, dans le sud de la France en 1992). ga
Les enjeux humains des inondations ne sont pas toujours clairement
définis. On estime qu'environ 30000 habitants sur 2855418 sont soumis à ce
risque. Lors des inondations de décembre 2000 et janvier 2001, 1162
personnes avaient été évacuées au moins une fois, 2 692 sinistres avaient été
déclarés par les particuliers, mais aucun accident mortel n'était à déplorer. n
Mémoire courte
En 1995, l'expression "crue du siècle" avait déjà été évoquée. En 1999,
puis en 2000 et 2001, l'expression revient. Les anciens sont d'accord pour dire
qu' "on n'a jamais vu ça". Et pourtant les archives départementales regorgent
de témoignages sur l'eau envahissant les villages et les villes aux siècles
passés. Les crues se succèdent, avec leurs lots de dégâts : maisons et routes
emportées, pertes humaines... n
24 PPRI pour la Bretagne, 186 communes concernées
DDE PPRI Communes Prescription Approbation
2001
2001
Bassin rennais,
Ille et Illet
Meu et Garun
Vilaine amont
Les PPk Plans de prévention
du risque inondation
n France, une commune sur trois (14000) est susceptible
d'être inondée, en partie ou en totalité. Elles ne le sont pas
davantage que par le passé, mais leur vulnérabilité a
augmenté de façon préoccupante"', d'où la mise en place en
février 1995 de textes de lois donnant naissance aux PPR,
Plans de prévention des risques prévisibles. Les PPRI
concernent spécifiquement le risque inondation.
Dix PPRI ont été prescrits dans
le Finistère, quatre en Côtes-d'Armor,
quatre en Morbihan, et six en Ille-et-
Vilaine. De taille variable, les PPRI
sont définis en fonction des bassins
hydrographiques12 , et non des communes.
Certains concernent une
seule commune (c'est notamment le
cas dans le Finistère pour Le Faou ou
Daoulas), d'autres en revanche en
regroupent plusieurs, et jusqu'à 42
pour le PPRI du bassin de Rennes.
"Dès lors qu'un PPRI est prescrit
pour un secteur, la multiplication de la
franchise d'assurance pour les dommages
causés par une inondation est
neutralisée, et ce pendant cinq ans.
C'est le premier effet pratique du
PPRI, indique Bernard Kermoal,
chef du service Urbanisme à la
DDE"' 35 chargé du suivi des PPRI
pour l'Ille-et-Vilaine. Ce coefficient
multiplicateur est définitivement supprimé
lorsque le PPRI est adopté." En
général il ne faut pas cinq ans entre
le moment où le PPRI est prescrit et
celui où il est adopté, mais les
études peuvent néanmoins demander
jusqu'à trois ans. Car élaborer
un PPRI nécessite de nombreuses
données.
Des études complexes
pourraient aggraver le risque. C'est
dans ce périmètre d'étude qu'est
défini l'aléa.
"Pour définir l'aléa, il faut des données
sur tout le linéaire du cours d'eau.
Il faut bien sûr des données topographiques,
mais cela ne suffit pas. Tous
les documents relatifs aux crues sont
utilisés : les photos aériennes, des relevés
sur le terrain, des témoignages, les
laisses de crues''' dans les champs, les
traces dans les maisons, les données
chiffrées des stations de mesure...",
poursuit Bemard Kermoal. Et ce n'est
toujours pas suffisant, il faut aussi
1 Blavet amont
Blavet aval
Oust
Oust aval
mettre en évidence les unités du
relief (définies en fonction de leurs
caractéristiques géologiques),
reconstituer leur évolution morphologique,
examiner leur mode de
fonctionnement vis-à-vis des écoulements
superficiels et souterrains, en
tenant compte des modifications
apportées par les implantations
humaines. Cette approche, dite
hydrogéomorphologique, permet
notamment de délimiter dans les
plaines, les zones qui seront exposées
aux crues fréquentes, rares ou
exceptionnelles (lit majeur, lit moyen
ou mineur) et celles qui ne seront
jamais submergées. Elle précise,
dans les zones de débordement, les
axes d'écoulement préférentiels, et
les zones déprimées où les hauteurs
d'eau s'accumulent. Enfin elle facilite
la mise en évidence des phénomènes
d'érosion.
1999 Mai 2001
2000
2000,2001
2001
2001
2001
1997
1990 Dec. 2001
2001
1997
C'est l'État qui impose le niveau
de risque, souvent la crue centennale.
Ensuite, l'élaboration des
cartes de l'aléa est confiée à des
bureaux d'études : la Safege
pour le PPRI de Redon, DCOM
pour celui de moyenne Vilaine,
la Sogreah pour celui de Rennes,
un bureau normand pour celui
du Meu et du Garun. L'étude
de zonage pour le PPRI Meu et
Garun (qui aboutit aux cartes
de zonage) va coûter à l'État
114000€.•
Un PPRI : des cartes de
zonage et un règlement
À la fin de la procédure d'élaboration,
le PPRI se résume à une
cartographie précise du risque.
Des cartes au 1/25000', parfois au
1/10 000' et même au 1/2000' pour
certaines zones urbaines, présentent
quatre zones réglementaires
différentes. Les zones A sont les
zones faiblement urbanisées, elles
sont divisées en lA correspondant à
un aléa faible et 2A correspondant à
un aléa fort. De la même façon, les
zones B, fortement urbanisées, sont
subdivisées en 1B (aléa faible) et 2B
(aléa fort).
Ces cartes s'accompagnent d'un
règlement qui précise les conditions
d'urbanisation et d'aménagement
de chaque zone. Étant un document
élaboré par l'État, le règlement s'impose
aux documents d'urbanisme. Il
précise quels types d'occupation ou
d'utilisation des sols sont interdits
(pas d'école, d'aires de stockage de
produits chimiques ou d'installation
d'élevage en zone B), et quels sont
les aménagements possibles ou à
réaliser. Le PPRI règle les occupations
futures des sols, pas la situation
des bâtiments existants.
Arguenon
Blavet
Quinic
Trieux Guingamp, Porrtdeux
lagon-les-tao, Plantant
Gouarec
Paimpol
Odet Steir Quimper, Guengat, Ergué_Gabéric 1995, 2001
Isole - Ellé Quimperlé, Trémeven, kaêr 1995,1996,2001
Aven Pont-Aven, Rosporden
Aulne Châteaulin, Port-Lamar, Saint{oulitz 1996, 2001
Aulne amont Pleyben, Gouezec, C âteaune u-Faon, Saint-Goazec 2001
Rivière du Faou Le Faou 2001
Mi. nonne Daoulas _ 2001
Queffleuth-Jadot Morlaix, Plourin-les•Modais, Saint-Martin-des-Champs - 1997, 2001
Dùuliine Pont-de-Buisles-Quimerch
Elorn Landemeau, Penman, Plouedem, La Roche-Maurice, Plouneventer
Pontivy, Neuillac, Cléguérec,Saint-Thuriau, Le Sourn, Saint-Aignan
Baud, Bieuzy, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Languidic, Lanvaudan,
Melrand, Plumeriau, Quistinic, Saint-Barthélemy
Saint-Gonnery Guellas, Rohan, Crédin, Bréhan, Pleugrifret, lantiflâc,
Les Forges, Lanouée, Josselin, Guégon, Guillac, Saint-Servant-sur-Oust,
Quily, Ploermel, Montertelot, Le Roc, Saint-André, La Chapelle-Caro,
Caro, Serent, Saint-Abraham, Saint-Marcel, Missiriac, Malestroit,
Saint-Laurent-sur-Oust, Saint-Congard, Saint-Martin-sur-Oust
Théhillac, Rieux, Saint-Jean-la-Poterie, Allaire, Saint-Perreux,
Saint-Vincent-sur-Oust, Glénac, Les Fougerets, Peillac,
Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Gravé, Saint-Congard
Vilaine et Oust
Vilaine moyens
Seiche et Ise
2000
2001
1997 Août 2002
2001
De taille variable, les PPRI sont définis en fonction des bassins hydrographiques et
non des communes. Certains concernent une seule commune (c'est notamment le
cas dans le Finistère pour Le Faou ou Daoulas), d'autres en revanche en regroupent
plusieurs, et jusqu'à 42 pour le PPRI du bassin de Rennes.
La première étape est de définir
le bassin de risque. C'est le travail
des géographes. Le bassin est généralement
limité par la ligne de crête
le séparant du bassin voisin.
Le périmètre d'étude est celui
dans lequel la connaissance des
aléas et des enjeux doit être approfondie,
c'est souvent la plaine alluviale
du cours d'eau principal et de
ses affluents. Il couvre donc les
zones de fond de vallée potentiellement
inondables, mais aussi les
franges non inondables et les zones
sur lesquelles des constructions, des
ouvrages ou des aménagements
Redon, Bain-sur-Oust, Saint-Marie, Rénac, La Chapelle-de-Brain,
Langon, Sainte-Anne-sur-Vilaine
LailleGuichet, Saint-Senoux, Pléchatel, Bourg-des-Comptes,
Saint-Malode-Phily, Guipry, Mess s, Poligné
Amanlis, Availles-sur-Seiche, Boistrudan, Bourgbarré, Brie, Brief
Chanteloup, Chateaugiron, Corps-Nuds, Domalain, Erré,
Gennes-sur-Seiche, Janzé, Pire-sur-Seiche, Marcillé-Robert Moutiers,
Nouvoitou, Orgéres, Retiens, Saint-Armel, Visseiche
Acigné, Betton, Bréal-sous-M, Brécé, Bruz, Cesson, Gntré, Claye,
La Chapelledes-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault
Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigne, Gévezé, Goyen,
L'Hennitage, Melesse, La Méziére, Montgermont, Montreuilsur-Ille,
Mordelles, Mouazé, Noyalsur-Vilaine, Noyai-Châtillon, Pacé,
Parthenay-de-Bretagne, Pleumeuleuc, Pont-Péan, Le Rheu, Rennes,
Saint-Erblon, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Gilles, Saint-Jacques,
Saint-Médard-sur-Ille, Saint-Grégoire, Talensac, ThorignéFouillard,
Le Verger, Vern, Vezin-le-Coquet
B€die, Bléurais, Breteil, Gael, Iffendic, Montfort-sur-Meu,
Montauban-de-Bretagne, Muèl, La Nouaye, Saint-Gonlay,
Saint-Maugan, Saint-Uniac, Talensac
Chiteaubourg, Comillé, Poce-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes,
Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine, Servon, Vitré
"' Une première circulaire de 1994 évoquait une vingtaine de
morts et plus de 3 milliards de francs de dégâts pour les inondations
survenues au nord de la France l'hiver 93-94. Des
textes plus récents arrivent d un total d'une centaine de morts
et de 17 milliards de francs de dégâts entre 1982 et 1997.
Un bassin hydrographique définit le bassin de risque. Il correspond
au bassin versant (versant où les pluies convergent
vers le même cours d'eau) lequel est ajusté en fonction de critères
de vulnérabilité, comme l'activité humaine, par exemple.
DDE : Direction départementale de l'État service de l'État.
"' Laisses de crues : traces (débris, branches arrachées,
déchets...) laissées par la crue et définissant la limite de celle-ci_
Contact 4 E, service urbanisme
habitat et construction,
Bernard Kermoal, 3, ay. de Cucillé,
BP 3167, 35031 Rennes Cedex,
tél. 02 99 33 43 00.
11
DOSSIER SCIENCES OUEST 195/IANVI ER 2003
•
Le réseau hydrographique de la Bretagne est surveillé
par deux Services d'annonce de crues : le Sac des
fleuves côtiers de l'Ouest et le Sac Vilaine.
Ils relèvent du ministère de l'Écologie et du
Développement durable, représenté
localement par les DDE.
Laurent Le Falher est un des deux seuls
permanents du Sac Vilaine. Il a décortiqué
pour Sciences Ouest le fonctionnement du Sac,
ses moyens et ses perspectives.
Le Sac Vilaine, qui s'étend sur
trois départements (35,44,56), est
organisé en deux Centres d'annonce
de crues (Cac) : l'un à Rennes et
l'autre à Redon, reliés à une même
base de données. "Nos matières
premières sont la hauteur d'eau et la
pluviométrie, elles nous permettent de
faire de l'observation et de la
prévision. Elles nous viennent de
notre réseau de stations de mesures
automatisées* réparties le long de la
Vilaine et de ses affluents. Chaque
matin je vérifie les données, je repère
sur la base les stations qui sont en
panne, et qui nécessitent une
intervention. Je vérifie les cotes. En ce
moment, par exemple, nous avons
l'Illet qui tend vers sa cote de
vigilance, c'est le premier niveau de la
surveillance, après nous pouvons
passer en préalerte, puis en alerte.
Cela dépend de la météo."
Pour effectuer ses prévisions de
hauteur d'eau", le Sac dispose de
ses propres pluviomètres sur 22 des
35 stations de mesure automatisées.
Ils sont en effet différents de ceux
de Météo France, car ils ne répondent
pas aux mêmes normes d'installation
et n'ont pas la même utilité.
"Météo France n'a à ce jour que cinq
pluviomètres automatisés sur notre
bassin, ce qui est trop peu pour faire
de la prévision localisée sur des petits
cours d'eau.
Cela étant, nous utilisons bien sûr
les prévisions de Météo France pour
calculer une hauteur d'eau probable.
Nous avons un site Internet de Météo
France qui nous est réservé et qui
nous fournit des données chiffrées sur
la pluviométrie prévue. Nous appelons
aussi leur prévisionniste d'astreinte
pour avoir des informations
supplémentaires, sur l'intensité de la
pluie ou sa direction."
* La plupart des stations appartiennent à la DDE 35,
quelques autres appartiennent à la Diren, à l'institution
d'aménagement de la Vilaine et au Conseil général d'Ille-et-
Vilaine. ** Ces compétences en matière de prévision sont
particulières au Sac Vilaine, les autres Centres d'annonce de
crues ne donnant que les cotes observées. Une réforme est
cependant en cours et les Sac devraient évoluer vers des SPC,
Service de prévision des crues, ce qui, sur le bassin de la Vilaine,
est déjà en partie une réalité.
Une échelle limnimétrique.
Les hauteurs sont exprimées
en mètres et déterminées
soit à partir du fond de la
rivière, soit à partir du zéro
de navigation (niveau
minimum défini pour la
navigation des péniches).
Vue satellite du
bassin de la Vilaine.
L'annonce de crue est confiée à
Redon pour la partie du bassin en
aval de l'écluse au Malon à Guipry, et
à Rennes pour toute la partie amont
de la Vilaine et de ses affluents.
On a besoin
de "zouaves"
Si les cotes aux stations parlent
bien aux spécialistes, c'est-à-dire au
personnel chargé de la surveillance
des cours d'eau dans les DDE et les
Sac, cela n'évoque parfois pas grand
chose aux personnes, qui, sur le terrain,
sont chargées d'informer la
population. D'où l'idée de rechercher
comme à Paris, un repère, un
"zouave", qui permette à tous de
mesurer le risque. "Quand nous
transmettons une cote probable de
2,50 m à la station en amont de Guipry,
cela n'indique pas d'emblée jusqu'où
l'eau peut monter dans la ville.
Si on dit cela correspond à I m d'eau
dans la pharmacie située sur le quai,
on visualise tout de suite l'étendue de
l'inondation. Nous avons déjà certains
repères. Par exemple, nous
savons que si nous prévoyons 0,95 m
d'eau à la station de Mordelles, la
RN 24 sera inondée." Dans le secteur
de Redon, toutes les routes
susceptibles d'être coupées sont
déjà rattachées à une station. Un travail
a été entrepris avec les pompiers
et les maires pour trouver
dans chaque lieu habité inondable
un "zouave" identifié par tous. Certaines
villes comme Châteaubourg
ont déjà une cartographie très précise
" I 0 cm par I 0 cm ils savent
exactement quelles vont être les maisons
touchées, dans quel ordre."
Trois alertes d-an_ s_rialerte
s La vigilance : lorsqu'un cours d'eau est à une cote supérieure à la normale ou que les
prévisions de Météo France permettent de le prévoir, le secteur est mis en vigilance. "Cela
signifie simplement que nous sommes plus attentifs à ce qui se passe dans ce sous-bassin."
Cet état fait l'objet d'une simple information à la préfecture.
a La préalerte: "au-delà d'une cote seuil atteinte dans certaines stations, nous proposons
la préalerte. Nous diffusons alors à la préfecture des messages de suivi de la crue rédigés en
clair (point sur la situation à 8 h et 16h et plus si besoin). Nous mettons pour cela en place une
cellule de crise. La préfecture peut alors décider de mettre en préalerte ses services. Cela veut
dire par exemple que les pompiers et gendarmes vont être mis en astreinte."
L'alerte: "à partir d'un second seuil, nous proposons l'alerte. Mais cela ne veut pas dire
que les maisons ont déjà les pieds dans l'eau. Le seuil est défini justement pour se donner
le temps de réagir. Nous faisons de la prévision, donc nous donnons une cote probable
compte tenu des cotes observées et des prévisions météo. Nous précisons notamment dans
la mesure du possible s'il y a un risque moyen ou grave d'inondation. Charge à la
préfecture de prévenir les maires." En temps de crise, sur le bassin de la Vilaine, le Sac peut
mobiliser 60 personnes, essentiellement dans les DDE. n
Exemples de seuils : Rohan (inondable par l'Oust) : vigilance à 0,70 m, préalerte à 0,90 m,
alerte à 1,10 m. Vitré (inondable parla Vilaine) : vigilance à 0,80 m, préalerte à 1,30 m,
12 alerte à 1,70 m.
Un site "inondation"
accessible
Pour améliorer la transmission de
l'information vers la population, la
préfecture travaille actuellement à la
mise en service d'un site Internet sur
la prévention des crues, dédié aux
informations. Ainsi tous les messages
d'alerte du Sac seraient directement
accessibles à la population qui aurait
les informations en même temps que
la préfecture. "En temps de crise,
comme en temps normal, notre interlocuteur
c'est la préfecture. Mais
notre téléphone est accessible à tous.
Alors quand l'inondation menace, les
gens nous appellent directement 11 y
a jusqu'à 50 appels par heure, 60 à
Redon, sans compter les demandes
de la presse. Un site accessible à tous
permettrait de diffuser l'information
plus rapidement. Les mairies et les
associations pourraient être des relais
sur le terrain pour que toute la population,
connectée ou non, soit informée.
Cela implique de notre part une
très grande vigilance dans la rédaction
de nos messages; insiste Laurent
Le Falher. Nous devons être compréhensibles
par tous." n
diants de l'Université de Rennes 2,
de la maîtrise d'histoire et du laboratoire
Costel. "Nous souhaitons établir
des relations avec les universités et
accueillir des étudiants pour des travaux
d'histoire et d'hydrologie. C'était
une des recommandations de la mission
d'expertise interministérielle sur
les crues de 2000-2001."
mesures
Une station automatisée : une boîte
remplie de systèmes électroniques et
équipée d'un système d'émission radio
et téléphone et d'un capteur qui
plonge dans l'eau. Un technicien du Sac
travaille à temps complet sur l'entretien
de ces stations.
Laurent Le Falher note les crues sur
des registres comparables à ceux
d'il y a un siècle, tout en utilisant les
outils informatiques pour analyser
l'évolution des niveaux du réseau
hydrographique sous surveillance.
bassin de la Vilaine
Les stations de
.4 Il y a 78 points de
mesure dont 35 automatisés
par le Sac disposés sur
5 départements. 6 stations (4 créations
et 2 automatisations) supplémentaires
sont même prévues sur
l'Oust dont la surveillance, depuis
les dernières inondations, est
confiée au Sac Vilaine et 3 sur le
Meu (2 créations et I automatisation).
La plupart des stations transmettent
par radio (la DDE de
Beauregard est équipée d'une
antenne pour recevoir ces données)
et quelques stations transmettent
par téléphone. Le réseau ne devrait
pas évoluer davantage. Le Sac ne
dispose que d'un seul technicien
pour l'entretenir.
En temps de crise, le Sac fait appel à ses 25 observateurs de crue,
essentiellement des agents des DDE, souvent des éclusiers, pour relever le
niveau d'eau sur les échelles limnimétriques.
Après les inondations de 2000-2001, la demande de multiplication des
stations automatisées était forte sans toujours une justification d'enjeux
économique ou humain. Mais pour faire de la prévision sur les hauteurs d'eau,
H faut disposer de séries de mesures historiques. Il faut en effet au minimum
une vingtaine de crues pour pouvoir caler un modèle de simulation qui
permette de faire de la prévision. Cela veut dire qu'à partir de l'installation de
la station, il faut plusieurs années (en fait cela dépend du nombre de crues
enregistrées chaque année) avant de pouvoir faire des prévisions de hauteurs
d'eau. Par ailleurs, une hauteur d'eau à la station ne veut pas dire grand chose
à un kilomètre en aval. Les hauteurs d'eau en effet ne se propagent pas, mais
le débit oui. La hauteur d'eau est transformée en débit grâce à une courbe de
tarage dont la mise au point complète demande des dizaines de crues
mesurées, d'où l'importance d'utiliser au maximum les échelles relevées
manuellement (et de faire de l'automatisation plutôt que de la création).
Une mine
pour historiens
et chercheurs
Le Service d'annonce de crues
existe depuis 1879. Dans les vieux
locaux du service navigation de
Rennes, en bordure de la Vilaine, les
registres des crues sont rangés
dans des cartons. Des tracés à la
main des lignes d'eau de la Vilaine,
des courbes, et des colonnes interminables
de relevés de hauteurs
prises toutes les deux heures... "Il y
a des milliers de données qui dorment
là-dedans. En plus des archives informatiques,
nous tenons, aujourd'hui
encore, toujours les mêmes registres.
Ainsi dans 100 ans, ces données
manuscrites seront encore exploitables,
alors que nous pouvons nous
interroger sur la pérennité des supports
informatiques."
Avec les données des registres,
Laurent Le Falher a pu, par exemple,
reconstituer la montée du niveau de
l'eau en janvier 1881 à Pont-Réan, où
il avait fallu 60 heures à la Vilaine
pour atteindre le maximum de la
crue (4,25 m), alors qu'elle a mis
80 heures pour atteindre 3,52 m en
janvier 1995, et près de 120 heures
en décembre 1999 (cote 3,77 m) ou
en janvier 2001 pour atteindre la
cote de 4,07 m. Le Sac a déjà mis ses
données à la disposition des étu-
Carte des 8 sous-bassins d'annonce
de crues. Nombre de communes
concernées dans chaque bassin.
Ille et Illet : 10,
Vitré-Châteaubourg : 12;
Châteaubourg-Rennes : 8 (-2);
Rennes-Guipry : 28;
Guipry-la-Chapelle-de-Brain : 4 (-2) ;
Redon Vilaine : 7 (-1);
Redon Oust: 20 (-1);
Rohan-Malestroit 23 (-2).
Soit au total : 63 communes en
Ille-et-Vilaine, 7 en Loire-Atlantique,
38 en Morbihan.
(-x) Commune en doublon avec un
autre sous-bassin d'annonce.
Contact 4
crues, DDE, subdivision hydrologie
et Rennes navigation,
1, mail François Mitterrand ,
35000 Rennes, tel. 02 99 59 20 60.
13
Équipe pluridisciplinaire Plan Loire :
des spécialistes du risque inondation
4 Composée de sept personnes,
l'équipe Plan Loire possède des
compétences pluridisciplinaires en
socio-économie du risque inondation,
stratégie de réduction du
risque, hydraulique, morphologie
fluviale-hydrologie, cartographie et
base de données et consacre 70%
de son activité à la protection des
populations contre le risque inondation.
Son territoire est centré sur le
bassin de la Loire, mais elle a travaillé
sur les inondations de la vallée
de la Vilaine. Elle a notamment
conduit une étude sur la vulnérabilité
des entreprises du secteur de
Redon, à la demande de l'Inspection
générale de l'environnement. Ses
résultats sont éloquents : une entreprise
qui anticipe le risque peut
réduire le coût du sinistre d'un facteur
100 !
Dans la zone industrielle inondable
de Redon, une société a
entrepris entre 1995 et 2000 une
démarche de prévention du risque.
Un expert s'est rendu sur place
après les crues de 1995.11 a collecté
les informations sur les conditions
d'inondation de l'entreprise, sur l'organisation
de l'alerte et des secours.
Il a réalisé un diagnostic pour différents
scénarios d'inondation et fait
des recommandations. Ces recommandations
étaient classées par
ordre de priorité, leur coût était chiffré
ainsi que celui du gain attendu.
Toutes les recommandations ne
relevaient pas de modifications
techniques, il s'agissait parfois de la
conduite à tenir, des tâches à entreprendre
pour sauvegarder l'outil de
production ou les stocks. Résultats :
alors que les inondations de 1995
avaient entraîné 10 jours d'arrêt
d'activité et 1,3 million de francs de
dommages, celles, comparables,
de l'hiver 2000-2001 n'ont arrêté
l'activité que pendant 4 jours, et ont
coûté 100 000 francs.
Actuellement, l'équipe Plan Loire
dispose donc d'un outil de diagnostic
opérationnel pour les grandes
entreprises. Une première version a
déjà été testée. L'équipe travaille
maintenant à la conception d'un outil
d'autodiagnostic pour les petites
entreprises et les exploitations agricoles.
"Les petites entreprises ne peuvent
pas se permettre de missionner un
expert, souligne Claire Devaux-Ros,
de l'équipe Plan Loire. C'est pourquoi
nous avons choisi l'autodiagnostic."
L'outil prend en compte le type
d'inondation, les caractéristiques de
l'entreprise. Et de la même façon
que pour les grandes entreprises,
tout est chiffré. "Un chef d'entreprise
ne va entreprendre des modifications
que si ça en vaut la peine." Cet outil
devrait être testé en 2003. n
Contact 4 Équipe pluridisciplinaire
Plan Loire, agence de l'eau,
BP 6339, 45063 Orléans Cedex 2,
tél. 02 38 69 18 28.
La zone
portuaire
de Redon,
une zone
d'activité
économique
particulièrement
touchée par les
inondations
depuis 1995.
Institution d'aménagement de la Vilaine :
des propositions d'aménagement contre les crues
a GflPPN SMF .OUxCF a
L'Institution d'aménagement de
la Vilaine, l'IAV`, a été créée en 1961.
Elle remplace la conférence interdépartementale
qui fonctionnait
depuis 1936 pour exécuter un programme
d'assainissement de la vallée
de la Vilaine et de ses affluents.
L'1AV est maître d'ouvrage pour les
aménagements hydrauliques (barrages,
pompages, endiguements,
protection des berges, ponts routiers)
et possède également une
mission de production d'eau
potable et de gestion de la navigation
sur les 80 km aval de la Vilaine.
Le premier grand chantier de l'IAV
en temps que maître d'ouvrage fut la
construction du barrage d'Arzal, qui
permet de protéger le secteur de
Redon des effets de la marée montante
lors des crues de la Vilaine
(mais pas des crues qui arrivent par
l'amont).
L'IAV anime par ailleurs un programme
de gestion des zones
humides et de lutte contre les inon-
14 dations et a conduit, à ce titre, des
études importantes sur les inondations
en aval de Guipry. En 1998, elle
a ainsi étudié différentes solutions
pour abaisser la ligne d'eau de crue
Les travaux prévus autour de Redon
s'effectueront en trois tranches,
la première concerne l'arasement
des remblais longeant la rive droite
de la Vilaine depuis la Goule d'eau
jusqu'au château de Rieux.
dans le secteur de Redon, notamment
par la construction d'un canal
de décharge de 6 km de long depuis
l'amont du pont SNCF jusqu'à Rieux.
L'abaissement de la ligne d'eau était
selon l'étude tout à fait significatif :
moins l mètre en amont du pont,
moins 50 cm dans la zone portuaire.
À l'époque, le coût d'un tel aménagement
avait été estimé à
400 MF HT, soit 8 à 20 fois le montant
des dégâts des crues de 2000-2001.
Cependant, le problème du site de
stockage des 5,3 millions de m° de
déblais issus du creusement du
canal n'avait pas été résolu et l'impact
écologique sur les marais
situés en aval de Redon avait été
jugé très négatif. Ce pour quoi
la solution avait été abandonnée.
D'autres aménagements ont donc
été proposés par l'IAV d'après une
liste de travaux élaborée par la mission
interministérielle d'expertise
sur les crues de l'hiver 2000-2001.
Les travaux retenus par l'IAV pour
la Vilaine et l'Oust : arasement
de remblais, reprofilage de la
confluence Oust-Vilaine, élargissement
du lit mineur de l'Oust, suppression
d'un pont, construction
d'une digue coûteront 12 millions
d'euros. Ils permettront d'abaisser la
ligne d'eau de 5 à 10 cm sur la Vilaine
et de 10 à 30 cm sur l'Oust, pour le
secteur autour de la confluence
Oust-Vilaine. Si ces quelques centimètres
peuvent paraître dérisoires,
ils sont déjà très significatifs pour les
commerces et les maisons alentour
et constituent un gain minimum
attendu, compte tenu des aménagements
prévoyant la suppression des
remous au niveau de la confluence
des deux rivières. n
Douze personnes sont employées à l'IAV et l'équipe est
renforcée par du personnel de la subdivision Navigation de
l'équipement pour la gestion de la Vilaine et du barrage d'Anal.
Contact 4 Institution d'aménagement
de la Vilaine, boulevard de Bretagne,
BP 11, 56130 La Roche-Bernard,
tél. 02 99 90 88 44.
Image du satellite Landsat d'un bassin versant breton (le Blavet) : contrastes des
paysages et de l'occupation du sol dans la région de Pontivy: bocage et prairies
sur granite à l'ouest (vert et rouge), parcelles sans haies de sols nus et céréales
sur schiste à l'est (en bleu).
U7 ~•rr 1971t Amarre. Nririanr ras
Photos de la forêt amazonienne : implantation des colons, et la ville (Sinop) quelques années
plus tard. Une évolution spectaculaire du paysage suivie par le laboratoire depuis 20 ans.
L'implication de chercheurs bretons
dans la compréhension des inondations
Le laboratoire Costel de
l'Université de Rennes 2
avait été sollicité par la
mission d'expertise interministérielle
à l'issue des crues
de l'hiver 2000-2001 pour
apporter des éléments de
réponse à deux questions :
est-ce qu'il pleut plus que
par le passé ? Cela va-t-il
s'accentuer ? Est-ce que l'eau
monte plus vite qu'avant ?
Réponses.
Une tendance passée
pour la pluviométrie
"Nous sommes climatologues
et géographes, explique Vincent
Dubreuil, directeur
du laboratoire. Nous
avions déjà entrepris
des travaux dans les
années 80 sur la
sécheresse (NDLR :
l'Ouest venait alors de connaître
une succession d'étés particulièrement
secs). Pour répondre à la question
de l'évolution de la pluviométrie,
nous avons effectué des études sur des
séries de mesures en remontant
jusque dans les années 50. Et on a
en effet observé une tendance."
Les études réalisées sur des
écarts à la normale des données
pluviométriques sur Rennes et les
autres stations de la France de
l'ouest ont permis au laboratoire de
mettre en évidence une diminution
des pluies d'été et une augmentation
des pluies d'hiver sur les 25
dernières années.
"Mais cela ne nous permet pas de
prévoir une tendance pour les prochaines
décennies, prévient Vincent
Dubreuil. Travailler sur des données
historiques pour mettre en évidence
une tendance et imaginer le climat de
l'ouest dans le futur, ce n'est pas du
tout la même chose. Pour faire ce
type de «prévision», il faut travailler
avec un modèle physique de l'atmosphère
dans lequel on va faire varier
différents paramètres (par exemple la
teneur en gaz à effet de serre). Ces
travaux sont faits à l'échelle globale
par des physiciens de l'atmosphère."
Les chercheurs de Météo France
à Toulouse ont en effet mis en évidence
un réchauffement modeste
des températures matinales en été
sur le grand Ouest, cependant les
simulations à échéance de 50 ou
100 ans ne sont pas encore en
mesure aujourd'hui de préciser
comment va évoluer la pluviométrie,
à l'échelle de la Bretagne.
L'eau monte plus vite
La question de la vitesse de montée
du niveau d'eau avait été confiée
aux hydrologues du laboratoire,
sous la responsabilité de Nadia
Dupont en collaboration avec l'Ensar
(C. Cudennec). L'équipe a travaillé
sur les hauteurs d'eau de la Vilaine à
Guipry en aval de Rennes. Elle a calculé
pour les crues d'hiver la vitesse
moyenne de montée de l'eau sur
4 heures et la vitesse maximale sur
8 heures. Les résultats indiquent
une augmentation des vitesses de
montée pour les vingt
dernières années, ce
que la rumeur populaire
avait clamé.
Cette augmentation
concerne surtout les
"petites" crues. Ces
montées rapides ont
déjà été enregistrées
par le passé lors des
grandes crues (1936) ; il
semble que le comportement
du fleuve se
soit modifié. La Vilaine
Le laboratoire
CosteL
Le laboratoire Costel (Climat et
occupation du sol par télédétection)
compte 13 chercheurs, ingénieurs
et enseignants chercheurs et 15
doctorants. Costel fait partie de
l'UMR 6554 du CNRS et de l'Institut
fédératif Caren (Centre armoricain
de recherche en environnement).
Outre ses travaux dans le domaine
de l'hydrologie et de l'occupation
des sols sur les bassins versants
bretons, le laboratoire développe
également un thème de recherche
sur la déforestation en Amazonie
et ses conséquences sur le climat
régional depuis une vingtaine
d'années (voir photos en bas de
page). Des collaborations entre
les universités du Mato Grosso,
de Brasilia, du sud du Brésil et le
laboratoire ont permis de nombreux
échanges. Les outils du laboratoire :
la télédétection. Ses ambitions :
mesurer les conséquences environnementales
de l'évolution des
paysages. n
répond aujourd'hui plus rapidement
à l'épisode pluvieux. Ce que l'étude
n'a pas permis de déterminer c'est
dans quelle mesure cette augmentation
de la vitesse de montée pouvait
être imputée au changement de
l'épisode pluvieux lui-même (plus
intense, plus mobile ou de répartition
différente), ou bien à une diminution
de l'effet tampon du bassin.
Un des axes de recherche des
hydrologues du laboratoire* est
notamment de suivre l'évolution
des paysages dans les bassins
versants et de pouvoir prévoir le
ruissellement en fonction de la couverture
végétale. n
'Certains travaux de snaitrise et de DEA portent aussi sur la
delimitation des zones inondables.
Contact 4 Laboratoire Costel,
Université de Rennes 2,
Vincent Dubreuil, tél. 02 99 14 10 00.
15
oulin deJVontfort 4ors des inondations de l'hiver 2000-2
DOSSIER SCIENCES OUEST 195/IANVI ER 2003
Montfort-sur-Meu. Un des rares documents photographiques du début du XX' siècle
pris parle photographe local, en 1910. Le moulin en bordure de rivière est en partie noyé.
onsternation chez les nouveaux habitants, incrédulité
chez les anciens. Lorsque les rivières ont débordé en 1995,
la rumeur populaire a largement couru : "Jamais on n'aurait
pu imaginer ça. Jamais l'eau n'était montée aussi haut, jamais
aussi vite." Hivers 1999, 2000, 2001, de nouveau les rivières
sont en crue et sortent de leur lit : "Autant de fois en si peu de
temps, on n'avait jamais connu ça, c'est sûr. Il y a quelque
chose d'anormal là-dedans."
La rumeur n'en démordra pas.
Pourtant, de nombreux documents
font état de successions d'inondations
dans les trente premières
années du siècle passé. Rennes a
été inondée tous les ans entre 1925
et 1931, puis de nouveau en 1935, 36
et 37. Si les photos sont rares, les
archives départementales conservent
des témoignages écrits de
sinistrés demandant des secours
aux maires. Il existait même des
imprimés spécifiques sur lesquels
étaient indiqués la composition de
la famille sinistrée, la nature des
dégâts et le montant de l'aide financière
accordée suivant les ressources
estimées du chef de famille.
/,`
4----
Chaque département possède des
archives classées selon leur origine.
Pour retrouver les documents relatifs
aux inondations, il faut notamment
s'intéresser aux archives des
Ponts et Chaussées. Les délibérations
des conseils municipaux
apportent également des informations
sur les dégâts et les victimes
dus aux inondations, tout comme
les registres paroissiaux. Pour ce qui
est des chiffres, les crues sur la
Vilaine sont consignées depuis
1846. Une analyse des cotes de la
Vilaine à Guipry, depuis 1846,
montre qu'une vingtaine de crues
ont dépassé la cote de 4 m (alors
que la cote d'alerte est à 1,40 m). La
crue de 1881 était montée jusqu'à
5,09 m, celle de 1995 s'est arrêtée à
4,96 m.
De la même façon, les données
pluviométriques consignées depuis
plus d'une centaine d'années dans
certaines stations montrent que les
épisodes pluvieux de l'hiver 2000-
, 2001 se sont déjà produits. L'hiver
t 1935-1936 est très comparable en
terme de pluviométrie à l'hiver
2000-2001.
Les journaux, nombreux au début
du XXe siècle, relatent les événements.
Les inondations de 1881
dans l'arrondissement de Saint-
Brieuc auraient sans aucun doute
fait les couvertures des journaux
nationaux et régionaux aujourd'hui.
À l'époque, les journaux locaux,
comme Le Lannionnais, y consacrent
une colonne de 15 cm de haut,
sans illustration.
Mais pourquoi le risque s'est-i:
dilué dans la mémoire humaine ? La
population est de moins en moins
fixe, on vit de moins en moins souvent
là où l'on est né. Les ruraux se
déplacent vers les villes emportant
la mémoire des générations qui les
ont précédés. Les citadins qui s'installent
en campagne vivent mal les
inondations et n'ont de repère que
par rapport aux dégâts qu'ils ont
subis. Sur place, aux angles des bâtiments
inondés, on ne pose plus de
plaque indiquant "le niveau d'eau
maximum atteint". Ces "zouaves-là"
pourtant avaient leur utilité, ne
serait-ce que pour rappeler que
"c'était déjà arrivé". n
ARAAPPPPOORflTT
Les commissariats de police enregistraient les plaintes sur des documents
16 imprimés en précisant la situation familiale, le revenu et les pertes subies.
terme (moussons, El Nino, oscillation
www.cnrs.fr/dossiers/dosclim
Une partie question-réponse très
Pour en savoir plus
Le rapport de la mission d'expertise sur les crues
de décembre 2000 et janvier 2001 en Bretagne
Un document essentiel d'information sur les dernières crues (avec
bilan détaillé et propositions). Philippe Huet, de l'Inspection
générale de l'environnement, était le coordinateur de la mission.
Le rapport, qui comprend 130 pages est téléchargeable depuis le
site du ministère de l'Environnement www.environnement.gouv.fr
(855 Ko, format pdf).
Guide inondation
Une dizaine de pages. Il vaut ce qu'il vaut. Il est très généraliste
(il ne fait pas la distinction entre crue rapide et brève et crue lente
et prolongée qui n'ont pas les mêmes effets). Il ne comporte pas
d'évaluation chiffrée du coût de l'inondation et des solutions
proposées pour diminuer la vulnérabilité, mais il a le mérite d'exister.
Il peut apporter une première information sur la conduite à tenir avant,
pendant et après la crue. Il peut donner des pistes pour évaluer la
vulnérabilité d'une habitation (téléchargeable sur le site du ministère
de l'Environnement www.environnement.gouv.fr/dossiers/risques).
www.prim.net
Un site spécial dédié aux risques majeurs. Chaque commune de
France fait l'objet d'une fiche pour les risques qui la concerne. Par
région, on peut chercher la fiche correspondant à sa commune et voir
si elle est concernée, par exemple par le risque inondation, et à quel
niveau (avec enjeux humains, enjeux humains non définis ou sans
enjeu humain).
Des documents précieux pour la mémoire réalisés à l'Université
de Rennes 2 par le laboratoire Costel :
Crues et inondations dans la région de Rennes de 1914 à
1939. Maîtrise d'histoire. Sébastien Dassonville.
Les catastrophes naturelles sur le littoral des Côtes-du-Nord
entre 1854 et 1914. Maîtrise d'histoire. Charlyne Gicquello.
Étude diachronique des crues de l'Oust depuis le début du
XX' siècle. Maîtrise d'histoire. M. Billot.
Le Meu, crue et inondation : historique et croissance urbaine.
Maîtrise de géographie. Youna Elléouét. Une étude très minutieuse
et bien illustrée sur l'évolution de l'urbanisation en secteur
inondable sur deux communes rurales d'Ille-et-Vilaine.
www.meteo.fr
32 50 Le site offre bien sûr des prévisions
météorologiques
détaillées pour chaque ville,
mais aussi un espace découverte
pour comprendre la
météo. Par ailleurs, il donne
-:: de plus en plus d'informainondations,
orages, cyclones font l'objet de
www.ifremer.fr
tions événementielles ;
bilan.
www.lavilaine.com
Le site de l'Institution d'aménagement de la Vilaine. Un site très
intéressant pour les cartes de toutes sortes sur le bassin de la Vilaine
et de ses affluents. Les cartes sont en format "jpg" téléchargeables.
On y trouve des informations générales (géologiques,
topographiques) et aussi des informations sur la qualité de l'eau
(phosphates, nitrates, pesticides, eau potable) et sur le risque
inondation avec les cours d'eau surveillés et les grands travaux
étudiés par l'institution.
C'est au-dessus de l'océan
Atlantique que s'élabore le
climat de notre région. Pour
comprendre l'interaction
entre le climat et les océans,
consulter la partie du site
consacrée à l'oscillation
Nord-Atlantique (/lpo/cours/nao).
L'Atlas des zones inondables
Il aurait dû être en ligne depuis quelques mois (il l'est déjà pour un
certain nombre d'autres régions, comme l'Aude, la Picardie). L'atlas
breton existe et la Diren travaille sur le développement d'un produit
Web consultable en ligne. Ce qui donc ne devrait plus tarder.
Patience.
iNONDATInNS EXI?ost1t1Qn
EN BRETAGNE
L'Espace des sciences a réalisé une exposition
ET PERTURBATIONS
CLIMATIQUES
n Pourquoi les inondations ?
itinérante sur ce thème "Inondations et perturbations climatiques en
Bretagne". Composée de 25 panneaux autoportants grand format,
elle a été financée par le Conseil régional. Elle revient sur les
inondations de l'hiver 2000-2001 pour expliquer le phénomène sur la
péninsule bretonne, avec photos, schémas et images satellite. Elle
évoque aussi les grandes crues du siècle passé et ce que l'on peut
attendre du siècle à venir.
Espace des sciences, Patrick Le Bozec,
service diffusion, tél. 02 99 31 79 10.
www.coriolis.eu.org
Aperçu du programme Coriolis pour le suivi des océans et de
leur évolution. Les données
recueillies au cours du
programme permettront
de faire des prévisions
climatiques à court terme
(pour la pêche, la navigation,
la météo) mais aussi à long
Nord-Atlantique).
intéressante sur le climat :
"Pourrait-on revoir des
périodes de glaciation ?
Pourquoi les trous dans la
couche d'ozone sont-ils aux
pôles ?" Avec des extraits du
film documentaire "Qu'est-ce
qui fait les climats" pour
étayer les réponses.
Coriolis
Prochain dossier : Les nanotechnologies
Le moteur
t
bouffée d'air
comprimé
15° C
1` piston 300 bars
80° C
150 bars
80° C
150 bars
80° C
20 bars
radiateur en contact
avec l'air ambiant Q
0° C
150 bars
80° C
20 bars
-40°C
1 bar
~
~
a
air évacué
via le pot
d'échappement
18
actionne le
vilebrequin
0° C
20 bars
bouffée d'air envoyée
simultanément sur les
quatre pistons
actionne le
vilebrequin
Comment ça marche?
SCIENCES OUEST 195/JANVI ER 2003
s
air comprime
0,„,„ oitures électriques alimentées par une pile à
combustible (voir "Comment ça marche ?", Sciences
Ouest n° 188, mai 2002), voiture fonctionnant à
l'hydrogène... beaucoup de solutions sont envisagées pour
réduire la pollution atmosphérique dans les zones urbaines.
Répondant également à cette préoccupation, une nouvelle
voiture "carburant" à air comprimé vient de naître. Son
"père", Guy Nègre, travaille à sa mise au point depuis plus
de dix ans. Si ses performances sont encore modestes
(200 km d'autonomie, 60 km/h avec des pointes à 110 km/h
pour une masse de 700 kg), rien n'interdit de penser qu'on
puisse encore les améliorer. Comment fonctionne-t-elle ?
-~ L'air comprimé est déjà utilisé
depuis longtemps qu'il s'agisse de
marteaux-piqueurs, de pistolets à
peinture ou de l'ouverture et de la
fermeture des portes des rames de
métro, par exemple. Cependant,
avec ces techniques, il faudrait des
quantités énormes d'air comprimé
pour atteindre des performances
acceptables.
Pour disposer d'un rendement raisonnable,
ce moteur fait appel à une
architecture originale constituée de
quatre cylindres munis de pistons
mobiles travaillant soit successivement,
soit ensemble. Le but : tirer
profit de la surpression de l'air comprimé
pour fournir du travail. Un premier
volume de gaz, initialement à
une température d'environ I5°C et à
une pression de 300 bars, est envoyé
dans un premier cylindre. Le gaz se
détend naturellement ce qui a pour
effet, d'une part, de diminuer sa température
et sa pression (à -80°C et
150 bars) et, d'autre part, de repousser
le premier piston. Ce mouvement
entraîne un vilebrequin qui permet à
son tour de transférer la bouffée d'air
dans un "radiateur" en contact avec
l'air ambiant. En se réchauffant jusqu'à
environ 0°C, le gaz se dilate à
pression constante. Transféré vers un
deuxième cylindre, le gaz continue à
se dilater et cette augmentation de
volume repousse le deuxième piston
et abaisse à nouveau la pression et la
température (-80°C et 20 bars). Toujours
grâce au système de vilebrequin,
cet air repasse dans un
deuxième "radiateur". Il est ainsi
réchauffé à 0°C à la pression
Pour disposer d'un rendement
raisonnable, ce moteur fait appel à
une architecture originale constituée
de quatre cylindres munis de pistons
mobiles travaillant soit
successivement; soit ensemble.
constante de 20 bars. Enfin, il est
envoyé en parallèle dans les quatre
cylindres et repousse simultanément
les quatre pistons. Il se retrouve alors
à environ -40°C et à une pression
à peine supérieure à la pression
atmosphérique, ce qui ne lui permet
plus d'entraîner le moteur. Il est donc
évacué par le pot d'échappement
et un cycle recommence avec une
nouvelle bouffée provenant des
réservoirs d'air comprimé.
Ces réservoirs, actuellement
d'une capacité de 300 I, sont en
carbone car, en cas de choc, ils ont
alors tendance à se fissurer et non
à exploser. On peut envisager soit
d'intégrer un petit compresseur à la
voiture, la recharge en air comprimé
des réservoirs demandant quelques
heures, soit de disposer d'air comprimé
à 300 bars dans les stationsservice,
la recharge ne prenant alors
que quelques minutes.
La voiture de Guy Nègre doit
prouver qu'elle répond aux normes
en vigueur pour les véhicules automobiles.
Pour qu'il en soit ainsi, elle
risque de prendre du poids, qu'il
s'agisse d'augmenter la rigidité
de sa structure ou d'insonoriser le
véhicule.
Pour l'instant le véhicule électrique
alimenté par une pile à
combustible semble avoir une longueur
d'avance. Qui peut, cependant,
prévoir l'avenir, en particulier,
celui d'une voiture à essence sur
route se transformant en ville en
voiture à air comprimé ? n
Texte réalisé en collaboration
avec Jean-Pierre Michaut, directeur
du Centre de vulgarisation de la
connaissance, Orsay, Paris-Sud.
aspace
les sciences
LES MERCREDIS
DE LA MER
Cycle de conférences organisé
par l'Espace des sciences et
I'Ifremer. Prochains rendezvous
:
Mercredi 15 janvier
Télédétection et littoral
Par Jacques Populus, ingénieur de recherche
au service applications opérationnelles de
la direction de l'environnement et littorale
de l'Ifremer.
Mercredi 12 février
Le challenge de l'explorationproduction
offshore en mer :
l'apport des sciences et techniques
modernes
Par Lionel Lemoine, ingénieur responsable
thématique offshore, direction de la
technologie marine et des systèmes
d'information, Ifremer.
Les conférences durent environ une heure
et se terminent autour des questions du
public. 20 h 30, maison du Champ-de-
Mars, 6, cours des Alliés, Rennes, entrée
libre et gratuite.
(13
Les mercredis de
Prénom
Fax
l'E SPACE DES SCIENCES SCIENCES OUEST 195/JANVIER2003
Exposition
"NAPOLÉON MANGEA ALLÈGREMENT
SIX POULETS SANS CLAQUER D'ARGENT"
Nous vous avons dépeint, les mois derniers, l'ambiance de l'exposition "La chimie
naturellement" avec ses molécules acidulées et ses tubes à essai géants remplis d'objets
multicolores ; nous vous avons présenté l'esprit des animations proposées chaque jour à 16h ;
arrêtons-nous maintenant un instant autour des maquettes interactives qui jalonnent
l'exposition. Parmi les 17 présentées, l'une des 3 bornes multimédias, celle reprenant le
célèbre tableau de Mendeleïev, vous offre, en quelques clics, un panorama complet sur les
différents atomes, pour qui est déjà un peu familiarisé avec le sujet. Car au-delà des données
classiques que sont le symbole chimique, le numéro et la masse atomique... ce tableau
interactif vous met nez à nez avec une représentation animée en 3 dimensions de l'atome et de
ses électrons, mais vous propose également quelques signes particuliers, l'étymologie du nom,
la date et le lieu de la découverte de l'élément ainsi que des photos d'objets ou de substances
où l'on peut le retrouver... bref, des représentations rendues possibles grâce à l'utilisation,
maintenant courante, des nouvelles technologies mais qui permettent certainement
d'apprendre et de retenir un peu moins "bêtement" -en usant de moyens mnémotechniques
qui on fait leur temps ! -, l'ordre et les particularités de ces éléments. Le reste des maquettes
est en général facilement accessible aux plus jeunes qui iront mettre leurs yeux sur les loupes
du jardin des cristaux, "joueront" avec les potentiels d'oxydoréduction, actionneront la colonne
expliquant le principe de la chromatographie ou découvriront la molécule de la vitamine C. Le
tout faisant toujours référence à des objets qui nous entourent, nous rappelant que la chimie
est tranquillement présente, tout autour de nous.
La chimie naturellement, jusqu'au 22 février 2003 au centre commercial Colombia.
Du lundi au vendredi de 12 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 18 h 30. Animations :
tous les jours à 16 h. Plein tarif : 2 € ; réduit : 1 € ; 25 € pour les groupes scolaires ;
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Renseignements et
réservations : tél. 02 99 35 28 28.
triiir/It
ital
Abonnez vous et recevez sOentifia U e Sc er>tces ~u~s~ + I~ec+~uvr°
chaquemois
et technique
~u grand Ouest
Tarif étranger ou abonnement de soutien
2 ANS 76 € 1 AN 50 €
F
Je souhaite un abonnement de
1 AN (11 NO5 Sciences Ouest + 11 N°5 Découvrir)
2 ANS (22 NO5 Sciences Ouest + 22 NO5 Découvrir)
Tarif normal q Tarif étudiant (joindre un justificatif)
Tarif étranger ou abonnement de soutien
Nom
Qrganisme/Société
Secteur d'activité__
Adresse
Code postal Ville
7'é1
Je désire recevoir une facture
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de l'Espace des sciences, à retourner d
A : Espace des sciences, 6, place des Colombes, 35000 Rennes.
Tarif normal
2 ANS 54 € (au lieu de 66r€"*) soit 4 numéros gratuits
1 AN 30 € (au lieu de *) soit I numéro gratuit
Tarif étudiant (joindre un justificatif)
2 ANS 27 € (au lieu de ber-te ) soit 13 numéros gratuits
1 AN 15 € (au lieu de 33*) soit 6 numéros gratuits
19
Supélec
Supélcc • Supélec propose à Rennes des sessions de formation
continue. Les premières commencent au mois de mars 2003.
-►Rens.: Catherine Pilet, tél. 02 99 84 45 00.
CNRS
Du 20 au 22 janvier, Orsay/Calcul parallèle
Du 27 au 31 janvier, Orsay/Le langage C
-'Rens. : Les programmes sont disponibles sur catalogue,
www.cnrs-giff.fr/cnrsformation
Archimex Arch i mex
Les formations proposées par Archimex concement la mise
au point de nouveaux produits, ingrédients et additifs :
phytomédicaments, colorants, arômes, actifs fonctionnels...
Elles débutent en mars 2003. Le guide est d'ores et déjà
disponible.
->Rens.: Archimex, service formation, tél. 02 97 47 97 35,
formation@archimex.com, www.archimex.com
r\~ Adria
Les 22 et 23 janvier, Nantes/La méthode Triz
(nouvelle méthode de management de l'innovation
industrielle)
Les 28 et 29 janvier, Paris/Nouveaux modes de
consommation et de distribution en IAA
Les 28 et 29 janvier, Paris/Évaluation et gestion des
risques professionnels en IAA
Les 29 et 30 janvier, Paris/Les toxines alimentaires :
analyse et prise en compte du danger
Les 29 et 30 janvier, Quimper/Stabilisation des
sauces et produits apparentés
Du 4 au 6 février, Quimper/Charcuterie de la mer
Le 6 février, Nantes/Dirigeants des entreprises
alimentaires et responsabilité pénale
Les 11 et 12 février, Paris/Utilisation et maîtrise du
sel dans les produits alimentaires
Les 12 et 13 février, Paris/Règlementation alimentaire
mode d'emploi
Les 12 et 13 février, Nantes/La communication
qualité dans le cadre de l'Iso 9001 v2000
Le 13 février, Paris/De la cuisine à l'usine
-►Rens.: Tél. 02 98 10 18 50, sebastien.lecouriaut@adria.tm.fr
AFP! Afpi
INETLaide • Le guide des formations 2003 de l'Afpi est disponible. Le
siège social de l'Afpi Bretagne est installé depuis le mois
d'octobre 2002 sur le campus de Ker Lann, à Bruz (35).
-►Rens.: Joël Quintic, tél. 02 99 52 54 30, afpi-bretagne.com
Université de Rennes 1
UMVE0.50E CE RENNES 1 • Du 20 au 24 janvier, Station biologique de Paimpont/
Éthologie du cheval, module de base
-►Rens.: Service de la formation continue, tél. 02 23 23 39 50.
UBO
Médecine du travail
Le 23 janvier, Brest/Évolution des organisations de
travail et effet sur la santé
Kens. : Albert Mévellec, conseiller en formation au service
formation continue de l'UBO, tél. 02 98 01 67 73 ou 63 32 ou
67 81, albert.mevellec@univ-brest.fr
Formations
QUI A T? '.i Georges Duhamel, écrivain
20 (1884-1966), dans la Possession du monde (1919).
Les Mardis d'Ethos
1.1thtqe., Nttro conviction et ,e*poM*Oilni
41/4``1.
)002 100.1
Le guide des stages
des écoles et universités
Soc +1/-6
aide des
Comme chaque année, Rennes
Atalante réunit dans un petit
guide les propositions de
stages de différents établissements
: Université de Rennes 1,
Université de Rennes 2, 10
écoles d'ingénieurs, groupe
École supérieure de commerce
de Rennes et Institut d'études
politiques.
Rens. : Rennes Atalante,
tél. 02 99 12 73 73,
technopole@rennes-atalante.fr,
www.rennes-atalante.fr
Conférences
16 janvier/
Mathématiques
des jeux de
hasard
Brest - Comment le calcul des probabilités
prédit les équilibres naturels
et justifie les inégalités persistantes,
par Emmanuel Lesigne de l'université
de Tours - Amphi E de la faculté
des sciences et techniques - UBO
Brest à 18 h.
-►Rens.: http://www.univbrest.
fr/fr/actu/Welcome.html
21 janvier/
Motorisation électrique :
comment choisir le bon
actionneur ?
Angers - Cette demijournée
d'information
est organisée par la Meito, Jessica
Ouest et Pays de la Loire Innovation
pour faire le point sur la démarche à
adopter pour choisir le bon système
de motorisation, ainsi que sur les
technologies existantes et leur
mise en oeuvre. Inscription avant le
15 janvier.
-'Rens.: Meito, tél. 02 99 84 85 00,
info@meito.com
27 janvier/
L'hépatite C
Brest - Les lundis de la
santé sont organisés par le
service santé publique de la ville de
Brest, en collaboration avec l'UBO et
l'UFR médecine. Les conférences,
gratuites et ouvertes à tous, se
déroulent de 18 h 30 à 20h, amphi 1
de la faculté de médecine. Celle-ci
sera animée par le professeur Nousbaum
du service de dermatologie
du CHU Brest.
-'Rens. : http://www.univbrest.
fr/fr/actu/Welcome.html
4 février/
Nouveaux éléments sur
les origines de l'Homme
Nantes - Dans le cadre du cycle de
conférences mardis-Muséum ; par
Pascal Picq, paléoanthropologue au
Collège de France, Paris. 20 h 30.
-►Rens. : Muséum d'histoire
naturelle de Nantes,
tél. 02 40 99 26 20,
www.museum.nantes.fr
11 février/
Qu'est-ce qu'un
consommateur juste ?
Rennes - Cette conférence entre
dans le cadre du cycle
"Les mardis d'ethos",
sur l'éthique, proposé
par l'École nationale
supérieure agronomique de
Rennes, un mardi par mois, jusqu'en
juin, de 13 h à 14 h 30. Par Axel
Gosseries, de la Chaire Hoover
d'éthique économique et sociale de
Louvain la Neuve.
-~Rens.: http://www.rennes.inra.fr
25 février/
Inondation et sécheresse :
quelle gestion de l'eau ?
Paris - Par Eric Servat, directeur
de recherche à l'IRD* et directeur
du laboratoire hydroscience
de l'université
de Montpellier 2
(CNRS) et Jean-Marie
Fritsch, de l'organisation météorologique
mondiale et directeur de
recherche à l'IRD. Conférence
ouverte à tous ; 18 h 30 ; contenus
restitués sous forme d'enregistrements
audio et vidéo sur le site
Internet.
-►Rens.: Cité de sciences et
de l'industrie,
www.cite-sciences.fr/college
'Institut de recherche pour le développement.
~
meito
FORMATION CONTINUE EN
Institut de Formation
Supérieure en
Informatique et
Communication
UQus avez une expérience
de la programmation et
vous souhaitez intégrer
une équipe de conception,
de développement, de
maintenance de logiciels
complexes : l'IFSIC vous
propose de suivre, en
formation continue, le
D.U. GN lE
LOGICIEL
INFORMATIQUE
UNIVERSITE DE RENNES 1
diplôme d'université
de 2e cycle
â temps plein ou
partiel â partir
d'avril 2003
CONTACT / INFORMATIONS
UNIVERSITÉ DE RENNESI
SERVICE FORMATION CONTINUE
4, RUE KLÉBER 35000 RENNES
tél.: 02 23 23 39 50 — http://sfc.univ—rennestfr
130( iotac
Nantes 003
~
Appels à projet
Réseau national des technologies
Présenté le 5 décembre dernier par l'ENST Bretagne, l'Irisa, avec le soutien
du RNTL (Réseau national des technologies logicielles) et de l'Anvar, l'appel
à propositions 2003 du RNTL est paru. Il sera clos le 13 janvier.
-+Rens. : Irisa, Chantal Le Tonquèze, chantal.letonqueze@irisa.fr,
tél. 02 99 84 75 33.
Salons 2003
Pour participer aux salons : lntertronic et/ou Rf & Hyper, qui auront lieu en
mars et avril 2003, n'hésitez pas à contacter Chantal Rahuel à la
Meito.
-►Rens.: Meito, tél. 02 99 84 85 00, c.rahuel@meito.com
Nouvelles technologies
Le Conseil régional de Bretagne, la banque commerciale pour le
marché de l'entreprise du groupe CMB et France Télécom ont
lancé, le 5 décembre dernier, la deuxième édition des trophées
Bret@gne -Collectivités. Ce concours récompensera 9 collectivités
pour leurs initiatives relatives aux nouvelles technologies. La participation
est possible jusqu'au 31 mars 2003 et les prix (en dotation de matériels
informatiques) seront remis en juin 2003.
-►Rens.: www.trophees-bretagne-collectivites.net 21
41
meito
Expositions Colloques
Jusqu'au 2 février/
Images de sciences
Nantes - Le
Muséum
d'histoire
naturelle et la
bibliothèque
municipale
se sont associés
pour
proposer un
voyage à travers l'histoire des livres
de sciences et plus particulièrement
des images qu'ils contiennent. À travers
l'exposition "Illustrations naturalistes",
le musée présente au
public un patrimoine exceptionnel
de livres anciens dont l'iconographie
très riche montre l'évolution
des représentations scientifiques
du XVI' au XVIII' siècle. La bibliothèque,
quant à elle, propose un
parcours au coeur de l'illustration
des ouvrages de vulgarisation
consacrés aux sciences de la vie de
la fin du XVIII' au XX' siècle.
->Rens.: Muséum d'histoire
naturelle, tél. 02 40 99 26 20,
médiathèque Jacques Demy,
tél. 02 40 41 95 95.
Jusqu'au 16 février/
La vie cachée de l'huître
4'
CCSTI tion vous fera découvrir
l'Ifremer, cette exposi-
Lorient - Créée par
LORIENT la vie d'un animal finalement
méconnu dont le parcours, de
la naissance à la vie d'adulte est très
riche en péripéties.
Présentée à la Thalassa, l'exposition
sera également prétexte aux rendez-
vous des Mardis de la Thalassa.
Les 4 février et 4 mars, deux conférences
seront en effet consacrées au
fameux bivalve à 18 h 30. Des animations
à destination des scolaires
sont également envisagées...
-►Rens.: CCSTI de Lorient,
tél. 02 97 84 87 37,
contact@ccstilorient.org,
www.ccstilorient.org
Jusqu'au 28 février/
Histoires au fil du lait
Landerneau - Interdisciplinaire,
cette
exposition conçue
par le Cidil*, l'Ademir** et Ebulli-
Science*** retrace l'histoire du lait
et des produits laitiers à travers
l'histoire de l'humanité et l'évolution
des découvertes scientifiques.
-+Rens. : André Rosec,
Agence de développement
Pays de Landerneau Daoulas,
tél. 02 98 85 45 85,
adet@landerneau.com
Jusqu'au 4 mai/
Mémoire de l'industrie en
Bretagne
Rennes - Créée
au musée de la
Cohue à Vannes,
cette exposition
couvre, à travers le
regard du photographe
Yves Bernier, une histoire
industrielle et technique de plus de
4 siècles et une soixantaine de sites
bretons.
-►Rens.: Écomusée du Pays
de Rennes - ferme de la Bintinais,
tél. 02 99 51 38 15,
ecomusee.rennes@agg lorennesmetropole.
fr
Jusqu'au 27 juin/
Les voiles de
Océanopolis l'audace
Brest - Présentée à Océanopolis et
réalisée à l'occasion du 250' anniversaire
de l'Académie de marine de
Brest, cette exposition retrace les
grandes expéditions de découvertes
qui, au départ de Brest, ont animé
l'histoire maritime mondiale dans la
seconde moitié du XVIII' siècle.
-,Rens. : Océanopolis,
tél. 02 98 3440 40,
www.oceanopolis.com
Du 22 au 24 janvier/
Travail coopératif,
espaces collaboratifs
Foix (Ariège) - Qu'il s'agisse d'autoorganisation
construite sur la base
de quelques principes simples ou
d'activités dirigées selon des relations
interindividuelles plus complexes,
le travail coopératif est un
facteur reconnu de l'évolution des
sociétés animales. Quelles conséquences
est-il possible d'envisager
dans le domaine de l'éducation et
de la formation ? Tel est le thème de
ce colloque international.
-,gens.: Centre universitaire
de l'Ariège, Foix,
http://www.toulouse.iufm.fr/
Recherche/Menu.htm
25 et 26 septembre/
7' carrefour européen des
biotechnologies
Nantes - La programmation des
conférences et la recherche d'intervenants
de ce carrefour européen,
organisé avec
le soutien des
Régions Bretagne,
Pays de
la Loire et Poitou-Charentes, ont été
confiées à un comité scientifique
présidé par Denis Escande de
l'UMR université/Inserm 533 (viceprésident
Michel Renard, directeur
de la Génopole Ouest). Possibilité
de s'informer et de s'inscrire en
ligne : www.biotech-nantes.com
-+Rens.: Isabelle Rivaud,
Atlanpole, tél. 02 40 25 27 20,
rivaud@atlanpole.fr
PAYSdeIANOERNEAU
.~5
FICCIIEDS13311XECI
'Cidil : Centre interprofessionnel de documentation et d'information laitières. ''Ademir: Association pour le développement de la micro-informatique et des réseaux. '• •EbulliScience : Centre de vulgarisation scientifique de Vaux-en-Velin (Rhône-Alpes).
January 2003•N°195
These abstracts in English are sent to foreign
universities that have links with Brittany and to
the Scientific Advisers in French Embassies, in an
effort to widen the availability of scientific and
technical information and promote the research
carried out in Brittany.
If you would like to receive these abstracts on a
regular basis, with a copy of the corresponding
issue of Sciences Ouest, please contact
Nathalie Blanc, Editor, fax +33 2 99 35 28 21,
E-mail: nathalie.blancc0espace-sciences.org
••••••144
EtRETAGNE
ri Brittany Regional
Council is providing
financial backing
for this service.
RESEARCH AND INNOVATION IN BRITTANY
ABSTRACTS FOR THE INTERNATIONAL ISSUE
SPOTLIGHT ON THE NEWS P.6/7
6TH EDITION OF THE "SCIENCE
& ETHICS" MEETINGS IN BREST
EXTREME ENVIRONMENTS,
FROM ONE WORLD TO ANOTHER
Extreme terrestrial, maritime and space
environments converged on Brest for a 2-day
conference, the 6th edition of the "Science &
Ethics" meetings. This year, the main topic
was "Extreme Environments, From One
World to Another". The meetings showed
that the extreme, inhospitable nature of the
environment does not prevent scientists
from asking themselves more general
questions. Moreover, it is not only scientists
who have the right (or the duty?) to ask such
questions. Lawyers, professional people,
philosophers, associations and ordinary
citizens added a sparkle to the meetings
and showed the need for public debate.
Among the speakers at round tables were
Emmanuel Morucci, Sociologist and Director
of the Maison de l'Europe in Brest, who
mooted the unusual idea of setting up local
ethics committees, and Armel Kerrest,
Professor of Law at the Centre de droit et
d'économie de la mer (Cedem) and the
Institut de droit des espaces internationaux
(IDEI) who discussed the view that space
law could well provide inspiration for
maritime law. n
SPOTLIGHT ON LABORATORIES P.8
WEATHER FORECASTING
MÉTÉOSAT: THE SECOND
GENERATION
The MétéoSat 7 weather forecasting satellite
is now reaching the end of its useful life and
a replacement has had to be found. A
European call for tender was therefore
launched by Eumetsat. The result was the
development of two satellites, one of which
has already been put into orbit by Mane 4.
They are expected to provide more accurate
meteorological data by 2005. The first MSG
(MétéoSat second generation) satellite was
designed and produced by Alcatel Espace.
The terrestrial weather stations were
designed by computer experts from a French
company called Inta while the electronics
component was developed in Brest, at the
Institut supérieur d'électronique de Bretagne
(Iseb), under the leadership of Pierre
Cambon, Head of the Opto-Electronics
Departments (Doti). "MSG is much more
powerful than MétéoSat 7. It has twelve
channels, three for «the visible» and nine for
IR. This gives us precision when observing
water vapour, the ozone layer or the carbon
dioxide present in the atmosphere." The
cutting-edge technology is, of course, of
interest to Météo France but it is also
attracting private weather forecasting
companies, and may be of interest for the
routers used by competitors in ocean racing,
or equip airports, seaports etc. n
AN IN-DEPTH LOOK AT FLOODS
P.9/17
Over the past ten or more years, not a winter
has gone by in France without the media
showing roads under water and houses
flooded. Vast areas of south-westem France,
Brittany, eastern France, the Paris Basin,
north-eastern France and, now, southern
France have suffered disasters which
highlight the fact that flooding is the most
frequent risk facing French people today
(one out of every three towns and villages is
liable to be flooded at some time). It is also
the most expensive risk for local authorities,
accounting for 80% of the funds earmarked
to cope with natural disasters. Society is
more and more at risk because of increasing
urbanisation.
The "In-Depth Look" in this January edition
of the review takes a close look at the risk
of flooding in Brittany. It discusses the
conditions in which flooding occurs and the
resources implemented to prevent and
control the risk or limit its consequences.
Flooding in Brittany during the winter of
2001 led to a number of preventive
measures, with numerous risk-prevention
plans being implemented. As to the
monitoring of water tables, it has been a
daily task for many years now, in some
places for more than a century. Yet it only
comes into the spotlight when rivers
threaten to burst their banks.
Quite apart from the fact that flooding is a
highly "visual" catastrophe and, therefore,
much appreciated as a media scoop, which
in turn increases its effects in the minds of
the general public, the repeated floods of
the past few years have led to legitimate
questions and a desire to understand
catastrophes which are quickly erased from
popular memory. n
22
FORFAITS
"SCIENTIFIQUES"
Congrès, Réunions, Écoles scientifiques...
Forfait hébergement-restauration
à partir de 63 € TTC
par personne et par jour
PALAIS DU
GRAND LARGE
SAINT-MALO
Travaillez au Palais, Respirez au Grand Large !
SAIN T -MAL O
BRETAGNE
I, QUAI DUGUAY TROUIN - BP 109 - 35407 SAINT-MALO CEDEX
TEL. 02 99 20 60 20 - FAX 02 99 20 60 30
email : contact@pgl-congres.com - site Web : www.pgl-congres.com
La lumière rend tous les chemins plus sûrs.
Parce que la lumière est un des grands enjeux pour la qualité de vie de l'homme, EDF
développe des programmes d'éclairage pour rendre nos villes et villages plus beaux
et plus sûrs. edf.fr
EDF
donner au monde l'énergie d'être meilleur
Electricité
de France
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest