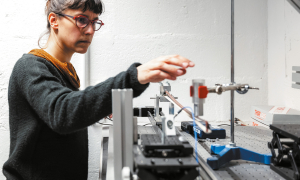Vers une crise des vocations chez les naturalistes ?
Carte blanche

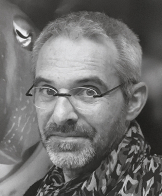
Depuis plusieurs décennies, nous accueillons en nombre, dans notre laboratoire, des étudiants fascinés par les comportements et l’intelligence des pieuvres et des seiches. Certains sont prêts à tous les sacrifices pour en faire leur métier. Pourtant, nous constatons une modification sensible dans la motivation de ces apprentis-chercheurs. Des changements sont intervenus dans la recherche en biologie au 21e siècle : de moins de 5 000 études dans la décennie 1990 sur les effets des perturbations climatiques sur les systèmes vivants, on dépassera probablement le million au cours de la décennie 2020-2030. L’explosion est du même ordre concernant les recherches sur la biodiversité, et à un degré un peu moindre sur les effets des substances toxiques sur l’environnement ou le bien-être animal.
Des effets secondaires
Ces recherches ont l’effet vertueux de sortir l’opinion publique de son insouciance, de mettre en lumière les problèmes dramatiques de l’anthropisation systémique des milieux, de la surexploitation des ressources et de nos relations à l’animal. Comme tout remède, ces études ont des effets secondaires. Le chercheur est devenu, malgré lui peut-être, lanceur d’alerte. Cela modifie, me semble-t-il, les motivations pour la recherche chez les plus jeunes, même chez les éthologues de demain. Dorénavant, les enthousiasmes naissants pour la discipline s’inscrivent fréquemment dans des démarches militantes2. À l’émerveillement et aux questionnements, provenant par exemple de la simple observation d’une petite pieuvre changeant de couleur au détour de baignades en mer, se substitue la nécessité d’avoir une cause à défendre. Les mystères de la petite pieuvre des récifs, qui nourrissaient l’imagination des enfants curieux, disparaissent maintenant derrière les courbes inquiétantes de tonnages de prélèvements annuels de l’espèce. Ils s’effacent aussi derrière les débats passionnés sur les projets d’élevages de poulpes en batterie.
Dans les programmes scolaires
La pieuvre est un invertébré tout à fait unique par le développement de son cerveau. On trouve des flots de vidéos sur la toile qui montrent ses performances étonnantes au cours de résolutions de problèmes « complexes ». Parce qu’elle peut ouvrir des bocaux en aquarium, la pieuvre est représentée comme un animal sensible, conscient de sa condition, ayant des états d’âme plus complexes que ceux des autres animaux. Certains lui attribuent même une forme de morale et des pouvoirs divinatoires. L’éthologue a rarement la parole dans cette circulation d’idées reçues. L’envie des futurs chercheurs et chercheuses est donc forte d’étudier l’intelligence et le bien-être de ce petit animal dans des aquariums en laboratoire. Je crains que le jeune éthologue qui travaillera sur ces animaux étonnants ne soit plus en contact avec leur vie réelle que par procuration. Il laissera le fantastique spectacle d’un petit poulpe sauvage qui évolue dans son habitat à quelques chasseurs d’images qui postent leur émerveillement sur les réseaux sociaux. Les études globales des populations de poulpes sont capitales, les recherches sur la génétique, l’intelligence et la sensibilité de ces animaux en aquarium sont très intéressantes, et font clairement avancer l’éthique et les neurosciences. Il me semble cependant crucial de laisser aux futurs naturalistes la possibilité de s’émerveiller devant l’animal dans son habitat naturel. La vraie intelligence du poulpe est de trouver comment y survivre et non d’empiler des objets géométriques dans un aquarium. Pour induire la curiosité et l’envie dans les jeunes esprits, l’éthologie des animaux devrait apparaître dans les programmes scolaires. Quant aux médias, ils ne devraient plus présenter exclusivement le biologiste comme un observateur parfois écouté mais impuissant au chevet d’une nature qui souffre.
1. Éthologie animale et humaine (CNRS), équipe de neuro-éthologie cognitive des céphalopodes.
2. Comme la crainte de la raréfaction d’une espèce ou la défense de son statut.
TOUTES LES CARTES BLANCHES
du magazine Sciences Ouest