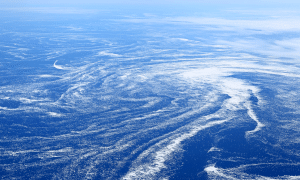L'environnement en Bretagne
AU SOMMAIRE Dossier : L'Environnement en Bretagne Le Livre blanc de la recherche Astronomie et civilisation IIII'/IIliSEA ,D MENSUEL DE L'INNOVATION REGIONALE MARS 1991-N°65-18F La Manche, une mer turbulente La Manche, nier européenne est le passage obligé pour un trafic maritime intense, entre l'Océan Atlantique et la Mer du Nord. Elle est l'objet de nombreuses études, coordonnées par Louis Cabioch, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff. Modèle réduit des courants dans la Manche. L'anneau autour de la cuve reproduit la force de Cioorlis, liée à la rotation de la Terre. Ce modèle, maintenant remplacé par une structure plus sophistiquée, avait servi a évaluer l'énergie marémotrice disponible et le parcours des rejets radioactifs. RESEAU est édité par le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI). TIRAGE MENSUEL : 3300 ex. CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tel. 99 30 57 97 - Fax 99 30 36 15. Louis Cabioch est biologiste : sa spécialité est l'étude des peuplements benthiques"' de la Manche. Il a aussi dirigé des recherches sur les conséquences de la catastrophe écologique de l'Amoco Cadiz et sur la pollution industrielle dans la Baie de Seine. Les biologistes ne sont pas les seuls à travailler dans la Manche : géologues, hydrodynamiciens et chimistes s'intéressent aussi à ce chenal qui alimente la Mer du Nord davantage que les grands fleuves qui s'y déversent et qui est aussi un modèle universel de mer à très fortes marées. C'est pourquoi des chercheurs de toutes disciplines se sont fédérés en un groupement de recherche (GDR) Manche du CNRS, créé en 1979 à la suite de la catastrophe de l'Amoco Cadiz, et qui a lancé en 1990 le programme FLUXMANCHE, conjointement avec 1'IFREMER, les Universités de Southampton et de Dundee et le Fisheries Laboratory de Burnham-on- Crouch, dans le cadre du programme européen MAST. "' benthique : qui vit dans les fonds marins. Carte d'identité de la Manche La Manche est une mer à très fortes marées, avec des courants puissants. C'est une mer peu profonde (généralement moins de 100 m.), à fond très plat, sauf à l'ouest, le long du massif armoricain. Le découpage des côtes induit d'importants gradients de courants de marée, dont la granulométrie des sédiments est un bon indice : galets dans les zones à forts courants, sédiments fins dans les zones à faibles courants. Il provoque aussi, dans la dérive générale des masses d'eau, la formation de vastes tourbillons à rotation lente. Une telle circulation réduit le renouvellement des eaux dans le Golfe normanno- breton, bien qu'à plus petite échelle, les courants de marée y soient particulièrement intenses. Par contre, devant l'embouchure de la Seine, une circulation plus ouverte reprend et disperse une grande part des apports du fleuve et la pollution chronique des fonds marins avoisinants ne reflète qu'incomplètement l'importance du flux de contaminants qui les traverse. L'hydrodynamique s'aborde de trois manières : l'approche directe (courantométrie), les mesures sur modèle réduit et la modélisation numérique. L'approche directe La mesure des courants à la surface, dans la masse d'eau et au fond, se fait à l'aide de courantomètres à partir de navires ou par mouillage, mais cette approche est limitée par l'état de la mer dans le premier cas et présente des risques de pertes dans le second cas, à cause des passages fréquents de cargos, de ferries et de chalutiers. Pour la mesu- Suite page 2 Photo Institut Mécanique de Grenoble. W65 0 OUI A DIT ? "Personne n'oserait affirmer que le parfum de l'aubépine est inutile aux constellations." Réponse page 17 Document 1: C. Salomon. /homer. N'6S © EDITORIAL L'ECOLOGIE MARINE : SCIENCE D'ACTION e mot écologie est associé presque toujours exclusivement à l'idée de protection de la nature. C'est un abus de langage, car l'écologie est avant tout une science : celle de "l'étude des interrelations entre les organismes et leur environnement" (Haeckel 1869). Les connaissances acquises à travers cette discipline peuvent être utilisées aussi bien pour protéger ce qui mérite de l'être, que pour produire. L'exploitation du domaine marin illustre tout particulièrement ce propos, car d'une part les interrelations entre animaux ou végétaux marins et leur milieu environnant sont très fortes et d'autre part les possibilités de contrôle du milieu sont évidemment très limitées. La base du développement de l'aquaculture (mais c'est également vrai, quoique moins apparent, pour la pêche) est donc l'écologie et ses différentes composantes (écophysiologie, écotoxicologie, etc.) et il est surprenant d'observer parfois des réactions, hostiles à ce type d'exploitation, justifiées par des soucis "écologiques". L'écologie marine est donc par nécessité à la pointe de la science écologique, science qui malheureusement, peut-être parce qu'elle est très interdisciplinaire, n'a pas toujours reçu en France, jusqu'à présent, le soutien qu'elle mérite. Elle est aussi en pleine évolution avec le passage de l'approche naturaliste descriptive à la modélisation mathématique des écosystèmes, pour conduire à de véritables outils prédictifs. Le programme National d'Océanographie Côtière dont l'Ifremer a pris récemment l'initiative devrait renforcer cette tendance. Ainsi l'écologie marine devient-elle sinon une science "dure" du moins une science d'action. Jean-Max de Lamare Directeur du Centre Ifremer de Brest. SOMMAIRE La Manche, une mer turbulente Tribune Astronomie et civilisation Une page d'histoire Une histoire de l'homéopathie 4 Les sigles du mois Actualités Le Livre blanc de la recherche 6 Perspectives Aidiamath 7 Environnement La forêt, de feuille en aiguille 8 Dossier L'Environnement en Bretagne 9/10/11/12 Le labo du mois Une médaille d'argent à l'IRISA 13 Développement Du service informatique à la formation 14 15/16/17 Que s'est-il passé ? 17/18 L'entreprise du mois Boiron : la santé par l'homéopathie 19 Suite de k pupe I re des courants de surface, on peut éviter ces difficultés en utilisant des radars haute fréquence installés le long de la côte ; un tel système de radars britanniques (OSCR II) fonctionne actuellement dans le goulet Douvres-Cap Gris Nez et donne de bons résultats. Les éléments radioactifs rejetés par l'usine de retraitement de La Hague marquent les eaux marines en très faibles traces. Pierre Guegueniat et son équipe du Laboratoire de Radioécologie marine de La Hague les mesurent à la mer et dessinent les trajectoires des masses d'eau sur de longues distances, principalement vers la Mer du Nord. Les biologistes du GDR Manche ont également étudié la dissémination des larves pélagiques de certains vers marins. En tirant parti des espèces ayant un biotope spécifique à l'état adulte et des larves bien identifiables dans la masse d'eau, il est possible de suivre le transport hydrodynamique des essaims larvaires et de mesurer les distances parcourues et la vitesse de la dérive. Les modèles réduits A l'Institut de Mécanique de Grenoble, Gabriel Chabert d'Hières et ses ingénieurs ont d'abord construit et exploité pendant de nombreuses années une Manche en réduction, montée sur une grande plaque tournante, reproduisant de manière très précise la marée et les courants associés, avec les effets de la force de Coriolis, liée à la rotation de la Terre. Cette petite Manche a été remplacée par une cuve cylindrique dans laquelle on procède actuellement, sur des maquettes simples, à la mise en évidence et à la mesure des phénomènes liés au frottement des courants de marée à la côte et sur le fond. Les modèles numériques Au centre IFREMER de Brest, Jean- Claude Salomon a élaboré un modèle mathématique bidimensionnel (courant moyenné sur la verticale), établissant notamment les trajectoires de courants résiduels dans diverses conditions de marée et de vent. En un point et pendant la durée d'une marée, le courant résiduel se manifeste par une différence efitre le parcours de l'eau durant le flot (courant commençant après la basse mer) et durant le jusant (courant commençant après la pleine mer). Les trajectoires qui en résultent sont donc celles parcourues par l'eau à long terme, par delà les cycles alternants des courants de marée. Jean-Claude Salomon construit actuellement un modèle en trois dimensions, qui représentera en outre la variation de la vitesse sur la verticale. Les mesures chimiques Le courant général portant vers la Mer du Nord véhicule des particules en suspension, des substances chimiques naturelles et des contaminants très divers (métaux, polluants organiques). Dans un premier temps, un groupe d'équipes franco-britanniques vise à Trajectoire des courants résiduels (après soustraction des courants de marée) dans la Manche, un jour sans vent. Le golfe normanno-breton est le siège de grands tourbillons lents. Dans le goulet Douvres-Cap Gris Nez, le remplissage de la Mer du Nord est associé à de forts courants. estimer la contribution de la Manche aux apports chimiques en Mer du Nord, en procédant, mois après mois, à des mesures du flux de matières transitant à travers le Pas-de- Calais. L'ensemble de ces travaux permettront aux scientifiques de dresser un modèle du fonctionnement de la Manche, modèle qui servira à prévoir les conséquences des pollutions et des aménagements du littoral. 1/2 3 5 Que va-t-il se passer ? Hubert Reeves Astrophysicien. mars °Rennes u C(S1 l le 20 marrsé flexions d'un Invité R ves livrera Les Entrée sur Nobel ate de la nature". nuée personne,i retinvirer our une et Techniques, le Cation , valable Sciences ni uh s, et rer à l'Espac e de 12 h 30 11 h. vensdaremdei di m mors, de 14 h a 9 Nubert Reeves le Avant à Rennes, Avnnt de vend es le 19 m°rs' sera à Vann N'65 El T R I BUNE Astronomie et civilisation On a trop longtemps sous-estimé et négligé l'importance pédagogique et civilisatrice de l'astronomie dans l'éducation. Longtemps on y a vu un aimable passe-temps, plus ou moins inutile. Un vernis de culture pour "honnête homme". 1 Cette science, pourtant, jouit d'une position tout à fait privilégiée. Elle s'intéresse à une réalité qui nous touche de toute part. Si le monde des étoiles est un monde d'émotions et de rêves, il est aussi un lieu de recherches scientifiques rigoureuses poursuivies avec les techniques les plus poussées et les analyses conceptuelles les plus abstraites. Cette position lui confère une valeur pédagogique tout à fait unique. Les professeurs de sciences savent combien leurs étudiants deviennent plus attentifs et plus motivés quand la théorie enseignée est appliquée aux corps célestes. Quand les exemples discutés viennent du ciel. La chimie prend du goût quand on s'intéresse, par exemple à la formation des molécules dans les nuages interstellaires. Les lois de la mécanique sont impressionnantes quand elles entraînent sur leurs orbites les planètes majestueuses. L'enseignant des classes de lettres sait aussi, par expérience, combien l'impact des nuits étoilées fait vibrer la sensibilité des étudiants. Les "littéraires" rejoignent là les "scientifiques" de la classe. Mais au-delà de cet intérêt pédagogique, l'astronomie peut prendre, quand elle est mordiale. Dans les brasiers incandescents des étoiles, les noyaux atomiques ont été forgés, puis disséminés dans l'espace, au moment des explosions de supernova qui marquent la mort de ces astres. Plus tard, dans les vides interstellaires, les atomes se sont liés en molécules et en grains. Ces grains, accumulés par milliards, ont ensuite donné naissance aux corps planétaires où la vie peut apparaître. Sur notre planète bleue, le mouvement organisateur s'est poursuivi jusqu'à l'apparition des mammifères et des plantes à fleurs. Dans ce contexte, notre présence ici et aujourd'hui, est liée à un ensemble de phénomènes dans lesquels tout le cosmos est impliqué. L'astronomie aujourd'hui, nous révèle notre généalogie et notre appartenance au monde. Elle nous situe dans ce grand mouvement d'organisation cosmique qui se poursuit depuis des milliards d'années, sur des milliards d'années-lumières. De là, plusieurs messages émergent qui prennent une importance particulière dans notre contexte politique. La dignité humaine peut trouver une assise nouvelle dans la prise de conscience de notre participation à la saga de la comple-xité cosmique. Avant d'être blancs ou noirs, ou canadiens ou français, ou juifs ou arabes, ou hommes ou femmes, nous sommes tous, à titres égaux, les enfants du cosmos. Mais, en plus, nous sommes responsables de l'avenir de cette prodigieuse histoire, c'est-àdire, d'une façon plus concrète, de notre planète et de sa capacité à héberger la vie. Cette remarque prend sa pertinence face à l'état de détérioration de notre environnement. Vue dans cette optique cosmique, la lutte contre la pollution prend une dimension plus dramatique encore. proprement située, une dimension civilisatrice de toute première importance. Notre univers a une histoire. Telle est sans doute la plus grande découverte de notre siècle. Contrairement à ce que le monde scientifique a pris pour acquis pendant très longtemps, notre univers n'est pas éternel et inchangeant. Les observations astronomiques s'accordent à nous présenter l'image d'un univers plus chaud et plus dense dans le passé ; en refroidissement depuis quinze milliards d'années. C'est ce qu'on appelle le "Big Bang". Aujourd'hui, on peut raconter l'histoire de l'univers comme la narration des événements qui ont permis à la matière de s'organiser. L'image la plus ancienne, celle qui est véhiculée par le rayonnement fossile à 3 degrés K, nous fait voir, à cette époque, un cosmos entièrement désorganisé. Il est alors dépourvu de toutes les structures qui font aujourd'hui sa richesse et sa variété. Nous sommes partiellement en mesure de retracer les phénomènes qui ont permis cette organisation progressive du monde. Les galaxies et les étoiles sont apparues grâce à l'action de la force de gravité sur la purée prirait d'Hahnemann UNE PAGE D'HISTOIRE Une histoire de l'homéopathie L'homéopathie est une philosophie, peutêtre médicale, peut-être scientifique, le débat reste ouvert. Dans l'histoire des sciences, il nous a paru intéressant de dresser brièvement un tableau chronologique de l'homéopathie, depuis Hippocrate jusqu'à Jacques Benvéniste. L'antiquité Certains font remonter l'idée homéopathique à Hippocrate, qui aurait dit, cinq siècles avant notre ère : "Les symptômes sont l'expression de l'effort d'un organisme pour retrouver son équilibre momentanément perdu. Ces symptômes, il ne faut pas les combattre, mais les favoriser. La médication devra agir dans un sens semblable à la maladie" m. Mais le père moderne de l'homéopathie, en tant que traitement expérimental, est Christian-Samuel Hahnemann. La révolution homéopathique En 1790, Hahnemann est médecin à Leipzig, en Allemagne. Déçu par les limites de son art, il décide d'élargir ses connaissances sur les substances médicamenteuses utilisées à l'époque :' la belladonne, le camphre, les sels de mercure, le soufre, la noix vomique, ... Alors en bonne santé, Hahnemann teste ces médicaments sur luimême et observe l'apparition de symptômes habituellement traités par ces médicaments. Il formule l'hypothèse de la similitude : pour guérir un malade, il est possible de lui administrer un remède qui lui donnerait, s'il était bien portant, la maladie dont il souffre. Cependant, si le remède est administré en trop grande quantité, l'état du malade empire. Il faut donc réduire les doses. La dilution Toujours expérimentalement, Hahnemann teste ses traitements de plus en plus dilués, et observe chaque fois la même efficacité, même lorsqu'il ne reste plus dans la solution une seule molécule de médicament. A la même époque (en 1811), Avogadro montrait qu'une molécule-gramme contient 1024 molécules, or sur l'échelle des dilutions Hahnemaniennes (nCH'2), n entre 1 et 30), la quantité de produit présente dans le solvant atteint 10-60 pour 30 CH. On peut considérer que jusqu'à 12 CH, il reste une chance pour que la molécule active soit présente. La dynamisation Lors du mélange du produit avec le solvant, l'opérateur secoue le récipient, pour dynamiser le mélange. Les premiers homéopathes pensent en effet que la dynamisation n'a pas seulement pour but d'homogénéiser la préparation : les deux opérations, dilution et dynamisation, paraissent contribuer à conférer au remède sa puissance médicamenteuse. Les défenseurs de l'homéopathie pensent que l'activité bénéfique recherchée n'est pas fixée à la molécule, mais liée à une onde, ou à une énergie spécifique, qui contaminerait le solvant après son contact avec la molécule. Les recherches actuelles tentent de déterminer le facteur capable d'expliquer l'effet thérapeutique de solutions diluées au-delà du seuil d'Avogadro. En 1988, médiatisation et controverse Les instruments de mesures physiques sont de plus en plus sophistiqués, et il devient possible de mesurer des quantités de plus en plus petites, grâce entre autres aux méthodes spectroscopiques... Mais jamais encore il n'a été possible de mesurer la présence d'un corps dilué 1060 fois. La polémique à propos de la "mémbire du solvant" ") montre cependant à quel point de grands scientifiques, comme Jacques Benvéniste, directeur de recherche à l'INSERM, peuvent s'investir dans la quête d'une explication de l'infinitésimal. Jacques Benvéniste avait mis en avant le fait qu'une information moléculaire pouvait être transmise sans le support de la molécule. La crédibilité de l'homéopathie En sciences, un critère d'évaluation d'un travail est sa parution dans une revue spécialisée internationale. La réputation de la revue étant en jeu, chaque communication est soumise à un jury compétent, qui vérifie les résultats annoncés. Pour l'homéopathie, deux articles sont parus dans des revues reconnues par la communauté médicale, à propos d'essais cliniques sur des patients traités soit par homéopathie, soit par placebo. Les prochaines années apporteront peut-être d'autres réponses, grâce aux recherches engagées dans les instituts spécialisés (Boiron'6', Dolisos, ...), dans certains CHU et laboratoires de l'INSERM, de l'INSA et du CNRS. "' M. Martiny : "Histoire de l'homéopathie in Histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire". Paris : Laffont, Tchou, 1979 ; 3 (VI) : 303-25. "'CH = Centésimale Hahnemannienne : Une dilution 1 Ch contient 99% de solvant et 1% de produit actif (10-2). Pour 2 Ch, 99% de solvant et 1% de 1 Ch (10'). r3, Nature, 1988, N° 333, p. 816-818. "' D.T. Reilly, M. Taylor, C. Mc Sharry, T. Aitchison : "Is homeopathy a placebo response ? Controlled trial of homeopathic potency, with pollen in hayfever as model". The Lancet, 1986, 18 octobre, p. 881-886. 'S1 P. Fisher, A. Greenwood, E.C. Huskisson, P. Turner, P. Belon : "Effect of homeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia)". Bristish Medical Journal, vol. 299 : 365, 5 août 1989. "'Voir article sur Boiron page 19. Ouvrages de référence Bernard Poitevin : "Le devenir de l'homéopathie : éléments de théorie et de recherche". Editions Dain, 1987. Michel de Brocantai : "Les mystères de la mémoire de l'eau". Editions La Découverte, 1990. Christian Boiron, Jean Rémy : "L'homéopathie, un com- N'65 bat scientifique". Editions Albin Michel, 1990. 0 SIGLES DU MOIS IRESTE Institut de Recherche et d'Enseignement Supérieur aux Techniques de l'Electronique et de l'Informatique Statut juridique : Créé par décret du 26/11/85, fonctionnant au sein de l'Université de Nantes. Nombre d'adhérents : 332 étudiants en 91. Structures : • Conseil d'administration : 12 personnalités extérieures, 8 enseignantschercheurs, 2 personnels administratif et technique, 2 étudiants, • association IRESTE - A, 3 associations d'étudiants. Budget - financement : • Subvention du Ministère de l'Education Nationale, contrats de recherche, • taxe d'apprentissage. Activités : • Formations : - Ingénieur (en 3 ans) : l'ingénieur IRESTE est un spécialiste de la conception et de la mise en oeuvre des systèmes électroniques, c'est-a-dire des ensembles "Matériel et Logiciel" qui s'insèrent dans des applications comportant des processus physiques, chimiques, mécaniques ou biologiques et qui assurent des fonctions de contrôle, de commande, de transmission d'information, d'interface. Il est capable de concevoir, de développer et d'adapter des systèmes électroniques, mais il sait aussi comment les industrialiser et les produire. La formation est accessible aux titulaires d'un DUT ou BTS de la filière électronique. L'IRESTE recrute aussi en deuxième année des étudiants titulaires d'une maîtrise de la filière électronique. - MIAGE (en 2 ans) : le "Miagiste" est un informaticien capable de concevoir, de réaliser et de mettre en oeuvre les systèmes informatiques des différents domaines de l'activité économique. Son orientation professionnelle est celle d'analyste ou chef de projet. La formation est accessible aux titulaires de : DEUG Scientifiques, DEUG Economie, gestion, DUT, BTS. Chaque promotion accueille 24 étudiants. La Formation continue permet aussi, selon plusieurs procédures, l'accès a la MIAGE )Fongecif,...). - Formation continue : stage IRESTE- CITCOM (Centre d'Ingénierie et des Techniques de la Communication), 7 mois en formation intensive ; stages de courte durée en électonique et informatique industrielle, informatique, systèmes d'exploitation et langages. • Recherche (quatre thèmes principaux sont développés à l'IRESTE) : - analyse et traitement des images : D. Barba, équipe de recherche appartenant au Laboratoire de Robotique et d'Informatique Industrielle, -conception de systèmes électroniques :1.-P. Calvez, équipe de recherche appartenant au LRII, -systèmes et signaux hautes fréquences : J. Saillard, Laboratoire membre du Groupement Régional de Recherche en Microondes, - modélisation et simulation de procédés pour l'électronique : Y. Catherine, antenne du Laboratoire des Plasmas et des Couches Minces, UMR CNRS 110. Nombre d'employés : 32 enseignants permanents, 74 enseignants vacataires, 10 ingénieurs/ techniciens/administratifs. Correspondant: Y. Lemeur. Tél. 40 68 30 51. Adresse : IRESTE, La Chantrerie, CP 3003, 44087 Nantes cedex 03, tél. 40 68 30 00. RESEAU MARS 91 - N°65 ORSTOM Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération Statut juridique : Etablissement Public Scientifique et Technique (EPST) placé sous la double tutelle des Ministères de la recherche et de la coopération. Effectif : 1 500 personnes. Structures représentées au Conseil d'Administration : Les ministères de tutelle et autres administrations et institutions scientifiques concernées par les activités scientifiques au service du développement : Ministère de l'économie des finances et du budget ; Ministère des Dom-Tom ; Ministère de l'éducation nationale ; Ministère des affaires étrangères ; Caisse centrale de coopération économique ; INRA ; INSERM ; IFREMER ; CIRAD. Budget - financement: 900 millions de francs. Missions: Conduire des recherches de base finalisées contribuant au développement des régions de la zone intertropicale, en particulier par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays et par des recherches expérimentales visant la maîtrise du développement. Ces recherches sont conduites en coopération en fonction des choix scientifiques et technologiques définis en accord avec des partenaires français et étrangers. L'Orstom contribue également à la formation, à la recherche et par la recherche de spécialistes français et étrangers. Entrent également dans ses missions la diffusion et la valorisation des résultats de ses recherches. Activités : Les programmes de recherche sont conduits par des équipes relevant d'unités de recherche regroupées en plusieurs départements touchant à cinq champs d'activités : Terre, Océan, Atmosphère ; Milieux et Activités agricoles ; Eaux continentales ; Santé ; Société, Développement, Urbanisation. L'interdisciplinarité thématique et méthodologique est la voie privilégiée de la recherche à l'Orstom. Informatique, télédétection, équipements et infrastructures scientifiques, moyens navigants, information scientifique et technique coordonnent et appuient les thèmes de recherche. Un service chargé de la formation assure l'animation et la coordination des actions conduites dans ces domaines. Projets : Depuis un an, l'Institut s'est engagé dans un mouvement visant un recentrage sur des problématiques et thématiques où il occupe une place d'excellence, tout en renforçant ses collaborations vers la communauté scientifique internationale, en favorisant l'émergence d'espaces scientifiques de coopération "Nord-Sud", pèles scientifiques à vocation régionale implantés dans les pays de la zone intertropicale. Correspondant: Bureau de presse et de communication : Arlette Goupy, tél. 16)1)48037519. Adresse: 213, rue La Fayette, 75010 Paris. RESEAU MARS 91 - N°65 CEANSE CEntre d'ANalyse SEnsorielle - Rennes Statut juridique : SARL créée le 02/04/1990. Budget - financement : Le capital de la société est de 50 000 F. Missions : • CEANSE a pour objet la réalisation d'études dans le domaine de la qualité des aliments et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse sensorielle, • CEANSE s'est donné également pour mission d'apporter du conseil aux entreprises agroalimentaires ou non alimentaires désirant faire appel aux techniques sensorielles. Activités : • Réalisation d'études dans le cadre "Recherche et développement", études portant sur des produits nouveaux ou en cours de modification, • réalisation d'études de marché étroitement liées à des études marketing, • mesures organo-leptiques de produits par un jury (test en salle), • études de positionnement d'un produit parmi ses équivalents de la concurrence - suivi de ce positionnement au cours du temps, • création d'un jury national de consommateurs pour enquêtes sensorielles - résultats d'une enquête sensorielle à l'échelle nationale, ceci permet de segmenter le marché selon des critères sensoriels, • corrélations entre acceptabilité des produits, décision d'actes d'achat avec l'origine régionale, l'état civil, les catégories socio-professionnelles... Projets : • Mise en place d'un jury d'enfants experts, • mise en place d'un jury d'experts en odeur, • mise en place d'un réseau européen de cabinets d'analyse sensorielle (en salle, auprès d'un jury de consommateurs), • réalisation d'audit de service d'analyse sensorielle interne, • application les travaux de recherche de statistique à l'analyse sensorielle. Nombre d'employés : 1 Correspondant : Sophie Rétif, gérante, tél. 99 54 95 27. Adresse : 85, rue de St-Brieuc, Bât. Nucléole, 35000 Rennes. RESEAU MARS 91 - N°65 LA BRETAGNE EN CHIFFRES SUPERFICIES BOISEES ET TAUX DE BOISEMENT La Bretagne a une superficie boisée totale de 266 779 hectares et un taux de boisement de 9,7 %, très éloigné du taux de boisement national qui se situe aux alentours de 25 %. C'est donc une petite région forestière. Départements Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Total Surfaces boisées 66 436 ha 54 387 ha 56158 ha 89798 ha 266 779 ha Toux boisement 9,5 % 8 % 8,2 % 13,1 % 9,7% Surface boisee productive par type de peuplement. Départements Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Total Futaie de feuillus 700 ha 2 260 ha 5 020 ha 880 ha 8 860 ha Futaie de pins 3 860 ha 4 500 ha 8130 ha 20 760 ha 37 250 ha Futaie d'autres conifères 13 920 ha 10180 ha 3 000 ha 5 720 ha 32 820 ha Futaie mixte 670 ha 460 ha 510 ha 840 ha 2 480 ha Mélange futaie-taillis 19120 ha 10 680 ha 20 230 ha 14 790 ha 64 820 ha Taillis simple 7 180 ha 9 590 ha 5160 ha 7330 ha 29 260 ha Peuplements morcelés 14 800 ha 9 890 ha 9 090 ha 20 580 ha 54 360 ha Boisements lâches 3 110 ha 3 250 ha 2120 ha 9 980 ha 18 460 ha Surface totale 63 360 ho 50 810 ha 53 260 ha 80 880 ha 248 310 ha RESEAU MARS 91 - N 65 N"65 annonçant dès à présent un recrutement préférentiel de chercheurs de haut niveau en province. R. - En Bretagne, comment les choses vontelles se passer ? J.H. - Un comité de pilotage désigné par le Préfet oriente la démarche concrète et se prononce sur le contenu du Livre blanc. Les collectivités territoriales, région, départements, villes, sont appelées à exprimer leur vision du développement futur de la recherche. Parce qu'elles apportent un concours précieux à son financement et à celui de son environnement, il est normal de les associer étroitement à ce document. Mais c'est à partir des réflexions prospectives des chercheurs et des industriels que les projets porteurs d'avenir pourront être identifiés et décrits. Dès à présent, une liste de thèmes de réflexion a été dressée. Pour chacun d'eux, un ou des animateurs sont désignés qui devront rassembler tous ceux qui sont susceptibles de contribuer à la réflexion. Cette information est diffusée largement par le canal des structures liées à la recherche, pour ceux qui auraient pu être oubliés puissent se signaler et être associés à la démarche. Nous comptons beaucoup sur une mobilisation spontanée, en particulier des jeunes chercheurs, davantage concernés par l'avenir de la recherche dans 10 ou 15 ans. Nous espérons également inciter les chercheurs à se fédérer, pour présenter un projet compétitif. COMITE DE PILOTAGE Président : Edouard Lacroix. Animateur : Jean Hameurt. Rapporteur général : Daniel Grandjean. Composition : Yvon Bourges, président du Conseil régional: Claude Champaud, président du CCRRDT (Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique). Yves Morvan, viceprésident du Conseil économique et social. Herbert Maisl, recteur de l'Académie. Les présidents des universités. Un directeur d'une structure de transfert. Un représentant de la Culture scientifique et technique. Des industriels. AC TU A LIT ES Le Livre blanc de la recherche Tous les acteurs de la recherche et du transfert de technologie en région Bretagne, recherche publique et privée, recherche fondamentale et appliquée, vont être appelés à participer à l'élaboration d'un Livre blanc de la recherche. Cette opération de réflexion prospective à 10-15 ans, d'initiative interministérielle, se déroulera sous l'autorité d'Edouard Lacroix, Préfet de la région Bretagne et sera animée par Jean Hameurt, Délégué régional à la recherche et à la technologie. Réseau : Quels événements ont motivé l'élaboration du Livre blanc ? Jean Hameurt - Depuis plusieurs années, les régions se plaignent de ce que l'effort national au profit de la recherche ait une importance exagérée dans la région parisienne (plus de 50%). En juin 90, après exploitation du rapport de Alain Mailfort, Hubert Curien, Ministre de la recherche et de la technologie, et Jacques Chérèque, Ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, ont annoncé cette opération en conseil des ministres. Elle a été officiellement lancée après la tenue d'un CIAT (Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire) en novembre 90. Ainsi, chaque préfet de région a été chargé de mettre en ouvre la réalisation d'un Livre blanc de la recherche et de la technologie, qui devra être remis le 15 juillet 91. R. - Quelles sont les différentes étapes de la réalisation de ce Livre ? J.H. - Chaque région doit effectuer un inventaire actualisé, réaliste, des forces de recherche : recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche réalisée par les industriels, culture scientifique et technique. Toutes ces données doivent être recensées, de manière aussi exhaustive que possible, afin de dégager les points forts, les spécificités de chaque région. A partir de ce constat vient la réflexion prospective, à échéance de 10 ou 15 ans, hors de toutes les contraintes inhérentes à une programmation, sans aucun souci ni de la nature des différentes structures de recherche, ni des possibilités de financement. C'est là l'originalité de la démarche : il ne s'agit pas d'un programme, mais d'une réflexion, débouchant sur des projets fédérateurs, ambitieux mais crédibles, privilégiés et spécifiques. R. - Comment les résultats de cette réflexion seront-ils utilisés ? J.N. - Les Livres blancs de chaque région seront validés au niveau national lors d'un CIAT qui se tiendra à la fin de l'année 91. Ils serviront alors d'outils pour construire les prochains programmes, comme les contrats de plan Etat-Régions. Dans le même temps, les grands organismes vont effectuer une réflexion prospective "verticale" : à l'intérieur de leur institution, ils vont réfléchir au développement de leurs implantations dans les régions. François Kourilsky, directeur général du CNRS, donne l'exemple en CA 1990 : 132 MF Conditions spéciales enseignement kta CNRS - SSII sur l'OUEST ler Distributeur de micro-informatique dans la région Larges compétences en TELECOM et RESEAUX - MICRO-INFORMATIQUE - PERIINFORMATIQUE - LOGICIELS : COMPAQ, IBM, HP, TOSHIBA : NEC, EPSON, IBM, HP... : MICROSOFT, LOTUS, IBM, BORLAND. INGENIERIE RESEAUX, INGENIERIE GRAPHIQUE, INGENIERIE LOGICIEL W65 6 une nouvelle conception de l'enseignement L'élève face à son professeur. Ce dernier, de temps en temps, adresse un message sonore d'encouragement, message sonore ou visuel. Dans certaines professions, des pro- La didactique blèmes simples de gestion deviennent des casse-tête. Les bancs de l'école sont loin, l'algèbre est redevenu de l'hébreu. Heureusement il existe des outils pratiques de remise à niveau en mathématiques. Trois organismes rennais se sont concertés pour mettre au point un outil informatique multimédia accessible à des adultes en formation : l'IREM, l'ENSP et l'INPAR (voir encadré). La naissance d'AIDIAMATH Tous trois ont de l'expérience en formation et en didactique et travaillent avec des publics ayant des besoins d'outils d'enseignement individualisé en mathématiques. En 1988, répondant à un appel d'offres de la Délégation à la Formation Professionnelle, les trois organismes se lancent dans la création d'AIDIAMATH, qui à terme se composera de deux modules. L'un concerne les mathématiques utiles à la gestion, l'autre la représentation et la structuration des données. Le 1" février à Rennes, au CCETTT", Roger Le Roux, de l'IREM, a présenté le premier sous-module "PARTAGE", élément du module "Mathématiques appliquées à la gestion", qui enseigne, par la résolution de problèmes, différents modèles de répartition, tels les partages directement proportionnels, les partages inversement proportionnels ou les partages inégaux. Un outil multimédia Chaque module d'AIDIAMATH fait intervenir l'informatique, l'audiovidéographie interactive, l'audiovisuel et le support papier (livret personnel). A tour de rôle, micro-ordinateur, papier et voix servent d'interface entre l'homme-élève et le logiciel-professeur. L'élève résoud les problèmes proposés par le système informatique, en choisissant ses réponses sur l'écran à l'aide d'une "souris". Le programme informatique est l'oeuvre de la société AUSY Automatismes et Systèmes. Si les réponses proposées par l'élève ne sont pas satisfaisantes, une voix vient l'aider à franchir progressivement les obstacles du problème. Ces aides associant son et image sont des applications d'audiovidéographie interactive, applications mises au point par le CERTAC'2'. La liaison avec le logiciel AIDIAMATH a fait l'objet d'un programme financé par l'ANVAR"', et réalisé par les société THINK Systems et Atlantide Grenat Logiciel. La partie audiovisuelle et le livretpapier accompagnant chaque module sont l'oeuvre d'INPAR-Communication. L'originalité de la démarche C'est un outil interactif, qui comporte une banque de problèmes critérisés, en particulier par un niveau dans une hiérarchie. En fonction des caractéristiques de l'élève, évaluées au travers de ses réponses, le système adapte la succession des problèmes à résoudre. L'élève choisit lui-même sa méthode de résolution. Prenons l'exemple d'un partage : Pierre, Paul et Roger ont respectivement 20, 60 et 100 hectares de cultures. Sachant qu'ils disposent de 450 kilos d'engrais, comment les répartir équitablement ? La méthode algébrique consiste à poser le problème en équations. La méthode graphique passe par le dessin, en segments ou en surfaces, des différentes parties. Reste la méthode empirique, celle où plusieurs réponses sont essayées et corrigées jusqu'à obtention du résultat. AIDIAMATH ne prend pas systématiquement partie pour l'une ou l'autre tactique, mais il aide l'élève à consolider sa démarche, voire à la modifier si elle est peu adaptée au problème en question. Lorsque l'élève est en difficulté, le logiciel propose une aide, qui va dans le sens du raisonnement en cours. En mémoire, AIDIAMATH enregistre les performances de l'élève, détermine ses points faibles, et décide des prochains problèmes. en priorité AIDIAMATH n'impose pas des procédures ou des représentations, mais aide l'élève à consolider et à varier les siennes, à son propre rythme. C'est ce qui est appelé Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur (EIAO), une application de cette intelligence artificielle de l'informatique, où la machine réagit différemment selon chaque individu. Si les résultats obtenus avec les adultes en formation sont satisfaisants, ce type de logiciels didactiques pourra se développer dans les lycées et collèges. LES PARTENAIRES D'AIDIAMATH IREM : Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, créé en 1969, lors de l'introduction des mathématiques modernes dans les écoles, lycées et collèges, pour former les enseignants à cette nouvelle discipline. Maintenant, l'IREM poursuit sa mission de formation continue des enseignants par son engagement dans des activités de recherche sur l'enseignement des mathématiques, de la maternelle à l'université. ENSP : Ecole Nationale de la Santé Publique, à Rennes depuis 1962. C'est la seule école française préparant aux carrières administratives de la santé. Ses 400 étudiants viennent de toutes les régions et de toutes les filières. L'ensemble est assez hétérogène, notamment en ce qui concerne les connaissances de base en mathématiques. INPAR : Institut National de Promotion Agricole et Rurale, association créée il y a 30 ans par les organisations professionnelles agricoles de l'Ouest, afin de promouvoir la formation de leurs élus et de leurs salariés. Rens.: Maryvonne Merri, IREM, tél.: 99 28 63 42. (" CCETT : Centre Commun d' Etudes de Télédiffusion et Télécommunications. (2) CERTAC : Centre Régional des Technologies de l'Audiovisuel et de la Communication. 'j' ANVAR : Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche. N'65 0 N'6S 0 ENVIRONNEMENT Un exemple de forêt climatique de Bretagne : la forêt de Ville-Cartier, près d'Antrain. La forêt n'est pas simplement une étendue de terrain peuplée d'arbres, comme l'indiquent les dictionnaires. C'est une communauté biologique, composée de plantes (arbres, arbustes, herbes, mousses, lichens), d'animaux (insectes, oiseaux, mammifères) et de microorganismes (bactéries, champignons) occupant un espace, le biotope, caractérisé par un sol, un climat. Tous ces éléments ont des interactions très étroites et constituent un système écologique en équilibre ou écosystème, qui utilise l'énergie solaire et puise l'eau et les substances minérales dans le sol pour élaborer de la matière organique ; celle-ci retourne au sol et libère, sous l'action des microorganismes décomposeurs, les éléments minéraux qui peuvent ainsi être réutilisés. Cette communauté biologique ou écosystème est généralement utilisée par l'homme. La genèse d'une forêt Dans nos régions, la forêt représente le stade ultime de l'évolution de la végétation. Elle peut apparaître plus ou moins rapidement (parfois après plusieurs siècles) à partir de la colonisation par les organismes vivants, soit des roches mères, soit des dunes, soit de l'eau libre, soit des espaces abandonnés par l'homme (champs, cultures, prairies). Lorsque la forêt a subi un traumatisme quelconque (feu, gel, maladie, ouragan), elle reprend inexorablement son évolution pour La forêt, de feuille en aiguille essayer d'atteindre à nouveau son équilibre biologique. Le type de forêt, qualifié de forêt climacique, qui prend ainsi naissance dépend de plusieurs facteurs et en particulier des conditions climatiques régionales et de la nature du substrat. Ainsi en Bretagne, la forêt climacique est la chênaie-hêtraie atlantique à sousbois de houx (climax climatique). Cependant, diverses communautés correspondant à des conditions écologiques différentes apparaîtront (climax stationnels) suivant les conditions stationnelles locales dues en particulier à la nature de la roche mère, à la topographie et à leur répercussion sur les types de sols et leurs régimes (nutritionnels et hydriques). La connaissance de ces communautés et des conditions écologiques qui leur sont liées permet de distinguer dans un même massif forestier plusieurs types de stations forestières dont les potentialités sont différentes. Certaines conviendront mieux au chêne pédonculé, d'autres au chêne sessile, d'autres au hêtre, etc. Le rôle écologique de la forêt La forêt protège le sol contre l'érosion, ce qui est particulièrement important en montagne, mais aussi sur les dunes, et l'enrichit en produisant de l'humus à partir des litières. Elle joue un rôle régulateur sur le climat, en particulier sur le cycle de l'eau. Elle rejette une quantité importante d'eau dans l'atmosphère (évapotranspiration). Elle stabilise les nap-pes souterraines, régénère la qualité de l'eau et régularise son régime en retenant les eaux de ruissellement comme une éponge ou en ralentissant la fusion de la neige. Elle filtre l'air et retient les poussières atmosphériques. Elle absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène. Elle joue un rôle de régulateur thermique. Enfin, elle permet à un certain nombre d'espèces végétales et animales de vivre. C'est aussi, de plus en plus, un lieu de détente et de loisir qui a un rôle social non négligeable. Cependant, la forêt est fragile. Des accidents climatiques imprévisibles tels que les gelées excessives ou tardives, la sécheresse exceptionnelle, les ouragans et les tornades, les avalanches de montagne, peuvent la détruire. Les effets peuvent être indirects en favorisant l'érosion, les maladies, la pullulation des parasites ou des ravageurs. L'homme et la forêt Les forêts sont utilisées depuis des millénaires par l'homme pour l'adapter à ses besoins. A l'époque préhistorique, les forêts recouvraient la quasi-totalité des zones tempérées et l'homme était parfaitement intégré à l'écosystème. Il y trouvait son habitation, ses habits, sa nourriture (chasse, pêche, cueillette). Puis, au néolithique, par diverses pratiques agricoles (défrichage, pâturage, incendie), l'homme a fait disparaître la plupart des forêts primitives. Par la suite, dans les massifs préservés, il a sélectionné les essences dont il avait besoin à un moment donné (hêtre ou chêne, par exemple en Bretagne). 11 a favorisé leur régénération et leur croissance, il a replanté les clairières en s'efforçant souvent de conserver les essences autochtones. Plus récemment, pour avoir une meilleure production, il a parfois introduit des essences exotiques à croissance plus rapide. L'homme est souvent responsable de graves perturbations par des exploitations abusives, des déséquilibres dans la faune, la pollution atmosphérique qui donne naissance aux pluies acides, les incendies, le surpâturage, l'introduction d'espèces acidifiantes, etc. Mais l'homme intervient également dans le bon sens, en restaurant la forêt après une catastrophe naturelle, comme l'ouragan de 1987. Un peu partout en Bretagne, des actions efficaces (nettoyage, reboisement) aident la forêt à se reformer, plus rapidement que ne l'auraient permis les cycles naturels. Jean Touffet Professeur d Rennes 1, Laboratoire d'écologie végétale. A partir du 7 mars, l'Espace Sciences et hioq ues présente m os al des forêts" l'exposition "A la recherche D OSSIE R Des technologies à la recherche en environnement Depuis toujours, l'homme a perfectionné les outils qui lui ont permis de s'affranchir des contraintes du milieu et de disposer des ressources indispensables à sa survie puis à l'amélioration de ses conditions de vie. Cette démarche tend à s'amplifier, et à s'accélérer au rythme des découvertes scientifiques et de leurs applications, mais aussi en fonction de l'explosion démographique de l'humanité. La prise de conscience des conséquences de cette évolution sur l'environnement n'est pas récente, puisque dès 1821 les compagnies responsables de la chasse à la baleine avaient constaté la raréfaction de tous les cétacés et phoques à proximité du continent antarctique, sans pour autant prendre les mesures indispensables. Depuis, les concepts d'exploitation et de gestion des ressources biologiques ont abouti à des mesures indispensables pour conserver nos coquilles Saint- Jacques, langoustines, et autres crustacés etc. Pour autant, il s'agit là d'un cas particulier qui constitue un secteur très précis de ce que l'on place aujourd'hui dans les CULTURES sciences de l'environnement. la constatation d'une augmentation constante les problèmes d'environnement? Comment naissent de notre consommation d'énergie, d'engrais, de,pesticides, et de l'importance de nos rejets toxiques dans les océans, l'atmosphère, et les D'une façon générale, les questions d'envi- continents. C'est ainsi qu'en 1986 s'est tenue ronnement sont mieux perçues lorsqu'elles à Berne la première réunion sur les conséaffectent directement nos intérêts, notre santé, quences globales de l'augmentation de la et aussi notre sensibilité. Nous avons tous été teneur en gaz carbonique de notre atmosphère, sensibles aux grandes catastrophes écolo- et la destruction de la couche d'ozone à proxigiques que sont les marées noires, surtout par mité des pôles ; la première est liée à l'indusleurs répercussions sur la qualité des sites tou- trialisation et la déforestation, la seconde pour chés, et par les images désolantes d'un cormo- une part à l'utilisation de chlorofluorocarran mazouté. De même, l'incendie de la forêt bones (CFC). Dans ce cas, ce sont des procesde Brocéliande, bien que beaucoup moins sus extrêmement complexes, encore en partie important que les incendies méditerranéens, mal expliqués. Ils se déroulent sur des est marquant en raison de la richesse symbolique du site. La question des nitrates est actuellement dans tous les esprits en raison des risques que ces substances peuvent entraîner, dans des cas particuliers, pour la santé humaine. Il en est de même du bruit, des odeurs, des déchets, des pesticides, etc. et pourtant, jusqu'à présent, nous sommes insuffisamment informés de phénomènes beaucoup plus discrets, mais qui n'en sont pas moins graves. Aujourd'hui, des problèmes de portée générale ont été soulevés par la communauté scientifique à l'échelle de notre planète après DE TRAITEMENT périodes très longues de l'ordre du siècle et mettent en jeu des interactions multiples entre des milieux naturels (forêts, océans, continent Antarctique), des activités humaines, et l'atmosphère terrestre. En résumé, il s'agit là d'une approche de notre planète considérée dans ce cas comme un système dont il convient de mieux connaître le mode de fonctionnement. Cette première réunion de 1986 a permis de créer le programme de recherches internationales intitulé : "International Geosphere Biosphere Program". De quelle façon peut-on envisager une technologie de l'environnement Les technologies peuvent aussi bien concerner la mise en oeuvre de procédés de traitements destinés à réduire les effets immédiats d'une pollution locale, EN T0 DE$ LLES d'une contamination ou d'une nuisance, ou bien à contrôler à moyen terme la dynamique d'une pollution, ou de la contamination d'un système écologique. Le plus souvent, les techniques mises en oeuvre relèvent de la chimie, de la physique, des mathématiques, de l'informatique, de la biologie et demandent une spécialisation dans ces disciplines. Des industriels ont déjà étudié des options technologiques en relation avec la restauration éventuelle de la couche d'ozone. Notre sensibilité toute récente aux questions d'environnement porte en elle le danger de voir se disperser les activités dans ce domaine sans aucune concertation, chacun dans son domaine étant persuadé, de bonne foi, de répondre aux questions posées. En réalité, les technologies et les recherches doivent être pluridisciplinaires, et doivent permettre d'identifier dans l'espace et dans le temps les répercussions de toute activité humaine afm de mettre en place toute mesure de contrôle ou de régulation des systèmes écologiques. Daniel Cluzeau et Paul Tréhen Station biologique de Paimpont. 9 Figue 1 120 rnm PRECIPITATIONS .1IIILIII 0__ 948 113,2 10 46,0 69,6 61.4 320 6,11 15,2 BOA 34,5 30,4 100 60 60 40 20 1,2 in3/11 figue 2 DEBITS DE LA CHEZE 0.8 0.6 J, DECEMBRE !vn 8E901E8 .14A80 JVIH Figure 3 VO CONCENTRATION DOSSIER Une réserve d'eau sous surveillance Plutôt que d'aborder le problème des nitrates de manière générale, il est parfois plus significatif d'exposer un cas local. L'étude réalisée par Luc Brient et Georges Bertru, sur le bassin de la (hèze au Sud de Rennes, montre les relations entre l'activité humaine, la pluviométrie, les retenues d'eau et les sols, et leur implication sur les teneurs en nitrates. Afm d'évaluer les flux des nitrates et des phosphates, les services techniques de la ville de Rennes ont procédé en 1989, conformément à l'étude réalisée par Mrs Perrot et Lecorf (Maîtrise des Sciences et Techniques - Université de Rennes I), à la mise en place de stations de jaugeage des débits sur la Chèze et le Canut, deux rivières du Sud de Rennes, ainsi qu'à l'installation d'un dispositif de prélèvements d'échantillons asservis aux débits.. Si l'étude précitée avait mis en évidence que la qualité de l'eau du réservoir de la Chèze était acceptable dans la mesure où les concentrations en nitrate restaient inférieures à la valeur guide de 25 mg/1, il n'en demeurait pas moins que celles-ci ne cessaient de progresser et que certaines manifestations d'eutrophisation") avaient été localisées au site du Pont-Musard. C'est donc pour dresser un véritable bilan de ces apports et surtout pour disposer d'un outil de contrôle et d'évaluation de la qualité de l'eau, que ces dispositifs ont été mis en place. En effet, la gestion de cette ressource doit nécessairement s'appuyer sur une base de données réellement objectives. La qualité de l'eau d'un réservoir comme celui de la Chèze ne peut être appréciée qu'en considérant l'interaction entre le réservoir et la totalité du bassin versant. Modélisation et prévision ne pouvant être envisagées qu'au travers de séries chronologiques portant sur plusieurs années, ce n'est qu'à titre indicatif que nous présentons ici les ddnnées analytiques recueillies pendant l'année 1990. Pluviométrie et débits Les figures 1 et 2 montrent bien que seules les précipitations de janvier et de février ont été efficaces quant à la reconstitution du stock de l'eau dans le réservoir, celles de mai, juin et octobre, qui avoisinent 60 mm, n'ont eu que peu ou pas d'incidence sur les débits de la Chèze. La remontée des débits n'est amorcée qu'en décembre après les pluies d'octobre et novembre. La station de jaugeage ne prend en compte que 9 km2 de l'ensemble du bassin versant (30 km2), de sorte que l'interpolation porterait à 3,50 millions de m3 le volume capté dans le réservoir, soit au plus 27% de sa capacité de charge. L'année exceptionnelle de 1990 n'a en fait que souligner la difficulté inhérente au remplissage du réservoir. Concentrations et flux La figure 4 relative aux flux d'azote nitrique résulte de la mesure des débits (fig. 2) et de celle des concentrations (fig. 3). Pour les deux premiers mois de l'année, les concentrations en nitrate restent supérieures à 70 mg/1 pour décroître progressivement jusqu'en juin, elles redeviennent supérieures à 50 mg/1 dès le mois de décembre pour atteindre en janvier 1991 des valeurs proches de 100 mg/1 à la fois dans le ruisseau de la Chèze et dans la retenue du Pont-Musard ! Nitrate (30143634) Figure 4 FLUX 5 4 l i6 3 2 FEVAIEA NA63 JOIN 030311113E Bien évidemment, ces concentrations sont celles à l'entrée de la retenue et non celles à la station de pompage, qui compte tenu du phénomène de dilution restent encore inférieures à 25 mg/1. Pour une superficie de 9 km2, l'évaluation du flux d'azote nitrique pour la période de janvier à février 1990 est de l'ordre de 65 tonnes, ce qui laisserait supposer que pour l'ensemble du bassin versant cet apport pourrait être de 200 tonnes pour les 30 km2, soit une perte par les sols de 7 g/m2 pour ces deux premiers mois. Les données bibliographiques font état de 2 à 3 g/m2 dans les régions d'agriculture intensive. Ces données ne peuvent que surprendre dans la mesure où le bassin versant de la Chèze ne compte qu'une seule agglomération significative : Maxent, avec 239 habitants raccordés à une station de traitement de type lagunage'2' qui exporte un équivalent de 4 tonnes d'azote nitrique par an. Le reste de la population participerait pour une valeur de 10 tonnes d'azote nitrique. Manifestement, le dispositif mis en place s'avère un outil indispensable pour la gestion de la quantité et de la qualité de la ressource en eau, non seulement pour les teneurs en nitrates mais également pour d'autres produits comme par exemple les phytosanitaires". Souhaitons que les pertes en azote nitrique, qui sont aussi dommageables pour les agriculteurs, soient très prochainement mieux maîtrisées. Luc Brient, Georges Bertru Laboratoire d'Evolution des Systèmes naturels et modifiés, Rennes 1. Tél 99 28 61 43. "Eutrophisation : Accumulation de débris organiques dans les eaux stagnantes, provoquant la désoxygénalion des eaux profondes. "' Lagunage : épuration dans des bassins par l'action oxydante naturelle des micro-organismes. N'65 ") Phytosanitaires : prddiiits de soin pour les végétaux. 10 DOSSIER Synthèse carts reguona CARTE COMMUNALE DU TAUX DE MATIERE ORGANIQUE graphique e 063,5% 3,5%66,5% >6,5% L'un des buts poursuivis par le Plan de Relance Agronomique concerne l'augmentation du nombre d'analyses de terre, et une meilleure valorisation des résultats, Au centre INRA de Rennes, Pierre Aurousseau a participé à l'élaboranui. û'1111c Syiiii c,v unIuyruptivuu, à partir des résultats des six laboratoires d'analyses de terre de la région Bretagne. Ces laboratoires ont fourni plus de 340000 données analytiques correspondant à 71000 sites. Ces données comportent principalement le code INSEE de la commune, la teneur en matière organique, en carbonate, en phosphate, en potassium, en calcium, en magnésium et le pH (coefficient d'acidité). Le traitement informatique a été réalisé au Centre Interuniversitaire de Calcul de Bretagne (CICB). Carte de la matière organique La carte communale du taux moyen de matière organique met en évidence un gradient croissant du nord-est de la Bretagne vers le sud-ouest. Le centre Finistère et le centre Morbihan sont réputés pour leurs taux élevés de matière organique, alors que le nord de l'Ille-et-Vilaine a des taux faibles (inférieurs ou égaux à 2%), semblables à ceux du Bassin Parisien. Ces observations ont en particulier conduit les pédologues à définir des unités de sols riches, comme par exemple les sols bruns humiques. Cette nouvelle carte montre qu'en général, les zones de transition en Bretagne avaient été imparfaitement diagnostiquées. Influence atlantique Entre le centre Morbihan et le nord de l'Ille-et-Vilaine, le taux passe de plus de 6,5% à moins de 2%, sur une distance de 110 km. Cette répartition est le plus souvent attribuée à la "dynamique atlantique" de la matière organique. Cette dynamique spécifique est liée à des climats océaniques très tempérés et à humidité atmosphérique forte et permanente. Une autre explication est liée à la répartition des limons sur la Bretagne. Les limons ont une épaisseur qui décroît du nord-est au sud-ouest, avec une variation du grain moyen dans le même sens (40 micromètres dans le nord, 30 dans le centre et 20 dans le sud). Source : Synthèse cartographique régionale à partir de données d'analyse de terre. A. leleux, P. Aurousseau, A. Roudaut. Science du sol, n° 1988/1, Vol. 26, pp. 29-40. Autres résultats D'autres cartes ont été réalisées, notamment la carte des taux moyens en phosphore, qui permet de distinguer les zones à forte concentration d'élevage hors-sol (exemple du canton de Locminé avec des teneurs moyennes supérieures à 500 mg/kg). L'ensemble de ces cartes, corrélées avec d'autres données comme l'épaisseur de la couche de terre ou le réseau hydrographique, permet de dresser la cartographie des potentialités du sol pour chaque type de culture.Ces documents sont en cours de réalisation au laboratoire des sciences du sol, au Centre INRA de Rennes. Leur utilisation mènera à une meilleure répartition des cultures, et à de meilleurs rendements. Améliorations souhaitées Cette étude a montré l'insuffisance des informations stockées par les laboratoires d'analyses de terre, et en particulier la quasiabsence de références géographiques précises des échantillons, et l'absence d'information agronomique sur le passé cultural des parcelles. Le retard de la France est considérable par rapport aux bases de données existant en Belgique, en Irlande ou en Angleterre. N'6ï m DOSSIER N'65 les formations en environnement Les métiers de l'environnement vont se développer, les programmes nationaux en cours actuellement visent à responsabiliser les producteurs de pollution et les collectivités locales. Chacun des organismes impliqués devra soit former son personnel dans des centres spécialisés, soit recruter des techniciens ou des ingénieurs compétents. Beaucoup de formations pourraient prétendre posséder un domaine de compétence relevant des grandes questions relatives à notre environnement, tant le concept est vaste et parfois même mal délimité. C'est pourquoi nous ne mentionnons ici que celles qui donnent à l'environnement une priorité clairement exprimée par leur contenu et leur finalité. L'UNIVERSITE Brest Université de Bretagne Occidentale : MSTm Géoarchitecture, diplôme créé en 1975. Cette formation, sur deux ans, reçoit chaque année 20 étudiants. Pluridisciplinaire, elle se distingue cependant par sa composante architecturale. A la sortie, la plupart des étudiants effectuent un troisième cycle, soit un DEA à Brest, soit l'IUP (Institut d'Urbanisme de Paris). Rens. : Daniel Le Couédic, tél. : 98 31 61 24. Maîtrise d'Océanologie Biologique. Environ 50 étudiants. DEA "Océanologie Biologique et Envi-ronnement Marin". Option "Gestion des Ecosystèmes en termes de Ressources", 13 étudiants dont 50% d'étrangers (collaborations avec l'ORSTOM). Resp. Michel Glémarec, tél. : 98 3162 65. RENNES 1 MST Aménagement et Mise en Valeur des Régions, diplôme créé en 1975 (environ 20 étudiants par an). Les étudiants acquièrent les bases de l'écologie, de la géologie, de la chimie de l'environnement, mais aussi des notions importantes et pratiques d'économie, sciences sociales, droit et gestion de l'environnement. Il existe aussi une version de cette maîtrise en formation continue, qui comporte les mêmes enseignements dispensés sur trois années par regroupements mensuels de 5 jours. Responsable de la MST : Paul Tréhen, tél.: 99 28 61 12 ou 99 07 81 81. Coordinateur de la formation continue : Bruno Bordage, tél. : 99 63 13 77. Maîtrise de Recherche "Biologie des Organismes et des Populations". Cette maîtrise comporte une filière spécialisée en Ecologie, dont l'originalité est de traiter des sujets précis tels "les ressources végétales de la biosphère" ou "la modélisation des systèmes écologiques". Rens. : Georges Bertru, tél. : 99 28 61 43. DEA de Biologie des Populations et Ecologie-Ethologie, option "Gestion du patrimoine espèces-espace". Rens. : Jean- Yves Gautier, tél. : 99 07 81 81. RENNES 2 Maîtrise de Géographie, filière "Aménagement". Responsable : Jean Mounier. DEA "Géographie : sociétés, environnement, aménagement", une trentaine d'étudiants, avec un tronc commun et deux options : - option A : espaces, sociétés, économie. - option B : environnement naturel, analyse de l'espace par télédétection. LES ECOLES D'INGENIEURS L'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes : DAA "Génie de l'environnement". Diplôme d'Agronomie Approfondie créé en 1990. L'ENSAR forme des ingénieurs (environ 20) capables de mettre en place une gestion intégrée de l'espace rural. Après un stage préliminaire et un tronc commun, l'étudiant se spécialise : transferts hydriques et énergétiques, préservation et aménageniént des milieux... Un stage de six mois assure la liaison avec le monde du travail. Rens. : Alain Joly, tél. : 99 28 50 00, poste 64 43. L'Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes, créée en 1962. Les formations de spécialisation en Environnement et Santé ont pour but de donner à des candidats de haut niveau scientifique les connaissances nécessaires pour appréhender les interactions entre l'homme et l'environnement, et pour proposer des solutions en réponse à un problème sanitaire donné. - ingénieur du génie sanitaire : spécialisation en un an pour les ingénieurs civils français titulaires d'un diplôme d'Etat, de DEA ou de Sème cycle. - assistant du génie sanitaire : cette formation, en un an, s'adresse aux titulaires de BTS ou de DUT scientifiques. Rens. : René Seux, tél. : 99 28 29 30. L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, créée en 1919. L'ENSCR possède une option de roisième année intitulée "Génie des procédés appliqués à l'Environnement et à l'Aménagement". Elle forme chaque année une quinzaine d'ingénieurs. Rens. : Guy Martin, tél. : 99 36 29 95. HISTOIRE SANS PAROLES... d3.- _~~ _-a ir- _ f- rao 'Ailii4, ` '~o e~f ~ 4 =_ , ô _s. . o~ - CO e p ~' CP . o F^... o a o ~ r.-a c, _ ., » .~ ©~o -_~~..- ` ."--"Arlr, ---77..7 Ir l Cette liste demande à être complétée. L'association Rennes Atalante effectue un recensement des organismes bretons investis dans la formation en environnement. L'objectif est la parution d'un ouvrage de référence, un cahier technique de l'environnement en Bretagne. 01MST :- Maîtrise des Sciences et Techniques. Plate-forme pétrolière en Mer du Nord. programme de surveillance a été mis en place, par des mesures régulières de déplacements dans les zones les plus actives de la structure métallique. Ce programme, que dirige également Michèle Basseville, peut être adapté aux grands ouvrages à charpente métallique, depuis les plateformes jusqu'aux immeubles en passant par les viaducs. EDF et la RATP se sont également équipés, l'un pour surveiller les arbres des alternateurs dans les centrales électriques, l'autre pour remédier au creusement des rails soumis à des rames de métro mal équilibrées. R. - Quel est le fonctionnement de votre équipe ? A.B. - Nous sommes 15 chercheurs, dont 5 stagiaires de différents pays : URSS, Chine, Israël, Allemagne, Etats-Unis. Ce sont des professeurs qui ont pris une année sabbatique pour venir travailler chez nous, ou des diplômés en stage post-doctorat. Grâce à ces visiteurs, nous avons un peu partout dans le monde des contacts scientifiques, qui apportent de nouvelles idées et font avancer les recherches. La gestion de ces échanges est certainement délicate, compte-tenu des différences de financement d'un pays à l'autre, mais il existe presque toujours une solution pour héberger quelques mois un collègue étranger. R. -Quelles sont vos sources de financement ? A.B. - L'IRISA est cofinancé par le CNRS, l'INRIA, l'Université de Rennes 1 . Il bénéficie également des subventions provenant des collectivités locales et régionales. Une partie du budget (environ 20%) provient de nos contrats avec des établissements publis ou privés. "' INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Les médailles du CNRS ne récompensent pas une action, mais l'ensemble des travaux réalisés, de qualité assez exceptionnelle, confirmés sur plusieurs années. Elles ne sont pas non plus le couronnement d'une carrière, la plupart des médaillés sont jeunes, et pas forcément CNRS. Chaque année, le CNRS décerne une médaille d'or, et 15 médailles d'argent. Cette année, la médaille d'or a été attribuée au professeur Marc Julia, en chimie. La cuvée 1990 a été particulièrement bonne pour l'Ouest, qui reçoit 5 médailles d'argent. LE LABO DU MOIS Une médaille d'argent à l'IRISA Le 30 janvier, Albert Benvéniste, chercheur à l'IRISA, recevait la médaille d'argent du CNRS, pour l'ensemble de ses travaux en automatique, traitement du signal et programmation synchrone. Albert Benvéniste travaille au sein de l'équipe "Automatique et Signal", à l'Institut de Recherches en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA, URA CNRS 227). Il est Directeur de Recherche à l'INRIA"' depuis 1979, et a été promu Directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle en 1990. A 41 ans, Albert Benvéniste est auteur ou co-auteur de quatre livres et de 27 parutions dans des revues internationales. En remettant la médaille, Jean-Claude Charpentier, directeur du département des Sciences Physiques pour l'Ingénieur, posait la question : "Comment faites-vous pour être si jeune, et déjà couvert de gloire ?". Albert Benvéniste a répondu qu'il avait certainement bénéficié d'un environnement favorable : l'Université, l'IRISA, l'INRIA et le CNRS sont des organismes qui, chacun à leur manière, stimulent l'activité de recherche : fréquentes rencontres avec d'autres laboratoires sur le campus de Beaulieu, équipements perfectionnés à l'IRISA, intégration à des programmes nationaux et internationaux. Réseau : Pouvez-vous résumer votre trajet, depuis vos études jusqu'à aujourd'hui ? Albert Benvéniste - En sortant de l'Ecole des Mines de Paris, j'ai soutenu un doctorat en Mathématiques en 1975. A mon arrivée à Rennes, je me suis intéressé aux applications industrielles des concepts mathématiques. Jusqu'en 1980, nous avons mis au point des calculateurs capables d'inverser les déformations subies par un signal numérique lors de sa transmission. Ensuite, avec l'équipe "Automatique et Signal", nous avons travaillé sur la surveillance informatique des structures métalliques en ambiance de travail. Parallèlement, avec Paul Leguernic, des travaux ont été entrepris en informatique "Temps réel", pour gérer instantanément un ensemble de données provenant d'un mécanisme en fonctionnement (chaîne de fabrication, circulation de plusieurs TGV). Ceci a nécessité l'écriture d'un langage, SIGNAL, adapté à la programmation synchrone. Actuellement, je participe au lancement du groupement scientifique "Antenne-Radar", qui a pour objet l'étude du concept de radar du futur, avec une nouvelle répartition des composants matériels et des algorithmes de traitement des signaux. R. - Que veut dire "surveillance des structures métalliques ?". A.B. - L'équipe "Automatique et Signal" met au point des systèmes informatiques permettant de déceler et d'analyser les vibrations dangereuses au sein des pièces métalliques. A la suite d'un accident de rupture sur une plate-forme pétrolière, des études ont montré que la rupture avait été précédée par la propagation de fissures dans les pièces métalliques, pendant près de deux ans avant l'accident. Avec la participation de l'IFREMER, un De gauche à droite : Jean-Claude Charpentier, Albert Benvéniste et Gérard Juyie, Délégué régional du CNRS. N'65 ® N'65 Ela Du service informatique à la formation En 1990, le premier prix de l'innovation du concours "High Tech Le Figaro" avait récompensé la société TRT Philips pour son produit de téléphonie rurale, en partie développé à Lannion. COMELOG, une société de service en informatique implantée sur Rennes-Atalante, a récupéré quelques lauriers de la couronne, suite à sa collaboration pour ce produit : IRT 2000. TRT"' construit des réseaux de télécommunications publiques à travers le monde. Son partenariat avec France Télécom, notamment dans les activités de recherche et de développement, lui assure la maîtrise des techniques les plus modernes. Dans des pays comme la France, la connexion d'abonnés sur un réseau ne pose plus de difficultés majeures. Mais il en est tout autrement des pays moins développés. En effet, l'éloignement géographique, les contraintes climatiques et la non disponibilité d'énergie rendent souvent difficile et peu économique le raccordement au réseau téléphonique national de groupes d'abonnés isolés. Sans aller chercher trop loin, le problème se pose également pour certaines régions de France, montagneuses et peu peuplées. TRT a trouvé à travers le système IRT une solution très appropriée, qui s'appuie sur l'association des techniques numériques de codage, de la liaison radio par faisceau hertzien et de l'accès multiple à répartition dans le temps. L'accès multiple Dans le sens abonné vers central, toutes les stations émettent successivement sur la même fréquence radio vers leur station de regroupement. Chaque "rafale" correspond à l'émission d'un paquet d'informations relatif à un abonné. Lié au trafic, le fonctionnement des émetteurs est discontinu. Ceci permet d'optimiser le plan de fréquence du réseau et de réduire la consommation des stations. Une fois en place, le réseau peut être modifié en fonction de l'évolution des populations. A partir d'un micro-ordinateur, Station de transmissions numéri9ues par faisceaux hertziens. l'exploitant centralise les informations, gère l'exploitation du réseau et assure sa maintenance. Jean-Yves André, ingénieur COMELOG en régie à TRT de Lannion, est responsable de la partie exploitation du réseau et du protocole des postes de travail. De plus, grâce au codage numérique, IRT 2000 propose aux abonnés divers services comme la transmission de données et l'accès aux réseaux RNIS... s'ils existent dans le pays. Des réseaux de téléphonie rurale IRT 2000 ont ainsi été installés dans une cinquantaine de pays (Nouvelle Zélande, Indonésie, Malaisie, Tunisie, Bangladesh,...). Actuellement, TRT installe ses réseaux en Australie et dans les pays de l'Est : Tchécoslovaquie, Hongrie, ... La prestation COMELOG Pour Frédéric Rialland, directeur de l'agence COMELOG de Rennes, la participation à un projet de l'envergure de IRT 2000 a été une bonne opération de promotion de l'agence. L'agence COMELOG de Rennes a un an et demi, et déjà 32 collaborateurs. Outre son activité de conseil en informatique, elle développe actuellement des structures de formation continue, au travers de deux cycles. En 1990, le cycle "concepteur" a déjà affranchi 50 informaticiens des particularités de l'environnement Bull. Cette année, COMELOG-Rennes démarre un cycle "réalisateur", davantage axé sur la réalisation de logiciels. "A Rennes", constate Frédéric Rialland, "le nombre d'ingénieurs informaticiens connaissant l'environnement Bull est insuffisant par rapport à l'implantation de ce matériel en Bretagne". Rens. Frédéric Rialland, tél. 99 63 29 00. "Télécommunications Radioélectriques et Téléphoniques. EXPOSITIONS Du 3 avril au 13 mai/ Les mystères de l'archéologie. Rennes : cette exposition, au Musée de Bretagne sera accompagnée de conférences ouvertes au public. Rens. : François Hubert, téL 99 30 04 04. Jusqu'au 6 avril/ Au coeur de votre assiette. Rennes : cette exposition est présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'Espace Santé, rue de Coetquen. Le coeur et l'alimentation, les produits allégés, le coeur et l'alcool feront l'objet d'animations dans le cadre de l'exposition. Rens. : Brigitte Rocher, tél. 99 7815 03. Jusqu'au 23 avril/ Posidonie superstar. Lorient : la posidonie est une plante sous-marine qui ne vit qu'en Méditerrannée. Son écosystème peut être comparé à celui d'une forêt. Rens. : Maison de la Mer, tél. 97 84 87 37. a.>'t MARS Mg ~ 7,qq4 -'2"EW DE TéM s sTcnls>. cxocgTs .0 wYigct~t¢ QUE VA-T-IL SE PASSER ? RESEAU N'65 A L'ESPACE SCIENCES ET TECHNIQUES Du 7 mars au 25 mai/A la recherche du mal des forêts. Rennes : pollution, pluies acides, les forêts sont malades. L'exposition dresse un bilan de leur état, et propose des solutions. Une partie de l'exposition est consacrée aux problèmes spécifiques à la forêt bretonne. Rens. : Monique Thorel, Frédéric Balavoine, tél. 99 30 04 02. La regénération de la forêt (Mander). 7 au 10 mars/ Cadre de vie. Clohars-Carnoët (29) : le parc du Quinquis organise les journées régionales de l'environnement et du paysage, autour de 6 thèmes, dont le traitement des déchets et la valorisation des sites naturels. Rens.: Gildas Le Roux, te 98 39 9413. 9-10 mars/ L'éthique internationale. Paris : ie Conseil National de l'Ordre des Médecins organise un congrès international sur les questions d'éthique. Le diagnostic anténatal, les essais thérapeutiques, le secret médical, le commerce des organes font partie des themes qui seront évoqués. Rens. : tél. 16 (1) 42 27 0139. 13 mars/ Fête à la Cité des Sciences. Paris : à La Villette, la Cité des Sciences et de l'Industrie fête ses 5 ans d'existence. Ce temple de la culture scientifique a accueilli en 1990 plus de 5 millions de visiteurs, davantage que le Louvre. 1991 est l'année des Télécommunications, avec une grande exposition à partir du mois prochain. Rens. : Pierre Laporte, tél. 16 (1) 40 0572 65. 1aV11ctte cité des sciences et de l'industrie 13 mars/ Inauguration. Rennes : l'exposition "A l'origine du mal des forêts" sera inaugurée à 17 h, à l'Espace Sciences et Techniques, en présence des différents collaborateurs : l'Université de Rennes 1, le Centre Régional des Propriétaires Forestiers, l'Office National des Forêts de Bretagne, etc. Rens.: Frédéric Balavoine, tél. 99 30 04 02. 13 mars/ Séminaire d'archéologie. Rennes : ce séminaire se déroule dans la salle des thèses du Campus de Beaulieu (bâtiment administratif). Quelques disciplines naturalistes appliquées à l'archéologie seront présentées : sédimentologie, micromorphologie, archéozoologie et anthropologie. Rens.: Jean-Laurent Monnier, tél. 99 28 6123, poste 50 92. 14 mars/ Microcam. Rennes : le club de microinformatique du Crédit Agricole, Microcam, tiendra son assemblée générale à 18hàla salle de conférences, rue Chicogné. Microcam fera le point sur ses activités en 1990, et présentera à ses 200 adhérents les nouveaux matériels Apple, Mac classic, Mac LC et Mac si. Rens.: Jean-Francois Percevault, tél. 94 03 34 58. Jusqu'au 15 mars/ Production Océanopolis. Brest : "La vie du phoque gris", premier film réalisé par Océanopolis et le Quartz, retrace pour les visiteurs du centre, l'épopée d'une jeune phoque à travers le monde. Rens.: (hanta! Guillerm, tél. 98 34 40 40. w 19 mars/ Océanopolzs Malicorne Vannes : l'astrophysicien Hubert Reeves livrera ses réflexions lors d'une soirée organisée par l'Université Tous Ages de Vannes et sa région. Entrée sur invitation. 19-21 mars/ JIPEO 91. Rennes : "Les Transmissions multimédia" est le thème retenu pour ces 20em°' journées Informatiques, Productiques et Electroniques de l'Ouest. Organisé par l'APEO et l'INSA ce salon se tiendra à l'INSA de Rennes, sur le campus de Beaulieu. Rens.: Valérie Thomas, téL 99 63 44 02. 21-22 mars/ Systèmes experts. Angers : quels sont les enjeux et les facteurs déterminants de l'option "systèmes experts" en entreprise ? C'est le thème des journées qui se dérouleront au Centre des Congrès, sous le patronage de la Commission des Communautés Européennes, et la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement des Pays de la Loire. Rens.: Francoise Marchand, tél. 41476f74. 26-27 mars/ Recherche et coopération technologique. Rennes : Euro Info Centre Bretagne, en collaboration avec l'ANVAR, organise un séminaire de mise à niveau et de présentation des grands programmes de recherche européens (III° programme cadre CEE et Eurêka) et des financements qui y sont attachés avec notamment la participation de Michel André, fonctionnaire CEE, Administrateur à la Direction Générale Science, Recherche et Développement. L'objet de ces deux journées sera de fournir à ceux qui, sur le terrain, sont chargés de conseiller et d'orienter les entreprises dans leur stratégie de recherche développement, les éléments, tant stratégiques qu'opérationnels, indispensables au montage des dossiers présentés dans le cadre d'un programme européen. Rens.: Paule Réginensi, tél 99254157. CRCI 28-29 mars/ Stage de l'ORME Rennes : un stage sur les techniques documentaires pour les études doctorales est proposé par l'Unité Régionale de Formation et de Promotion pour l'Information Scientifique et Technique. Rens.: André Le Meur, tél. 99 54 2166. 30-31 mars/ Salon des inventions. Fougères : l'Association des Inventeurs et Chercheurs de l'Ouest et la Jeune Chambre Economique invitent les innovateurs de tous genres à présenter leurs créations. Rens.: Bruno Bertin, tél. 99 97 37 38. De mars à juillet/ Initiation Environnement. Quimper : l'Association Départementale de l'Information pour la Jeunesse (ADIJ) lance une grande opération sur tout le Finistère, pour sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans sur leur cadre de vie. 65000 enfants recevront un livret pédagogique, qu'ils illustreront eux-mêmes avec des autocollants disponibles aux divers points stratégiques de leur commune (mairie, SIVOM, etc.). Depuis l'instruction civique jusqu'aux problèmes de la nature, en passant par la santé, la prévention routière et autres sujets, l'enfant doit ainsi acquérir les bases de sa conscience de futur adulte, en découvrant le monde qui l'entoure. Rens.: Murielle Evenat, téL. 98 53 65 44. 4 avril/ Parlons d'éthique. Rennes : le comité régional d'éthique abordera trois thèmes : le SIDA, la législation et la religion. Rens. : Secrétariat du professeur Lobel, tél. 99 28 42 69. En avril/ Sorties Nature. Dans le cadre de l'exposition "A la recherche du mal des forêts", le CCSTI organise des sorties, sur réservation. 6 avril : visite de la forêt de Paimpont : découverte des espèces végétales, relations arbres et sol. 13 avril : visite de la forêt de Rennes : découverte des espèces végétales, gestion et entretien de la forêt. Rens. : Frédéric Balavoine, téL 99 30 04 02 Du 9 au 12 avril/ BIOEXPO. Paris, Porte de Versailles: 10000 visiteurs sont atten- N'65 W65 ~ CONFERENCES Conférences de I'URFIST. Rennes : l'Unité Régionale de Formation et de Promotion pour l'Information Scientifique et Technique organise des journées à thème à la Bibliothèque Interuniversitaire de Villejean. Rens. : Jean-Max Noyer, tél. 99 54 2166. 5 mars : intervenant 'Jean-Max Noyer ou M. Polanco (INIST/CNRS) - "Veille technologique et scientifique et science Monde". 12 et 13 mars : intervenant : M. Turner (CERESI) - "De la Bibliométrie à l'Infométrie/ Recherche/ Développement et Innovation technologique". Conférences d'Océanopolis (Brest,à l'Auditorium, à 18 h) 14 mars : "Conséquences prévisibles de l'utilisation des biotechnologies sur la production des semences de l'an 2 000', par Michel Branchard, professeur à l'UBO. 21 mars : "La vie autour des sources hydrothermales océaniques", par Daniel Desbruyères, IFREMER. 28 mars : "Les médicaments de la mer", par Eric Deslandes, UBO. 13 mars/Conférence de Médecine (Amphi F, 18 h) Rennes : "Joseph Babinsky, sa vie et l'apport de son oeuvre à la neurochirurgie', par E. Fauconnet. Rennes : Université du temps libre. 15 mars : "Histoire de l'électronique en France", par Monsieur Chapron, de la Mission Communautaire de l'EDF. 22 mars : "Développements futurs en matière de production, de transport et d'utilisation de l'électricité", par Monsieur Chapron. Rens.: ENSP, tél 99 28 28 89. 20 mars/A propos de Malicorne. A 18 h 30, sur invitation : Conférence de l'astrophysicien Hubert Reeves, intitulée "Réflexions d'un observateur de la nature". Voir article page 3. 28 mars/L'économie bretonne. Rennes : Dans le cycle "identité, citoyenneté et intégration", le Musée de Bretagne organise une conférence sur le thème "Y-a-t-il un style economique breton ?", par Maurice Basle et Yves Morvan. Rens.: François Hubert, tél. 99 30 04 04. 4 avril/L'état des forêts bretonnes en 1991. Rennes : à 20 h, à la Maison du Champ de Mars, le CCSTI organise une table ronde sur l'état des forêts bretonnes et les solutions à envisager. Le débat sera animé par Jean Touffet, professeur à l'Université de Rennes 1, Michel Dutour, chef du service régional des Forêts et des Bois, M. de la Broise, directeur de l'Office National des Forêts de Bretagne et Denis Groëné, responsable du Centre Régional de la Propriété Forestière. Rens.: Monique Thorel, téL 99 30 04 02. A NOTER Les trophées de l'économie sociale Rennes : la Fondation du Crédit Coopératif organise un concours destiné à récompenser les entreprises du secteur de l'économie sociale. Les lauréats de la région entreront ensuite en compétition au niveau national, pour la remise de trophées et de prix de 600 000 F. Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 25 mars. Rens. : Catherine Bouffort, tél. 99 31 42 11. A RETENIR 1990-1991 : LES GRANDS COLLOQUES DE PROSPECTIVE Le Ministre de la Recherche et de la Technologie organise des colloques thématiques, en vue de susciter l'émergence de nouvelles orientations scientifiques. 18-19 juin. "Gérer les ressources technologiques", à Lyon. Rens. : Télécopie 16 (1) 46 34 39 62 ou minitel: 36.16 MRT. dus au 3° salon des biotechnologies appliquées à la recherche, l'industrie et l'agriculture. Rens. : Marina Dulon, téL 99 63 28 28. 11-12 avril/ Gérer les ressources. Rennes : en préparation au colloque de prospective du Ministère de la Recherche et de la Technologie sur la gestion des ressources technologiques, Auguste Genovèse, directeur général des usines Citroën de Rennes, organise un séminaire régional. Rens.: René Le Gall, tél. 99 26 3717. Du 15 au 17 avril/ Technofood. Rennes : organisée par le Conseil Régional de Bretagne, cette convention internationale évoquera les thèmes du process et du génie industriel en agroalimentaire. Rens.: Dominique Barbotin, tél. 99 33 66 30. 16-17 avril/ RCO: Cosmétiques. Rennes : l'Ecole de chimie (ENSCR) organise les Rencontres Chimiques de l'Ouest, sur le thème des cosmétiques du futur : "Parfums et produits de beauté, naturels ou synthétiques, quels choix pour demain ?". Conférences et expositions animeront ces rencontres. Rens. : Nadine Bouquin, tél. 99 36 29 95. Du 15 au 19 avril/ Marchés de la mer. Lorient : 2e édition du salon de la valorisation des produits de la mer. L'année dernière, ce salon a accueilli 4500 visiteurs et notamment des professionnels venus de toute l'Europe, mais aussi d'Inde et d'Amérique du sud. Rens. : Agence pour le Développement Economique du Pays de Lorient, tél. 97 64 50 85. 26-27 avril/ Santé portes ouvertes. Rennes : la Maison Associative de la Santé reçoit dans son manoir du boulevard Albert-1'. les journées "Portes ouvertes" seront animées par trois débats sur les transplantations d'organes, sur l'alcoolisme, et sur les soins palliatifs. Tél. 99 53 48 82. Avril/ Biologie moléculaire. Nantes : le Centre Hospitalier Régional et l'Université proposent au personnel de niveau Bac +2, une formation en biologie moléculaire en 212 heures, validée par un diplôme universitaire. L'enseignement théorique est prévu du 15 au 20 avril, et les travaux pratiques du 3 au 29 juin. Inscriptions : tél. 40 74 01 11, poste 410. Du 5-7 mai INOV'CO 91. St-Brieuc : pour sa troisième édition, le Salon des Commerçants du Grand Ouest sera structuré en cinq salons spécialisés, dont un salon de la Communication et un salon de l'Informatique. Tables rondes et conférences ponctueront cette manifestation, organisée par la Chambre Régionale et les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie de Bretagne. Rens. : Gérard Garnier, tél. 96 78 78 79. ~~~~~z ~~i_q~` Du 5-10 juin/ Journées de l'Environnement. Rennes : en 1990, à l'instigation de Brice Lalonde, Ministre chargé de l'En vironnement, près de 30000 personnes avaient participé à plus de 100 manifestations sur toute la Bretagne. Cette année devrait faire mieux encore. De nombreux acteurs dont le CCSTI animeront les prochaines journées, organisées en Bretagne par la Direction Régionale à l'Architecture et à l'Environnement. Rens. : Jean-Pierre Ledet, tél. 99 3158 59. 6-7 juin/ SANTEXPO. Rennes : la Ville de Rennes associe trois partenaires : l'Ecole Nationale de la Santé Publique, le Comité Français d'Education pour la santé et la Fédération Nationale de la Mutualité Française, pour créer un événement national sur le thème "Ville-santé". Santexpo comprendra - un colloque pour les professionnels sur la santé et l'environnement dans la ville (à l'ENSP) les 6 et 7 juin, - un salon professionnel (a l'ENSP) les 6 et 7 juin, - une exposition grand public préparée par le CCSTI et presentée a l'Espace Sciences et Techniques du 29 mai au 27 juillet. Rens. : Dominique Calafuri, tél. 99 65 54 54. Jr( Du 2 au Suillet/ Chimie et Santé. Caen : l'Université et la faculté des sciences pharmaceutiques organisent QUE S'EST-IL PASSE ? RESEAU N'65 QUI A DIT ? Réponse de la page 2 Victor Hugo. DU COTE DES'ENTREPRISES 10 janvier/ La réoe investit dans les Côtes-d'Armor. Lannion : une usine coréenne de la société Winn- France, va venir s'installer à Pleubian, près du Centre d'Eudes et de Valorisation des Algues (CEVA). Cette usine, qui à terme employera 60 personnes, va fabriquer des plats cuisinés à base d'algues, pour la clientèle asiatique vivant en Europe. Rens. : Jean-Yves Simon, téL 96 22 93 50. Guingamp/ Téléphones L'entreprise Samipro vient d'être choisie par Thomson pour fabriquer les nouveaux téléphones et répondeurs à destination du grand public. Ceci devrait déboucher sur la création de 150 emplois à Guingamp, et compenserait les suppressions de Thomson a orlaix. Rens.: Alain Richer, tél. 96 44 50 03. Bretagne, terre d'accueil. En 10 ans, les investissements étrangers ont créé et sauvé plus de 3 800 emplois dans l'Ouest. En tête viennent les Américains (55 %), suivis par les Japonais (28 %), les Anglais (12 %) et les Allemands (5 %). Paul Chevillet, président de l'association Ouest Atlantique, prévoit une augmentation des investissements japonais dans les prochaines années. Rens. : Marie-Pierre Labrégère, téL 40 89 35 00. Le Pays de Vitré est en bonne santé. Vitré : selon une étude réalisée en novembre dernier par la Chambre de Commerce et d'Industrie, 1000 nouveaux emplois sont attendus dans les 3 prochaines années : un tiers dans l'électronique, un tiers dans l'agroalimentaire et un tiers dans le bois et les industries diverses. Rens. : Jean-Michel Avan, tél. 99 74 41 90. 23 janvier/Un pôle électronique dans l'Ouest. Rennes : la Sofrel (320 salariés) rejoint le holding nantais Lacroix Electronique, qui contient déjà Ouest Tôleries (tôlerie fine) et Synergie production (circuits imprimés). Le rassemblement des PME devrait permettre d atteindre la taille critique nécessaire au développement de partenariats avec les grands groupes français et étrangers. Rens. : Bernard Angot, tél. 99 28 59 00. les 27eme9 rencontres internationales de chimie thérapeutique, en présence du professeur Jean Levy, Président de la société de chimie thérapeutique. Le dernier jour se déroulera un symposium sur le thème "Quelle chimie thérapeutique pour l'an 2000 ?". Rens. : Professeur Max Robba, tél. 31 94 68 63. 2-3 octobre/ Appel à communications. Rennes : le groupe régional ouest de la Société des Electriciens et des Electroniciens organise un colloque sur la propagation electromagnétique dans l'atmosphère, du décamétrique à l'angstrom, avec la participation du CELAR et de l'Université de Rennes 1. Les chercheurs souhaitant présenter leurs travaux dans ce domaine sont priés de s'inscrire et d'envoyer un résumé de leur communication avant le 15 mars. Rens.: Joël Vandenberghe, tél. 98 0012 35. Rentrée 91/ Institut d'Etudes Politiques. Rennes : l'IEP ouvrira ses portes en octobre 91, dans les locaux de l'Ecole Normale, boulevard de la Duchesse Anne. Ce nouvel Institut d'Etudes Politiques offrira une formation de choix aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, ainsi qu'aux étudiants en sciences humaines, juridiques, économiques et sociales. Rens. : Marcel Morabito, tél. 99 38 03 01. 10 janvier/ Une nouvelle école : Weller. Rennes : l'Institut des Petites et Moyennes Entreprises change de nom : il devient l'Ecole Internationale de Management, sous le nom de Weller. Weller est un réseau d'écoles qui couvre l'Allemagne, l'Espagne, la France et les Etats-Unis. Le programme pédagogigue se déroule sur 4 années avec en continu des contacts avec les entreprises, au niveau international. En 1991, 220 étudiants sont inscrits à l'école Weller de Rennes. Rens. : Patricia Monier-Savary, téL 99303366. 11 janvier/ Anniversaire dentaire. Rennes : l'UFR "Faculté d'Odontologie" a fêté ses vingt ans d'intégration à l'Université de Rennes 1. Aujourd'hui, l'UFR regroupe 45 enseignants pour 500 étudiants, et développe des recherches sur la biologie buccale et sur les matériaux de prothèse. 18 janvier/ Institut Automobile. St-Brieuc : la première pierre de l'Institut Supérieur des Techniques Automobiles (ISTA) est posée. A partir de septembre 91, 260 élèves seront formés aux techniques de plus en plus sophistiquées de l'automobile. Rens. : Chambre des Métiers, téL 96 78 0570. 21 janvier/ GRANIT, intercoluteur de District de Rennes. Rennes : une soixantaine de chefs d'entreprise ont assisté à l'assemblée générale de GRANIT. A cette occasion, Edmond Hervé, président du District de Rennes, a brossé les grandes lignes de l'agglomération de demain. Un projet articulé autour de 4 objectifs : développement de la formation, de la recherche et de la vie culturelle, renforcement du tissu économique, accroissement des reseaux de relation de l'agglomération, amélioration du cadre de vie. Des projets repris au bond par GRANIT, qui a proposé de mettre en place des groupes de travail sur les projets suivants : la communication dans la ville, l'Institut européen des normes techniques, la décentralisation et les liens Paris-province. Le président, Roger Gabriel, et le Vice-President, André Renault, ont ensuite proposé d'organiser "GRANIT 91 ", un symposium pour assurer la promotion des nouvelles technologies dans l'entreprise. Avec l'idée d'observer et d'analyser la répercussion des nouvelles technologies. Une idée passionnante... Rens. : Roger Gabriel tél. 99 30 26 62. 23 janvier/ Instituts professionnels. Paris : Claude Allègre, conseiller spécial de Lionel Jospin, Ministre de l'Education Nationale, a annoncé pour 1991 et 1992, la création d'Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP). Au départ, chaque université accueil era 1 ou 2 instituts spécialisés en administration, gestion financière, commerce, information et communication, ou ingénierie. 23 janvier/ Environnement. Paris : le conseil des ministres prévoit d'augmenter le budget des recherches en environnement, de 3% du budget total aujourd'hui à 5% dans 5 ans. Brice Lalonde, Ministre délégué à l'Environnement, estime que les futurs progrès technologiques résoudront en partie les problèmes écologigues actuels. Plusieurs programmes de recherche interdisciplinaires sont en cours, et un nouveau programme va être lancé pour mettre au point une station d'épuration modèle. 23 janvier/ Convention Citroën - Académie. Rennes : Herbert Maisl, recteur de l'Académie de Rennes, et Auguste Génovèse, directeur du centre de production Citroën de Rennes, ont mis en place une convention de formation. Les échanges dans ce domaine sont déjà nombreux : accueil de stagiaires chez Citroën, formation continue des salariés de l'usine. A l'avenir ces activités feront l'obejt d'un suivi et d'une évaluation. Rens. : René Le Gall, tél. 99 26 3717. 23 janvier/ La révolution des PTT. Rennes : Jean Pichon, directeur régional de la Poste en Bretagne, voit l'avenir avec optimisme. La Poste, maintenant séparée des Télécommunications (France Télécom), évolue vers un statut semi- COLLOQUES 20-21 MARS/CAP Productique 4 Nantes : cette année la conférence des Pôles Productique est organisée par le CRITT Productique des Pays de Loire. Deux thèmes sont retenus : la productique en Europe et les transferts de technologies. Les animateurs des programmes européens Esprit, Eurêka, Brite et Euram seront présents. Rens.: CRITT Pays de la Loire Productique, tél. 4144 33 32. Du 2 au 5 juillet/Les mécanismes de la cirrhose. Rennes : l'Ecole Nationale de la Santé Publique organise un colloque international sur le thème "Bases cellulaires et moléculaires de la cirrhose du foie", sous le parrainage de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Rens.: André Guillouzo, tél. 99 54 37 37. N'65 RE/IISt ',,E,ii ii/iU/ ,MENSUEL DE L'INNOVATION REGIONALE Président : Paul Tréhen. Directeur : Michel Cabaret. Rédaction : Hélène Tattevin. Comité de lecture : Jacques de Certaines, Lydie Jouys, Philippe Gillet, Thierry Chochon, Monique Thorel. Publicité : Danièle Zum-Folo. Abonnements : Odile Corvaisier. Dépôt légal n° 650. ISNN 0769-6264. ROSEAU est publié grâce au soutien des Ministères de la Recherche et de la Technologie IDISTI, de la Culture, de la Région de Bretagne et de la Ville de Rennes. Edition : CCSTI, 35000 Rennes. Réalisation : CREA'PRIM, 35135 Chantepie. Pour être sûr de recevoir le numéro suivant de RESEAU, abonnez-vous ! Abonnement our I an (11 numéros) Tarif :180 F. 'Abonnement de soutien : 280 F. Nom Prénom Adresse Tél. Organisme Facture OUI q NON q Bulletin d'abonnement et chèque à retourner au : CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. 99 30 57 97. public qui propose de véritable s perspectives de développement. De plus, les prochaines années devraient voir une restructuration des régions, réduites au nombre de 6 ou 8. Jean Pichon sera alors directeur régional de la Poste Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie et/ou Poitou- Charentes. TéL 99 02 61 11. 23 janvier/ Audience record pour Christian Lemoine. Rennes : lors d'une conférence au Grand Huit, le directeur du CRECI (Centre de Recherche et d'Etude sur la Croissance Industrielle) a mobilisé 1 200 cadres et chefs d'entreprise. Christian Lemoine est un partisan de l'être humain en tant que force de développement, tout est affaire de motivation, que ce soit pour une usine ou un club sportif. Rens.: Christian Lemoine, tél. 99 36 87 87. 25 janvier/ Un pôle agronomique Ouest. St-Nicolas de Redon : la Bretagne et les Pays de la Loire ont décidé de mettre en commun les compétences de leurs 5 grandes écoles, dans la création d'un pôle centré sur Rennes. Le nouvel établissement sera co-présidé par Yvon Bourges, Président du Conseil Régional de Bretagne et par Olivier Guichard, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire. C'est l'aboutissement des efforts d'AGRENA, l'association de regroupement des écoles supérieures en agronomie, horticulture et vetérinaire de Rennes, Nantes et Angers. Le nouveau centre élargira le contenu pédagogique des écoles en place, grâce aux techniques de téléenseignement. La création d'un centre de formation et d'une école doctorale sont incluses dans ce projet. Rens. : Camille Moule, tél. 99 28 22 05. 26 janvier/ Marée noire. Brest : Brice Lalonde, Ministre délégué à l'Environnement, a demandé II1 au CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux), d'analyser les conséquences de la pollution actuelle dans le Nord du Golfe Persique. Les spécialistes brestois sont reconnus à un niveau international, depuis leurs interventions en divers points de la planète, comme l'Alaska en 1989 lors de la catastrophe de l'"Exxon-Valdes". Rens. : Marthe Melguen, tél. 98 4912 66. 28 janvier/ Engrais et nitrates. Rennes : les producteurs et distributeurs d'engrais lancent une campagne nationale sur le thème de la fertilisation raisonnée. L'objectif est de revaloriser les engrais, responsables de la pollution des eaux par les nitrates. Une bonne connaissance de la fertilisation permettra de mieux gérer la qualité et la quantité d'engrais à utiliser, en fonction de chaque type de sol et de culture. Un guide pratique sera diffuse à 200 000 exemplaires. Du 28janvier au 1" réiver/ Formation lfremer. Brest : 170 stagiaires venus de toute la France ont suivi pendant une semaine un enseignement sur les recherches actuelles en aquaculture et halieutique. Une visite des laboratoires de I lfremer est venue compléter les cours. Rens. : Brigitte Millet, tél. 98 22 40 05. 29 anvier/ L'électronique dans l'Ouest. Angers : l'Assemblée Générale de la MEITO a rassemblé environ 200 personnes au cours de deux demi-journées consacrées la première, à un sujet technique : la maîtrise de la qualité la seconde à l'Assemblée Générale et à une large discussion sur la place des cadres dans l'equilibre du territoire. Michel Villain, directeur général de T. NECI, a presenté les différents processus à mettre en oeuvre pour contrôler la qualité des composants élémentaires utilises dans les systèmes électroniques. Gabriel Chataigner, directeur technique à Eurosoft Robotique, a traité dans le second exposé de l'assemblage de ces éléments en illustrant sa présentation par des exemples précis. Enfin, Paul Raguin, président de la Selco, a présenté de façon plus globale le problème de l'intégration de la maîtrise de la qualité dans l'organisation et la vie interne de l'entreprise, mais aussi dans ses relations avec les donneurs d'ordres. La seconde partie de la réunion était consacrée aux actions menées par la MEITO et au rôle que peuvent touer les cadres dans l'amenagement du territoire. A côté de ses activités plus traditionnelles (Annuaire, actions techniques, édition du bulletin Amplitel...) l'année 1990 a été marquée par une ouverture concrète à des actions de partenariat international, soit comme conseil d'organismes régionaux comme Ouest Atlantique, la MIRCEB, les Chambres de Commerce..., soit plus directement avec des cabinets internationaux. MEITO Janvier/ Trop d'eau, trop de nitrates. Entre sécheresse et déluge, la Bretagne a des problèmes avec son eau. Lors des fortes pluies, le sol est abondamment drainé, et libère dans les cours d'eau les nitrates contenus dans le sol. Selon les volumes des retenues d'eau et la nature des socles (granites, schistes ou grès), l'évolution du taux de nitrates dans l'eau l'otable varie d'un point à autre de la Bretagne. Au dessus de 50 mg/I, elle est déconseillee aux femmes enceintes et aux nourrissons. Au dessus de 100 mg/I, elle est déconseillée pour tout le monde, bien que la nocivité des nitrates absorbés occasionnellement soit encore mal connue. Fin janvier, le taux de nitrates dans les cours d'eau diminue ; mais les grandes retenues d'eau, jusqu'alors épargnées grâce à l'inertie que leur confère leur volume, sont à leur tour menacées. Les spécialistes pensent que les nitrates devraient progressivement se résorber début mars. Rens. : Jean-Michel Buisset, DDASS, tél. 99 02 92 22. 4 février, Prix de l'innovation. Rennes : cette année, la ville de Rennes a décerné le Prix National de la Mutation et de l'Innovation à la société Lippi, de Mouthiers (Charentes). Jusqu'en 1988, cette societe fabriquait du grillage métallique. Maintenant, Lippi produit de la clôture plastifiée, et dévellope ses exportations vers 20 pays. La mutation de l'entreprise a été suivie par l'ensemble du personnel (72 salariés), grâce à un programme de formation approprié. Rens. : Jacques Lippi, tél. 45 67 96 83. 5 février/ Réseau de la Recherche. Paris : Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de la Technologie, a annoncé la mise en oeuvre d'un réseau informatique à haut débit d'informations (entre 1 et 10 mégabits/ seconde) interconnectant les grands centres de recherche, les universités et les instituts régionaux. France Télécom réalisera l'ingénierie et l'exploitation de ce réseau, Renatel, qui devrait fonctionner à partir de 1992. 5 février/ Campagne OREST. St-Brieuc : Herbert Maisl, recteur de l'Académie, a décidé de favoriser l'orientation des élèves vers les emplois scientifiques et technologiques. Les filles en particulier, sont très peu représentées dans ces secteurs, où existe pourtant une forte demande en Bretagne. La campagne OREST, lancée sur toute la région, devra persuader les enseignants et les familles de l'adéquation de ces formations dans le contexte économique actuel. Rens. : Jean-Pierre Degardin, tél. 99 3819 48. 6 février/ Les sciences en plein air. Pleumeur-Bodou : la journée de découverte du Trégor scientifique a accueilli 150 enseignants intéressés par le concept de "classes de sciences" pour les élèves. La région de Pleumeur-Bodou concentre un centre d'algologie, une station ornithologique, une station de télécommunications par satellite, un planétarium et bientôt un musée des télécommunications. Dans ce site exceptionnel, l'ABRET (Association Bretonne pour la Recherche et la Technologie) organise des classes de découverte. Pour le deuxième trimestre 91, s'inscrire avant le 6 mars. Rens.: Jean-Pierre Millet, tél. 96 05 2216. BULLETIN D'ABONNEMENT RESEAU N'65 L'ENTREPRISE DU MOIS Boiron la santé par I homéopathie A Saint-Grégoire, les laboratoires Boiron préparent les médicaments homéopathiques pour tous les pharmaciens de la région. Commandés le matin, ils sont livrés dans la journée. Dès 1932, les frères jumeaux Boiron ont misé sur l'homéopathie, qui ne sera reconnue officiellement par la Pharmacopée française qu'en 1965. Actuellement, Boiron détient 65% du marché de l'homéopathie en France (voir encadré). De l'Inde à la Bretagne Dirigé par Christian Boiron à Sainte-Foyles- Lyon, dans le Rhône, le groupe comprend deux usines de production, clans le Rhône et en Gironde, et 31 maisons de l'Homéopathie (laboratoires régionaux) réparties sur toute la France. Créé en 1985, l'Institut Boiron, à Sainte-Foy-les-Lyon, regroupe 150 médecins de 18 nationalités. Sa mission est la communication médicale sur l'homéopathie, ainsi que la recherche et l'enseignement. Boiron possède trois filiales en Europe (Espagne, Italie et Allemagne), et trois autres aux USA, au Canada et en Inde (le pays où l'homéopathie est la plus répandue). Le chiffre d'affaires de Boiron en 1989 a été de 800 MF, dont 73% de médicaments génériques (dilutions de souches de base, remboursées par la Sécurité Sociale) et 27% de spécialités grand public (Oscillococcinum, Homéodent, ...). Dans l'Ouest, l'équipe Boiron comprend 140 personnes, réparties dans quatre maisons de l'Homéopathie : Brest, Rennes (Saint- Grégoire), Nantes et Niort. Ces maisons alimentent les 3 300 pharmacies de la région, animent des sessions de formation pour les médecins et les pharmaciens, et des Clubs Boiron Santé pour le public (20000 adhérents sur toute la France). L'activité de Saint-Grégoire Jean-Yves Garçon, pharmacien, dirige le laboratoire de Saint-Grégoire, où travaillent 35 personnes. Dix téléphonistes appellent quotidiennement les pharmacies du secteur (7 départements et demi) et saisissent les commandes par informatique. Le service est équipé d'un modem° de télétransmission automatique des commandes, de jour comme de nuit. La commande traitée est transmise aux services concernés (chaland, préparatoire) par des imprimantes. Le service chaland, approvisionné tous les matins, stocke les produits de grande rotation fabriqués à Bordeaux ou à Lyon. Le service préparatoire fabrique en fonction des commandes les médicaments plus spécifiques. Le troisième service, magasin-expédition, se charge de regrouper les médicaments issus de chaque service et de les acheminer, dans la journée, aux pharmaciens concernés. La distribution est assurée par des moyens propres à Boiron, mais aussi par l'intermédiaire de la répartition pharmaceutique (service commun aux différents laboratoires). La préparation des produits Les médicaments homéopathiques sont produits à partir de substances végétales (80%), animales ou minérales, macérées dans de l'alcool. La teinture-mère obtenue est filtrée, concentrée, puis conservée dans des flacons de verre dans une pièce climatisée, à l'abri de la lumière. Des contrôles qualitatifs (chromatographie sur couche mince) et quantitatifs (densitométrie, chromatographie liquide haute performance, chromatographie en phase gazeuse) assurent la reproductibilité de chaque teinture-mère fabriquée. L'opération de dilution successive est très délicate, puisqu'elle conduit rapidement à des médicaments impossibles à doser. C'est pourquoi la montée en dilution est réalisée dans une enceinte "à flux laminaire", qui filtre l'air jusqu'au maximum de pureté : moins de 100 particules pour 30 litres d'air (la norme des salles blanches de la NASA). Entre chaque dilution, le mélange est vigoureusement secoué (étape de dynamisation). Ensuite les granules ou globules (plus petits) de sucre sont imprégnés de la dilution, et conditionnés dans des tubes de polypropylène. Il existe 3500 substances, pouvant être diluées de 1CH à 30CH (voir article page 4). D'autres produits (ampoules, gouttes) sont occasionnellement fabriqués dans le laboratoire. L'avenir de l'homéopathie Patrick Caré, Directeur de Boiron pour la région Ouest, et Isabelle Vidal, responsable de la communication régionale, pensent que l'homéopathie va se développer dans les prochaines années. Entre l'image dont jouit l'homéopathie auprès des généralistes°2', et l'intérêt grandissant du public (68% favorables, selon un sondage de l'IFOP) pour cette thérapeutique, les petits granules ont de beaux jours devant eux. De plus, beaucoup de produits sont remboursés par la Sécurité Sociale, et ils reviennent 2 à 3 fois moins chers que les autres médicaments. Les laboratoires Boiron mènent une véritable campagne de promotion de l'homéopathie : formation de médecins, organisation de conférences, édition de revues spécialisées et grand public, et ouverture de Maisons de l'Homéopathie. Celle de Saint-Grégoire est la plus récente : elle met à la disposition des médecins une documentation importante, sous forme de livres, revues, thèses, banque de données bibliographiques et vidéos. "' modem : appareil utilisé dans le traitement à distance de l'information. (2) 7 médecins sur 10 reconnaissent l'efficacité de l'homéopathie, d'après le Journal International de Médecine, N°136, sept. 89. Part de l'homéopathie dans le chiffre d'affaires du médicament en France 2,2% - en Europe 1,5% - dans le monde 1% Part de Boiron en France 65% - en Europe 30% dans le monde 16% 19 I I ~il rly s ~~>trs~~ TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES, LA COMMUNICATION DES IDÉES. Le CNET conçoit et expérimente les systèmes et les services de la communication de demain. Le transfert du résultat de ses recherches à l'industrie française est pour lui un objectif prioritaire. Sa compétence technologique s'appuie sur le dynamisme de sept centres de recherche : Caen, Grenoble, Lannion A, Lannion B, Paris A, Paris B, Rennes. Chaque centre est maître d'oeuvre de plusieurs projets associant des équipes du CNET, de l'industrie, de l'Université. Le CNET propose aux entreprises diverses formes de soutien technique et d'optimisation de leur savoir-faire Pour toute information CNET - 2, route de Trégastel - BP 40 - 22301 LANNION CEDEX Téléphone : 96 05 11 11 technologique : contrats de licence, accès à des moyens d'essais et de mesure, contrats de maquettes probatoires avec les PMI. Les transferts de technologies, en renforçant les compétences et en favorisant les capacités d'exportation des entreprises, ouvrent des perspectives déterminantes pour les succès futurs de l'industrie française des télécommunications. enet rFRANCE TELECOM L'AVENIR DES TÉLÉcOMMUNICATIONS
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest