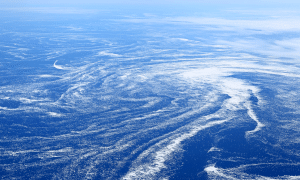La politique régionale de la recherche
NUMÉRO SPÉCIAL
L'INSTITUT POLAIRE
A BREST P 3
L'ARCHÉOMÉTRIE P 4
LE DOSSIER DU MOIS
Les phases de Chevrel.
RE EAU est é•ité par e Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCST1). Tirage mensuel : 5000 ex. I ,
CCSTI, 6, place des Colombes, 35000 RENNES. Tél. 99 30 57 97 - Fax 99 30 36 15.
,_7/1
nmeww
,1 1
MENSUEL DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN BRETAGNE
MARS 1993 • N*87 • 18 F
Bruno Latour rejouant
Louis Pasteur au
25' anniversaire du CSI,
en septembre 1992.
INFOSOURCE
3 nouveaux services
d'information
scientifique I
et technique
accessibles
par le minitel
Dans le cadre de sa politique d'aide
à une meilleure accessibilité des
fonds d'information scientifique, la
délégation à l'information scientifique
et technique du MRE (département
Information spécialisée) a
favorisé l'ouverture sur le kiosque
Télétel de trois nouvelles banques
de données. Celles-ci sont donc désormais
interrogeables sans mot de
passe à l'aide de menus qui guident
l'utilisateur jusqu'à l'information
désirée.
!ALINE propose 280 000 références bibliographiques
concernant le secteur alimentaire,
issues d'articles de périodiques scientifiques internationaux,
de comptes-rendus de congrès et
de rapports techniques. Ce service permet la
consultation de références mais aussi la commande
de photocopies envoyées sous 48
heures par le Centre de documentation des industries
utilisatrices de produits agricoles
(CDIUPA).
Accessible parle 36 29 00 85.
Coût : 9,06 F la minute.
Contact : Mme Carra - CDIUPA -1, Av. des
Olympiades - 91300 MASSY. Tél. (1) 69 20
97 38.
INRS BIBLIO, banque de données bibliographiques
sur la prévention des risques professionnels.
Produit par l'Institut national de
recherche et de sécurité (INRS), ce service rend
possible la consultation de 25 000 références
de périodiques internationaux, d'ouvrages, de
notes techniques et de normes, qui peuvent
être commandées directement à l'INRS.
Accessible par le 36 28 82 63.
Coût : 5,48 F la minute.
Contact : M. Le Ruz - INRS - 30, rue Olivier
Noyer - 75014 PARIS. Tél. (1) 40 44 30 00.
GUIDE DES BDD MINITEL, répertoire
des banques de données Minitel pour l'entreprise,
qui recense 300 banques de données
Télétel à usage professionnel. Deux modes
d'interrogation sont possibles (par mots clés
ou en mode guidé). Une description détaillée
en 6 à 20 écrans est donnée pour chaque
base, accompagnée d'un exemple de document
et d'informations pratiques. Au cours de
la recherche, il est possible de mémoriser une
sélection de banque de données pertinentes.
Accessible par le 36 28 30 33.
Coût: 5,48 Fla minute.
Contact : Mme Riou - FIA Consultant • 27, rue
de la Vistule - 75013 PARIS. Tél. (1) 45 82
78 78.
Contact : Marie-Claude Siron,
tél. (1) 46 34 36 31.
PAS DE CONNAISSANCE SANS INSTITUTION
omment savons-nous quelque chose ? Par exemple que l'homéopathie est parfois efficace,
que certains écologistes lâchent des vipères dans le Vercors pour faire fuir les paysans, qu'il
existe des trous noirs, que les soucoupes volantes n' existent que dans l' imagination, que le
virus du SIDA ne saurait se transmettre par la salive ou que la bataille de Waterloo a bien été gagnée
par Wellington ?
S'agit-il de rumeurs, de croyances ou de faits ?
Réfléchissez à l'ensemble des intermédiaires qui sont nécessaires afin de vous faire douter de ces
affirmations ou de les rendre véritables. Pouvez-vous, seuls dans le silence de votre chambre, en
modifier la nature ? Pouvez-vous sans effort, rendre crédible l'existence des soucoupes volantes et
douter de l'existence des trous noirs ou modifier, à volonté, le mode de transmission du SIDA ?
Certainement pas. Il s'agit là d'un phénomène collectif qui oblige d mobiliser un grand nombre
de gens -amis et ennemis-, des médias nombreux, des équipements souvent sophistiqués et beaucoup
de salive, de réflexions et de démonstrations.
Eh bien, voilà le domaine de la sociologie des sciences. Plus large que la sociologie de la
croyance, ou de la connaissance, elle s' intéresse aux savoirs vérifiés, aux certitudes scientifiques
aussi bien qu'aux erreurs. Développée depuis quinze ans, elle bouleverse, discipline après discipline,
bien des domaines des sciences humaines, de l'anthropologie à la psychologie en passant
par les sciences politiques et, bien sûr, la sociologie.
Avant elle, nous nous passions volontiers des institutions pour comprendre la connaissance.
Nous analysions les énoncés tout seuls et comme tout nus, comme s' ils pouvaient survivre et se développer
par leurs seules forces, les malheureux.
Aujourd'hui, nous ne laissons pas sortir un énoncé sans le réseau qui l'accompagne, qui le soutient
et qui l'infirme ou le confirme. Comme un coureur du Tour de France, un fait scientifique, a
besoin maintenant de son équipe de soutien.
La démocratie gagne dans cette affaire de ne plus distinguer trop brutalement la vie scientifique
et la vie politique.
Il ne suffit pas que deux chercheurs dans leur laboratoire découvrent une maladie dangereuse,
pour que nous devions tous, aussitôt, les croire, changer nos habitudes et nos lois, et voter, à l'Assemblée,
de profondes modifications de notre système de santé. La connaissance ne s'accroît pas
ainsi, nous le savons maintenant, en sautant d'un coup du laboratoire de quelques uns au savoir de
tous. Il y faut des intermédiaires d'autant plus nombreux que le fait est plus nouveau, plus incroyable,
plus dangereux et qu'il met à mal plus d'habitudes et plus d'intérêts. Il y aurait bien de
l'hypocrisie à exiger des politiques une conversion prompte aux faits nouveaux que des savants,
spécialistes et ignorants, chercheurs et politiques, tous également hésitent, doutent, prennent leur
temps, négocient, rusent, enfin, se rendent aux raisons, mais quand la connaissance commence à
s' instituer.
Pas de connaissance sans la lente et progressive mise en place d'une institution. Si vous doutez
de ce que j'affirme, descendez en vous-même et rappeliez-vous le temps qu'il vous a fallu pour
vous convaincre d'arrêter de fumer ou de boucler votre ceinture de sécurité ou de ne plus croire au
Père Noël... En dressant le répertoire des intermédiaires qui vous furent indispensables, vous avez
fait, sans le savoir, un petit exercice de sociologie des sciences ! n
Bruno Latour
Sociologue et philosophe, professeur au Centre de Sociologie de l'Innovation à l'Ecole des Mines de Paris
et à l'Université de San Diego, en Californie. Tél. 40 51 91 90.
BREST,
BASE LOÇISTIQUE
DES EXPEDITIONS
POLAIRES
LA DÉLOCALISATION
DE L'INSU
L'Institut national des
sciences de l'univers, agence
de moyens et de programmation
scientifique en géophysique,
va développer son
antenne de Brest, aujourd'hui
limitée à deux personnes.
Cette antenne, rendue nécessaire
du fait de l'augmentation
du parc national
d'instrumentation résultant
d'un accroissement de l'activité
de recherches des
équipes du CNRS et des universitaires
en océanographie,
aura en charge les moyens
liés à la mer. Il s'agira d'assurer
l'achat, le suivi, la
maintenance, la mise d disposition
et quelquefois le déploiement
des équipements
pour le compte des scientifiques.
Une dizaine d'agents
travailleront ainsi à Brest, où
existe un ensemble de sociétés
susceptibles de travailler
en sous-traitance.
glace épaisse de 4 kilomètres. A
l'issue de l'installation qui durera
trois ans, les scientifiques
pourront étudier des phénomènes
qui pour l'instant ne l'étaient que
sur le pourtour du territoire. De
l'avis de Roger Gendrin, ce projet
va mobiliser beaucoup de
monde et de moyens. n
'" Les fies Kerguelen et Crozet, au sud de
l'Océan Indien, elles abritent des bases scientifiques.
IFREMER : Institut français de recherche
pour l' exploitation de la mer.
Cela suppose d'importants moyens de communication,
l'IFRTP, d ce sujet, travaille actuellement
avec !'IFREMER et l'école
Télécom-Bretagne. Il s'agit des communications
opérationnelles avec les bases polaires d
terre et les navires, des transmissions de données
telles les mesures et les images, des liaisons
entre laboratoires français et avec de
nombreux partenaires étrangers.
ACTUALITÉS
Le transfert à Brest de l'Institut
français pour la recherche
et la technologie
polaire (IFRTP) devient réalité.
Le 29 janvier, les ministres
Hubert Curien et
Louis Le Pensec ont scellé la
première pierre des bâtiments
où seront préparées
les expéditions en Terre
Adélie et îles subantarctiques''
î.
Créé le 13 janvier 1992,
l'IFRTP recevait pour mission
de coordonner le travail des
organisations spécialisées dans
la recherche polaire. L'effectif,
composé de 46 personnes mais
devant atteindre une soixantaine
à court terme, devrait être opérationnel
à Brest à la fin de cette
année. Avant cela, il faut construire
les bâtiments. Sur un terrain
rétrocédé par l'IFREMERt2'
sur le Technopôle Brest-Iroise,
ils couvriront 4500 m2 pour un
coût de 16,8 millions de francs
répartis entre l'état, pour moitié,
la région, le département et la
communauté urbaine de Brest
pour l'autre moitié.
LOGISTIQUE
DE RECHERCHE
"L'IFRTP ne possède pas de
laboratoires, c'est avant tout
une organisation logistique
pour les chercheurs" précise son
directeur, Roger Gendrin. Ces
chercheurs, qu'ils dépendent du
CNRS, de !'IFREMER, des Expéditions
polaires françaises
(EPF), explorent de nombreux
domaines ayant tous trait, de près
ou de loin, au monde polaire.
Comme ceux des sciences de
la terre solide, qui recouvrent le
magnétisme terrestre, la sismologie,
la géologie ; ceux des
sciences de la terre fluide, qualification
sous laquelle on trouve
l'océanologie, la physique de
l'atmosphère, la glaciologie,
l'astronomie ; ceux, enfin, des
sciences de la vie, regroupant la
zoologie, la botanique, la biologie
terrestre et maritime, la microbiologie,
la médecine et la
psychologie. La France est particulièrement
en avance dans le
domaine de la glaciologie, cette
science qui permet d'avoir une
meilleure connaissance du climat
et de l'environnement des temps
anciens, grâce aux "merveilleuses
archives", selon l'expression
d'Hubert Curien, que constitue la
calotte glaciaire. L'analyse des
sédiments obtenus par forage
profond permet de déterminer la
température de l'atmosphère et la
composition de l'air au moment
où cette neige, depuis accumulée,
est tombée. Le navire Océanographique
Marion-Dufresne,
qui compose la flotte de l'Institut
avec l'Astrolabe, est équipé du
carotteur de sédiments le plus
puissant du monde. Au fur et à
mesure que l'on fore profondément,
on parvient à des âges de
plus en plus reculés.
L'institut polaire, dont voici
la silhouette, va renforcer
le pôle scientifique et maritime
que représente déjà Brest.
LE DOME CONCORDIA
L'IFRTP est au centre de
toutes ces prospectives, il
coordonne les programmes de
recherche en Arctique et Antarctique,
assure les relations internationales
dans ce domaine
précis, organise la logistique
des expéditions°>, diffuse les
connaissances vers le grand public...
Il est doté d'un budget de
126 millions de francs. L'Institut
se lance actuellement dans un
projet franco-italien très important,
la construction du Dôme
Concordia à 1000 kilomètres de
la côte de Terre Adélie. Cette
base située à 3200 mètres d'altitude
couronnera une couche de
L'ARCHÉOMÉTRIE
OU LA SCIENCE
AU SERVICE
DE L'HISTOIRE
INFOSOURCE
Quand la physique et la
chimie, l'histoire et l'informatique
font bon ménage,
cela donne des résultats
surprenants, comme, par
exemple, pouvoir dater, à
15 ans prés, des tuiles, des
amphores et des aqueducs
ou bien reconstituer des
paysages vus d'avion.
Au rez-de chaussée de l'un
des nombreux laboratoires
du Campus de Beaulieu, à
Rennes, on trouve, entassés pêlemêle,
des tuiles romaines et des
morceaux de terre cuite d'aspect
tout à fait ordinaire, en provenance
de Lyon, Marseille ou Perpignan.
Pourtant, grâce aux travaux de
l'équipe de recherche dirigée par
Loïc Langouet, nous apprenons à
connaitre trés précisément leur
âge et leur histoire.
DATER À 15 ANS PRÈS
En effet, des techniques de datation
particulièrement sophistiquées
viennent d'être mises au
point dans le laboratoire d'archéométrie
de l'Université de
Rennes I. Cette équipe de recherche
associée au CNRS qui
compte 3 enseignants-chercheurs,
1 chercheur CNRS et de
nombreux stagiaires et vacataires,
travaille sur de nouvelles
techniques de datation. Elle s'est
spécialisée dans l'exploitation de
l'archéomagnétisme et de la thermoluminescence.
L'archéomagnétisme est une
technique qui consiste à reconstituer
l'évolution des caractéristiques
du champ magnétique
terrestre (CMT) dans les temps
historiques. Elle utilise pour cela
la particularité des terres cuites
qui s'aimantent suite à leur
cuisson, grâce à l'oxyde de fer
qu'elles contiennent.
A partir de fragments de terre
cuite prélevés sous forme de "carottes",
les chercheurs peuvent
mesurer l'aimantation de ces
échantillons, et calculer les composantes
du CMT présent lors de
la cuisson.
Il est alors possible de donner
avec une grande précision, à 15
ans prés, l'âge du matériau prélevé
en recherchant à quelle période
le champ magnétique avait
de telles caractéristiques.
La recherche sur la reconstitution
des variations du champ magnétique,
en France, durant les
vingt derniers siècles, s'est faite
grâce au traitement statistique
de données acquises à travers
l'étude de sites de référence.
Un logiciel mis au point récemment
à Rennes sous la direction
de Pierre Lanos permet
d'effectuer les traitements des
mesures provenant aussi bien
des matériaux déplacés que des
structures en place. Ce logiciel
prend en compte toutes les opérations
de calcul effectuées en laboratoire
et offre toute la palette
des traitements informatiques
nécessaires. Deux stagiaires de
l'IUT d'informatique de Lannion
y ont collaboré.
La thermoluminescence qui est
la production de lumière par un
échantillon chauffé permet également
d'effectuer des datations.
Comme le dit Loïc Langouet :
"quand on chauffe un matériau,
il émet de la lumière et ce signal
lumineux est proportionnel au
temps passé sous terre depuis sa
dernière cuisson. Plus le matériau
est ancien et plus le signal
est fort."
LE PASSÉ VU DU CIEL
Devant le développement que
connait actuellement la prospection
aérienne, Loïc Langouet a
eu l'idée de doter la France d'un
Centre d'imagerie archéologique
spécialisé dans le traitement des
images obtenues par cette voie.
Un logiciel unique en France
vient d'être mis au point. Il permet,
à partir d'une photographie
aérienne oblique de reporter sur
un plan cadastral la structure vue
d'avion après seulement le repérage
de quatre points. A partir de
calculs très sophistiqués, les
chercheurs arrivent donc à
recréer la réalité. Ce logiciel
nommé Reimagae est déjà fonctionnel.
Parallèlement à cette recherche,
un nouvel axe se développe
: l'analyse des paysages
par voie informatique. En collaboration
avec Pierre Lanos, G.
Jumel met au point un système
fiable d'analyse dimensionnelle
à partir de données cartographiques.
De plus, conjointement à ces
activités de recherche pure, se
poursuit une activité d'expertise
faite à la demande, un service offert
à de nombreux chantiers
archéologiques en France et à
l'étranger.
Enfin, un Pôle éditorial archéologique
de l'Ouest (PEAO)
fait aussi partie du laboratoire
d'archéométrie. Une activité très
importante qui
permet la publication
de la Revue
d'Archéométrie et
de la Revue Archéologique
de
l'Ouest, destinées
aux spécialistes et
appréciées aussi
par les amateurs
avertis. n
Lots d'échantillons
prélevés sur
des matériaux
de construction
d'argile cuite
(briques et tuiles).
Contact : Loïc Langouet,
téL 99286070.
"Il y a véritablement besoin,
à notre époque, d'une éducation
scientifique de base
pour tous les enfants, parce
qu'ils vont être appelés à
prendre des décisions de société
tellement graves que
s'ils les prennent selon les
critères actuels, on court au
désastre."
Réponse page 22
QUI A DIT ?
LES SIGLES DU MOIS
C RAIE Centre de Recherches sur les
Applications de l'Informatique à l'Enseignement
Statut juridique : Centre de recherches de l'Université de Rennes
2. Composante du Laboratoire interdisciplinaire de recherches linguistiques
(LIRL). Créé en 1984.
Structures : Comporte deux groupes de recherche : • un groupe
de recherche sur les applications de l'informatique et des technologies
nouvelles à l'enseignement des langues • un groupe de recherche
sur la terminologie, la phraséologie, le traitement
automatique des données linguistiques et l'ingénierie linguistique.
Financements : Ministère de l'éducation nationale, aides du Ministère
de la recherche et de l'espace, aides du Conseil régional,
financements par contrats (DGLF, entreprises, MRE, etc.).
Activités : • Elaboration d'outils d'enseignement assisté par ordinateur
• développement des espaces langues (Claude Henry) • élaboration
de normes et de standards terminologiques (D. Gouadec /
A. Le Meur / J.-P. Hingamp) • conception de base de données terminologiques
et phraséologiques (D. Gouadec) • développement
de méthodes de formation linguistique multi-média (E. Rees) •
principes et méthodogie de la description des données linguistiques
• recherches sur contrats portant sur la constitution de données,
la normalisation des usages, la définition d'icônes, l'harmonisation
des désignations/dénominations, les prototypes de bases
terminologiques, la néologie et les politiques linguistiques.
Références : Elf-Aquitaine, Bull, Site-Eurolang, TRT-Philips et
Matra-Marconi Spacc.
Nombre d'employés : 12 enseignants-chercheurs et 76 étudiants.
Correspondant : Daniel Gouadec, Directeur du CRAIE.
Adresse : Université de Rennes 2, 6, Av. Gaston Berger, 35043
Rennes Cedex, tél. 99 33 13 37, fax 99 33 52 73.
RÉSEAU MARS 93 - N 87
ECRIN Echange et Coordination
Recherche Industrie
Statut juridique : Association Loi 1901, créée en 1990.
Nombre d'adhérents : 42 personnes morales (11 organismes de recherche ou assimilés,
31 entreprises).
Structure : 24 clubs ou dispositifs de travail regroupés dans l'Association. Chaque
Club comporte un Bureau composé d'un Président issu d'une entreprise, d'un Rapporteur
en activité dans la communauté scientifique, de Correspondants (décisionnels
d'Organismes de recherche) et d'une dizaine de personnalités du monde industriel, de
la recherche ou des institutions concernées (Ministères, Fédérations professionnelles,
etc.). Tous sont choisis par le Président du Club en raison de leurs compétences et de
leur dynamisme. Le Bureau se réunit quatre à cinq fois par an pour déterminer les objectifs,
les thèmes et le rythme de travail, dégager des pistes de coopération, émettre
des recommandations quand cela est jugé utile. On s'efforce, en particulier, de repérer
les thèmes en émergence.
Activités : Des Réunions multiformes sont le creuset de coopération. Chaque Club
organise au minimum deux ou trois réunions thématiques par an. Des travaux sont
engagés en amont (inventaire de compétences, enquête sur les besoins, études d'approfondissement,
bibliographie, etc.). Ces réunions comportent généralement des exposés
ou des récits d'expériences. Elles entraînent des échanges et des approfondissements
à visées concrètes. Des ateliers ou commissions permettent à des groupes
restreints de dégager des possibilités de coopération. La formule "table ronde" est
également utilisée. Des orateurs peuvent être invités pour l'occasion, sans être pour
autant participants du Club. Ces réunions peuvent être complétées de visites de sites.
Financement : Contributions des partenaires et subventions du CNRS.
Missions : Favoriser les échanges et les coopérations entre les Organismes publics de
recherche et les entreprises. Les Clubs offrent des occasions de rencontre, sur des
thèmes à contenu scientifique ou technologique généralement interdisciplinaires. Audelà
de la simple information, leurs réseaux d'experts ont pour objectifs statutaires
"d'étudier des perspectives de recherche à objectifs partagés" et de "préparer le terrain
à des coopérations entre équipes de la recherche publique et entreprises". Les Clubs
CRIN veulent être des catalyseurs favorisant l'émergence de thèmes de recherche,
conformément aux souhaits des entreprises et des Organismes publics fondateurs, qu'il
s'agisse de déclencher directement des coopérations ou de recommander des actions futures.
Nombre d'employés : 16 personnes (3 personnes ECRIN, 13 personnes mises à
disposition parle CNRS, le CEA et ELF).
Correspondant : Véronique Conde, responsable de la communication écrite et des
relations publiques.
Adresse : ECRIN, 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris, tél. (1) 45 50 48 11, fax
(1)475302 91.
RÉSEAU MARS 1993 - N' 87
LIFE l'Instrument Financier
pour l'Environnement
Décision du Conseil : Règlement CEE n° 1973/92 du Conseil du 51 mai 1992.
Durée : 1992-1995.
Montant : 400 millions d'Ecus.
Objet : Contribuer au développement et à la remise en oeuvre de la politique et de
la législation communautaire de l'environnement par le financement d'actions prioritaires,
d'actions d'assistance technique et de projets de démonstration (mise en
oeuvre d'une technique, d'un procédé innovant ou réalisation concrète et exemplaire
d'une des priorités du programme).
Domaines d'actions :. Actions visant le développement durable de la qualité
de l'environnement : - mise au point de technologies nouvelles propres, peu polluantes
et économes en ressources, notamment dans cinq secteurs : traitement de
surface, textile, tanneries, industrie du papier, industrie agro-alimentaire, - actions
visant à la réduction des déchets et au recyclage, - réhabilitation de sites contaminés,
- aménagement et gestion du milieu rural, - mise en oeuvre de concepts nouveaux
en matière de tourisme et de transport, amélioration de la qualité de
l'environnement urbain. • Actions visant la protection des habitats et de la nature :
- rétablissement et maintien des types d'habitats naturels et des espèces animales et
végétales, - conservation des zones d'eaux douces souterraines et de surface, gestion
des bassins, économies des eaux et réutilisation des eaux usées. • Actions concernant
les stuctures administratives et les services pour l'environnement : - action visant
à stimuler la coopération entre les administrations des Etats-Membres
s'agissant de problèmes transfrontaliers, - équipement, modernisation, développement
de réseaux de surveillance. • Actions de formation. • Actions en dehors du territoire
communautaire : - assistance technique nécessaire à l'établissement de
politiques et de programmes d'actions en matière d'environnement.
Modalités :. Projet à caractère innovant et transnational • ne sont pas éligibles
les projets ne visant que la recherche • le projet ne doit pas bénéficier d'aides des
Fonds structurels ou d'une autre ligne du budget communautaire. • Taux de financement
: 30% du coût du projet, lorsqu'il s'agit d'actions impliquant le financement
d'investissements générateurs de recettes, 50% pour les autres actions, 75% pour
certaines actions visant la conservation de la nature, exceptionnellement 100% pour
des mesures d'assistance technique, mises en oeuvre à l'initiative de la Commission.
Contacts : Thierry Acquitter, Euro Info Centre Bretagne, tél. 99 25 41 57,
M. Yatchinovski, Ministère de l'environnement, tél. (1) 40 81 21 22.
BRETAGNE EN CHIFFRES
LE FINANCEMENT RÉGIONAL
DE LA RECHERCHE
Lors de la discussion du budget 93, le Conseil régional de Bretagne
a voté une enveloppe globale de 50,5 millions de francs
pour la recherche. Ce crédit se répartit en trois grands volets :
l'équipement des laboratoires, doté de 20 millions de francs,
soit :
- 5 635 000 F en engagements de principe dont notamment :
2 000 000 F pour l'acquisition de la plate forme de MagnétoEncéphaloGraphie,
850000 F à l'ADRIA de Quimper, 600000 F à
l'UBO pour l'acquisition d'un spectomètre laser.
- 14 365 000 F en opérations nouvelles : délocalisations d'équipes
de recherche, acquisition de matériels et d'équipements dont
2 500 000 F à l'ENSSAT de Lannion pour la création du pôle
d'optique électronique.
les programmes de recherche d'intérêt régional sont dotés de
21 millions de francs dont :
-4000 000 F au CREBS afin de renforcer le pôle régional en imagerie
médicale.
- 2 000 000 F à l'IFREMER, à la Société MORS et à l'UBO pour la
réalisation du programme RAVEL.
-1500000 F pour les 3 CRITT : Electronique et Communication,
Biotechnologie Chimie fine et Environnement, Génie Biologique
et Médical.
la formation par la recherche se voit allouer la somme de
9,5 millions de francs pour :
- le renouvellement des bourses accordées les années précédentes.
- les 15 nouvelles bourses co-financées avec les grands organismes
de recherche.
- les 30 nouvelles bourses doctorales au taux unitaire de 70 000 F/an.
PÉ~OR~~E
RÉSEAU MARS 93 - N'87 d1b
RÉSEAU MARS 93 - N'87
DAAT - Ateliers Centraux de France Telecom
B.P. 48 - Z.I. de la Montagne du Salut - 56607 LANESTER CEDEX
Plus de 800 agents* pour
3 GRANDS DOMAINES D'ACTIVITES :
FABRICATION
Peinture par poudrage
Pièces de mécanique générale
Ensembles de tôlerie fine
Réalisation de Circuits Imprimés nus
(C.l.) et de cartes électroniques
MOYENS
Parc de machines à commande
numérique
Chaîne de peinture par poudrage
Chaîne de métallisation pour C.I.
REPARATION
Maintenance des cartes des centraux
électroniques, des matériels d'énergie,
de transmission
Minitel, postes haut de gamme,
publiphones, intercoms, Numéris
MOYENS
Testeurs fonctionnels
Maquettes de test
Baies d'intégration, étuves...
SERVICES
Entretien du parc national
des centraux mobiles
Téléphonométrie
Homologation des logiciels
pour minitel
Gestion du recyclage des terminaux
Cellule Suggestions
SAV des postes vendus...
Expertise des terminaux
*dont 100 à Paris
Pour tous renseignements : ATC CONTACT 97 02 5 6 7 8
France Telecom Téléphone : 97 02 56 56 Standard
Télécopie : 97 02 54 92
Télex : 740 215
La SECTION INFORMATIQUE DE GESTION & L' Association INPACT
vous invitent aux
4è^1P5 OCTALIES
Lycée Technique Privé de la Salle - 5 Rue de la Motte-Bridon - RENNES
le vendredi 26 mars 1993 à 9 heures
Thèmes abordés :
Echange de Données Informatisées ou E.D.I. et la Communication Inter Entreprises
Objectifs :
Etablir un contact entre professionnels et entreprises concernéespar l'E.D.I.
(Circulation d'informations par interconnexions de réseaux, transfert de fichiers...)
Professionnels présents :
FRANCE TELECOM - OST - OLIVETTI - SEMA GROUP
TRANSPAC - AQL - PROST - ALCATEL - SERTEL 2000 - OVP
pour diverses conférences et démonstrations !
Rens. Tél. 99 87 12 12
6
L'UNIVERSITÉ
DE RENNES I
DANS LE PELOTON
DE TÊTE
ACTUALITÉS
Si l'on en croit le rapport
d'évaluation du Ministère
de l'éducation nationale"),
l'Université de Rennes I figure
parmi les meilleures
universités françaises, en
matière de recherche et
d'évolution des connaissances
scientifiques, aux
côtés des plus grandes universités
provinciales comme
Toulouse, Grenoble ou Aix-
Marseille.
CINQ PÔLES
D'EXCELLENCE "'année 1992 a été particulièrement
riche en production
scientifique", reconnaît
Jean-Claude Hardouin, le président
de l'Université de Rennes I,
lors de sa conférence de presse
du 8 décembre 1992. C'est apparu
assez nettement dans la préparation
du XI' contrat de plan
Etat-Région, qui a déterminé les
pôles d'excellence des différents
sites universitaires. Développée
au travers des livres blancs, cette
évaluation a classé toutes les
équipes de recherche en quatre
catégories pour ne soutenir que
les meilleures. Sur les 1200 enseignants-
chercheurs de l'Université
de Rennes I, 900 ont ainsi
été évalués positivement. Parmi
les pôles d'excellence défmis, on
peut citer le secteur informatique-
électronique-télécommunications,
celui des matériaux, des
mathématiques, de la chimie fine
et des sciences de la terre.
"Mais attention !" prévient le
Président, "Il ne faut pas considérer
cette terminologie comme
une discrimination : un pôle
d'excellence est un secteur distingué
après des dizaines d'années
d'activité, c'est la reconnaissance
d'un savoir-faire
directement lié à l'expérience
des équipes de recherche. Par
ailleurs, d'autres sujets d'excellence
existent tels que : la génétique
moléculaire, la stérilité
masculine, la nutrition. Ils font
de plus en plus partie de nos
préoccupations quotidiennes, et
leur étude est appelée à se développer
rapidement."
3' RANG NATIONAL
POUR LES THÈSES
Dans le domaine scientifique,
le Président appuie sa démonstration
d'excellence sur des
chiffres, ceux publiés dans ce
rapport de la DRED"). "Notre indice
de thèse est de 0,28, soit 28
soutenances par an pour 100
enseignants-chercheurs, ce qui
nous place au 3' rang hors
Paris. Un autre indice est celui
de l'attribution de la prime
d'encadrement doctoral : l'Université
de Rennes I se place en
8' position hors Paris, avec l'attribution
de 24 primes par an
pour 100 enseignants-chercheurs.
Mais là où la domination
rennaise est réellement
excellente, c'est au regard des
chercheurs associés à des
grands organismes de recherche,
CNRS, INSERM,
INRA, etc. Avec 78% de chercheurs
associés, nous dépassons
la moyenne nationale de 13%.
Cette association aux grands organismes
est pour nous vitale :
elle nous a permis de placer
Rennes parmi les pôles nationaux,
que ce soit en environnement
avec le CNRS, en biologie
du développement avec l'INSERM,
ou en imagerie médicale
par décision interministérielle.
Nous sommes de même très redevables
aux collectivités locales,
qui complètent avec
beaucoup d'efficacité le dispositif
national. Depuis de nombreuses
années, la région
Bretagne s'est particulièrement
investie dans l'enseignement
supérieur et la recherche, apportant
ponctuellement les équipements
de recherche sans
lesquels les grands projets n'auraient
jamais pu se réaliser."
MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Jacques Lenfant, premier Viceprésident
du conseil scientifique
de l'URI, insiste sur l'évolution
de la recherche et de la mentalité
du chercheur. "Chaque année,
l'URI invite une centaine de
professeurs et de chercheurs
étrangers, et expatrie son personnel
de recherche dans les
mêmes proportions. Mais c'est
encore insuffisant, il faudra développer
ces échanges : l'un des
programmes de recherche communautaire
a d'ailleurs pour
thème la mobilité du capital
humain. Les enjeux sont importants,
citons notamment l'accueil
des chercheurs de la CEI,
un accueil indispensable à
la sauvegarde du patrimoine
scientifique de notre continent.
D'autre part, l'organisation des
réseaux de recherche, reliant
entre eux les différents laboratoires,
permet de valoriser la
complémentarité des équipes de
recherche, qui ont le devoir de
garder leur spécificité." n
Après ce premier bilan
concernant l'Université de
Rennes 1, nous poursuivrons,
en avril, avec l'Université de
Bretagne Occidentale, puis,
en mai, avec l'Université de
Rennes 2.
", Eléments d'évaluation de la formation doctorale
et de la recherche universitaire, rapport
publié parla DRED (Direction de la recherche
et des études doctorales), 61-65, rue Dutot,
75732 Paris Cedex 15. Tél. 16 (1) 40 65 65 40.
Contact: Clarence Cormier,
tél. 99 25 36 12.
Rencontre
d'universitaires
chinois et
rennais dans
les locaux de
la présidence
de l'Université
de Rennes I:
5 oct. 1992.
1
roc
FORUM DE L'INNOVATION
DU CAPTEUR
À L'ABSQRBEUR
D'OXYGENE:
du nouveau
dans l'emballage
Découverts dés 1982 au
sein du laboratoire de chimie
des métaux de transition
et de synthèse organique
de l'Université de
Rennes 1 , les premiers détecteurs
d'oxygène ont fait
place à une nouvelle famille
de capteurs : les absorbeurs
d'oxygène qui
sont capables de consommer
chimiquement tout
l'oxygène contenu dans un
emballage étanche
UN "MOUCHARD"
D'OXYGÈNE
Spécialiste des organométalliques,
molécules de synthèse
caractérisées par une liaison
entre un atome de carbone et un
atome de métal, Claude Lapinte,
directeur de recherche au CNRS,
travaille depuis plus de dix ans
sur la recherche de nouveaux
processus chimiques par transfert
d'électrons. Ces recherches fondamentales
trouvent rapidement
des applications dans le domaine
de la vie courante. C'est lui , en
effet, qui, avec son collègue
Jean-René Hamon et son équipe,
a mis au point un indicateur
coloré détecteur d'oxygène. Un
"mouchard", en quelque sorte,
qui change de couleur au contact
de l'oxygène .
"La plupart des composés
organométalliques, explique
Claude Lapinte, sont colorés et
changent de couleur selon le
nombre d'électrons de valence
autour de l'atome de métal.
Souvent trés réactives, ces molécules
changent de couleur au
contact de l'oxygène. A partir de
là, nous avons synthétisé un
composé de couleur orangé qui
présente la propriété de réagir
spécifiquement avec l'oxygène
pour devenir bleu turquoise.
L'activité inventive a également
porté sur la stabilisation
de ce complexe
du cuivre
par un gel
polypep-
Les absorbeurs
d'oxygène Atco.
tidique
pour pouvoir
l'utiliser
même en milieu
humide."
Ce procédé a
donné lieu à un brevet
déposé en 1985 auprés de
l'INPF" en 1985, grâce à une
aide financière de l'ANVAR2>. Il
est commercialisé par la société
lilloise Qualifrais.
UNE "ÉPONGE"
À OXYGÈNE
Ce premier dispositif ne faisant
cependant qu'indiquer la
présence d'oxygène, il ne constituait
pour les industriels, qu'une
contrainte. D'où leur réticence
à le commercialiser à grande
échelle. Ils désiraient surtout un
véritable absorbeur d'oxygène
qui puisse protéger les produits
emballés.
Un nouveau dispositif est alors
mis au point par l'équipe du Professeur
Lapinte et, en 1989, les
premiers absorbeurs d'oxygène
sont commercialisés par Standa
Industrie, sous le nom de Atco.
Ils se présentent sous forme de
petits sachets de sels à base de
fer qui consomment l'oxygène
présent dans l'emballage.
Sachant que la principale
cause de dégradation des aliments
(oxydation chimique ou
dégradation bactérienne) est due
pour l'essentiel à l'oxygène, il
fallait le supprimer , sans
pour autant mettre les
aliments sous vide,
ce qui, pour
certains aliments
comme les charcuteries pâtissières
et les viennoiseries, par
exemple, posait quelques problèmes.
Ce nouveau procédé permet
donc de protéger les denrées alimentaires
de l'oxydation et du
développement de certains micro
organismes sans aucune toxicité
pour le consommateur.
Ainsi, poursuit Claude Lapinte
: "contrairement aux antioxydants
qui sont ajoutés aux
aliments et donc ingérés avec
celui-ci, l'absorbeur est placé
dans l'emballage à coté de la
denrée pendant la phase de
conservation, puis jeté avec
l'emballage avant utilisation."
Des coquilles Saint-Jacques à
la tarte aux pommes, toute sorte
d'aliments peuvent ainsi garder
plus longtemps leur fraîcheur.
Pourtant, ces détecteurs d'oxygène
qui présentent un intérêt
certain, et qui sont considérés par
tous comme les meilleurs en
France n'ont pas encore, à ce
jour, trouvé leur véritable marché.
Contrairement aux industriels
japonais ou américains,
les industriels français
sont toujours très
réticents.
Pour Claude Lapinte, "le
consommateur pourrait être une
force motrice, à moins que la
législation ne l'impose. Mais
comme l'Institut national de la
consommation ne semble pas
vouloir en faire son cheval de
bataille, nous risquons fort d'attendre
longtemps."
Pour l'avenir, il travaille à la
mise au point d'un matériau nouveau
imperméable à l'oxygène
externe et absorbant l'oxygène
interne. Ce produit s'apparenterait
davantage à un service qu'à
une contrainte pour l'utilisateur.
Dans l'immédiat, il aimerait
bien voir commercialiser à plus
grande échelle son détecteur
d'oxygène, un procédé français
qui pourrait concurrencer la
"puce fraîcheur" de Monoprix. •
°i INPI : Institut national de la propriété industrielle.
0) ANVAR : Agence nationale pour la valorisation
de la recherche.
Contact : Claude Lapinte,
tél. 99 28 6123.
Fibres
optiques.
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
LA POLITIQUE RÉGIONALE
EN MATIÈRE DE RECHERCHE
L'or gris de la recherche P. 10
La formation par la recherche P. 11
20 millions de francs pour
l'équipement des laboratoires P. 12
21 millions de francs
pour la recherche
d'intérêt régional (PRIR) P. 13
La MagnétoEncéphaloGraphie P. 14
ADRIA :
de nouvelles perspectives P. 14
Ecrans plats
et optique électronique P. 15
Ouest-Recherche :
la matière grise bretonne
reliée à l'Europe P. 16
Ravel : 2 millions de francs P. 16
La politique régionale en matière de
recherche est fortement orientée
vers le développement économique de
la Bretagne. Originale et soutenue, elle
s'inscrit dans la continuité des années
précédentes et réflète bien la double
volonté de la Région : renforcer les
pôles d'excellence et valoriser les résultats
de la recherche en région.
Le Conseil régional espère ainsi
contribuer à placer la Bretagne parmi
les premières régions françaises en
matière de recherche et de hautes
technologies. n
~
€
Phases supraconductrices de Chevrel (CNRS).
L'OR GRIS DE
LA RECHERCHE
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
La politique de la Région
Bretagne en matière de recherche
n'est pas nouvelle.
Dés 1974, elle avait, en
effet, commencé à s'y intéresser
en aidant à l'équipement
des laboratoires,
et, en 1979, bien avant les
Assises Nationales de la
Recherche, avait créé le
CCRRDT (Comité consultatif
régional de la recherche et
du développement technologiquer.
I
les quatre axes essentiels qui
guident l'intervention de la
Région sont : le renforcement de
la recherche, les priorités thématiques,
l'aménagement du territoire
et le soutien aux relations
entre les laboratoires eux-mêmes
et avec les entreprises. L'un de
ses objectifs majeurs est de
compter 5% des chercheurs
français en 2020. La Région
Bretagne, qui vise aussi à l'excellence
internationale, veut
surtout valoriser les résultats de
cette recherche régionale auprès
des entreprises
Arrivant en fin de contrat de
plan et compte tenu de ses exigences
budgétaires, elle a défini
le cadre de ses interventions autour
de sept thèmes correspondant
aux enjeux stratégiques de
l'économie régionale. Ces domaines
d'intervention privilégiés
sont :
- l'environnement juridique,
économique social et culturel
de l'entreprise ;
- les bases biologiques du cycle
de la vie ;
les sciences et technologies marines
;
- les technologies des télécommunications
;
le génie biologique et l'imagerie
médicale ;
- l'informatique industrielle et le
génie des procédés ;
- les technologies du traitement
des eaux et de la récupération
des matériaux.
Pour mener à bien cette politique
de la recherche, la Région
a deux règles d'or. La première
consiste à n'agir qu'en accompagnement
des actions de l'Etat en
s'appuyant sur ses priorités pour
entraîner les décisions nationales
dans un sens favorable à leur
renforcement. Comme, par
exemple : la décentralisation
d'unités de recherche de l'INSERM
ou du CNRS
La deuxième est de garder
suffisamment de marge de manoeuvre
pour pouvoir réagir rapidement
à tout changement de
situation, à toute opportunité.
Cette souplesse d'adaptation est,
en effet, essentielle dans la
conduite d'une politique pragmatique
dans ses modalités, mais en
même temps rigoureuse quant à
ses objectifs.
Première nouveauté pour 1993:
la distinction entre la politique
de la recherche et ses actions en
matière de développement technologique
et d'innovation dans
les entreprises. C'est une conséquence
de la nouvelle organisation
des travaux du Conseil
régional. La politique de la recherche
est, en effet, du ressort
de la Commission de l'Enseignement
et de la Recherche présidée
par Claude Champaud, tandis
que l'innovation reste rattachée à
la Commision du Développement
Economique. Dans le cadre
de cette réorganisation, la partie
recherche du programme Britta
est intégrée à la politique générale
de la recherche. Les deux
autres nouveautés sur lesquelles
nous reviendrons concernent la
promotion de la recherche régionale
et la formation des jeunes
chercheurs.
L'enveloppe globale allouée
pour la mise en oeuvre de cette
politique régionale en matière de
recherche s'élève à 50,5 millions
de francs, dont 10 millions de
francs consacrés à la poursuite
des actions relatives au volet recherche
du programme Britta.
Cette politique se concrétise
par la mise en oeuvre de trois
types d'actions :
- les programmes d'équipement
des laboratoires (20 MF) ;
- les programmes de recherche
d'intérêt régional (21 MF) ;
- la formation par la recherche
(9,5 MF).
Une attention particulière est
portée aux retombées économiques
des opérations aidées par
la Région.
"L'or vert a relancé l'économie
bretonne à la fin du XX'
siècle, l'or gris assurera son
avenir à l'aube du troisième
millénaire", telle est la prédiction
de Claude Champaud. n
(H Le CCRRDT, instance qui rassemble la communauté
scientifique, des socio-professionnels,
des personnalités qualifiées et des élus, a pour
mission de conseiller le Président du Conseil
régional en matière de recherche. Il est actuellement
présidé par Claude Champaud.
LA FORMATION
PAR LA RECHERCHE
Le Laboratoire de biotechn
de I'ADRIA à Quimper.
11
A POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
W
V)
N
O
0
"Ils constituent le terreau
de ce que sera demain la
recherche bretonne", dit
Claude Champaud des
jeunes chercheurs. D'où la
nécessité, à la fois d'encourager
leur formation et de
leur assurer des perspectives
au niveau régional.
est pourquoi les priorités
régionales, dans ce domaine
comme ailleurs, consistent à
aider les programmes de thèse à
fortes retombées économiques.
Le budget de la Région pour
1993 prévoit, ainsi, un soutien
accru (+20%) et mieux ciblé
pour la formation doctorale.
UN NOUVEAU
DISPOSITIF
Les bourses mises en place par
le Conseil régional ont pour but
d'initier, pendant trois ans, les
étudiants aux métiers de la recherche.
Venant compléter le
dispositif national - Etat et
grands organismes de recherche -
elles sont accordées en priorité
dans les secteurs privilégiés par
la Région. Jusqu'ici, le dispositif
régional distinguait trois modalités
d'aide à la formation par la
recherche : les bourses doctorales,
versées directement aux
boursiers ; les bourses technologiques
régionales, versées à
l'établissement d'enseignement
supérieur, et les bourses cofinancées
avec les grands organismes
de recherche. Afin d'uniformiser
la démarche et de
réduire les coûts - frais de gestion
et charges - le nouveau dispositif
ne retiendra que les
bourses doctorales, dont le
nombre passe de 20 à 30 et dont
le montant annuel est porté de
60 à 70000 francs, et les bourses
co-financées avec les grands organismes
de recherche.
LA BOURSE
DOCTORALE
Considérée comme une allocation
d'études, la bourse doctorale
peut être exonérée de charges sociales
et fiscales, dès lors qu'elle
est directement versée au boursier.
Bien entendu, les engagements
pris en 91 et 92 pour les
bourses technologiques seront
honorés dans les conditions prévues.
En particulier, ces bourses
technologiques régionales peuvent
être renouvelées sous forme
de contrats associant la Région,
1'Etablissement d'Enseignement
Supérieur et l'entreprise régionale
co-finançant la bourse.
Cette nouvelle modalité permettra
au dispositif régional de
se distinguer de la procédure
Cifre, mise en place par
l'Etat pour co-financer, en région,
la formation doctorale
d'un jeune chercheur salarié
d'une entreprise. Le budget
93, consacré à la formation
par la recherche, permettra de
poursuivre les engagements
pris les deux années précédentes
et d'honorer 50 nouvelles
demandes dont 15 co-financées
avec les grands organismes de
recherche. n
20 MILLIONS
DE FRANCS POUR
L'EQUIPEMENT
DES LABORATOIRES
Le texturomètre permet d'évaluer la texture de produits alimentaires
par pénétrométrie, cisaillement, compression ou
extrusion. Les mesures peuvent être reliées à des descripteurs
sensoriels tels que la fermeté, l'élasticité...
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
L'expérience montre que la
participation de la Région à
l'équipement des laboratoires
est fortement incitative.
Pour obtenir un effet
de levier significatif, la
priorité a été accordée aux
opérations lourdes et structurantes
qui se voient attribuer
un crédit total de 20
millions de francs répartis
entre les engagements de
principe et les opérations
nouvelles.
LES ENGAGEMENTS
DE PRINCIPE
1993 correspond à la troisième
et dernière tranche de l'acquisition,
à l'Université de Rennes I,
de la plate-forme de MagnétoEncéphaloGraphie.
Cet appareil,
le premier installé en France,
permet de progresser dans la
connaissance du cerveau grâce à
la mesure électro-magnétique
des plus infimes courants induits
par l'activité cérébrale. Les trois
universités bretonnes bénéficient
également de divers équipements,
analytiques et informatiques.
En attribuant un premier
crédit de 2,5 MF à l'ENSSAT"'
de Lannion pour la réalisation du
pôle de recherche en optique
électronique de Bretagne, et en
prenant un engagement de principe
pour 4 autres millions les
années suivantes, la Région
marque sa ferme volonté de voir
se concrétiser ce projet. Elle se
situe bien ainsi dans le cadre
d'une pratique qu'elle a déjà utilisée,
pour la MagnétoEncéphaloGraphie
par exemple : entraîner
la décision de l'Etat dans
un sens favorable au renforcement
de la recherche régionale.
Enfin, l'ADRIA de Quimper bénéficie
toujours du soutien régional
pour sa restructuration et son
nouveau plan de développement
(voir Réseau 84).
Un tiers environ des 20 millions
de francs devrait être alloué
à l'ensemble de ces divers engagements,
les sommes restantes
se répartissant sur 15 nouvelles
opérations pour la moitié.
L'autre moitié reste à disposition
pour des opérations parvenant à
maturité en cours d'année.
LES 15 OPÉRATIONS
NOUVELLES
Seul un tiers des demandes a
obtenu un avis favorable, en
fonction des priorités définies au
préalable par la Région. Citons,
par exemple, la participation de
1,2 million de francs à l'équipement
des 2 nouvelles équipes de
l'INSERM et du CNRS transférées
de Paris à Rennes : 1 équipe
de l'INSERM en biochimie des
sciences pharmaceutiques et biologiques
et 1 unité CNRS spécialisée
dans la recombinaison
génétique.
Les nouveaux thèmes comme
"L'optique électronique" sont
aussi largement pourvus. C'est
l'une des particularités de la Région,
de miser sur les nouvelles
technologies, avec, parfois, plusieurs
années d'avance sur l'avis
des commissions nationales. Si
cette politique comporte des
risques, elle suscite, également,
l'émergence de résultats scientifiques
inédits, reconnus à
l'échelle internationale, comme
le Prix Hannawalt de chimie décerné
pour la première fois en
1992 à un non américain, un breton
de l'Université de Rennes I :
Daniel Louer, ou encore le Prix
IBM du jeune chercheur, attribué
à Fabien Bretenaker pour ses travaux
sur les gyrolasers. La Région
avait contribué fortement au
lancement de leurs travaux.
L'INSA"', l'IFREMER, l'IRISA'
et le groupe régional de
recherche en micro-ondes bénéficient,
également, du soutien
régional, aux côtés des universités.
L'ensemble de ces 15
opérations représente un investissement
de 85 millions de
francs dont 10 % alloués par la
Région. •
"' ENSSAT : Ecole nationale supérieure
de sciences appliquées et de technologies.
"' INSA : Institut national des sciences appliquées.
"' IRISA : Institut de recherche en informatique
et systèmes aléatoires.
Reconstruction 3D
tridimensionnelle
d'un examen IRM.
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
21 MILLIONS DE
FRANCS POUR LA
RECHERCHE
D'INTÉRÊT RÉGIONAL
(PRIR)
W
N
N
O
S'il est vrai que la Région ne
participe pas directement au
fonctionnement des laboratoires,
ce type de dépense
relevant plutôt de l'Etat ou
du marché, en revanche, les
21 MF attribués dans le
cadre des programmes de
recherche d'intérêt régional
constituent une véritable incitation
à la collaboration
entre les laboratoires et l'industrie
régionale. Après appels
d'offre et expertise des
dossiers, l'aide régionale
aux dépenses externes du
laboratoire peut monter
jusqu'à 25% du coût total
du programme.
TROIS PRIORITÉS La partie recherche du programme
Britta, consacré au
développement des biotechnologies,
se poursuivra après évaluation
des résultats déjà obtenus.
Les opérations correspondantes
mobiliseront plus du tiers (7,5
MF) de l'enveloppe prévue pour
les PRIR"). Vient ensuite un cinquième
consacré au développement
de l'imagerie médicale, un
secteur en plein essor puisque,
comme l'indique Claude Champaud
: "la Bretagne est désormais
reconnue comme l'un des
trois pôles d'excellence en
France, avec Orsay et Lyon".
L'université de Rennes I recevra
ainsi 4 millions de francs pour
la mise en place du CERIUM
(Centre de recherche en imagerie
à usage médical). Une autre
grande priorité régionale, associant
chercheurs et industriels,
est le programme européen
RAVEL (Réseau automatisé de
veille de l'environnement littoral),
développé en décembre 92
dans notre dossier consacré à la
Recherche Européenne en Bretagne
(Réseau 84). L'IFREMER
à Brest, l'Université de Bretagne
Occidentale et la société Mors,
recevront chacun une part des
2 MF accordés par la Région.
Cette opération est exemplaire
par la complémentarité de ses acteurs,
unis par un site et une passion
commune : Brest et la mer.
UNE NOUVEAUTÉ :
LA PROMOTION
En 1993, la Région décide de
soutenir des actions pilotes de
promotion de la recherche régionale.
Il ne suffit pas d'être bon,
encore faut-il le faire savoir !
Ces actions comprennent l'organisation,
en Bretagne, de congrès
scientifiques de niveau international,
la participation de chercheurs
bretons à de telles manifestations
pour y présenter
des communications scientifiques,
dans des pays cibles
comme le Japon ou les Etats-
Unis et l'organisation de prix
régionaux de la recherche
dans les disciplines correspondant
aux priorités régionales.
Cette animation de la
recherche régionale s'accompagnera
du développement de la
culture scientifique, avec la diffusion
des informations sur la
recherche et sur ses résultats.
L'ensemble de ces opérations de
promotion se voit consacrer un
crédit de 2,5 millions de francs,
dont une réévaluation du soutien
apporté, depuis plusieurs années,
au CCSTI, pour la diffusion de
Réseau. Plus que jamais, Réseau
est le mensuel de la recherche
en Bretagne, grâce aux multiples
participations des chercheurs
bretons, tant à la rédaction des
articles qu'à l'approvisionnement
constant d'informations
scientifiques et techniques. •
"' PRIR : Programmes de recherche d'intérêt
régional.
13
La plate-forme de
MagnétoEncéphaloGraphie
sera mise en service
en mai-juin 93,
dans le service
de Radiologie du CHRU
de Pontchaillou,
à Rennes.
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
La MagnétoEncéphaloGraphie
Plus communément appellée
MEG, la MagnétoEncéphaloGraphie
est une
technique d'exploration du
cerveau trés supérieure aux
technologies actuelles utilisées
en imagerie médicale,
telles que les scanners ou
les appareils à résonance
magnétique nucléaire. Elle
permet, en particulier,
grâce à l'utilisation de
champs magnétiques trés
puissants, de repérer et de
traiter des pathologies du
cerveau. Elle fait appel à
des compétences dont la
réunion à Rennes constitue
une situation exceptionnelle.
Installée, sous l'autorité du
Professeur Scarabin, en maijuin
93, dans le service de radiologie
du CHRU de Pontchaillou,
la MEG sera la seule plateforme
de ce type en France.
Le coût d'acquisition de la
machine, qui s'élève à 14 MF,
sera partagé entre la Région
(6 MF), le District de Rennes
(2,5 MF), le Conseil Général
d'Ille-et-Vilaine (2,5 MF), le
Ministère de la recherche (2
MF) et le Ministère de la défense
(1 MF).
C'est le constructeur américain
BTI (Biomagnetic Technology
Industry), une PME de San
Diego (Californie), qui a été retenu
pour être le partenaire industriel
de l'opération, ce qui
doit entraîner l'implantation à
Rennes d'une filiale de BTI.
Outre l'implantation de BTI à
Rennes, l'enjeu de ce projet est
double, il permet de développer
des activités industrielles périphériques,
notamment en matière
de logiciels ; et de conférer
à la Bretagne une position ex-
Il'Association pour le développement
de la recherche
appliquée aux industries agricoles
et alimentaires, sise à
Quimper, a bénéficié de la part
du Conseil régional d'une subvention
d'équipement de 4,875
millions de francs, sur un investissement
total de 18 millions
portant sur la construction d'un
bâtiment doté de nouveaux laboratoires
et ateliers. Par ailleurs,
dans le cadre de ses activités
normales, l'ADRIA a reçu 0,7
million en 1991 en abonnement
ceptionnelle dans le domaine de
l'imagerie médicale. •
à un contrat avec la CEE sur le
thème "Valorisation de sousproduits
végétaux par production
de fibres alimentaires". Actuellement,
elle perçoit aussi 0,225
million par an pour le financement
d'un poste de conseiller
technologique. Enfin, les aides
apportées dans le cadre du programme
Britta, ainsi que dans la
recherche qui se met en place
sur le stockage du poisson à
bord des bateaux, se chiffrent à
1,350 million. •
ADRIA : de nouvelles
perspectives
114
ÉCRANS PLATS
ET OPTIQUE
ÉLECTRONIQUE:
NE PAS JETER
LE BEBE AVEC
L'EAU DU BAIN
A POLITIQUE REGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE REGIONALE DE LA RECHERCHE
C'est le Président du Comité
régional de la recherche
(CCRRDT), Claude Champaud
qui a soulevé le lièvre
en novembre dernier, devant
ses collègues du
Conseil régional. Alerté par
les réticences du CNET"' à
s'impliquer dans la création
du PROB121 à Lannion, il
s'était vu confier par Yvon
Bourges, Président du
Conseil régional, une
mission d'information.
Il y avait bien
anguille sous
roche : ni le
CNET, ni France
Télécom, sa maison-mère, ni le
Ministère des télécommunications,
leur autorité de tutelle, ne
paraissaient décidés à appliquer
les décisions du CIAT (Comité
interministériel d'aménagement
du territoire) du 29 janvier
1992, qui avait fait du PROB une
priorité des priorités, puisque le
gouvernement décidait de lancer
cette opération avant même que
soit établi le contrat Etat-Région
du XI' plan.
Mais il y avait pire. Poursuivant
ses investigations, Claude
Champaud découvrit que les
écrans plats à cristaux liquides,
mis au point au CNET de Lannion,
allaient être industrialisés à
grande échelle à Eindhoven, aux
Pays-Bas, par Philips, avec l'accord
de Thomson, de Sagem, qui
en construit déjà à Lannion, mais
qui ne peut développer
l'outil industriel
nécessaire à la multiplication
par
100 de la production,
et bien
sûr de France Télécom, via le
CNET qui détenait les brevets
"bretons" indispensables à la réalisation
de l'opération. Le tout
avec des crédits publics français
et européens.
En soi, cela n'est pas scandaleux,
reconnaissait-il. Ce qui
l'est, c'est que ce "déménagement
du territoire" se produise
toujours dans le même sens : le
renforcement de la riche Lotharingie
au détriment des régions
périphériques de l'Europe, et
particulièrement de la Bretagne.
Encore plus grave, Claude
Champaud constatait que, derrière
ces deux affaires, se profilait
une stratégie de France
Télécom visant à ne faire du
CNET qu'un centre technique de
cet établissement public, au détriment
de sa mission, reconnue
par le nouveau statut de France
Télécom, d'une recherche plus
fondamentale, quoique finalisée.
A terme, cela ne pouvait manquer
d'avoir des incidences sur
la capacité de recherche régionale
: "On tue la vocation électronique
de la Bretagne",
écrivait-il dans "Le Monde",
pendant que le Président Yvon
Bourges saisissait les ministres
concernés, et que le
Conseil régional adoptait à
plats !
l'unanimité des voeux proposés
par Claude Champaud sur ces
affaires.
Leurs interventions, semble-til,
ont fait du bruit dans les "Landerneau"
parisiens et bruxellois :
aux dernières nouvelles, en effet,
la Commission Européenne aurait
décidé d'ouvrir une enquête
sur la conformité de l'accord sur
les écrans plats en regard de l'article
85 du traité CEE, qui réglemente
le droit de la concurrence,
et le Ministère des télécommunications,
et donc France Télécom
et le CNET, seraient plus ouverts
sur la question du
PROB. Le Préfet de Région
organise prochainement une
réunion sur ce dernier sujet :
nous serons alors fixés.
Tout en étant révélatrice de
certaines tendances allant à
l'encontre des objectifs poursuivis
par la Région en matière
de valorisation de la
recherche, l'affaire des écrans
plats ne semble pas devoir remettre
en cause sa politique à cet
égard : "il ne faut pas, déclarait
Claude Champaud, lors de la
dernière session du Conseil régional,
jeter le bébé avec l'eau
du bain. Cet exemple, bien au
contraire, doit nous inciter à la
vigilance et au renforcement de
P4
`ç": 23
notre capacité de veille stratégique
et institutionnelle, et
pourquoi pas, à faire revivre le
CELIB1" ; ce serait en tout cas
un beau message posthume à la
mémoire de René Pleven." n
des écrans
0"CNET : Centre national d'études des télécommunications.
", PROB : Pôle de recherche en optoélectronique
de Bretagne.
"'CELIB :Comité d'étude et de liaison des intérêts
Bretons. René Pleven en était le Président.
Il a eu ses heures de gloire avec les
grandes décentralisations des années soixante.
France Télécom investit
1 milliard dans les assurances.
C'était le montant nécessaire
à l'industrialisation
OUEST-RECHERCHE:
la matière grise
bretonne
reliée à l'Europe
1~~
/~~
1
O .
i••
R:,~w a~
RÉYRU
Le Réseau OUEST-RECHERCHE,
flux inter-métropoles à moyen terme.
Bande passante >10 Mb/s
Bande passante : 2 Mb/s
Bande passante : 256 Kb/s
LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE • LA POLITIQUE RÉGIONALE DE LA RECHERCHE
A partir de mars 1993, 39
centres de recherche ou laboratoires
de Grandes
Ecoles et d'Universités bretons
seront reliés au sein
d'un réseau de communication
scientifique trés performant
: le réseau OUESTRECHERCHE.
rnancé par le Conseil régional,
les quatre départements
bretons et les neuf agglomérations
concernées, ce réseau
devrait permettre une démultiplication
des échanges entre
scientifiques et un meilleur accés
aux sources d'information nationales
européennes et même internationales.
Sa mise en place coûtera 68,5
MF répartis sur cinq ans.
Le Conseil régional de Bretagne,
pour sa part, apportera
15,1 MF les trois premières années.
Afin de répondre aux trés importants
besoins de transmission
des centres de recherche, il a
fallu créer un réseau à trés haut
débit. Il offrira à chacun de ses
utilisateurs des capacités de
raccordement jusqu'à 2 megabits/
seconde en continu en 1993,
et 10 megabits/seconde en 1996.
L'interconnexion du réseau
OUEST-RECHERCHE au réseau
national RENATER" t sera
réalisée en 2 megabits/seconde
en 1993 et passera à 34 megabits/
seconde à moyen terme.
Le projet est né il y a deux ans
au sein de l'équipe d'informaticiens
animée par Hervé Le Goff
à l'INRIA/IRISA de Rennes. Il
permettra les utilisations suivantes
:
- la communication entre les
scientifiques au travers des messageries
électroniques, forums
électroniques et transfert de données
;
- l'accès à des calculateurs
scientifiques performants situés
dans une autre région ou un
autre pays;
le partage des ressources sous
réserve du respect des accords
commerciaux ;
la téléformation et les téléséminaires.
n
"'RENATER : Réseau national de télécommunications
pour la technologie, l'enseignement
et la recherche.
RAVEL:
2 millions
de francs
I ancé en 1991, le programme
JRAVEL (Réseau automatisé
de veille pour l'environnement
littoral) a obtenu les subsides du
Conseil régional pour la phase pilote
qui se déroule actuellement.
RAVEL, opération commune à
l'IFREMER et à Mors-Environnement,
une société implantée à
Brest, a pour objectif, d'ici à
1996, d'équiper cent bouées sur
les côtes françaises. Ces stations,
munies de capteurs, enregistreront
les principaux paramètres
de l'évolution du milieu naturel,
données ensuite transmises par
satellite au centre de gestion du
programme. Il n'existe à l'heure
actuelle ni bouée ni instrument
répondant en l'état aux exigences
de RAVEL. Aussi la phase pilote
consiste-t-elle à concevoir et à
tester une première station qui
sera prochainement mouillée en
rade de Brest. Le budget de cette
phase est de 17 millions de
francs, dont 2 en provenance du
Conseil régional. n
Le réseau RAVEL, entre eau,
ciel et terre, fait appel à de
multiples technologies (voir Réseau
84).
116
LE CONTRÔLE
DU TRAFIC AÉRIEN
AUTOMATISÉ
La salle de contrôle du Centre national
de la navigation aérienne de l'Ouest.
FORUM DE L'INNOVATION
l'interrogation des calculateurs
se fera par le biais de l'informatique.
"Phidias permettra d'éliminer
les petites tâches
secondaires du métier de
contrôleur" explique Jean Souquet.
Le système, dont Thomson
assurera la production, est déveles
plus importantes est sûrement
celle réalisée avec le radar
d'Espineiras, en Galice". Grâce
à un interface de conversion mis
au point par les ingénieurs de
Brest, ce radar étranger vient
s'ajouter à la batterie de récepteurs
dont dispose le CRNA-0
Le 28 janvier, le Centre
national de la navigation
aérienne de l'Ouest, à Loperhet
près de Brest, marquait
en fanfare l'extension
de sa surface opérationnelle.
C'était aussi l'occasion
de faire connaître les
progrès en cours dans le
contrôle aérien.
Le CRNA-O, autrement appelé
Radar de Bretagne, emploie
280 personnes à Loperhet,
parmi lesquels 162 contrôleurs.
"Leur rôle est d'assurer la gestion
du trafic aérien en toute sécurité
pour les avions" définit
Jean Souquet, directeur du
centre. A l'instar des années précédentes,
le trafic a encore augmenté
en 1992 de 5,49%, pour
un total de 315 727 vols. Certains
jours de pointe, plus de mille
appareils sont ainsi contrôlés. Le
centre arrive à saturation, d'où
l'extension des bâtiments, chiffrée,
uniquement pour le génie
civile, à 45 millions de francs.
"L'investissement est supporté à
100% par l'aviation civile" précise
le directeur. Le passage de
8 à 20 postes de contrôle, la
construction d'une structure
propre à la formation répondent
aux besoins estimés d'ici 15 à 20
ans. Les évolutions techniques
du contrôle aérien ne sont pas en
reste : apparaissent concrètement
Phidias, le nouvel environnement
informatique du contrôleur ; l'intégration
européenne au niveau
des calculateurs et la génération
des radars mono-impulsion.
PHIDIAS,
HAUTE DÉFINITION
Aujourd'hui, le contrôleur
aérien dispose d'un écran radar
circulaire. Des données telles la
position, l'altitude, la vitesse des
avions y sont visualisées. Il peut
comparer ces informations avec
celles, inscrites sur un "strip"
papier, du plan du vol fourni à
l'avance par la compagnie ou le
pilote. Il utilise également un
calculateur traitant dans l'espace
aérien les données radar réelles
et celles du plan de vol. Ces
connaissances en tête, il peut
donner des instructions au pilote
: indiquer la route la plus
directe quand le trafic est fluide,
demander qu'il change de cap
ou d'altitude quand le ciel est
encombré, ou, en cas de blocage,
de rester au sol. Le concept Phidias,
en cours d'étude, est appelé
à être le futur partenaire du
contrôleur aérien. En quelques
mots, ce que sera Phidias : de
nouveaux écrans de télévision à
très haute définition et en couleur,
accompagnés, à travers de
multiples systèmes logiques, de
possibilités de dialogue hommemachine
aux moyens étendus.
Les données de plan de vol notamment
apparaîtront sur l'écran
et non plus sur papier. De même,
loppé par le centre d'études et le
service technique de la navigation
aérienne.
INTÉGRATION
EUROPÉENNE
Le CRNA de Loperhet couvre
l'espace aérien du grand Ouest
et les zones Manche et Atlantique
jusqu'au 8' méridien. Par
exemple, un aéronef, en provenance
d'Amérique du sud, entre
dans le champ des radars espagnols
avant d'être "pris en
charge" par les contrôleurs français.
Il y a encore quelques années,
le passage du relais entre
les centres, fussent-ils français,
se faisait par téléphone. Une politique
volontariste au niveau européen
a permis l'automatisation
quasi-générale des échanges de
données radar et de liaisons intercalculateurs,
le principal obstacle
étant de rendre compatibles
les standards techniques. En
1986, Loperhet était connecté
avec Londres, en 1992, les liaisons
étaient abouties avec Madrid,
Shannon en Irlande,
Jersey... "L'une des connexions
dans son espace aérien. A ce propos,
les radars actuels vont être
remplacés par de plus modernes,
dits à mono-impulsion. Grâce à
une onde hyperfréquence codée
interrogeant le système de bord
de l'avion, ces radars enregistreront
davantage de paramètres
que la génération actuelle. •
Contrôleur CRNA-Ouest.
Rens. : Jean Souquet,
hél. 98 31 84 00.
1171
PONT-DE-BUIS:
COMMENT
DÉCLENCHER
L'AIRBAG ?
ACTUALITÉS
La vogue est aux airbags,
ces ballons qui se gonflent
en une fraction de seconde
et protègent le conducteur
automobile des chocs brutaux.
La société Livbag, à
Pont-de-Buis"", fabrique en
série des dispositifs pyrotechniques
à l'usage des
modèles européens et américains.
Depuis janvier 1993, l'usine
de Pont-de-Buis a pris l'appellation
de Livbag S.A., jointventure
à 50/50 entre la SNPE
(Société nationale des poudres
et explosifs) et Autoliv Klippan,
fournisseur mondial en systèmes
de sécurité pour l'automobile,
dépendant du géant Electrolux.
En France, Livbag possède une
usine de production à Pont-de-
Buis et un centre de recherche en
région parisienne. L'apparition
sur le marché, marché énorme,
des coussins protecteurs donne
un sérieux coup de fouet à son
activité. Il existe en fait deux
sortes de ballons : l'airbag, modèle
américain, dissimulé au
coeur du volant et l'euroflator,
son équivalent d'outre-Atlantique,
qui vient en complément
de la ceinture de sécurité (nonobligatoire
aux Etats-Unis). Les
chaînes automatisées de Pont-de-
Buis produisent uniquement le
déclencheur des procédés airbag
et euroflator, pas les ballons.
PYROTECHNIE
"Entre 1984 et 1990, nous
avons fourni des générateurs de
gaz à Mercedes pour des réfracteurs
de ceinture" dit Daniel
Labourdique, l'un des responsables
de l'entreprise. L'usine
s'était taillée un créneau, aujourd'hui
Renault et Nissan,
entre autres, ont pris le relais. Le
tournant intervient pourtant avec
les airbags, pour lesquels elle a
produit l'an dernier quelques
millions de micro-générateurs, à
la cadence de 400 par heure en
ce qui concerne les euroflators.
Techniquement, le procédé allie
l'électronique et la pyrotechnie.
L'automobile est munie de capteurs
qui mesurent sa décélération
en cas de freinage. Ces
données transitent par un
condensateur, qui en restitue la
nature exacte. Un petit appareillage
électronique interprète
alors le phénomène et déclenche,
si besoin est, une impulsion
électrique. Celle-ci fait réagir le
composant explosif, quelques
milligrammes de poudre appelée
propergol qui a la particularité
de générer un grand volume de
gaz(2). Le coussin, instantanément,
est gonflé. Bien sûr, ce
système fonctionne en quelques
dixièmes de seconde. Il doit être
extrêmement acéré pour se déclencher
lorsque la sécurité du
conducteur est vraiment en danger,
et au contraire rester statique
quand le freinage, même
brusque, ne présente pas de
risque. Dans certaines circonstances,
l'émergence du coussin
dans le champ de vision peut,
en effet, être préjudiciable. De
l'avis des constructeurs, les airbags
forment cependant une
grande avancée en matière de sécurité,
d'autant que l'instrument
est discret : un euroflator se résume
à un micro-générateur de
quelques centimètres, un sac de
30 litres plié dans le volant et un
réenrouleur de ceinture (quand
l'airbag se déclenche) imbriqué
dans la carrosserie.
TRIPLER LA PRODUCTION
Livbag est promis à fournir,
dès 1994, le quart du marché
mondial, soit près de six millions
de générateurs par an ! A la fin
de cette année, un investissement
de 30 millions de francs sera
consenti pour tripler les bâtiments,
à l'instar de la production.
De cinquante aujourd'hui,
le nombre de salariés devrait
augmenter, avec priorité d'embauche
pour les anciens de la
SNPE, qui pour sa part perd des
effectifs. n
Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, 3600 habitants,
est une commune du centre Finistère, elle
vit principalement de la Société nationale des
poudres et explosifs, héritière de la poudrerie
créée en 1688 par Louis XIV.
n) Propergol : substance ou mélange de substances
susceptible de libérer une grande
quantité d'énergie et un fort volume de gaz
chauds dans une réaction chimique od n'intervient
pas l'oxygène de l'air.
Le dispositif pyrotechnique
de l'euroflator, version
européenne de l'airbag
américain, dont tous les
véhicules seront équipés
à terme.
Rens.: Daniel Labourdique,
téL 98 81 30 00.
1181
~ ~ \•:7• : ~ \ 4): • ► • ►
Triballat en Chine.
Noyai-sur-Vilaine : aprés Shanga , en mai
1992, la Laiterie Triballat de Noyal-sur-Vilaine
vient de vendre deux autres usines, clés en
main, à Pékin et Zhen Zhou, en Chine. Ces
usines produiront sur place le fameux Sojasun
dont les chinois semblent friands. Un contrat
prometteur qui pourrait lui ouvrir les portes du
marché asiatique.
Rens.: tél. 99 00 5101.
"Pilote Performance".
Brest : Le label "Pilote Performance" a été décerné
à la société Protechno de Brest, spécialisée
dans la réalisation de circuits imprimés.
Créée en 1973 par Lucien Traon, la société a
fait l'objet d'un important programme d'investissements
(7 MF) cont les principaux objectifs
sont la réduction des délais et l'amélioration de
la qualité.
Rens. : L. Traon, téL 98 02 03 40.
Musée 2000.
Lannion : à l'occasion du salon SITEM 93, la
société Systèmes G a lancé le nouveau système
de muséographie "tout numérique" :
Musée 2000. Il combine un système d'enregistrement/
restitution sonore de haute qualité à un
séquenceur pouvant piloter des contacts de sortie,
des gradateurs de puissance, des projecteurs
de diapositives, en parfait synchronisme
avec les commentaires sonores.
Rens. : C. Barbeau, téL 96 48 8518.
Ducros à Saint-Divy.
Landerneau : Gibert Ducros, de Ducros (qu'il a
vendu à l'Italien Ferruzzi), a investi dans l'usine
de la "Surgélation bretonne" à Saint-Divy. Employant
75 personnes, elle va fournir cette
année 3750 tonnes de produits surgelés aromatiques
: persil, ciboulette, estragon... produits en
grande partie par les coopératives bretonnes
Even, Coopagri et Trieux. Les herbes et épices
surgelées grimpent en flèche en ce moment.
Rens. : 98 20 2916.
Trégor-OEuf certifié
Guingamp : ouvert en 1990, Tréggor-OEuf,
centre de conditionnement d'ceufs plein-air, a
obtenu la certification du bureau Véritas. Le
centre, qui exporte la moitié de sa production,
conditionne 50 millions d'aeufs par an.
Rens. : Jean Flouriot, téL 96 4375 94.
Orca : l'export artisanal.
Brest : créé en 1988 par deux transfuges
d'IFREMER, Orca instrumentation, situé sur le
technopole Brest-Iroise, a reçu le 11 février le
grand prix de l'exportation artisanale décerné
par le Fondexja. Dans le créneau des mesures
océanograp-igues (kits, écho-sondeur de
l'êche...), Orca réalise 28% de son chiffre à
export. On se souvient d'Orca pour sa participation
à l'exploration du Titanic...
Rens. : Jean-Michel (oudeville, tél. 98 0529 05.
Des marchés pour Grenat Productique.
Brest : Grenat Productique, société employant
26 personnes et implantée sur ce qui allait devenir
le technopole Brest-Iroise, gagne des marchés
importants : le contrôle de la distribution de
l'énergie pour une ligne du tramway de Nantes ;
la mise en place d'un système d'informations
logistiques pour la Direction des constructions
navales ; la gestion de production dans des entreprises
agro-alimentaires ; ou encore un contrat
de gestion d'entrepôt avec Naf-Naf...
Rens. : Alain Lambert, tél. 98 05 3170.
Even : Une usine moderne
de transformation de viande.
Brest : la coopérative Even investit 25 millions
de francs dans une usine de traitement de
viandes à Brest, près de l'abattoir qu'elle possède
déjà, via sa marque Kerguelen. Il s'agit
en fait d'un transfert de l'unité de Ploudaniel,
dont les capacités passeront de 3000 tonnes
annuelles à 8000 tonnes dans un bref délai.
Rens. : Jean-Yves Renan, tél. 98 85 50 00.
Le PROB à Tréguier ?
Tréguier : le transfert d'Alcatel CIT vers Lannion
prive Tréguier d'une source d'emploi et de taxe
professionnelle. Le SIVOM des Trois Rivières,
qui regroupe Tréguier et trois communes périphériques,
s'est porté candidat pour accueillir
le PROB, Pôle de recherche de l'optique en
Bretagne.
Jumelage Rennes/Alma Ata.
Rennes : dans le cadre de la coopération
de l'Université de Rennes 1
avec les universités d'Alma Ata, une
vingtaine d'étudiants kazakhs sont
accueillis jusqu'au 5 mars par la Faculté
de Sciences Economiques. Pendant
un mois, ils s'initient à l'entreprise
dans une économie de marché.
Rens. : M. Audroing, tél. 99 25 35 45.
7 estoniens à Rennes 1.
Rennes : reçus par le service d'éducation
permanente de l'Université de
Rennes 1, sept estoniens ont passé
six semaines à Rennes pour apprendre
à mieux protéger l'environnement.
Leur accueil , dans le cadre
du programme Tempus, un programme
d'échanges universitaires
avec les Pays de l'Est, est une première
étape d'un projet plus vaste
de collaboration avec l'Estonie qui
s'étalera sur trois ans. L'objectif est
de créer à l'université technique de
Talinn, un département environnement,
recherche et formation.
Chimistes rennais
récompensés.
Rennes : la société allemande de
chimie: GDCh vient de récompenser
deux jeunes chimistes rennais pour
leurs recherches originales sur les
"organométalliques". Elle leur a attribué
deux bourses de participation à
des congrés internationaux. Il s'agit
de Bénédicte Seiller et Christophe
Darcel, tous deux titulaires d'un DEA
de chimie moléculaire et travaillant
au sein de l'URA CNRS 415.
Prix IBM
Jeune Chercheur de Physique.
Rennes : c'est un jeune physicien
de l'Université de Rennes 1, Fabien
Bretenaker, qui vient de recevoir le
Prix "IBM Jeune Chercheur de Physique"
pour ses recherches sur la
physique des lasers en anneaux et
application aux gyro-lasers. Physicien
au laboratoire d'Electronique
Quantique Physique des Lasers, ses
recherches ont servi, entre autre, à
l'élaboration du magnétomètre laser.
Rens. : Clarence (ormier, tél. 99 25 3612.
Isogone récompense les PME
agro-alimentaires bretonnes.
Rennes : association d'étudiants
de l'ENSAR et de la Faculté de
Sciences Economiques de Rennes,
ISOGONE organise chaque année,
depuis 1986, le prix de l'Innovation
Marketing et Technologique en
Agro-Alimentaire pour la région
Bretagne. Ce prix sera décerné le
jeudi 1' avril lors d'une soirée qui
proposera aussi un débat sur le
thème :"L'Innovation et son avenir
dans le grand Ouest."
Rens. : Laurent Griffon, téL 99 59 5185.
La Société Statistique de
Paris présidée par un rennais.
Rennes : c'est Georges Le Calvé,
professeur à l'UFR SSMA qui a été
élu Président de la Société de Statistique
de Paris créée en 1860.
Membre de l'Institut International de
Statistique, la SSP a pour orientation
scientifique générale les statistiques
économiques, officielles et du milieu
des affaires.
19
Points à l'Ouest.
Brest : parrainée par le groupe GMF, l'association
"Points à l'Ouest" a créé une machine
à lire pour aveugles. Cette machine
va permettre aux non-voyants d'avoir accés
à la culture, à l'information et à l'éducation.
Au delà de cette innovation, l'association
prépare la création de "BIBOP BRAILLE", la
bibliothèque télématique braille.Pour mener
à bien ce projet qui demande des fonds importants,
l'association lance un appel à soutien
auprés des chefs d'entreprises de la
Région Bretagne.
Rens. : Maryse Narvor, tél. 98 05 24 66.
Effervescience.
Paris : l'Association science-technologiesociété
(ASTS) et la radio TSF ont lancé
depuis le 1 "' février "Effervescience", la rubrique
quotidienne des sciences et des
techniques. Présentée et préparée par
Jacques-Olivier Baruch, "Effervescience"
présente, chaque jour, l'actualité scientifique
et technique. Du lundi au vendredi à
8h15, sur le réseau TSF.
Rens.: ASTS, tél. 40 35 10 10.
Cinématographie scientifique.
Paris : l'Institut de cinématographie scientifique
fondé en 1930 est lelus ancien des
services audiovisuels scientifuiqes français.11
propose, outre la projection de films scientifiques
au Palais de la Découverte, un catalogue
de la cinémathèque de l'Institut. Il
peut aussi apporter ses conseils dans la recherche
de documents.
Rens. : Alexis Martinet, tél. 42 50 35 51.
Docteurs Es Sciences.
Rennes : une section régionale de l'ANDES
(Association nationale des docteurs es
sciences) sera créée à Rennes lors d'une assemblée
générale qui aura lieu le 20 mars.
Association pluridisciplinaire et multiprofessionnelle,
elle servira de ralliement à des
scientifiques très diversifiés et devrait permettre
de développer les contacts et l'information
entre l'Université et l'Industrie.
Rens. : Pierre Kimfoko, tél. 99 5186 14.
CCSTI
Dans le cadre de l'exposition "Aux origines de l'homme",
ENTREE LIBRE
au centre culturel le Rallye à 20h30.
17 mars/Les Hommes de Néandertal.
Rennes : Jean-Louis Heim, sous-directeur du Muséum national d'histoire naturelle
de Paris, raconte comment il a reconstitué le crâne de l'Homme de Néandertal
de la Chapelle-aux-Saints (Corrèze).
Rens. : Monique Thorel, tél. 99 30 04 02.
6 avril/Conférence CCSTI.
er
Rennes : Jean-Yves Collet viendra présenter les singes
d'Arabie Saoudite. Au centre culturel Le Rallye à 20h30.
Rens. : Frédéric Balavoine, tél. 99 30 04 02.
HÔTEL DE VILLE
13 mars, 17h30/
Vannes : "A l'origine de l'Urbanisme antique : l'exemple de Quimper", une
conférence de Jean-Paul Le Bihan présentée dans le cadre des manifestations
du Bimillénaire de Vannes.
20 mars, 17h30/
Vannes : "L'Epoque Gallo-Romaine", conférence de Louis Pape, professeur
d'histoire ancienne à l'UHB (Rennes 2).
Rens. : tél 97 0180 20.
IFREMER
24 mars, 15h30/
Brest : "les flotteurs dérivants et la circulation
générale de l'océan, par Michel 011itrault, FREMER chercheur à l'IFREMER.
Rens. : Ghislaine Gourmelen, tél. 98 22 40 07.
INSTITUT DE GESTION
16 mars, 15h et 17h/
Rennes : "Design, innovation and the boundaries of the firms", conférence doctorale
par V. Walsh, professeur invité à l'Ecole des Mines de Paris.
23 mars, 15h et 17h/
Rennes : "Anti-trust and anti-dumping law : lessons from the Zenith-Mastsushita
case", par Peter Holmes, professeur à l'Université de Sussex.
Deux conférences qui s'inscrivent dans le cadre du cycle de conférences doctorales
organisées par la Faculté des Sciences Economiques et l'Institut de Gestion
de Rennes.
Rens. : Mme Levelu, tél. 99 25 3575.
OCEANOPOLIS
3 mars, 20h30/
Brest : "des volcans et des ires ; aperçu sur
le volcanisme des îles océaniques", par
Jean-Pierre Eissen, chargé de recherche au
centre Orstom de Brest. OC?,C6ylOpOIIS
ST
7 avril, 20h30/
Brest : "la coquille Saint-Jacques, espèce symbole de la rade de Brest", par
Jean-Pierre Cantal, secrétaire du Comité local des pêches maritimes de Brest.
Rens. : Chantal Guillerm, tél. 98 34 40 40.
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
18 mars/Le coeur et la raison.
Brest : jusqu'à la fin du printemps, l'université de Bretagne occidentale, en relation
avec la ville de Brest, Océanopolis, Le Quartz et la librairie Dialogues,
organise une série de conférences dton les thémes sont rassemblés sous le générique
"L'Europe : Le coeur et la raison". Les dates : 18 mars, Océanopolis,
"Les ports de commerce de l'Arc Atlantique" ; 25 mars, Le Quartz, "Situation
linguistique dans les pays de la CEE" ; 27 mars, le Quartz, "Les représentations
du corps dans les sociétés humaines" ; 8 avril, faculté de droit, "Arme
ment et désarmement" ; 15 avril, Océanopolis, "Programme RAVEL et moyens
de surveillance". Suite au prochain numéro.
18-19 mars/Electronique et pêche maritime.
Lorient : l'AFEIT (Association pour les filières électroniques, informatiques
et télématiques) en Bretagne Occidentale et le CCSTI,
Maison de la Mer de Lorient organisent, en collaboration avec
l'IFREMER et Télécom Bretagne, un colloque consacré à l'électronique
dans la pêche. Les thèmes abordés
sont : la télélocalisation, la gestion
de l'information à bord et la détection.
Rens. : Joel Van den Berghe,
tél. 98 0012 35. A F E I T
20 mars/
Portes ouvertes à l'Université.
Rennes : les Universités de Rennes I et Rennes 2 ouvrent leurs
portes au public.
Rens. : Clarence Cormier, URI, tél. 99 25 36 12 ;
Thérèse 011ivier, R2, tél. 99 33 52 07.
26 - 27 mars/15B' Journées de Chirurgie Digestive.
Rennes : le CHR de Rennes-Pontchaillou organise ses quinzièmes
journées de chirurgie digestive sous la présidence du
Professeur Maurice Mercadier. Elles ont pour thème général :
"La place de la chirurgie dans les ictères par rétention".
Rens. : Professeur Launois, tél. 99 28 42 65.
Du 29 au 31 mars/Irlande et Bretagne.
Rennes : les relations historiques entre l'Irlande et la Bretagne
font l'objet d'un colloque bilingue, organisé par les Archives municipales
et présidé par Jean Meyer, professeur à l'Université de
Paris IV Sorbonne. Saints, arts et géographie sont au progamme
de ce colloque celtique.
Rens. : Marie-Christine Trégaro, tél. 99 28 5514.
17 mars/Les Antioxydants.
Vannes : ARCHIMEX, le Centre de recherche et de formation en
chimie extractive organise une journée sur le thème des "antioxydants".
Cette session est destinée aux utilisateurs d'antioxydants
dans les filières alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.
Elle aura lieu à la Chambre de commerce et d'industrie
de Vannes.
Rens. : Philippe Masson, tél. 97 47 06 00.
24-25 mars/Les Enzymes et les Micro-Organismes.
Vannes : deuxième session de mars organisée
par ARCHIMEX, cette session a pour objectif
bjet
tif de faire le point sur l'utilisation des enzymes
et des micro-organismes et de leurs
potentialités au niveau industriel. Les appli- KIM
cations orientées vers l'extraction et la purifi- ' t
cation de molécules seront particulièrement
développées.
Rens. : Philippe Masson, tél. 97 47 06 00.
23-24-25 mars/Journées Catalanes.
Rennes : organisées à l'initiative de la section catalan de l'UFR
Espagnol de l'Université de Rennes 2, avec le soutien de la
Ville de Rennes, ces journées seront centrées sur le thème de "la
langue comme signe d'identité".
Rens.: Imma Fabregas, tel 99 33 52 52.
11 et 12 juin/Cancer de l'oesophage.
Brest : à l'initiative de trois équipes du CHU de Brest, le cancer
de l'oesophage sera le thème d'un congrès international qui se
tiendra au Quartz les 11 et 12 juin 1993. Des facteurs tels le
tabac, l'alcool, l'alimentation, seraient à l'origine du fort taux
de cancers de l'oesophage et de l'estomac en Bretagne.
Rens : Pr. Lozach, tél. 98 22 33 33.
Du 13 au 16 septembre/
OSÂTES sous pavois américain.
Brest : pour sa seconde édition, le séminaire Osates, qui se
tiendra à Brest du 13 au 16 septembre 1994, verra s'impliquer
dans l'organisation l'Institute of electrical and electronics engineers.
L'IEEE est la plus grande association mondiale d'ingénieurs.
O
U
1201
BR VESD RSA k• :7 • SBR D R S AUN•87• SBR V SD RE .; • ~
A LA MAISON DE LA MER
Jusqu'au 26 avril/
"Pêcheurs du Nouveau Monde".
Lorient : réalisée par le groupe pêche de Solagral
et le CRISLA, cette exposition présente le résultat
d'un travail d'enquête mené par l'ingénieur P. Favrelière
en Amérique Latine, du Mexique au Chili.
Il s'agit d'une analyse d'un système de production
orienté sur le développement socio-économique
de ces pays. A travers photographies et documents,
le visiteur découvrira la pêche minotière
pratiquée dans ces zones, l'aquaculture, les menaces
sur l'environnement et les problèmes sociaux
de ces populations maritimes.
Rens. : D. Petit, téL 97 84 87 37.
A L'ESPACE SCIENCES & TECHNIQUES
Du 11 janvier au 30 avril/
Aux origines de l'homme.
Rennes : depuis quelques 200 ans, des scientifiques
se penchent sur le berceau de l'humanité,
chacun avec sa spécialité. Ces détectives du
passé nous aident à reconstituer la généalogie humaine.
L'album de famille, toujours à compléter,
présente nos ancêtres les plus proches depuis
l'Australopithèque, dont Lucy est la représentante
la plus célèbre à 3,5 millions d'années. L'exposition
évoquera les grandes étapes de l'évolution
biologique et culturelle de cet étrange primate qui
a dompté le feu et inventé l'écriture.
Rens. : Monique Thorel, tél. 99 30 04 02.
A L'ESPACE SANTÉ
Jusqu'au 6 mai/
"Les Chemins du corps".
Rennes : la Caisse primaire d'assurance maladie
d'Ille-et-Vilaine poursuit sa campagne "La Santé au
quotidien" en présentant une nouvelle exposition à
l'Espace Santé, 8, rue de Coêtquen, intitulée "Les
Chemins du Corps". De la naissance à la mort,
notre corps, en évolution permanente, prend vie
dans les échanges et l'affection. Toutefois, il est
aussi un ami qui nous invite ou nous appelle à se
soucier de lui : un corps reconnu, accepté et apprécié
de soi-même constitue un facteur essentiel
d'équilibre et de bien-être.
Rens. : A. Piton, tél. 99 29 44 44.
AU MUSÉE DE LA COHUE
Jusqu'au 31 décembre/
"Quand Vannes s'appelait Darioritum".
Vannes : à l'occasion de son bimillénaire, Vannes
organise une série de manifestations dont l'une
des plus importantes est l'exposition du Musée de
la Cohue qui présente le résultat des fouilles effectuées
dans le secteur sauvegardé de la ville.
Une exposition qui invite le spectateur à remonter
le temps à travers cinq tableaux où sont évoquées
: la Gaule pré-romaine, la vie quotidienne
à Vannes sous les romains, les villas en bordure
du Golf du Morbihan, la vie au grand air et la
décadence du peuple vénète.
Rens. : Sandrine Le Roch, tél. 97 0180 20.
A OCEANOPOLIS
Depuis le 6 février/
La colonne océane.
Brest : Océanopolis a ouvert ses portes le 6 février,
après sa fermeture annuelle. Le centre prol'
ose de nouvelles expositions : au niveau 1,
espace multimédia, présentation de l'importante
étude scientifique sur la rade de Brest connue sous
le nom "contrat de baie" ; au niveau 2, la colonne
océane, aquarium cylindrique en métacrylate
dans lequel évolue des bancs de poissons.
Cette colonne d'eau transforme la vision générale
des aquariums situés en dessous.
"La Roussette, un vrai requin".
Brest : aprés les anémones de mer et les mollusques,
c'est la roussette qu'Océanopolis met,
cette année en vedette. Cette exposition présentée
au niveau 0 permet d'illustrer toutes les fonctions
d'un requin typique : un squelette cartilagineux,
une peau caractéristique, une batterie d'organes
sensoriels trés développés.
Rens. : Chantal Guillerm, tél. 98 00 96 00.
PARC RÉGIONAL D'ARMORIQUE
230 000 visiteurs par an/Ecomusées.
Finistère : le Parc régional d'Armorique, association
de 39 communes qu'elles soient îliennes ou
du centre Finistère, reçoit 230000 visiteurs par
an dans ses différents sites. Notons le parc animalier
de Hanvec, la maison des minéraux à Saint-
Hernot près de Crozon, les maisons de la
pisciculture et de la rivière à Sizun, le musée des
phares et balises à Ouessant, ou le conservatoire
botanique de Brest.
Rens. : Pour visiter, téL 98 21 90 69.
Rennes Atalante.
Rennes : afin de favoriser le rapprochement
entre les organismes de formation supérieure
et les entreprises, l'Association Rennes Atalante
a organisé une enquête auprés des différents
établissements qui organisent des
stages sur Rennes et en a fait le recensement.
Il s'agit de l'Université de Rennes 1, de sept
écoles d'ingénieurs et de l'École Supérieure
de Commerce de Rennes. A cet effet, elle
vient de publier un répertoire des stages de
l'enseignement supérieur que vous pouvez
vous procurer sur demande
Rens. : Jacqueline Poussier, tél. 99127373.
Sciences Techniques Jeunesse.
Brest : l'Association nationale sciences techniques
jeunesse organise deux stages de formation
BAFA, dans l'Ouest, pour devenir
animateur scientifique. Un stage théorique
plus tourné vers l'animation des sciences et
des techniques, et un stage pratique axé sur
les sciences en vacances. Tous deux auront
lieu du 30 avril au 8 mai, à Coat Ar Mit (221.
Rens. : CISTEM, Jérôme Jouanneau,
téL 98 0512 04.
INSA, mode d'emploi.
Rennes : la plus importante école d'ingénieurs
de l'Ouest qui compte cette année
prés de 1000 étudiants s'ouvre plus largement
aux étudiants. Il suffira désormais d'un
bac mention assez bien pour y entrer.11 faudra,
cependant, outre une bonne note en
maths, posséder une solide formation humaniste
et avoir eu des responsabilités dans des
activités extra-scolaires. Il est aussi possible
d'entrer directement en 3' année avec un
DEUG sciences, un DUT ou encore un BTS.
Rens. : tél. 99 28 64 00.
Petits Débrouillards.
Rennes : l'Association des "Petits Débrouillards"
en collaboration avec les Francas
organisent un stage d'approfondissement
BAFA à l'activité scientifique et technique ,
du 1' au 6 mars 93.
Pour tout renseignement sur ce stage,
contacter les Francas de Bretagne,
tél. 99 5148 51.
A LIRE • A LIRE • A LIRE • A LIRE
"Annuaire des Cabinets Conseils
en Bretagne"
L'édition 93-94 de cet annuaire édité par la
Chambre régionale de commerce et d'industrie
de Bretagne vient de paraître. Il est disponible
gratuitement pour toute entreprise bretonne qui en
fera la demande. En éditant cet ouvrage la CRCI
de Bretagne a souhaité mettre l'accent sur l'intérêt
pour une entreprise de bénéficier de conseils judicieux
et sur la nécessité pour cela de s'adresser à
des professionnels compétents.
Rens.: Antoinette Bossé-Cohic, tél. 99 25 4102.
"Créer un club scientifique"
C'est le premier guide pratique à l'usage des
jeunes de 13 à 25 ans qui désirent partager et
pratiquer en groupe leur passion des sciences.
Publié par l'ANSTJ (Association nationale
sciences techniques jeunesse), ce mémento a
pour but de guider les bonnes volontés et de permettre
aux jeunes de structurer et de mener à bien
leurs projets scientifiques. Il est gratuit et peut être
envoyé sur simple demande à l'ANSTJ.
Rens : Eric Semenzin, téL (1) 69 06 82 20.
1211
LES BREVES DE RESEAU N •87 • LES BREVES DE RESEAU N •87 • LES BREVES DE RESEAU N •87 • LES BREVES DE RESEA
r '
~
1-1 /
~
ME"SIJkl CfuIlf.SCHE 171.0V"DONENBRETAGNE
Président : Paul Tréhen.
Directeur : Michel Cabaret.
Rédaction : Hélène Tattevin,
Elyette Guiol, Jacques Péron.
Comité de lecture :
Jacques de Certaines, Louis
Rouit, Christian Willaime,
Gilbert Blanchard, Monique
Laigneau, Michel Kerbaol,
Philippe Gillet, Monique
Thorel.
Publicité : Danièle Zum-Folo.
Abonnements :
Odile Corvaisier.
Dépôt légal n° 650.
ISNN 0769-6264.
RESEAU est publié grâce au soutien
des Ministères de la Recherche et de
l'Espace (DIST), de la Culture, de la
Région Bretagne, du département du
Finistère et de la Ville de Rennes.
Edition : CCSTI, 35000 Rennes.
Réalisation : CRÉA'PRIM,
35135 Chantepie.
BULLETIN
D'ABONNEMENT
RESEAU
QUI A DIT ?
Réponse de la page 3
Pierre-Gilles
de Gennes
Paris, décembre 1992.
Pour être sûr
de recevoir le
numgro suivant
de RESEAU,
abonnez-vous !
Abonnement pour 1 an
(11 numéros)
Tarif: 180 F.
Abonnement de soutien :
280 F.
Abonnement étudiants :
100 F.
Nom
Prénom
Adresse
Tél.
Organisme
Facture OUI q NON q
Bulletin d'abonnement et chèque
à retourner au : CCSTI, z
6, place des Colombes,
35000 RENNES. Tél. 99 30 57 97. t
LES BREVES DE RESEAU N•87 • LES BREVES DE RESEAU N•87 • LES BREVES DE RESEA N•85
22
23 janvier/
Un logiciel au CHU Morvan.
Brest : Théma V2, c'est le nom du nouveau
logiciel de communication conçu
au centre hospitalier Morvan, avec
une kyrielle de partenaires. Ce logiciel,
fruit d'un investissement de 2 millions
de francs, est utile au travail
administratif du personnel soignant. Il
fait l'objet d'une commercialisation au
niveau national.
25-30 janvier/Semaine
aquaculture à IFREMER.
Brest : répondant aux sollicitations, le
centre IFREMER a instauré une semaine
d'enseignement sur le thème de l'aquaculture.
200 étudiants de différentes
écoles françaises y assistaient. Pour
Yves Harache, responsable de ce secteur
à l'institut, l'avenir de l'aquaculture
passe par de petites productions,
comme la palourde, la coquille Saint-
Jacques, la truite fario, le turbot...
Rens. : Yves Harache, tél 98 22 40 40.
25 janvier/CCI :
Documentation internationale.
Rennes : la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Rennes a signé une
convention pour la création d'un centre
régional de documentation internationale,
plus particulièrement axé sur
l'Europe. Un centre qui lui permettra
de jouer pleinement son rôle d'informateur
auprés des entreprises régionales
de plus en plus amenées à travailler
avec l'étranger. Les partenaires qui
ont co-signé cette convention sont : le
Centre français de commerce extérieur
et l'Assemblée des chambres françaises
de commerce
et d'industries.
Rens. : Catherine Millet,
tél. 99 33 66 66.
26 janvier/
Prix Qualité Bretagne.
Rennes : cinq entreprises bretonnes ont
été primées lors du concours Qualité
Bretagne organisé par la Direction régionale
de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement. Il s'agit de :
Bretagne Ateliers (prix formation),
Armor Inox (prix des PMI), Gelagri
Bretagne (prix des industries agro-alimentaires),
la Sobalg (prix de l'environnement)
et CBL (prix BTP). Des
entreprises sélectionnées parmi la cinquantaine
retenue, pour leur recherche
constante de la qualité dans des domaines
aussi différents que la formation,
le respect de l'environnement ou
l'excellence du produit.
26 janvier/Conseil régional :
65 millions pour la mer.
Rennes : dans le cadre de sa politique
de soutien à l'économie maritime, le
conseil régional a voté le 26 janvier
des subventions de 47,4 millions de
francs pdur la filière pêche et de 18
millions pour les ports de commerce.
Dans le contexte de crise que l'on
connaît, ces aides vont favoriser la modernisation
des flottilles et la valorisation
de la production. Ce sont entre
autres, 500000 francs à l'ADRIA pour
une étude sur le stockage du poisson à
bord ; 2 millions à ID-Mer ; 300 000
francs au comité régional de promotion
pour l'informatisation des organisations
professionnelles (O.P.).
28 janvier/
Histoire de l'écologie.
Brest : le 28 janvier, Jean Paul Deléage,
de l'université de Paris VII, tenait
à l'école Télécom-Bretagne une
conférence sur le théme "Histoire de
l'écologie, une histoire de l'homme et
de la nature, vers un nouvel humanisme
?".
Rens. : Michel Briand, tél. 98 0012 80.
29 janvier/Hubert Curien
inaugure l'ISAMOR.
Brest : Hubert Curien, Ministre de la
recherche et de l'espace, était présent
à Brest le 29 janvier pour inaugurer
l'Isamor, l'Institut des sciences agro-alimentaires
et du monde rural, implanté
depuis l'automne dans ses nouveaux
locaux de la Pointe du diable. Même
si, comme le dit son directeur, Michel
Branchard, "l'Isamor est un institut sans
murs", puisque les recherches sont dispersées,
pour mieux coller aux réalités
économiques du Finistère.
Rens. : Michel Branchard, tél. 98 3162 51.
29 janvier/
Inauguration de l'Esmisab.
Brest : l'Ecole supérieure de microbiologie
et sécuritaire alimentaire, l'ESMISAB
(qui dépend de l'UBO) a été
inaugurée le 29 janvier. Elle forme des
ingénieurs dont la mission sera de
contrôler la qualité des produits de l'industrie
agro-alimentaire, de la production
à la transformation. Pour la
première année, l'école a reçu 1200
candidatures pour une promotion de
30 étudiants.
Rens. : Daniel Thouvenot, tél. 98 3162 51.
29 janvier/L'UBO soutient
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Brest : par le biais d'une convention,
signée le 29 janvier à Brest, l'université
de Bretagne-Occidentale est devenue
partenaire du France-Forum de
Saint-Pierre-et-Miquelon, un institut
dont la vocation est de faire rayonner
la langue et la culture française sur
l'Amérique du Nord.
2 février/Qualité : phase 3.
Brest. Après la sensibilisation et la formation,
l'opération qualité lancée par
l'AFEIT (Association des filières de
l'électronique, de l'informatique et de
la télématique de Bretagne occidentale),
en relation avec le technopole
Brest-Iroise, en est à la phase 3 : la
démarche collective de certification
ISO 9000.
Rens. : Claudine Venn, téL 98 4414 40.
3 février/Panneau solaires
sur les bouées.
Brest : en cinq ans, le service technique
des phares et balises a équipé
de panneaux solaires 86 phares flottants.
Auparavant, la plupart de ces
bouées fonctionnaient au gaz, le nouveau
système est plus fiable. Mission
accomplie pour le baliseur "Georges
de Joly°.
3 février/
La vie en milieu aquatique.
Brest : le 3 février, Gilles Boeuf, chercheur
à l'IFREMER, tenait une conférence
sur la vie en milieu aquatique. Le
scientifique, retraçant l'évolution depuis
que la vie est apparue il y a plus
de 2 milliards d'années dans l'océan
primitif, a précisé les contraintes physiques
essentielles de la vie dans ce
milieu en montrant les mécanismes
d'adaptation des vertébrés.
Rens. : Chantal Guillerm, tél. 98 00 96 00.
16-23-24 février/
Contre les nitrates.
Côtes-d'Armor : conçue par l'Observatoire
départemental de l'environnement,
une opération pilote visant à
piéger les nitrates vient d'être lancée
par les agriculteurs de ce département.
Trois journées d'information concernant
l'intérêt des couverts végétaux ont
donc été organisées dans trois communes.
Elles ont permis de semer 800
hectares de plantes spécifiques qualifiées
de "pièges à nitrates" qui pompent
l'azote et protègent les sols.
Rens.: Chantal Jolivet, tél. 99 79 60 89.
19 février/Assises Régionales
du Remembrement.
Rostronen : afin de faire le point sur les
acquis de la nouvelle loi "Paysage"
votée en décembre 92 et de réfléchir
sur les enjeux futurs de la politique
d'aménagements fonciers en Bretagne,
le collectif "Bocage 2000" a tenu ses
Assises régionales à Rostrenen, le 19
février 93. Une réunion particulièrement
importante au moment où se
trouve relancées des opérations
d'aménagement foncier et de remembrement
en Bretagne.
Rens. : Collectif "Bocage 2000
tél. 98 81 41 21.
En mars/
Rennes : l'Institut Culturel de Bretagne
s'installe dans de nouveaux locaux situés
dans les bâtiments de l'ancienne
entreprise Oberthur, rue de Paris.
Cette installation devrait permettre aux
membres del'Institut d'accéder plus
facilement au fonds audiovisuel et à
la bibliothèque qui contient plus de
3000 ouvrages. Une grande salle
permettra aussi de mettre à la disposition
du public les expositions conçues
par l'Institut.
Rens. : Philippe Lanoë, téL 99 38 98 88.
tjCHAMBRE W
/41. N
ô
~0 Z
~ C)
Ô DE RENNES w
L'ENTREPRISE DU MOIS L'usine Smithkline Beecham
de Plélan-le-Grand inaugurée
le 1" février 1993.
SMITHKLINE
BEECHAM
S 'INSJALLE
A PLELAN
Inaugurée le 1" février
en présence de Bernard
Kouchner, Ministre de la
santé et de l'action humanitaire,
de Pierre Mehaignerie,
Président du Conseil
général et d'Alain Madelin,
ex-Ministre de l'industrie,
l'usine pharmaceutique
Smithkline Beecham de Plélan-
le-Grand se présente
comme l'un des fleurons du
groupe. Première unité de
fabrication de pénicilline de
synthèse en Europe, elle est
exemplaire en matière de
protection de l'environnement
et de sécurité de l'emploi.
UNE PREMIÈRE
INDUSTRIELLE
4
e groupe de santé dans le
monde, Smithkline Beecham
emploie 54000 personnes pour
un chiffre d'affaires de 47 Milliards
de Francs. Implanté dans
plus de 60 pays, il commercialise
300 produits dont les plus
connus, en France, sont : le
Clamoxyl, l'antibiotique le plus
utilisé par les médecins, l'Augmentin,
le Tagamet et le Gaviscon.
Avec 1400 salariés et 2,7 Milliards
de Francs de chiffre d'affaires,
la filiale S.B. France est le
8' groupe pharmaceutique français.
En installant à Plélanle-
Grand la première usine chimique
de fabrication de pénicilline
de synthèse, Smithkline
Beecham prouve la vitalité du
groupe qui ne craint pas de s'implanter
en milieu rural.
Selon Henri Phillipart, le PDG
de S.B. France, cette première
industrielle est "l'illustration
même de l'entreprise bonne citoyenne
coopérant avec son environnement,
avec l'Education
nationale et avec ses sous-traitants".
Pour la commune de Plélan,
une commune essentiellement
rurale de 2600 habitants, située à
une trentaine de kilomètres à
l'Ouest de Rennes, cette implantation
est "une véritable aubaine
qui devrait marquer le renouveau
de la commune" affirme
M. Bissonier, son maire. De
plus, en employant 31 personnes
dont 90% sont d'origine bretonne,
elle renforce le pôle industriel
régional.
Sa situation dans l'Ouest,
proche de Rennes et de son laboratoire
de recherche de Saint-
Grégoire, mais aussi du Sud de
l'Angleterre, berceau du Groupe,
en fait un site pilote pour l'ensemble
du Groupe.
UN PROCÉDÉ NOUVEAU
Fruit d'une coopération exemplaire
entre l'entreprise, le
CNRS et les universités de
Montpellier et de Rennes, un
nouveau procédé de fabrication,
révolutionnaire et écologique, a
été découvert par l'équipe de
chimistes regroupée autour de
Jean-Pierre Le Goff . Il consiste
à remplacer l'un des solvants -le
plus dangereux, car toxique et inflammable-
par de l'eau. Ce procédé
dont la mise en oeuvre a été
confiée à une société française
du Nord, "Sahut Coureur", a fait
économiser l'équivalent de 10%
de l'investissement réalisé à Plélan.
Comme il permet à la fois de
diminuer les risques et les coûts,
il a été accepté par l'ensemble du
Groupe Smithkline Beecham
qui envisage de le faire appliquer
à l'échelle mondiale, dans ses
autres sites de production. n
SMITHKLINE BEECHAM
À PLÉLAN-LE-GRAND,
C'EST :
40 000 m2 de terrain
de superficie.
68 Millions de Francs
d'investissements :
dont 10 Millions de
Francs consacrés à des
dépenses en matière de
sécurité et de protection
de l'environnement.
31 personnes, dont
15 pour la production
de 100 tonnes
d'amoxicilline par an .
Contact : Jean-Pierre Le Goff,
tél.99069661.
UN PROCESSUS
DE FABRICATION INTERNATIONAL
La pénicilline G, à l'origine de la chaîne, est fabriquée dans
l'usine S.B. d'Irvine, en Ecosse. Elle est ensuite transférée à
l'usine de Worthing, en Angleterre, où est isolé le "noyau"
commun à toutes les pénicillines de synthèse. Ce produit est
alors expédié à Plélan-le-Grand où sera obtenue l'amoxicilline.
D'abord chargées dans deux réacteurs où elles sont activées
par les composants principaux en présence de solvants, les matières
premières sont, ensuite, transférées dans un autre réacteur
où se produit le "couplage" à -50°, pendant 1 h 30.
La solution obtenue est transférée dans un 4' réacteur où se
produit une hydrolyse destinée à extraire le produit actif. Ce
produit est alors chargé dans un 5' réacteur où il est "précipité",
puis isolé par passage sur une centrifugeuse-essoreuse.
La poudre obtenue est traitée dans un compacteur qui va la
densifier et la granuler. C'est là qu'intervient le procédé original
mis au point par Jean-Pierre Le Goff qui consiste à remplacer
un solvant toxique par de l'eau.
Enfin, dernière opération, la poudre d'amoxicilline est séchée,
avant d'être expédiée à l'usine de Mayenne où elle sera conditionnée.
23
'0• ,- ; •
:.i.t. • . - ,,. '4/'' , • ,
dkilt-ii i i , , • , - Zt4til , ,.•4! f. , ,.:,e it,,,. 4.
4k, l'• ).A1.,, .j4 4. 't ;-
''''',y •i';'-ii. ., , '..-;,01;,.** - , I pg,gq , •
i m .4
' ,et
1
.
;,“/ k .
1 ' r • , 0 4' • '' +
/,'' ,,,,;^ • 4 • . t
t . • l' % 1 t ' 4
...4 i f
p:
r '
,04
/
i
(
tt te
1
,, .
1 JA VIER AU ‘ i'6'./RIL Qq, ' .1, , ,
ESPACE SCIENCES 8,t TEIII1F1NiQUES COL6'M'IBI'Py:'Iet- ETA ''É RENNES'
LES DERNIERS MAGAZINES
du magazine Sciences Ouest