Sommes-nous électriques ?
Électricité : histoires, usages et défis
TOUT LE DOSSIER
du magazine Sciences Ouest

Mi-décembre, la goélette Tara a mis le cap sur le Triangle de corail, en Asie du Sud-Est, pour percer le mystère de récifs coralliens qui résistent mieux qu’ailleurs au réchauffement climatique et aux activités humaines.
Le 14 décembre dernier, la goélette scientifique de la fondation Tara Océan a quitté le port de Lorient, entamant sa quatorzième expédition. Le navire de trente-six mètres de long a débuté une transatlantique, à l’issue de laquelle il empruntera le canal de Panama puis traversera l’océan Pacifique. Sa destination : le Triangle de corail, au sein des archipels d’Asie du Sud-Est, une zone concentrant à elle seule près de 30 % des récifs coralliens mondiaux.
Partout sur la planète, le réchauffement climatique entraîne une hausse des températures marines, et le Triangle de corail n’échappe pas à la règle. La région est par ailleurs densément peuplée, exposant le milieu marin à de multiples pressions liées aux activités humaines, telles que le trafic maritime soutenu, la mauvaise gestion des déchets, ou encore des pratiques de pêche destructrices (utilisant la dynamite ou le cyanure). « Il s’agit donc d’une zone maritime à biodiversité exceptionnelle, mais impactée à la fois par le réchauffement des eaux et par différentes activités humaines », souligne Paola Furla, co-directrice scientifique de l’expédition. Pourtant, paradoxalement, la perte de récifs coralliens apparaît moins importante que dans le reste du monde. Certaines zones du triangle enregistrent même une croissance corallienne. Plusieurs pistes sont avancées pour expliquer cette étonnante résistance. « Leur résilience pourrait tenir à la biodiversité exceptionnelle — microbienne, végétale et animale — qui entoure les coraux, ou bien être liée aux caractéristiques génétiques et physiologiques propres à certaines espèces », avance la scientifique.
Pour éclaircir le sujet, environ 50 000 fragments de coraux, d’algues, de sédiments, de faune marine et d’eau de mer seront prélevés en vingt points du Triangle de corail. Au total, plus de 700 plongées sont programmées pour mener à bien cette vaste collecte. Un volume d’échantillonnage ambitieux, régit par une rigoureuse standardisation des méthodes. « En science, des prélèvements destinés à être analysés conjointement doivent être récoltés de la même manière, afin de garantir leur normalisation et de permettre une analyse fiable », explique Clément Castrec, plongeur scientifique de l’expédition. Les procédés de collecte sont alors qualifiés de protocoles d’échantillonnage. Ceux-ci « ont été préparés par les 38 instituts scientifiques partenaires de l’expédition, et seront mis en application durant les immersions », détaille le plongeur. Une fois sortis de l’eau, les échantillons devront être conservés à bord de la goélette durant de longues périodes¹. Prévus en mai 2026, les premiers prélèvements seront réalisés dans la baie de Kimbe, en Papouasie Nouvelle-Guinée.
1. Pour cela, il a fallu embarquer des congélateurs et des bonbonnes d’azote liquide. Une opération loin d’être anodine, sur un navire déjà chargé de matériel de collecte et de vivres.

Sur l’île morbihannaise d’Hœdic, un projet de recherche a tenté de retracer les usages de l’estran depuis la Préhistoire, éclairant de manière originale la vie des populations côtières.
C’est une île française située au sud de la Bretagne, à 13 km de Belle-Île. C’est aussi le lieu d’étude d’un ambitieux projet interdisciplinaire achevé en décembre, après trois ans de recherches. TERdesILES1 avait pour objectif d’étudier l’exploitation des ressources d’estran en milieu insulaire à Hœdic, au large du Morbihan, de la Préhistoire à nos jours. « Les populations côtières sont invisibilisées des textes historiques, explique Catherine Dupont, directrice de recherche CNRS en archéologie des invertébrés marins au Creaah2 à Rennes, et co-porteuse du projet. Comme elles étaient peu intégrées aux circuits économiques, on n’écrivait pas sur elles, on connaît donc mal leur histoire. »
À Hœdic, des vestiges archéologiques prouvent pourtant une exploitation des ressources marines depuis 8 000 ans. Le projet visait à interroger ces usages passés en les mettant en dialogue avec l’expertise des populations actuelles. « Certains natifs ont des connaissances aussi précises que celles de biologistes, issues de l’expérience et de l’observation, transmises de génération en génération. Cela fait partie du patrimoine immatériel », note la chercheuse. Certains habitants utilisent par exemple des algues pour fertiliser leurs jardins. Au fil du temps, ils ont sélectionné les espèces les plus adaptées à cet usage. Autre exemple : « Des pêcheurs à pied savent reconnaître les traces changeantes que laisse la lutraire, un coquillage enfoui dans le sable, selon le sens du vent ou la granulométrie du sédiment », illustre Catherine Dupont. À travers un questionnaire, des entretiens ou encore des séances de pêche à pied, une quinzaine d’archéologues, historiens, biologistes et économistes, se sont donc intéressés aux usages de l’estran. Une publication interdisciplinaire sur l’utilisation des algues est d’ailleurs en cours de rédaction. Mais les scientifiques voulaient aussi s’adresser au grand public, à travers des podcasts à retrouver en ligne3.
Le projet a permis de dessiner une forme de continuité temporelle entre les populations de l’île. « Tous les coquillages ou crustacés retrouvés sur le site archéologique ont déjà été consommés par les populations actuelles », note Catherine Dupont. Leur bonne connaissance de l’environnement peut même aider les scientifiques à interpréter certains vestiges. « En archéologie, retrouver des petites coquilles de patelle indique une surexploitation. Mais des habitants nous ont dit qu’ils choisissent ces dernières délibérément pour leur tendreté, cela pourrait remettre en cause certaines hypothèses. » Face à un site archéologique, les vestiges ne sont que la partie émergée de l’iceberg, une fenêtre ouverte sur ce qui ne laisse pas de trace : le patrimoine immatériel. « Il faut savoir rester ouvert d’esprit, et observer comment le présent peut aider à comprendre le passé », conclut la chercheuse.
1. Trajectoire d’exploitation des ressources d’estran en milieux insulaires.
2. Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire.
3. Sur le site : catherinedupont.blogspot.com

La start-up brestoise HIT Mag, issue de l’UBO, met au point une nouvelle génération d’aimants permanents sans terres rares.
C’est une innovation de rupture qui pourrait révolutionner l’industrie des aimants. Actuellement, la production de ces composants incontournables dans de très nombreux équipements industriels ne peut s’envisager sans terres rares, dont le bilan écologique est désastreux. Mais la start-up brestoise HIT Mag, créée en octobre 2025, entend bien changer la donne.
Tout débute par une découverte réalisée « par hasard » par Jean-Luc Mattei, professeur au Lab-Sticc de l’UBO1. « Il travaillait sur de la poudre d’hexaferrites de baryum à l’aide d’une presse à champ magnétique et il a obtenu un type d’aimant, sans terres rares », raconte Antoine Hoez, docteur en chimie, qui fut son élève. Il réussit à en percer le mystère, au bout de plus d’un an de recherches. « À l’aide d’un microscope électronique à rayons X, j’ai pu identifier un composé d’hydroxyde de fer bien particulier, la goethite. Ici, l’alignement de ces tout petits cristaux formés lors de la coprécipitation assure la propriété magnétique de l’aimant. » Fort de ce résultat prometteur, Antoine Hoez a déposé une déclaration d’invention, bientôt suivie par la création d’une start-up, baptisée HIT Mag, qui a bénéficié de l’accompagnement de la SATT Ouest Valorisation2. Il en est désormais le directeur recherche et développement.
Une première levée de fonds de 1,6 million d’euros, bouclée fin 2025, va permettre à la jeune pousse d’investir dans des équipements et du personnel. « Notre siège est à Plouzané, dans les locaux de l’UBO, pour garder ce lien avec l’université. Nous allons nous doter d’un premier outil de production à Brest dès cette année », confie Arnaud Trac, cofondateur et président. Ses travaux portent sur deux familles d’aimants permanents, les hexaferrites pour lesquels la phase d’industrialisation est proche, et les nitrures, plus puissants, dont la mise au point nécessite encore des investissements significatifs. Déjà, le Cnes3 a passé commande pour un projet spatial.
1. Université de Bretagne Occidentale.
2. La société d’accélération du transfert de technologie Ouest Valorisation est l’opérateur de valorisation de la recherche publique pour 28 établissements en Bretagne et Pays de la Loire.
3. Centre national d'études spatiales.
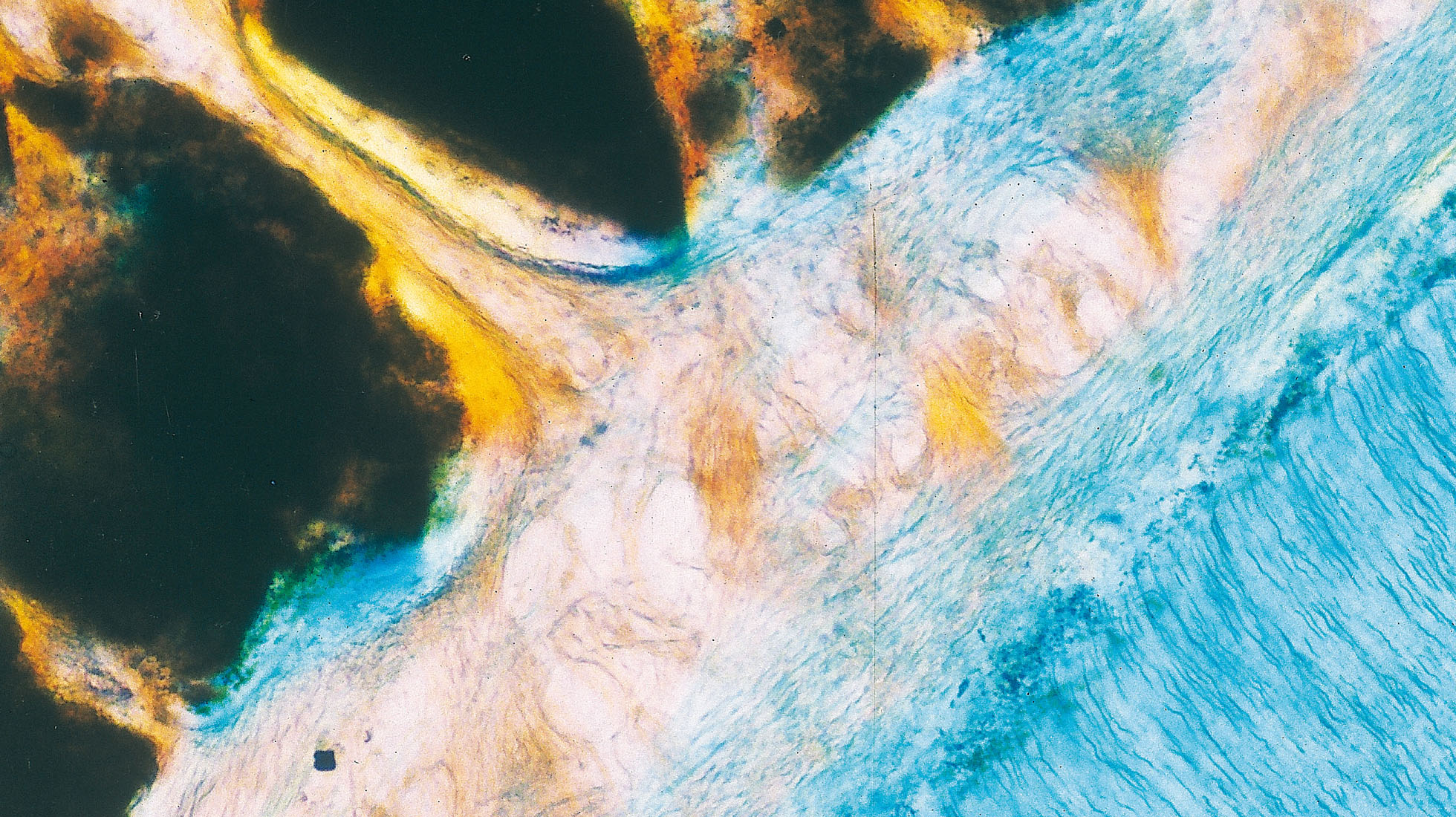
Des crèmes anti-âge à base de collagène de poisson, des pansements issus de crustacés ou encore du corail en guise de substitut osseux : les biomatériaux naturels ont le vent en poupe. Utilisés pour réparer ou remplacer un organe, ils présentent de nombreux avantages. Biocompatibles, biodégradables, écologiques et parfois bioactifs1, ils suscitent un intérêt croissant. Voilà pourquoi la prestigieuse revue Nature organise un colloque international sur le sujet du 10 au 12 janvier à Hong Kong. Objectif : favoriser les échanges entre recherche fondamentale et pratique clinique.
À Brest, le Lemar2 cherche à utiliser des sous-produits et résidus d’origine marine jusqu’alors peu exploités. « L’objectif est de valoriser le collagène issu de peaux de saumons atlantiques en démontrant son potentiel sous forme de biomatériau », explique Manon Buscaglia, biochimiste au Lemar. Le gel naturel ainsi récupéré sert de trame organique tissulaire, c’est-à-dire qu’il forme un réseau de fibres dans lequel les cellules osseuses peuvent s’accrocher et se multiplier. Ce procédé pourrait notamment être utilisé pour réparer un os endommagé après une maladie ou un choc. En parallèle, les chercheurs bretons extraient des composés d’algues marines et étudient leurs propriétés ostéogéniques et antibactériennes. Couplées à la matrice de collagène, ces substances pourraient « stimuler la régénération osseuse et ainsi limiter les infections dans la zone traitée ».
1. Le chitosane, extrait de la carapace des arthropodes, est par exemple antibactérien et cicatrisant.
2. Laboratoire des sciences de l’environnement marin.

Le dépistage génomique est expérimenté dans trois CHU de l’Ouest. Il permettrait de détecter plusieurs centaines de maladies génétiques à la naissance.
C’est un moment que beaucoup de parents oublient, pris dans le bouleversement qui accompagne une naissance. À la maternité, vers le troisième jour du bébé, une sage-femme vient prélever quelques gouttes de sang, sur un papier buvard. Seize maladies sont alors dépistées par des tests chimiques ou par la détection d’un gène, dans le cadre du programme national de dépistage néonatal.
À Rennes, Angers et Nantes, le projet Perigenomeds étudie la possibilité d’utiliser le séquençage du génome pour détecter plusieurs centaines de maladies génétiques en même temps. « On séquence le génome en entier, et ensuite on met des loupes informatiques sur 800 gènes, et les résultats sont donnés uniquement pour ces gènes-là », précise Laurent Pasquier, généticien au CHU de Rennes, coordinateur de l’étude, qui a démarré en septembre 2025 et inclut 1 395 nouveau-nés. Ce projet pilote vise à « évaluer la faisabilité du dépistage génomique, précise-t-il, tant du point de vue de l’information vers les femmes enceintes, que du rendu du résultat en moins de quatre semaines ». L’un des buvards avec le sang du bébé est transmis au CHU de Nantes.
Les 800 gènes analysés correspondent à 349 maladies se déclarant avant 5 ans, qui figurent sur deux listes. « La première regroupe des maladies pour lesquelles un traitement existe. La seconde, que les parents peuvent choisir d’ajouter ou non, concerne des pathologies pour lesquelles on peut seulement prendre en charge une partie des symptômes, ou pour lesquelles les pistes thérapeutiques sont en cours d’évaluation », poursuit Laurent Pasquier. C’est le cas, par exemple, de l’une des formes de la myopathie de Duchenne, pour laquelle des essais cliniques ont débuté. Ces listes ont fait l’objet de longues réflexions entre les généticiens, car un diagnostic à la naissance peut affecter la construction du lien entre les parents et leur enfant. Il faut donc qu’il soit dans l’intérêt supérieur du bébé.
« L’interprétation du génome est l’enjeu majeur du projet, souligne Stéphane Bézieau, chef du service de génétique médicale au CHU de Nantes. La signification de certaines variations reste inconnue : on ne sait pas si elles vont être responsables d’une maladie. » Les résultats ne sont rendus que pour des mutations pour lesquelles les généticiens sont certains. Et les questions éthiques soulevées par le dépistage génomique sont explorées par une post-doctorante en épistémologie, Clémence Guillermain¹.
À Rennes, le projet a permis à un premier bébé d’être diagnostiqué, « d’un déficit en G6PD, un défaut enzymatique du globule rouge. Ses parents vont pouvoir prendre des précautions simples pour éviter les crises, comme bannir certains aliments », explique Laurent Pasquier. Dans une seconde phase test2, le dépistage génomique sera expérimenté cette année à l’échelle d’une région, en Bourgogne-Franche-Comté.
1. Centre François Viète d’épistémologie et d’histoire des sciences et des techniques, Nantes Université.
2. Pilotée par le CHU de Dijon, avec le projet national Perigenomed.

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, quatre jeunes phoques veaux-marins ont été relâchés équipés de balises GPS. Un suivi important pour mieux connaître les habitudes de cette espèce.
Le 7 novembre 2025, après un passage en centre de soins, les quatre jeunes phoques veaux-marins 809, 810, 812 et 813 ont été réhabilités dans la baie du Mont-Saint-Michel, abritant la colonie la plus proche de l’espèce. Chaque année, dix comptages aériens des animaux sont réalisés lorsqu’ils sont à terre.
« Nous suivons l’évolution de cette espèce protégée depuis 2012 dans la baie. Elle y a fait son retour depuis l’interdiction de la chasse à la fin des années 1970, révèle Audrey Hemon, responsable environnement à l’Établissement public national du Mont-Saint-Michel. La population est dynamique, les phoques ne sont pas tous sédentaires. Avant leur maturité sexuelle, ils peuvent se déplacer en dehors du site. »
La pose de balises GPS-GSM sur la nuque des animaux permet de mieux étudier l’utilisation de l’espace par les phoques. Financées par la Fondation Breizh Biodiv de la Région Bretagne, elles servent à comprendre le rythme d’activité des jeunes relâchés. « On voit leurs déplacements en direct sur les cartes. Dès que le phoque revient respirer à la surface, la balise émet et les données apparaissent, sourit Sami Hassani, directeur de l’Acmom1, hébergée à Océanopolis, à Brest. Sites de repos fréquentés, profondeurs de plongée, durées de chasse… Tout est enregistré. C’est l’un des premiers suivis de l'espèce réalisé à cet âge ! »
Ces jeunes phoques sont souvent retrouvés échoués sur le sable. Mais pourquoi ? Les naissances et l’allaitement des phoques veaux-marins ont lieu en juillet dans la baie, une période touristique importante. Lors d’un dérangement2, la femelle peut s’enfuir et abandonner son jeune, qui est alors condamné. Afin de les limiter, il est conseillé de ne pas s’approcher d’un phoque sur le sable à moins de 300 mètres et d’appeler le Réseau national d'échouages (RNE) en cas de doute.
« Le petit non sevré est en effet dépendant de sa mère. Dans la nature, elle l’allaite avec un lait très gras riche en anticorps, indispensable à sa prise de poids et à sa bonne santé, précise Océane Guyomard, technicienne soigneuse chargée des soins à l’Acmom. À la suite de cette séparation précoce, de nombreux petits amaigris et affaiblis sont observés sur le littoral, comme 809, 810, 812 et 813. »
Recueillis par l’association durant quatre mois, les jeunes sont soignés et nourris, avant d’être réhabilités lorsqu’ils atteignent le poids optimal de 30 kg. Trois jours avant, les animaux sont équipés des balises. « Après avoir attrapé et sédaté le phoque, le pelage est dégraissé et séché avant que la balise soit posée derrière la nuque. Elle sera tombée d’ici l’été », explique Océane Guyomard, qui précise d’ailleurs qu’une campagne de parrainage des phoques du centre de soins vient de s’ouvrir. Une autre façon d’accompagner les phoques en difficulté !
1. Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins de Bretagne.
2. Interaction entre une espèce et un humain ou toute autre activité entraînant un changement du comportement de l’animal tel que la fuite.