Portrait
TOUS LES PORTRAITS
du magazine Sciences Ouest
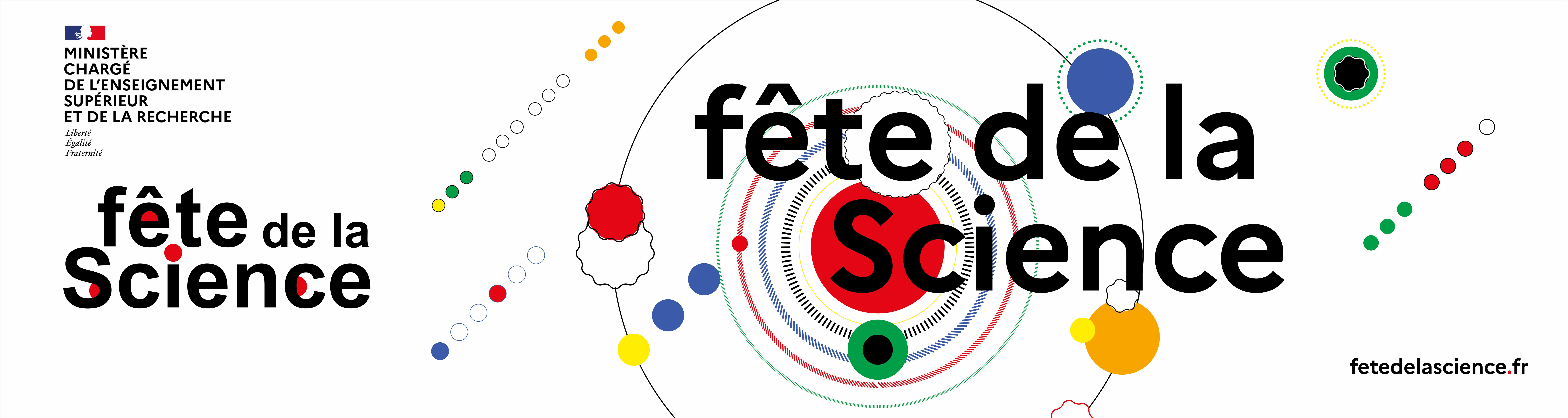
Du 3 au 13 octobre 2025
Initiée par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, la 34ème édition de la Fête de la science est organisée en Ille-et-Vilaine et coordonnée en Bretagne par l'Espace des sciences.
👩🔬 Qui peut participer ?
Les centres de recherche, les étudiants, les entreprises, les associations, les établissements scolaires, les collectivités, les musées, les médiathèques, les artistes… La variété des projets fait toute la richesse de l’événement !
La charte de la Fête de la science
💬 Sur quels sujets ?
Tous les sujets portés par un centre de recherche, les savoir-faire techniques et industriels, la manière dont se construit une connaissance scientifique, l’histoire des sciences et le patrimoine industriel.
Les événements portant sur la thématique nationale “Intelligence(s)” seront mis en avant dans la programmation nationale.
👀 Pourquoi participer ?
📍 Où participer ?
Dans les communes d’Ille-et-Vilaine : toutes les thématiques sont acceptées.
🎬 Sous quelle forme ?
Animation, atelier, exposition, escape game, conférence, portes ouvertes, théâtre…
💻 Comment candidater ?
Merci de contacter la coordination à fetedelascience [at] espace-sciences.org (fetedelascience[at]espace-sciences[dot]org)
✅ Comment les projets sont-ils sélectionnés ?
Les projets sont soumis et validés par l’équipe de coordination selon les critères suivants :